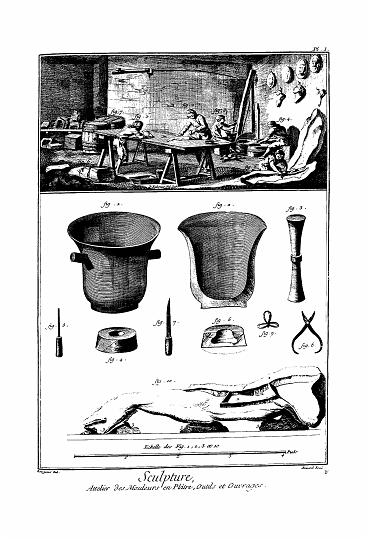S. f. (Art et Science) La Médecine est l'art d'appliquer des remèdes dont l'effet conserve la vie saine, et redonne la santé aux malades. Ainsi la vie, la santé, les maladies, la mort de l'homme, les causes qui les produisent, les moyens qui les dirigent, sont l'objet de la Médecine.
Les injures et les vicissitudes d'un air aussi nécessaire qu'inévitable, la nature des aliments solides et liquides, l'impression vive des corps extérieurs, les actions de la vie, la structure du corps humain, ont produit des maladies, dès qu'il y a eu des hommes qui ont vécu comme nous vivons.
Lorsque notre corps est affligé de quelque mal, il est machinalement déterminé à chercher les moyens d'y remédier, sans cependant les connaître. Cela se remarque dans les animaux, comme dans l'homme, quoique la raison ne puisse point comprendre comment cela se fait ; car tout ce qu'on sait, c'est que telles sont les lois de l'auteur de la nature, desquelles dépendent toutes les premières causes.
La perception désagréable ou fâcheuse d'un mouvement empêché dans certains membres, la douleur que produit la lésion d'une partie quelconque, les maux dont l'âme est accablée à l'occasion de ceux du corps, ont engagé l'homme à chercher et à appliquer les remèdes propres à dissiper ces maux, et cela par un désir spontané, ou à la faveur d'une expérience vague. Telle est la première origine de la Médecine, qui prise pour l'art de guérir, a été pratiquée dans tous les temps et dans tous les lieux.
Les histoires et les fables de l'antiquité nous apprennent que les Assyriens, les Chaldéens, et les mages, sont les premiers qui aient cultivé cet art, et qui aient tâché de guérir ou de prévenir les maladies ; que delà la Médecine passa en Egypte, dans la Lybie cyrénaïque, à Crotone, dans la Grèce où elle fleurit, principalement à Gnides, à Rhodes, à Cos, et en Epidaure.
Les premiers fondements de cet art sont dû. 1°. au hasard. 2°. A l'instinct naturel. 3°. Aux événements imprévus. Voilà ce qui fit d'abord naître la Médecine simplement empyrique.
L'art s'accrut ensuite, et fit des progrès, 1°. par le souvenir des expériences que ces choses offrirent. 2°. Par la description des maladies, des remèdes, et de leur succès qu'on gravait sur les colonnes, sur les tables, et sur les murailles des temples. 3°. Par les malades qu'on exposa dans les carrefours et les places publiques, pour engager les passants à voir leurs maux, à indiquer les remèdes s'ils en connaissaient, et à en faire l'application. On observa donc fort attentivement ce qui se présentait. La Médecine empyrique se perfectionna par ces moyens, sans cependant que ses connaissances s'étendissent plus loin que le passé et le présent. 4°. On raisonna dans la suite analogiquement, c'est-à-dire en comparant ce qu'on avait observé avec les choses présentes et futures.
L'art se perfectionna encore davantage, 1°. par les médecins qu'on établit pour guérir toutes sortes de maladies, ou quelques-unes en particulier. 2°. Par les maladies dont on fit une énumération exacte. 3°. Par l'observation et la description des remèdes, et de la manière de s'en servir. Alors la Médecine devint bien-tôt propre et héréditaire à certaines familles et aux prêtres qui en retiraient l'honneur et le profit. Cependant cela même ne laissa pas de retarder beaucoup ses progrès.
1°. L'inspection des entrailles des victimes. 2°. La coutume d'embaumer les cadavres. 3°. Le traitement des plaies, ont aidé à connaître la fabrique du corps sain, et les causes prochaines ou cachées, tant de la santé et de la maladie, que de la mort même.
Enfin les animaux vivants qu'on ouvrait pour les sacrifices, l'inspection attentive des cadavres de ceux dont on avait traité les maladies, l'histoire des maladies, de leurs causes, de leur naissance, de leur accroissement, de leur vigueur, de leur diminution, de leur issue, de leur changement, de leurs événements ; la connaissance, le choix, la préparation, l'application des médicaments, leur action et leurs effets bien connus et bien observés semblèrent avoir presqu'entièrement formé l'art de la Médecine.
Hippocrate, contemporain de Démocrite, fort au fait de toutes ces choses, et de plus riche d'un excellent fonds d'observations qui lui étaient propres, fit un recueil de tout ce qu'il trouva d'utile, en composa un corps de Médecine, et mérita le premier le nom de vrai médecin, parce qu'en effet outre la médecine empyrique et analogique qu'il savait, il était éclairé d'une saine philosophie, et devint le premier fondateur de la médecine dogmatique.
Après que cette médecine eut été longtemps cultivée dans la famille d'Asclépiade, Arêtée de Cappadoce en fit un corps mieux digéré et plus méthodique ; et cet art se perfectionna par le différent succès des temps, des lieux, des choses ; de sorte qu'après avoir brillé surtout dans l'école d'Alexandrie, il subsista dans cet état jusqu'au temps de Claude Galien.
Celui-ci ramassa ce qui était fort épars, et sut éclaircir les choses embrouillées ; mais comme il était honteusement asservi à la philosophie des Péripatéticiens, il expliqua tout suivant leurs principes ; et par conséquent s'il contribua beaucoup aux progrès de l'art, il n'y fit pas moins de dommage, en ce qu'il eut recours aux éléments, aux qualités cardinales, à leurs degrés, et à quatre humeurs par lesquelles il prétendait avec plus de subtilité que de vérité, qu'on pouvait expliquer toute la Médecine.
Au commencement du VIIe siècle on perdit en Europe presque jusqu'au souvenir des arts. Ils furent détruits par des nations barbares qui vinrent du fond du nord, et qui abolirent avec les sciences tous les moyens de les acquérir, qui sont les livres.
Depuis le IXe jusqu'au XIIIe siècle, la Médecine fut cultivée avec beaucoup de subtilité par les Arabes, dans l'Asie, l'Afrique et l'Espagne. Ils augmentèrent et corrigèrent la matière médicale, ses préparations, et la Chirurgie. A la vérité ils infectèrent l'art plus que jamais des vices galéniques, et presque tous ceux qui les ont suivis ont été leurs partisans. En effet les amateurs des sciences étaient alors obligés d'aller en Espagne chez les Sarrasins, d'où revenant plus habiles, on les appelait Mages. Or on n'expliquait dans les Académies publiques que les écrits des Arabes ; ceux des Grecs furent presqu'inconnus, ou du-moins on n'en faisait aucun cas.
Cette anarchie médicinale dura jusqu'au temps d'Emmanuel Chrysoloras, de Théodore Gaza, d'Argyropyle, de Lascaris, de Démétrius Chalcondyle, de George de Trébisonde, de Marius Mysurus, qui les premiers interprétèrent à Venise et ailleurs des manuscrits grecs, tirés de Bysance, firent revivre la langue grecque, et mirent en vogue les auteurs grecs vers l'an 1460. Comme l'imprimerie vint alors à se découvrir, Alde eut l'honneur de publier avec succès les œuvres des Médecins grecs. C'est sous ces heureux auspices que la doctrine d'Hippocrate fut ressuscitée et suivie par les Français. Arnauld de Villeneuve, Raymond Lulle, Basîle Valentin, Paracelse, introduisirent ensuite la Chimie dans la Médecine. Les Anatomistes ajoutèrent leurs expériences à celles des Chimistes. Ceux d'Italie s'y dévouèrent à l'exemple de Jacques Carpi, qui se distingua le premier dans l'art anatomique.
Tel fut l'état de la Médecine jusqu'à l'immortel Harvey, qui renversa par ses démonstrations la fausse théorie de ceux qui l'avaient précédé, éleva sur ses débris une doctrine nouvelle et certaine, et jeta glorieusement la base fondamentale de l'art de guérir. Je viens de parcourir rapidement l'histoire de cet art, et cet abrégé succinct peut suffire à la plupart des lecteurs ; mais j'en dois faire un commentaire détaillé en faveur de ceux qui ont mis le pied dans le temple d'Esculape.
La Médecine ne commença sans doute à être cultivée que lorsque l'intempérance, l'oisiveté, et l'usage du vin multipliant les maladies, firent sentir le besoin de cette science. Semblable aux autres, elle fleurit d'abord chez les Orientaux, passa d'Orient en Egypte, d'Egypte en Grèce, et de Grèce dans toutes les autres parties du monde. Mais les Egyptiens ont si soigneusement enveloppé leur histoire d'emblêmes, d'hiéroglyphes, et de récits merveilleux, qu'ils en ont fait un chaos de fables dont il est bien difficîle d'extraire la vérité ; cependant Clément d'Alexandrie nous apprend que le fameux Hermès avait renfermé toute la philosophie des Egyptiens en quarante-deux livres, dont les six derniers concernant la Médecine, étaient particulièrement à l'usage des Pastophores, et que l'auteur y traitait de la structure du corps humain en général, de celle des yeux en particulier, des instruments nécessaires pour les opérations chirurgicales, des maladies, et des accidents particuliers aux femmes.
Quant à la condition et au caractère des Médecins en Egypte, à en juger sur la description que le même écrivain en a faite à la suite du passage cité, ils composaient un ordre sacré dans l'état : mais pour prendre une idée juste du rang qu'ils y tenaient, et des richesses dont ils étaient pourvus, il faut savoir que la Médecine était alors exercée par les prêtres, à qui, pour soutenir la dignité de leur ministère et satisfaire aux cérémonies de la religion, nous lisons dans Diodore de Sicîle qu'on avait assigné le tiers des revenus du pays. Le sacerdoce était héréditaire, et passait de père en fils sans interruption : mais il est vraisemblable que le collège sacré était partagé en différentes classes, entre lesquelles les embaumeurs avaient la leur ; car Diodore nous assure qu'ils étaient instruits dans cette profession par leurs pères, et que les peuples qui les regardaient comme des membres du corps sacerdotal, et comme jouissants en cette qualité d'un libre accès dans les endroits les plus secrets des temples, réunissaient à leur égard une grande estime à la plus haute vénération.
Les Médecins payés par l'état ne retiraient en Egypte aucun salaire des particuliers : Diodore nous apprend que les choses étaient sur ce pied, au-moins en temps de guerre ; mais en tout temps ils secouraient sans intérêt un égyptien qui tombait malade en voyage.
L'embaumeur avait différents statuts à observer dans l'exercice de son art. Des règles établies par des prédécesseurs qui s'étaient illustrés dans la profession, et transmises dans des mémoires authentiques, fixaient la pratique du médecin : s'il perdait son malade en suivant ponctuellement les lois de ce code sacré, on n'avait rien à lui dire ; mais il était puni de mort, s'il entreprenait quelque chose de son chef, et que le succès ne répondit pas à son attente. Rien n'était plus capable de ralentir les progrès de la Médecine ; aussi la vit-on marcher à pas lents, tant que cette contrainte subsista. Aristote après avoir dit, chap. IIe de ses questions politiques, qu'en Egypte le médecin peut donner quelque secours à son malade le cinquième jour de la maladie ; mais que s'il commence la cure avant que ce temps soit expiré, c'est à ses risques et fortunes ; Aristote, dis-je, traite cette coutume d'indolente, d'inhumaine, et de pernicieuse, quoique d'autres en fissent l'apologie.
Par ce que nous venons de dire de la dignité de la Médecine chez les Egyptiens, de l'opulence de leurs médecins, et de la singularité de leur pratique, il est aisé de juger que les principes de l'art et l'exigence des cas déterminaient beaucoup moins que des lois écrites. De-là nous pouvons conclure que leur théorie était fixée, que leur profession demandait plus de mémoire que de jugement, et que le médecin transgressait rarement avec impunité les règles prescrites par le code sacré.
Quant à leur pathologie, ils rapportèrent d'abord les causes des maladies à des démons, dispensateurs des biens et des maux ; mais dans la suite ils se guérirent de cette superstition, par les occasions fréquentes qu'eurent les embaumeurs de voir et d'examiner les viscères humains. Car les trouvant souvent corrompus de diverses façons, ils conjecturèrent que les substances qui servent à la nourriture du corps sont elles-mêmes la source de ces infirmités. Cette découverte et la crainte qu'elle inspira, donnèrent lieu aux régimes, à l'usage des clystères, des boissons purgatives, de l'abstinence d'aliments, et des vomitifs : toutes choses qu'ils pratiquaient dans le dessein d'écarter les maladies, en éloignant leurs causes.
Les usages varient selon l'intérêt des peuples et la diversité des contrées ; les Egyptiens, sans être privés de la chair des animaux, en usaient plus sobrement que les autres nations. L'eau du Nil, dont Plutarque nous apprend qu'ils faisaient grand cas, et qui les rendait vigoureux, était leur boisson ordinaire.
Hérodote ajoute que leur sol était peu propre à la culture des vignes ; d'où nous pouvons inférer qu'ils tiraient d'ailleurs les vins qu'on servait aux tables des prêtres et des rais. Le régime prescrit aux monarques égyptiens, peut nous donner une haute idée de la tempérance de ces peuples. Leur nourriture était simple, dit Diodore de Sicile, et ils buvaient peu de vin, évitant avec soin la réplétion et l'ivresse ; en sorte que les lois qui réglaient la table des princes, étaient plutôt les ordonnances d'un sage médecin, que les institutions d'un législateur. On accoutumait à cette frugalité les enfants dès leur plus tendre jeunesse.
Au reste, ils étaient très-attachés à la propreté, en cela fidèles imitateurs de leurs prêtres qui, selon Hérodote, ne passaient pas plus de trois jours sans se raser le corps, et qui, pour prévenir la vermine et les effets des corpuscules empestés, qui pouvaient s'exhaler des malades qu'ils approchaient, étaient vêtus dans les fonctions de leur ministère d'une toîle fine et blanche. Nous lisons encore dans le même auteur, que c'était la coutume universelle chez les Egyptiens d'être presque nuds ou légèrement couverts, de ne laisser croitre leurs cheveux que lorsqu'ils étaient en pélerinage, qu'ils en avaient fait vœu, ou que quelques calamités désolaient le pays.
Cent ans après Moïse, qui vivait 1530 ans avant la naissance de Jesus-Christ, Mélampe, fils d'Amythaon et d'Aglaïde, passa d'Argos en Egypte, où il s'instruisit dans les sciences qu'on y cultivait, et d'où il rapporta dans la Grèce ce qu'il avait appris de la théologie des Egyptiens et de leur médecine, par rapport à laquelle il y a trois faits à remarquer. Le premier, c'est qu'il guérit de la folie les filles de Praetus, roi d'Argos, en les purgeant avec l'ellébore blanc ou noir, dont il avait découvert la vertu cathartique, par l'effet qu'il produisait sur ses chèvres après qu'elles en avaient brouté. Le second, c'est qu'après leur avoir fait prendre l'ellébore, il les baigna dans une fontaine chaude. Voilà les premiers bains pris en remèdes, et les premières purgations dont il soit fait mention. Le troisième fait concerne l'argonaute Iphiclus, fils de Philacus. Ce jeune homme, chagrin de n'avoir pas d'enfants, s'adressa à Mélampe, qui lui ordonna de prendre pendant dix jours de la rouille de fer dans du vin, et ce remède produisit tout l'effet qu'on en attendait : ces trois faits nous suggèrent deux réflexions.
La première, que la Médecine n'était pas alors aussi imparfaite qu'on le pense communément ; car, si nous considérons les propriétés de l'ellébore, et surtout de l'ellébore noir dans les maladies particulières aux femmes, et l'efficacité des bains chauds à la suite de ce purgatif, nous conviendrons que les remèdes étaient bien sagement prescrits dans le cas des filles de Praetus. D'ailleurs, en supposant, comme il est vraisemblable, que l'impuissance d'Iphiclus provenait d'un relâchement des solides et d'une circulation languissante des fluides, je crois que pour corriger ces défauts en rendant aux parties leur élasticité, des préparations faites avec le fer étaient tout ce qu'avec les connaissances modernes on aurait pu ordonner de mieux. 2°. Quant aux incantations et aux charmes dont on accuse Mélampe de s'être servi, il faut observer que ce manège est aussi ancien que la Médecine, et doit vraisemblablement sa naissance à la vanité de ceux qui l'exerçaient, et à l'ignorance des peuples à qui ils avaient affaire. Ceux-ci se laissaient persuader par cet artifice, que les Médecins étaient des hommes protégés et favorisés du ciel. Que s'ensuivait-il de ce préjugé ? c'est qu'ils marquaient en tout temps une extrême vénération pour leurs personnes, et que dans la maladie ils avaient pour leurs ordonnances toute la docilité possible. L'on commençait l'incantation : le malade prenait les potions qu'on lui prescrivait comme des choses essentielles à la cérémonie : il guérissait, et ne manquait pas d'attribuer au charme l'efficacité des remèdes.
L'histoire nous apprend que Théodamas, fils de Mélampe, hérita des connaissances de son père, et que Polyidus, petit-fils de Mélampe, succéda à Théodamas dans la fonction de médecin : mais elle ne nous dit rien de leur pratique.
Après Théodamas et Polyidus, le centaure Chiron exerça chez les Grecs la Médecine et la Chirurgie ; ces deux professions ayant été longtemps réunies. Ses talents supérieurs dans la médecine de l'homme et des bestiaux, donnèrent peut-être lieu aux poètes de feindre qu'il était moitié homme et moitié animal. Il parvint à une extrême vieillesse, et quelques citoyens puissants de la Grèce lui confièrent l'éducation de leurs enfants. Jason le chef des Argonautes, ce héros de tant de poèmes et le sujet de tant de fables, fut élevé par Chiron. Hercule non moins célèbre fut encore de ses élèves. Un troisième disciple fut Aristée, qui parait avoir assez bien connu les productions de la nature, et les avoir appliquées à de nouveaux usages : il passe pour avoir inventé l'art d'extraire l'huîle des olives, de tourner le lait en fromage, et de recueillir le miel. M. le Clerc lui attribue de plus la découverte du laser et de ses propriétés. Mais de tous les élèves de Chiron, aucun ne fut plus profondément instruit de la science médicinale, que le grec Esculape qui fut mis au nombre des dieux, et qui fut trouvé digne d'accompagner dans la périlleuse entreprise des Argonautes, cette troupe de héros à qui l'on a donné ce nom. Voyez son article au mot MEDECIN.
Les Grecs s'emparèrent de Troie 70 ans après l'expédition des Argonautes, 1194 avant la naissance de Jesus-Christ, et la fin de cette guerre est devenue une époque fameuse dans l'histoire. Achille qui s'est tant illustré à ce siege par sa colere et ses exploits, élevé par Chiron, et conséquemment instruit dans la Médecine, inventa lui-même quelques remèdes. Son ami Patrocle n'était pas sans doute ignorant dans cet art, puisqu'il pansa la blessure d'Euripîle : mais on conçoit bien que Podalire et Machaon, fils d'Esculape, surpassèrent dans cette science tous les Grecs qui assistèrent au siege de Troie. Quoiqu' Homère ne les emploie jamais qu'à des opérations chirurgicales, on peut conjecturer que nés d'un père tel qu'Esculape, et médecins de profession, ils n'ignoraient rien de ce qu'on savait alors en Médecine.
Après la mort de Podalire, la Médecine et la Chirurgie cultivées sans interruption dans sa famille, firent de si grands progrès sous quelques-uns de ses descendants, qu'Hippocrate le dix-septième en ligne directe, fut en état de pousser ces deux sciences à un point de perfection surprenant.
Depuis la prise de Troie jusqu'au temps d'Hippocrate, l'antiquité nous offre peu de faits authentiques et relatifs à l'histoire de la Médecine : cependant, dans ce long intervalle de temps, les descendants d'Esculape continuèrent sans doute leur attachement à l'étude de cette science.
Pythagore qui vivait, à ce qu'on croit, dans la soixantième olympiade, c'est-à-dire, 520 ans ou environ avant la naissance de Jesus-Christ, après avoir épuisé les connaissances des prêtres égyptiens, alla chercher la science jusqu'aux Indes : il revint ensuite à Samos qui passe pour sa patrie ; mais la trouvant sous la domination d'un tyran, il se retira à Crotone, où il fonda la plus célèbre des écoles de l'antiquité. Celse assure que ce philosophe hâta les progrès de la Médecine ; mais, quoiqu'en dise Celse, il parait qu'il s'occupa beaucoup plus des moyens de conserver la santé que de la rétablir, et de prévenir les maladies par le régime que de les guérir par les remèdes. Il apprit sans doute la Médecine en Egypte, mais il eut la faiblesse de donner dans les superstitions qui jusqu'alors avaient infecté cette science ; car cet esprit domine dans quelques fragments qui nous restent de lui.
Empédocle, son disciple, mérite plus d'éloges. On dit qu'il découvrit que la peste et la famine, deux fléaux qui ravageaient fréquemment la Sicile, y étaient l'effet d'un vent du midi, qui, soufflant continuellement par les ouvertures de certaines montagnes, infectait l'air, et séchait la terre ; il conseilla de fermer ces gorges, et les calamités disparurent. On trouve dans un ouvrage de Plutarque, qu'Empédocle connaissait la membrane qui tapisse la coquille du limaçon dans l'organe de l'ouie, et qu'il la regardait comme le point de réunion des sons et l'organe immédiat de l'ouie. Nous n'avons aucune raison de croire que cette belle découverte anatomique ait été faite avant lui. Quant à sa physiologie, elle n'était peut-être guère mieux raisonnée que celle de son maître ; cependant, par une conjecture aussi juste que délicate, il assura que les graines dans la plante étaient analogues aux œufs dans l'animal, ce qui se trouve confirmé par les expériences des modernes.
Acron était compatriote et contemporain d'Empédocle : j'en parlerai au mot MEDECINE.
Alcméon, autre disciple de Pythagore, se livra tout entier à la Médecine, et cultiva si soigneusement l'anatomie, qu'on l'a soupçonné de connaître la communication de la bouche avec les oreilles, sur ce qu'il assura que les chèvres respiraient en partie par cet organe.
Après avoir exposé les premiers progrès de la Médecine en Egypte et dans la Grèce, nous jetterons un coup d'oeil sur l'état de cette science chez quelques autres peuples de l'antiquité, avant que de passer au siècle d'Hippocrate, qui doit attirer tous nos regards.
Les anciens Hébreux, stupides, superstitieux, séparés des autres peuples, ignorants dans l'étude de la physique, incapables de recourir aux causes naturelles, attribuaient toutes leurs maladies aux mauvais esprits, exécuteurs de la vengeance céleste : delà vient que le roi Asa est blâmé d'avoir mis sa confiance aux médecins, dans les douleurs de la goutte aux pieds dont il était attaqué. La lepre même, si commune chez ce peuple, passait pour être envoyée du ciel ; c'étaient les prêtres qui jugeaient de la nature du mal, et qui renfermaient le patient lorsqu'ils espéraient le pouvoir guérir.
Les maladies des Egyptiens, dont Dieu promet de garantir son peuple, sont, ou les plaies dont il frappa l'Egypte avant la sortie des Israélites de cette contrée, ou les maladies endémiques du lieu ; comme l'aveuglement, les ulcères aux jambes, la phtisie, l'éléphantiasis, et autres semblables qui y règnent encore.
On ne voit pas que les Hébreux aient eu des médecins pour les maladies internes, mais seulement pour les plaies, les tumeurs, les fractures, les meurtrissures, auxquelles on appliquait certains médicaments, comme la résine de Galaad, le baume de Judée, la graine et les huiles ; en un mot, l'ignorance où ils étaient de la Médecine, faisait qu'ils s'adressaient aux devins, aux magiciens, aux enchanteurs, ou finalement aux prophetes. Lors même que notre Seigneur vint dans la Palestine, il parait que les Juifs n'étaient pas plus éclairés qu'autrefois ; car dans l'Evangile, ils attribuent aux démons la cause de la plupart des maladies. On y lit, par exemple, Luc, XIIIe Ve 16. que le démon a lié une femme qui était courbée depuis dix-huit ans.
Les gymnosophistes, dont parle Strabon, se mêlaient beaucoup de médecine en orient, et se vantaient de procurer par leurs remèdes la naissance à des enfants, d'en déterminer le sexe, et de les donner aux parents, mâles ou femelles à leur choix.
Chez les Gaulois, les druides, revêtus tout ensemble du sacerdoce, de la justice et de l'exercice de la Médecine, n'étaient ni moins trompeurs, ni plus éclairés que les gymnosophistes. Pline dit qu'ils regardaient le gui de chêne comme un remède souverain pour la stérilité, qu'ils l'employaient contre toutes sortes de poisons, et qu'ils en consacraient la récolte par quantité de cérémonies superstitieuses.
Entre les peuples orientaux qui se disputent l'antiquité de la Médecine, les Chinois, les Japonais et les habitants de Malabar, paraissent les mieux fondés. Les Chinois assurent que leurs rois avaient inventé cette science longtemps avant le déluge ; mais quelle que soit la dignité de ceux qui l'exercèrent les premiers dans ce pays-là, nous ne devons pas avoir une opinion fort avantageuse de l'habileté de leurs successeurs : ils n'ont d'autre connaissance des maladies que par des observations minutieuses sur le pouls, et recourent pour la guérison à un ancien livre, qu'on pourrait appeler le code de la médecine chinoise, et qui prescrit les remèdes de chaque mal. Ces peuples n'ont point de chimie ; ils sont dans une profonde ignorance de l'anatomie, et ne saignent presque jamais. Ils ont imaginé une espèce de circulation des fluides dans le corps humain, d'après un autre mouvement périodique des cieux, qu'ils disent s'achever cinquante fois dans l'espace de 24 heures. C'est sur cette théorie ridicule que des européens ont écrit, que les Chinois avaient connu la circulation du sang longtemps avant nous. Leur pathologie est aussi pompeuse que peu sensée : c'est cependant par elle qu'ils déterminent les cas de l'opération de l'aiguille, et de l'usage du moxa ou coton brulant. Ces deux pratiques leur sont communes avec les Japonais, et ne différent chez ces deux peuples, qu'en quelques circonstances légères dans la manière d'opérer. En un mot, leur théorie et leur pratique, toute ancienne qu'on la suppose, n'en est pas pour cela plus philosophique ni moins imparfaite.
On dit que les brahmanes ont commencé à cultiver la Médecine, en même temps que les prêtres égyptiens ; mais ce qu'il y a de sur, c'est que depuis tant de siècles ils n'en ont pas avancé les progrès. Jean-Ernest Grudler danois, qui fit le voyage du Malabar en 1708, nous apprend que toute la médecine de ces peuples était contenue dans un ouvrage misérable, qu'ils appellent en leur langue vagadasastirum. Le peu qu'ils ont de théorie est plein d'erreurs et d'absurdités. Ils divisent les maladies en huit espèces différentes ; et comme c'est pour eux une étude immense, chaque médecin se doit borner à un genre de maladie, et s'y livrer tout entier. Le premier ordre des médecins est composé de ceux qui traitent les enfants ; le second, de ceux qui guérissent de la morsure des animaux venimeux ; le troisième, de ceux qui savent chasser les démons, et dissiper les maladies de l'esprit ; le quatrième, de ceux qu'on consulte dans le cas d'impuissance, et dans ce qui concerne la génération ; le cinquième, pour lequel ils ont une vénération particulière, est composé de ceux qui préviennent les maladies ; le sixième, de ceux qui soulagent les malades par l'opération de la main ; le septième, de ceux qui retardent les effets de la vieillesse, et qui entretiennent le poil et les cheveux ; le huitième, de ceux qui s'occupent des maux de tête, et des maladies de l'oeil. Chaque ordre a son dieu tutélaire, au nom duquel les opérations sont faites, et les remèdes administrés. Cette cérémonie est une partie du culte qu'on lui rend. Le vent préside aux maladies des enfants ; l'eau à celles qui proviennent de la morsure des animaux venimeux ; l'air à l'exorcisme des démons ; la tempête à l'impuissance ; le soleil aux maladies de la tête et des yeux.
La saignée n'est guère d'usage chez eux, et les clystères leur sont encore moins connus. Le médecin ordonne et prépare les remèdes, dans lesquels il fait entrer de la fiente et de l'urine de vache, en conséquence de la vénération profonde que leur religion leur prescrit pour cet animal. Au reste, personne ne peut exercer la Médecine sans être inscrit sur le registre des brahmanes, et personne ne peut passer d'une branche à une autre. Il est à présumer, sur l'attachement presqu'invincible que tous ces peuples marquent pour leurs coutumes, qu'ils ne changeront pas sitôt la pratique de leur Médecine pour en adopter une meilleure, malgré la communication qu'ils ont avec les Européens.
Je ne puis finir l'histoire de la médecine des peuples éloignés, sans observer que de tous ceux dont les mœurs nous sont connues par des relations authentiques, il n'y en a point chez qui cette science ait été traitée avec plus de sagesse, sans science, que chez les anciens Américains.
Antonio de Solis assure, en parlant de Montézuma, empereur du Mexique, qu'il avait pris des soins infinis pour enrichir ses jardins de toutes les plantes que produisait ce climat heureux ; que l'étude des médecins se bornait à en savoir le nom et les vertus : qu'ils avaient des simples pour toutes sortes d'infirmités, et qu'ils opéraient des cures surprenantes, soit en donnant intérieurement les sucs qu'ils en exprimaient, soit en appliquant la plante extérieurement. Il ajoute que le roi distribuait à quiconque en avait besoin, les simples que les malades faisaient demander ; et que satisfait de procurer la guérison à quelqu'un, ou persuadé qu'il était du devoir d'un prince de veiller à la santé de ses sujets, il ne manquait point de s'informer de l'effet des remèdes.
Le même auteur raconte que dans la maladie de Cortès, les médecins amériquans appelés, usèrent d'abord de simples doux et rafraichissants pour suspendre l'inflammation, et qu'ensuite ils en employèrent d'autres pour mûrir la plaie, et cela avec tant d'intelligence, que Cortès ne tarda pas à être parfaitement guéri. Quoi qu'il en sait, c'est des Amériquains que nous tenons deux de nos remèdes les plus efficaces, le quinquina et l'ipécacuanha, tandis que nos subtils physiciens ne connaissent guère de la vertu des plantes qui croissent en Europe, que ce qu'ils en ont lu dans Dioscoride.
Mais il est temps de rentrer en Grèce pour y reprendre l'histoire de la Médecine, où nous l'avons laissée, je veux dire au siècle d'Hippocrate, qui, de l'aveu de tout le monde, éleva cette science au plus haut degré de gloire. On se rappellera sans doute que ce grand homme naquit à Cos, la première année de la 80e olympiade, 30 ans avant la guerre du Péloponnèse, et environ 460 ans avant la naissance de Jesus-Christ.
Conserver aux hommes la santé, soit en prévenant, soit en écartant les maladies, c'est le devoir du médecin ; or, le mortel capable de rendre noblement ce service à ceux qui l'invoquent, honore son état, et peut s'asseoir à juste titre entre les fils d'Apollon.
Quelles que soient les idées du vulgaire, les personnes instruites n'ignorent point combien il est difficîle d'acquérir le degré de connaissance nécessaire pour exercer la Médecine avec succès.
Le chemin qui conduit, je ne dis pas à la perfection, mais à une intelligence convenable dans l'art de guérir, est rempli de difficultés presqu'insurmontables. Ceux qui le pratiquent sont souvent dans une grande incertitude sur la nature des maladies ; leurs causes relatives sont cachées dans une obscurité qu'il sera bien difficîle de jamais découvrir : mais y parvint-on un jour, une connaissance suffisante de la vertu des remèdes manquerait encore : d'ailleurs chacune des parties de la Médecine est d'une étendue supérieure à la capacité de l'esprit humain ; cependant le parfait médecin devrait les posséder toutes.
Est-ce à l'expérience, est-ce au raisonnement que la Médecine doit ses plus importantes découvertes ? Qui des deux doit-on prendre pour guide ? Ce sont des questions qui méritent d'être agitées, et qui l'ont été suffisamment. Il s'est heureusement trouvé des hommes d'un mérite supérieur qui ont montré la nécessité de l'une et de l'autre, les grands effets de leur conspiration, la force de ces deux bras réunis, et leur faiblesse lorsqu'ils sont séparés.
Avant que la Médecine eut la forme d'une science, et fût une profession, les malades encouragés par la douleur, sortirent de l'inaction, et cherchèrent du soulagement dans des remèdes inconnus ; les symptômes qu'ils avaient eux-mêmes éprouvés, leur apprirent à reconnaître les maladies. Si par hasard, ou par une réunion de circonstances favorables, les expédiens auxquels ils avaient eu recours avaient produit un effet salutaire, l'observation qu'ils en firent fut le premier fondement de cet art, dont on retira dans la suite de grands avantages. De-là vinrent et la coutume d'exposer les malades sur les places publiques, et la loi qui enjoignait aux passants de les visiter, et de leur indiquer les remèdes qui les avaient soulagés en pareil cas.
La Médecine fit ce second pas chez les Babyloniens et chez les Chaldéens, ces anciens fondateurs de presque toutes les sciences ; de-là, passant en Egypte, elle sortit entre les mains de ses habitants industrieux de cet état d'imperfection. Les Egyptiens couvrirent les murs de leurs temples de descriptions de maladies et de recettes ; ils chargèrent des particuliers du soin des malades : il y eut alors des médecins de profession ; et les expériences qui s'étaient faites auparavant sans exactitude, et qui n'avaient point été rédigées, prirent une forme plus commode pour l'application qu'on en pouvait faire à des cas semblables.
Cependant les hommes convaincus que l'observation des maladies et la recherche des remèdes ne suffisaient pas pour perfectionner la Médecine avec une rapidité proportionnée au besoin qu'ils en avaient, eurent recours à cette raison dont ils avaient reconnu longtemps auparavant l'importance dans la distinction et la cure des maladies ; mais on préfera, comme il n'arrive que trop souvent en pareil cas, les conjectures rapides de l'imagination à la lenteur de l'expérience, et l'on sépara follement deux choses qu'il fallait faire marcher de pair, la théorie et les faits. Qu'en arriva-t-il ? C'est que sans égard pour la sûreté de la pratique, on établit la Médecine sur des spéculations spécieuses et fausses, subtiles et peu solides.
L'éloquence des rhéteurs et les sophismes des philosophes ne tinrent pas longtemps contre les gémissements des malades ; l'art de préconiser la méthode n'en prévint point les suites fatales : après qu'on avait démontré que le malade devait guérir, il ne laissait pas de mourir. L'insuffisance de la raison n'étonnera point ceux qui considèrent les choses avec impartialité. La santé et les maladies sont des effets nécessaires de plusieurs causes particulières, dont les actions se réunissent pour les produire ; mais l'action de ces causes ne deviendra jamais le sujet d'une démonstration géométrique, à moins que l'essence de chacune en particulier ne soit connue, et qu'on n'ait déduit de cette comparaison les propriétés et les forces résultantes de leur mélange. Or, l'essence et les propriétés de chacune ne se manifestent que par leurs effets ; c'est par les effets seuls que nous pouvons juger des causes ; la connaissance des effets doit donc précéder en nous le raisonnement. Mais qui peut assurer un médecin, de quelque profondeur de jugement qu'il soit doué, qu'un effet est l'entière opération de telle et telle cause ? Pour en venir-là, il faudrait distinguer et parer une infinité de circonstances, pour la plupart si déliées, qu'elles échappent à toute la sagacité de l'observateur. D'ailleurs, telle est la variété prodigieuse des maladies, tel est le nombre des symptômes dans chacune d'elles, que la courte durée de la vie, la faiblesse de notre esprit et de nos sens, les difficultés que nous avons à surmonter les erreurs dont nous sommes capables, et les distractions auxquelles nous sommes exposés, ne permet jamais de rassembler assez de faits pour fonder une théorie générale, un système qui s'étende à tout.
Il s'ensuit de-là, qu'il faut se remplir des connaissances des autres, consulter les vivants et les morts, feuilleter les ouvrages des anciens, s'enrichir des découvertes modernes, et se faire de la vérité une règle inviolable et sacrée. Le vrai médecin ne s'instruira qu'avec ceux qui ont suivi la nature, qui l'ont peinte telle qu'elle est, qui avaient trop d'honneur pour appuyer une théorie favorite par des faits imaginés, et que des vues intéressées n'engagèrent jamais à altérer les événements, soit en y ajoutant, soit en en retranchant quelque circonstance. Voilà les fontaines sacrées dans lesquelles il ne descendra jamais trop souvent.
Depuis que la Médecine est une science, tel a été le bonheur du monde, qu'elle a produit de temps à autre quelques mortels estimables, qui n'ont gouté que la lumière et la vérité. Elle ne faisait que de naître lorsqu' Hippocrate parut ; et malgré l'éloignement des temps, elle est encore toute brillante des lumières qu'elle en a reçues. Hippocrate est l'étoîle polaire de la Médecine. On ne le perd jamais de vue sans s'exposer à s'égarer. Il a représenté les choses telles qu'elles sont. Il est toujours concis et clair. Ses descriptions sont des images fidèles des maladies, grâce au soin qu'il a pris de n'en point obscurcir les symptômes et l'évenement : il n'est question chez lui, ni de qualités premières, ni d'êtres fictifs. Il a su pénétrer dans le sein de la nature, prévoir et prédire ses opérations, sans remonter aux principes originels de la vie. La chaleur innée et l'humeur radicale, termes vides de sens, ne souillent point la pureté de ses ouvrages. Il a caractérisé les maladies, sans se jeter dans des distinctions inutiles des espèces, et dans des recherches subtiles sur les causes. Ceux qui pensent qu'Hippocrate a donné dans les acides, les alkalis, et les autres imaginations de la Chimie, sont des visionnaires plus dignes d'être moqués que d'être réfutés : cet esprit aussi solide qu'élevé, méprisa toutes les vaines spéculations.
Non moins impartial dans ses écrits qu'énergique dans sa diction et vif dans ses peintures, il n'obmet aucune circonstance, et n'assure que celles qu'il a vues. Il expose les opérations de la nature ; et le désir d'accréditer ou d'établir quelque hypothése, ne les lui fait ni altérer ni changer. Tel est le vrai, l'admirable, je dirais presque le divin Hippocrate. Il n'est pas étonnant que ses expositions des choses, et ses histoires des maladies, aient mérité dans tous les âges l'attention et l'estime des savants.
On peut joindre à ce grand homme, Arétée de Cappadoce, et Rufus d'Ephèse, qui, à son exemple, ne se sont illustrés dans l'art de guérir, qu'en observant inviolablement les lois de la vérité. Presque tous leurs successeurs, jusqu'au temps de Galien, abandonnèrent cette voie sacrée. Quand on vient à peser, dans la même balance, les travaux des autres médecins de la Grèce avec ceux d'Hippocrate, qu'on les trouve imparfaits et défectueux ! Les uns dévoués en aveugles à des sectes particulières, en épousèrent les principes, sans s'embarrasser s'ils étaient vrais ou faux. D'autres se sont occupés à déguiser les faits, pour les faire quadrer avec les systèmes. Plusieurs plus sincères, mais se trompant également, négligèrent les mêmes faits, pour courir après les causes imaginaires des maladies et de leurs symptômes.
Ce n'est pas assez que de la pénétration dans un médecin, et de l'impartialité dans ses écrits, il lui faut encore un style simple et naturel, une diction pure et claire. Il lui est toutefois plus important d'être médecin qu'orateur. Toutes les phrases brillantes, toutes les périodes, toutes les figures de la rhétorique, ne valent pas la santé d'un malade. S'attacher trop à polir son discours, c'est trop chercher à faire parade de son esprit dans des matières de cette importance. Un usage affecté de termes extraordinaires, une élocution pompeuse, ne sont capables que d'embrouiller les choses, et d'arrêter le lecteur. Un étalage d'érudition, une énumération des sentiments tant anciens que modernes, les recherches subtiles des maladies, et la connaissance des antiquités médicinales, ne constituent point la Médecine. Ce n'est point avec ce qui peut plaire à des gens de lettres, qu'on fixera l'attention d'un homme, dont le devoir est de conserver la santé, de prévenir les maladies, et qui ne lit que pour apprendre les différents moyens de parvenir à ses fins. Plein de mépris pour les productions futiles de l'éloquence et du bel esprit, lorsque ces talents déplacés tendront moins à avancer la Médecine, qu'à briller à ses dépens, il aura sans cesse sous les yeux le style simple d'Hippocrate. Il aimera mieux entendre et voir la pure nature dans ses écrits, que de se repaitre des fleurs d'un rhéteur, ou de l'érudition d'un savant : le mérite particulier du grand médecin de Cos, c'est le jugement et la clarté.
La plupart des auteurs qui l'ont suivi ne font que se répéter eux-mêmes, et se copier les uns les autres : la seule chose qu'on y trouve, et qu'on n'y cherchait point, c'est une compilation d'antiquités, de fables ou d'histoires inutiles au sujet ; sans parler de la barbarie de leur langage, occasionné par une vaine ostentation de la connaissance de différents idiomes. Il n'y en a presque aucun qui ait eu en vue l'honneur et les progrès de la Médecine. D'un côté les Arabes et les commentateurs de Galien semblent s'être piqué de barbarie dans le style ; au contraire, les interpretes d'Hippocrate ont négligé les faits, pour se trop livrer à la diction : de-là vient qu'on n'entend point les uns, et qu'on n'apprend rien dans les autres.
Mais Hippocrate ne l'emporta pas sur tous ses collègues par le mérite seul de sa composition : c'est par une infatigable contention d'esprit à envisager les choses dans les jours les plus favorables ; c'est par une exactitude infinie à épier la nature, et à s'éclaircir sur les opérations ; c'est par le désintéressement généreux avec lequel il a communiqué ses lumières et ses ouvrages aux hommes, que cet ancien, considéré d'un oeil impartial, paraitra supérieur même à la condition humaine : son mérite ne laissera point imaginer qu'il puisse avoir de rivaux ; rival lui-même d'Apollon, il avait porté tant de diligence dans ces observations, qu'il était parvenu à fixer les différents progrès des maladies, leur état présent, leurs révolutions à venir, et à en prédire l'évenement. Si nous considérons les distinctions délicates qu'il établit entre les accidents qui naissent de l'ignorance du médecin, et de la négligence ou de la dureté des gardes-malades, et les symptômes naturels de la maladie, nous prononcerons sans balancer, que de tous ceux qui ont cultivé la Médecine, soit avant, soit après lui, aucun n'a montré autant de pénétration et de jugement.
Il y a plus, les travaux réunis de tous les médecins qui ont paru depuis l'enfance de la Médecine, jusqu'aujourd'hui, nous offriraient à peine autant de phénomènes et de symptômes de maladies, qu'on en trouve dans ce seul auteur. Il est le premier qui ait découvert, que les différentes saisons de l'année étaient les causes des différentes maladies qu'elles apportent avec elles, et que les révolutions qui se font dans l'air, telles que les chaleurs brulantes, les froids excessifs, les pluies, les brouillards, le calme de l'atmosphère, et les vents, en produisent en grand nombre. Il a compté entre les causes des maladies endémiques, la situation des lieux, la nature du sol, le mouvement ou l'amas des eaux, les exhalaisons de la terre, et la position des montagnes.
C'est par ces connaissances qu'il a préservé des nations, et sauvé des royaumes de maladies qui, ou les menaçaient, ou les affligeaient ; et semblable au soleil, il a répandu sur la terre une influence vivifiante. C'est en examinant les mœurs, la nourriture et les coutumes des peuples, qu'il remonta à l'origine des maladies qui les désolaient : c'était beaucoup pour les contemporains, d'avoir possédé un tel homme : mais il est devenu par ses écrits le bienfaiteur de l'univers. Il nous a laissé ses observations jusques dans les circonstances les plus légères ; détail futîle au jugement des esprits superficiels, mais détail important aux yeux pénétrants des esprits solides et des hommes profonds.
Son traité de aere, locis et aquis, est un chef-d'œuvre de l'art. Je ne dirai pas qu'il a posé dans cet ouvrage les fondements de la Médecine, mais qu'il a poussé cette science presqu'au même point de perfection où nous la possedons. C'est-là qu'on voit ce savant et respectable vieillard, décrivant avec la dernière exactitude les maladies épidémiques, avertissant ses collègues d'avoir égard, non-seulement à la différence des âges, des sexes, et des tempéraments, mais aux exercices, aux coutumes, et à la manière de vivre des malades ; et décidant judicieusement que la constitution de l'air ne suffit pas pour expliquer pourquoi les maladies épidémiques sont plus cruelles pour les uns que pour d'autres. C'est-là qu'on le trouve occupé à décrire l'état des yeux et de la peau, et à réfléchir sur la volubilité ou le bégayement de la langue, sur la force ou la faiblesse de la voix du malade, déterminant par ces symptômes son tempérament, la violence de la maladie, et sa terminaison. C'est-là que l'on se convaincra que jamais personne ne fut plus exact qu'Hippocrate dans l'exposition des signes diagnostics, dans la description des maladies caractérisées par ces signes, et dans la prédiction des événements.
Mais s'il savait découvrir la nature, observer les symptômes, et suivre les révolutions des maladies, il n'ignorait pas les secours nécessaires dans tous ces cas. Il n'était ni téméraire dans l'application des médicaments, ni trop prompt à juger de leurs effets : il ne s'enorgueillissait point lorsque les choses répondaient à son attente, et on ne lui voit point la mauvaise honte de pallier le défaut du succès, lorsque les remèdes ont trompé ses espérances : mais c'est un malheur auquel il était rarement exposé ; son adresse maitrisait, pour ainsi dire, le danger : les maladies semblaient aller d'elles-mêmes où il avait dessein de les amener ; et c'était avec un petit nombre de remèdes dont l'expérience lui avait fait connaître le pouvoir, et dont la préparation faisait tout le prix, qu'il opérait ces prodiges. Moins curieux de connaître un plus grand nombre de médicaments, que d'appliquer à propos ceux qu'il connaissait ; c'était à cette dernière partie qu'il donnait son attention.
Imitateur et ministre de la nature, pour ne point empiéter sur ses fonctions, ni la troubler dans ses exercices, il distingue dans les maladies différents périodes, et dans chaque période des jours heureux et malheureux. Il hâtait ou réprimait l'action des matières morbifiques selon les circonstances, il les conduisait à la coction par des moyens doux et faciles, il les évacuait, lorsqu'elles étaient cuites, par les voies auxquelles elles se déterminaient d'elles-mêmes, ne se chargeant que de leur faciliter la sortie, et de ne la permettre qu'à temps.
Après qu'il eut appris, soit par hasard, soit par adresse, à discerner les remèdes salutaires des moyens nuisibles, et découvert la manière et le temps que la nature employait à se débarrasser par elle-même des maladies, il fixa par des règles sures l'usage des médicaments. Ce ne fut que quand ces médicaments eurent été éprouvés par une longue suite d'expériences journalières et de cures heureuses, qu'il se crut en état d'indiquer les propriétés des végétaux, des animaux, et des minéraux ; ce qu'il exécuta en joignant à ses instructions un détail des précautions nécessaires dans la pratique, détail capable d'effrayer ceux qui seraient tentés de se mêler des fonctions du médecin, sans en avoir la science et les qualités. Voilà l'unique méthode de traiter la Médecine avec gloire, et de procurer aux hommes tous les secours qu'ils peuvent attendre de leurs semblables. Voilà la méthode qu'Hippocrate a transmise dans ses écrits, et dont sa pratique a démontré les avantages.
Dans les maladies chroniques, la médecine d'Hippocrate se bornait au régime, à l'exercice, aux bains, aux frictions, et à un très-petit nombre de remèdes. On a beau vanter les travaux des modernes, il ne parait pas qu'ils en sachent en ceci plus que cet ancien, qu'ils aient une méthode plus raisonnée de traiter ces maladies, et qu'il s'en tirent avec plus de succès. Il est des médecins, je le sais, qui ont alors recours à un grand nombre de remèdes, entre lesquels il y en a de violents : mais je doute que ce soit avec satisfaction pour eux, et avec avantage pour le malade ; car on a mis en question, et avec justice, si en le guérissant par ces moyens, ils n'avaient point attaqué sa constitution et abrégé sa vie, en lui procurant un mal plus incurable que celui qu'il avait. Je ne prétends pas proscrire dans tous les cas l'usage des remèdes violents : il y a des maladies qui demandent des secours prompts et proportionnés à leur violence, c'est ce qu'Hippocrate n'ignorait pas : mais il n'y avait recours que lorsque les moyens les plus doux devaient être insuffisans, ou demeuraient sans effet.
Il savait par expérience que dans les maladies violentes, la nature faisait elle-même la plus grande partie de l'ouvrage, et qu'elle était presque toujours assez puissante pour préparer la partie morbifique, la cuire, amener une crise, et l'expulser ; car il faut qu'un malade passe par tous ces états pour arriver à la santé. En conséquence de ces idées, sans troubler la nature dans ses opérations salutaires par une confusion de remèdes, ou faire le rôle de spectateur aisif, il se contentait de l'aider avec circonspection, d'avancer la préparation des humeurs, et leur coction, et de modérer les symptômes quand ils étaient excessifs ; et lorsqu'il s'était assuré de la maturité des matières, et de l'influence de la nature pour les expulser, il s'occupait à lui donner, pour ainsi dire, la main, et à la conduire où elle voulait aller, en favorisant l'expulsion par les voies auxquelles elle paraissait avoir quelque tendance.
Voici les maximes principales par lesquelles Hippocrate se conduisait. Il disait en premier lieu, que les contraires se guérissent par les contraires, c'est-à-dire, que, supposé que de certaines choses soient opposées les unes aux autres, il faut les employer les unes contre les autres. Il explique ailleurs cet aphorisme en cette manière ; la plénitude guérit les maladies causées par l'évacuation, et réciproquement l'évacuation celles qui viennent de plénitude ; le chaud détruit le froid, et le froid éteint la chaleur.
2°. Que la Médecine est une addition de ce qui manque, et une soustraction de ce qui est superflu ; axiome expliqué par le suivant. Il y a des sucs ou des humeurs qu'il faut chasser du corps en certaines rencontres, et d'autres qu'il y faut reproduire.
3°. Quant à la manière d'ajouter ou de retrancher, il avertit en général, qu'il ne faut ni vider ni remplir tout-d'un-coup, trop vite, ni trop abondamment ; de-même qu'il est dangereux de refroidir subitement, et plus qu'il ne faut, tout excès étant ennemi de la nature.
4°. Qu'il faut tantôt dilater et tantôt resserrer ; dilater ou ouvrir les passages par lesquels les humeurs se vident naturellement, lorsqu'ils ne sont pas suffisamment ouverts, ou qu'ils s'obstruent. Resserrer au contraire et retrécir les canaux relâchés, lorsque les sucs qui y passent n'y doivent point passer, ou qu'ils y passent en trop d'abondance. Il ajoute qu'il faut quelquefois adoucir, endurcir, amollir ; d'autres fais, épaissir, diviser et subtiliser ; tantôt exciter, réveiller ; tantôt engourdir, arrêter ; et tout cela relativement aux circonstances, aux humeurs et aux parties solides.
5°. Qu'il faut observer le cours des humeurs, savoir d'où elles viennent, où elles vont ; en conséquence les détourner, lorsqu'elles ne vont point où elles doivent aller ; les déterminer d'un autre côté, comme on fait les eaux d'un ruisseau, ou en d'autres occasions les rappeler en arrière, attirant en-haut celles qui se portent em-bas, et précipitant celles qui tendent en-haut.
6°. Qu'il faut évacuer par des voies convenables, ce qui ne doit point séjourner, et prendre garde que les humeurs qu'on aura une sois chassées des lieux où elles ne doivent point aller, n'y rentrent derechef.
7°. Que lorsqu'on suit la raison, et que le succès ne répond pas à l'attente, il ne faut pas changer de pratique trop aisément ou trop vite, surtout si les causes sur lesquelles on s'est déterminé, subsistent toujours : mais comme cette maxime pourrait induire à erreur, la suivante lui servira de correctif.
8°. Qu'il faut observer attentivement ce qui soulage un malade, et ce qui augmente son mal, ce qu'il supporte aisément, et ce qui l'affoiblit.
9°. Qu'il ne faut rien entreprendre à l'aventure : qu'il vaut mieux ordinairement se reposer que d'agir. En suivant cet axiome important, si l'on ne fait aucun bien, au-moins on ne fait point de mal.
10°. Qu'aux maux extrêmes, il faut quelquefois recourir à des remèdes extrêmes : ce que les médicaments ne guérissent point, le fer le guérit ; le feu vient à bout de ce que le fer ne guérit point : mais ce que le feu ne guérit point, sera regardé comme incurable.
11°. Qu'il ne faut point entreprendre les maladies désepérées, parce qu'il est inutîle d'employer l'art à ce qui est au-dessus de son pouvoir.
Ces maximes sont les plus générales, et toutes supposent le grand principe que c'est la nature qui guérit.
Hippocrate connaissait aussi tout ce que nos Médecins savent des signes et des symptômes des maladies, et c'est de lui qu'ils le tiennent. Ils lui sont encore obligés des maximes les plus importantes sur la conservation de la santé. Nous apprenons de lui qu'elle dépend de la tempérance et de l'exercice. Il est impossible, dit-il, que celui qui mange continue de se bien porter s'il n'agit. L'exercice consume le superflu des aliments, et les aliments réparent ce que l'exercice a dissipé. Quant à la tempérance, il la recommande tant à l'égard de la boisson, du manger et du sommeil, que dans l'usage des plaisirs de l'amour. Ces deux règles sur lesquelles les modernes ont fait cent volumes, sont tellement sures, que si tous les hommes étaient assez sages pour les mettre en pratique, la science de guérir deviendrait presque inutîle ; car, excepté les maladies endémiques, épidémiques et accidentelles, les autres seraient en petit nombre, si l'intempérance ne les multipliait à l'infini.
Telles que des sources limpides et pures, les préceptes d'Hippocrate ne sont point mêlés de faussetés, ni souillés par des rodomontades. Comme leur auteur était également éclairé, et exemt de toute vanité, on y reconnait par-tout le ton de la modestie. Non-content des instructions que ses ancêtres lui avaient laissées et de la science qu'il avait puisée chez les nations étrangères, il étudia avec une ardeur infatigable les opinions et les sentiments des autres Médecins. Il y avait alors un temple renommé à Gnide, dont les murs étaient ornés de tables, sur lesquelles on avait inscrit les observations les plus importantes, concernant les maladies et la santé des hommes. Il ne manqua pas de le visiter, et de transcrire pour son usage tout ce qu'il y trouva d'inconnu pour lui.
Entre les moyens dont il se servit pour augmenter le fonds des connaissances qu'il avait ou reçues de ses ancêtres, ou recueillies chez les peuples éloignés, il y en a un d'une espèce singulière, et qui lui fut propre. Il envoya Thessalus son fils ainé dans la Thessalie, Dracon le plus jeune sur l'Hellespont, Polybe son gendre dans une autre contrée ; et il dispersa une multitude de ses élèves dans toute la Grèce, après les avoir instruits des principes de l'art et leur avoir fourni tout ce qui leur était nécessaire pour la pratique. Il leur avait recommandé à tous de traiter les malades, quels qu'ils fussent, dans les lieux de leur mission ; d'observer la terminaison des maladies ; de l'avertir exactement de leurs espèces et de l'effet des remèdes ; en un mot, de lui envoyer une histoire fidèle et impartiale des événements. C'est ainsi qu'il rassembla en sa faveur toutes les circonstances qui pouvaient concourir à la formation d'un médecin unique.
Peu d'auteurs ont embrassé toutes les maladies qui ont paru dans une seule ville. Hippocrate a pu traiter de toutes celles qui désolèrent les villages, les villes et les provinces de la Grèce. Cela seul suffisait sans doute pour lui donner la supériorité sur ceux qui avaient exercé et qui exerceront dans la suite la même profession, mais sans avoir les mêmes ressources que lui, et sans être placés dans des circonstances aussi favorables.
Telle était, en un mot, l'étendue des lumières d'Hippocrate, que les plus savants d'entre les Grecs, les plus polis d'entre les Romains, et les plus ingénieux d'entre les Arabes n'ont confirmé sa doctrine, en la répétant dans leurs écrits. Hippocrate a fourni aux Grecs tout ce que Dioclès, Arétée, Rufus l'éphesien, Soranus, Galien, Aeginete, Trallien, Aètius, Oribase ont dit d'excellent. Celse et Pline les plus judicieux d'entre les Romains ont eu recours aux décisions d'Hippocrate, avec cette vénération qu'ils avaient pour les oracles ; et les Arabes n'ont été que les copistes d'Hippocrate, j'entends toutes les fois que leurs discours sont conformes à la vérité.
Enfin que dirai-je de plus à l'honneur de ce grand homme, si ce n'est qu'il a servi de modèle à presque tout ce qu'il y a eu de savants Médecins depuis son siècle, ou que les autres se sont formés sur ceux qui l'avaient pris pour modèle ? Son mérite ne demeura pas concentré dans l'étendue d'une ville ou d'une province : il se fit jour au loin, et lui procura la vénération des Thessaliens, des insulaires de Cos, des Argiens, des Macédoniens, des Athéniens, des Phocéens et des Doriens. Les Illyriens et les Paeoniens le regardèrent comme un dieu, et les princes étrangers invoquèrent son assistance. Les nations opulentes honorèrent sa personne, et le récompensèrent de ses services par de magnifiques présents ; et l'histoire nous apprend que ses successeurs dans l'art de guérir ont acquis, en l'imitant, la confiance des rois et des sujets, et sont parvenus au comble de la gloire, des honneurs et de l'opulence en marchant sur ses traces.
Il laissa deux fils, Thessalus et Draco, qui lui succédèrent dans l'exercice de la Médecine, avec une fille qu'il maria à Polybe un de ses élèves. Thessalus l'ainé a fait le plus de bruit. Galien nous apprend qu'il était en haute estime à la cour d'Archélaus, roi de Macédoine, dans laquelle il passa la plus grande partie de sa vie. Quant à Draco, frère de Thessalus, on n'en sait aucune particularité, si ce n'est qu'il eut un fils nommé Hippocrate, qui fut médecin de Roxane, femme d'Alexandre le grand. Polybe parait encore s'être acquis le plus de réputation, suivant le témoignage de Galien.
Les premiers médecins qui se soient illustrés dans leur profession, après Hippocrate, ses fils et son gendre, furent Dioclès de Caryste, Praxagore de la secte des dogmatiques, Chrisippe de Cnide, Erasistrate et son contemporain Hérophile, voyez leurs articles. C'est assez de remarquer ici que ce fut au temps d'Erasistrate et d'Hérophile, si l'on s'en rapporte à Celse, que la Médecine, qui jusqu'alors avait été exercée avec toutes ses dépendances par une seule personne, fut partagée en trois parties, dont chacune fit dans la suite l'occupation d'une personne différente. Ces trois branches furent la diététique, la pharmaceutique et la chirurgique. On serait porté à croire que Celse a voulu caractériser les trois professions, par lesquelles la Médecine s'exerce aujourd'hui ; celle des Médecins, celle des Chirurgiens, et celle des Apothicaires : mais ces choses n'étaient point alors sur le même pied que parmi nous ; car, par exemple, les plaies, les ulcères, et les tumeurs étaient le partage des Médecins pharmaceutiques, à-moins que l'incision ne fût nécessaire.
On vit après la mort d'Erasistrate et d'Hérophîle une révolution dans la Médecine bien plus importante, ce fut l'établissement de la secte empirique. Elle commença avec le xxxviij. siècle, environ 287 ans avant la naissance de Jesus-Christ. Celse nous apprend dans la préface de son premier livre, que Sérapion d'Alexandrie fut le premier qui s'avisa de soutenir qu'il est nuisible de raisonner en Médecine, et qu'il fallait s'en tenir à l'expérience ; qu'il défendit ce sentiment avec chaleur, et que d'autres l'ayant embrassé, il se trouva chef de cette secte. D'autres nomment au lieu de Sérapion, Philinus de Cos, disciple d'Hérophile. Quoi qu'il en sait, le nom d'empirique ne dérive point d'un fondateur ou d'un particulier qui se soit illustré dans cette secte, mais du mot grec , expérience.
On connait assez les différentes révolutions que les théories imaginaires en se succédant ont occasionnées dans la Médecine, et les influences qu'elles ont eu sur la pratique. On ne conçoit pas moins que les dogmatiques et les empiriques, en disputant les uns contre les autres, ne s'écartèrent jamais de la fin ordinaire qu'on se propose dans les disputes, je veux dire la victoire, et non la recherche de la vérité ; aussi la querelle fut longue, quoique le sujet en fût très-simple. Les dogmatiques prétendaient-ils qu'on ne pouvait jamais appliquer les remèdes, sans connaître les causes premières de la maladie : certes s'ils avaient raison, les malades et les médecins seraient dans un état bien déplorable. D'un autre côté, n'est-il pas constant que les maladies ont des causes purement mécaniques, qu'il importe à la Médecine de les connaître, que le médecin habîle les découvre souvent, et qu'alors il ne balance point dans le choix et l'application des remèdes.
Il est inutîle de nous arrêter à parler des défenseurs de la nouvelle secte empirique, entre lesquels Héraclide le Tarentin se distingua ; je ne parlerai pas non plus de la théorie et de la pratique d'Asclépiade, qui parait avoir mis trop de confiance dans son esprit, et s'être formé des monstres pour justifier son adresse à les combattre : mais je dois dire quelque chose de la secte fondée par Thémison qui prit l'épithète de méthodique, parce que le but qu'il se proposa était de trouver une méthode qui rendit l'étude et la pratique de la Médecine plus aisées. Voici en peu de mots quels étaient ses principes.
1°. Il disait que la connaissance des causes n'était point nécessaire, pourvu qu'on connut bien l'analogie ou les rapports mutuels des maladies, qu'il réduisait à deux ou trois espèces : celles du premier genre naissaient du resserrement ; celles du second genre provenaient du relâchement ; et celles du troisième, de l'une et de l'autre de ces causes.
2°. Il rejetait la connaissance des causes occultes avec les empiriques, et admettait avec les dogmatiques l'usage de la raison.
3°. Il comptait pour rien toutes les indications que les dogmatiques tiraient de l'âge du malade, de ses forces, de son pays, de ses habitudes, de la saison de l'année et de la nature de la partie malade.
4°. Les méthodiques disaient qu'on doit s'attacher à guérir les maladies par les choses les plus simples, par celles dont nous faisons usage dans la santé, telles que l'air que nous respirons, et les nourritures que nous prenons. Les anciens Médecins s'étaient occupés à en connaître les avantages : les méthodiques les surpassèrent encore dans cette étude ; ils prirent des soins tout particuliers pour rendre l'air que le malade respirait, tel qu'ils le supposaient devoir être pour contribuer à sa guérison ; et comme ils ne distinguaient que de deux sortes de maladies, des maladies de relâchement et des maladies de resserrement, toute leur application tendait à procurer au malade un air resserrant ou relâchant, selon le besoin.
Pour avoir un air relâchant, ils choisissaient des chambres bien claires, fort grandes, et médiocrement chaudes : au contraire pour donner au malade un air resserrant, ils le faisaient placer dans des appartements peu éclairés et fort frais. Non contens de distinguer les lieux tournés au septentrion ou au midi, ils faisaient descendre les malades dans des grottes et des lieux souterrains. Ils faisaient étendre sur les planchers des feuilles et des branches de lentisque, de vignes, de grenadier, de myrthe, de saules, de pin. Ils arrosaient les chambres d'eau fraiche. Ils se servaient de soufflets et d'éventails ; en un mot, ils n'oubliaient rien de ce qui peut donner de la fraicheur à l'air. Il faut, disaient-ils, avoir plus de soin de l'air qu'on respire que des viandes qu'on mange ; parce qu'on ne mange que par intervalles, au lieu qu'on respire continuellement, et que l'air entrant sans cesse dans le corps, et pénétrant jusques dans les plus petits interstices, resserre ou relâche plus puissamment que les aliments qu'ils réglaient aussi sur leurs principes ; car ils s'étaient soigneusement appliqués à distinguer les viandes et les boissons qui relâchent de celles qui resserrent.
5°. Les méthodiques, ou du moins les plus éclairés ne faisaient aucun usage des spécifiques ; ces remèdes étant pour la plupart incertains et composés d'ingrédiens, dont les malades n'usaient point dans la santé.
6°. Ils bannirent aussi de la Médecine les forts purgatifs, parce qu'ils étaient persuadés que ces remèdes attaquaient l'estomac ou relâchaient le ventre, et que par conséquent en guérissant d'une maladie, ils en causaient une autre. Cependant ils ordonnaient des clystères, mais d'une espèce émolliente. Ils rejetaient les narcotiques et les cautères ; mais ce qui distinguait particulièrement les méthodiques, c'était leur abstinence de trois jours qu'ils faisaient observer aux malades dans le commencement de leurs maladies.
7°. Les méthodiques n'admettant que deux genres de maladie, le genre resserré et le genre relâché, ils n'avaient besoin que de deux espèces de remèdes, les uns qui relâchassent et les autres qui resserrassent. C'est au choix et à l'application de ces remèdes qu'ils donnaient une attention particulière.
8°. Entre les remèdes relâchans, la saignée tenait chez eux le premier rang ; ils saignaient dans toutes les maladies qui dépendent du genre resserré, et même dans celles qu'ils comprenaient sous le genre mêlé, lorsque le resserrement prévalait sur le relâchement.
9. Ils faisaient grand usage des ventouses, tantôt avec scarifications, tantôt sans scarifications ; ils y joignaient les sangsues. Quant aux autres moyens de relâcher dont ils se servaient, ils consistaient en fomentations faites avec des éponges trempées dans de l'eau tiede, et en des applications extérieures d'huîle chaude et de cataplasmes émolliens, sans oublier le régime par rapport aux choses naturelles.
10°. Ils n'étaient pas moins occupés à trouver des moyens de resserrer. On a Ve de quelle manière ils s'y prenaient pour rendre l'air astringent et rafraichissant. Ils tournaient encore à cette fin autant qu'ils le pouvaient la nourriture et les exercices.
Ce système de Médecine eut un grand nombre de défenseurs ; entr'autres Thessalus élève de Thémison, Soranus d'Ephese, Coelius-Aurelianus, Moschion dont nous avons un traité des maladies des femmes. Vindictianus qui vécut sous l'empereur Valentinien, Théodorus, Priscianus son disciple, etc. Voyez les articles de chacun d'eux sous le mot MEDECINS ANCIENS.
La secte méthodique ne finit qu'à Gariopontus, qui vivait dans le même temps que Pierre Damien : c'est-à-dire dans le XIe siècle : mais Prosper Alpin, au commencement du XVIIe siècle, fit un nouvel effort pour ressusciter le système des méthodiques, en publiant son excellent ouvrage de Medicinâ methodicâ. Baglivi écrivit ensuite sur le même sujet, et dans les mêmes vues. Enfin Boerhaave a exposé, éclairci et augmenté ce système avec toute la profondeur de son génie, en sorte que les neuf pages in -12. que ce système occupe dans ses aphorismes, imprimés en 1709, ont été commentés dans une multitude prodigieuse de volumes.
Quoique Thémison eut fait un grand nombre de disciples, et que sa secte se soit soutenue si longtemps, cependant plusieurs de ses contemporains et de ses successeurs immédiats ne l'embrassèrent point. Les uns demeurèrent fermes dans le parti des dogmatiques, et continuèrent de suivre Hippocrate, Hérophile, Erasistrate et Asclépiade ; les autres s'en tinrent à l'empirisme. La dissension même qui regnait entre les méthodiques donna naissance à de nouveaux systèmes, et leur secte poussa deux branches ; savoir l'épisynthétique et l'éclectique, ainsi qu'il parait par le livre intitulé Introduction, qui est attribué à Galien. Comme le terme épisynthétique est tiré du mot grec, qui signifie entasser ou assembler, l'on est tenté de conjecturer que les Médecins ainsi nommés réunissaient les principes des méthodiques avec ceux des empiriques et des dogmatiques, et que leur système était un composé des trois autres. Le mot éclectique, qui veut dire choisissant, nous fait entendre sans peine que dans la secte éclectique on faisait profession de choisir et d'adopter ce qu'on pensait que les autres sectes avaient enseigné de mieux.
Le système des Pneumatiques, imaginé par Athénée et qui eut peu de partisans, consistait à établir un cinquième principe, qu'ils nommèrent esprit, lequel recevant quelque altération, cause diverses maladies. Cette opinion théorique ne mérite pas de nous arrêter parce que les pneumatiques ne formèrent point de secte distinguée ; que d'ailleurs leur pratique était la même que celle des anciens Médecins, tant dogmatiques qu'empiriques ; et qu'elle s'accordait à quelques égards avec celle des méthodiques. Si le livre de flattibus était véritablement d'Hippocrate, on pourrait dire que ce grand homme avait conçu le premier le système d'Athénée. Cependant l'auteur de ce livre, quel qu'il sait, est à-coup-sur un médecin dogmatique. Arétée, qui semble avoir admis le cinquième principe des pneumatiques, suivit aussi généralement dans sa pratique celle des méthodiques ; lisez, je ne dis pas son article, mais ses ouvrages, ils en valent bien la peine.
Quoique Celse n'ait fondé aucune secte particulière, il a écrit en latin de la Médecine si judicieusement et avec tant de pureté, qu'il n'est pas permis de le passer sous silence.
Il est vraisemblable qu'il naquit sous le règne d'Auguste, et qu'il écrivit au commencement du règne de Tibere ; c'est ce qu'on peut inférer d'un passage de Columelle qui vivait du temps de Claude, et qui parle de Celse comme d'un auteur qui avait écrit avant lui, mais qu'il avait vu. Corneille Celse, dit-il, notre contemporain, a renfermé dans cinq livres tout le corps des beaux-arts ; et ailleurs Julius Atticus et Corneille Celse sont deux écrivains célèbres de notre âge. Quintilien remarque aussi que Celse avait écrit non-seulement de la Médecine, mais de tous les arts libéraux ; cependant de tous ses ouvrages il ne nous reste que ceux qui concernent la Médecine, et quelques fragments de la rhétorique.
Toute la Médecine de cet auteur judicieux est renfermée dans huit livres, dont les quatre premiers traitent des maladies internes, ou de celles qui se guérissent principalement par la diete. Le cinquième et le sixième, des maladies externes ; à quoi il a ajouté diverses formules de médicaments internes et externes. Le septième et le huitième parlent des maladies qui appartiennent à la Chirurgie.
Hippocrate et Asclépiade sont les principaux guides que Celse a choisis, quoiqu'il ait emprunté plusieurs choses de ses contemporains : il suit le premier, lorsqu'il s'agit du pronostic et de plusieurs opérations de Chirurgie. Il Ve même jusqu'à traduire sur cette matière Hippocrate mot-à-mot, d'où il a acquis le surnom d'Hippocrate latin. Quant au reste de la Médecine, il parait s'être conformé à Asclépiade, qu'il cite comme un bon auteur, et dont il convient avoir tiré de grands secours. Voilà ce qui a donné lieu à quelques-uns de compter Celse entre les méthodiques. Mais quand il ne serait pas évident par la manière dont il parle des trois sectes principales qui partageaient la Médecine de son temps, qu'il n'en embrasse aucune en particulier, on n'aurait qu'à conférer sa pratique avec celle des méthodiques pour se garantir ou pour sortir de cette erreur. En un mot, si Celse ne se déclara pas pour la secte éclectique, il est du-moins certain qu'il en suivit les principes, choisissant avec beaucoup d'esprit ce qui lui paraissait le meilleur dans chaque secte et dans chaque auteur. On en peut juger par ses écrits qui sont entre les mains de tout le monde ; il serait inutîle par cette seule raison d'en faire ici l'analyse ; mais je ne puis m'empêcher de rapporter le conseil qu'il donne pour la conservation de la santé, et qui seul peut suffire pour faire connaître son génie et ses lumières.
Un homme né, dit-il, d'une bonne constitution, qui se porte bien et qui ne dépend de personne, doit ne s'assujettir à aucun régime et ne consulter aucun médecin. Pour diversifier sa manière de vivre, qu'il demeure tantôt à la campagne, tantôt à la ville ; mais plus souvent à la campagne. Il navigera, il ira à la chasse, il se reposera quelquefois, et prendra fréquemment de l'exercice, car le repos affoiblit et le travail rend fort. L'un hâte la vieillesse, l'autre prolonge la jeunesse. Il est bon qu'il se baigne tantôt dans l'eau chaude, et tantôt dans l'eau froide ; qu'il s'oigne en certain temps, et qu'il n'en fasse rien en un autre ; qu'il ne se prive d'aucune viande ordinaire ; qu'il mange en compagnie et en particulier ; qu'il mange en un temps un peu plus qu'à l'ordinaire ; qu'en un autre il se règle ; qu'il fasse plutôt deux repas par jour qu'un seul ; qu'il mange toujours assez, et un peu moins que sa faim. Cette manière de s'exercer et de se nourrir est autant nécessaire que celle des athletes est dangereuse et superflue. Si quelques affaires les obligent d'interrompre l'ordre de leurs exercices, ils s'en trouvent mal ; leurs corps deviennent replets, ils vieillissent promptement, et tombent malades.
Voici ses préceptes pour les gens mariés : on ne doit ni trop rechercher, ni trop fuir le commerce des femmes ; quand il est rare, il fortifie ; quand il est fréquent, il affoiblit beaucoup ; mais comme la fréquence ne se mesure pas tant ici par la répétition des actes qu'elle s'estime par l'âge, le tempérament et la vigueur, il suffit de savoir là-dessus que le commerce qui n'est suivi ni de douleur, ni de la moindre débilité, n'est pas inutîle ; il est plus sur la nuit que le jour. Il faut en même temps se garder de veiller, de se fatiguer, et de manger trop incontinent après. Enfin toutes les personnes d'une forte santé doivent observer, tant qu'ils jouiront de cet heureux état, de ne pas user mal-à-propos des choses destinées à ceux qui se portent mal.
Je ne me propose point de discuter l'état de la Médecine chez les Romains. Il est vraisemblable qu'ils n'ont pas été absolument sans médecins au commencement de leur république ; mais il y a apparence que jusqu'à la venue d'Archagatus à Rome l'an 575 de la fondation de cette ville, ils ne s'étaient servi que de la Médecine empirique, telle que les premiers hommes la pratiquaient ; c'est cette Médecine qui était si fort du goût de Caton, et de laquelle il avait écrit le premier de tous les Romains ; mais le règne de Jules César fut favorable à ceux de cette profession. Jules César, dit Suétone, donna le droit de la bourgeoisie de Rome à tous ceux qui exerçaient la Médecine, et à ceux qui enseignaient les arts libéraux, afin qu'ils demeurassent plus volontiers dans cette ville, et que d'autres vinssent s'y établir. Il n'en fallait pas davantage pour attirer un grand nombre de médecins dans cette capitale du monde, où ils trouvaient d'ailleurs des moyens de s'enrichir promptement.
En effet, dès que la profession de la Médecine fut ouverte aux étrangers comme aux Romains, tous ceux qui se sentaient quelque ressource dans l'esprit, ou des espérances de faire fortune, ne manquèrent pas de l'embrasser à l'exemple d'Asclépiade qui avait abandonné le métier ingrat de la Rhétorique pour devenir médecin. Les uns se faisaient chirurgiens, d'autres pharmaciens, d'autres vendeurs de drogues et de fards, d'autres herboristes, d'autres compositeurs de médecine, d'autres accoucheurs, etc.
Auguste, successeur de Jules César, favorisa les médecins, de même que les autres gens de lettres, surtout depuis qu'Antonius Musa l'eut guéri d'une maladie opiniâtre par le secours des bains froids. Cette cure valut à Musa, outre de grandes largesses qui lui furent faites par l'empereur et par le sénat, le privilège de porter un anneau d'or ; privilège qu'il obtint pour ses confrères, qui furent encore exemtés de tous impôts en sa considération. Suétone ajoute que le sénat fit élever à Musa une statue d'airain, que l'on mit à côté de celle d'Esculape.
Cependant la condition servîle d'Antoine Musa, avant tous les honneurs dont il fut revêtu, a persuadé quelques modernes qu'il n'y avait que des esclaves qui exerçassent la Médecine à Rome sous le règne des premiers empereurs, et même assez longtemps après. On ne peut pas nier qu'il n'y ait eu quantité d'esclaves médecins, ou qu'on appelait tels, et qui exerçaient toutes ou quelques parties de cet art ; cependant je n'en voudrais pas conclure qu'il n'y eut point à Rome de médecin d'une autre condition. Ce ne furent point des esclaves qui introduisirent la Médecine dans cette capitale du monde, ce furent des Grecs d'une condition libre, tels qu'étaient Archagatus et Asclépiade. Si le médecin Artorius, qui fut pris avec Jules César par des pirates, avait été de condition servile, il semble que Plutarque aurait eu mauvaise grâce de l'appeler l'ami de César ; mais il y a un passage de Cicéron qui prouve, ce me semble, que la Médecine était de son temps regardée à Rome comme un art que les personnes libres pouvaient exercer sans se dégrader. Les arts, dit-il, qui demandent une grande connaissance, ou qui ne sont pas d'une médiocre utilité, comme la Médecine, comme l'Architecture, comme tous les autres arts qui enseignent des choses honnêtes, ne déshonorent point ceux qui les exercent, lorsqu'ils sont d'une condition à laquelle ces professions conviennent. Offic. liv. I. chap. xlij.
Il est vrai qu'on vit à Rome et ailleurs un très-grand nombre d'esclaves médecins, soit qu'ils eussent appris leur profession étant déjà esclaves, soit qu'étant nés libres, ils fussent tombés par malheur dans l'esclavage : mais de quelque condition qu'aient été les médecins qui succédèrent à ceux dont nous avons parlé jusqu'ici, ils ne se distinguèrent les uns ni les autres par aucun ouvrage intéressant ; la plupart ne s'occupèrent que de leur fortune, et les Historiens ne parlent avec éloge que d'Andromachus, médecin de Néron, et de Rufus d'Ephese qui vécut sous Trajan.
Galien qui naquit à Pergame sous le règne d'Adrien environ la 131e année de l'ére chrétienne, se distingua singulièrement dans cette profession par sa pratique et par ses ouvrages.
Pour connaître l'état de la Médecine lorsque Galien parut, il faut se rappeler que les sectes dogmatiques, empiriques, méthodiques, épisynthétiques, pneumatiques et éclectiques subsistaient encore. Les méthodiques étaient en crédit, et l'emportaient sur les dogmatiques affoiblis par leur division ; les uns tenant pour Hippocrate ou Praxagore, les autres pour Erasistrate ou pour Asclépiade. Les empiriques étaient les moins considérés. Les éclectiques les plus raisonnables de tous, puisqu'ils faisaient profession d'adopter ce que chaque secte avait de bon, sans s'attacher particulièrement à aucune, n'étaient pas en grand nombre. Quant aux épisynthétiques et aux pneumatiques, c'étaient des espèces de branches du parti des méthodiques.
Galien proteste qu'il ne veut embrasser aucune secte, et traite d'esclaves tous ceux de son temps qui s'appelaient Hippocratiques, Praxagoréens, et qui ne choisissaient pas indistinctement ce qu'il y avait de bon dans les écrits de tous les Médecins. Là-dessus qui ne le croirait éclectique ? Cependant Galien était pour Hippocrate préférablement à tout autre, ou plutôt il ne suivait que lui : c'était son auteur favori ; et quoiqu'il l'accuse en plusieurs endroits d'obscurité, de manque d'ordre, et de quelques autres défauts, il marque une estime particulière pour sa doctrine, et il confesse qu'à l'exclusion de rout autre, il a posé les vrais fondements de cette science. Dans cette idée, loin de rien emprunter des autres sectes, ou de tenir entr'elles un juste milieu, il composa plusieurs livres pour combattre ce qu'on avait innové dans la Médecine, et rétablit la pratique et la théorie d'Hippocrate. Plusieurs Médecins avaient commenté cet ancien, avant que Galien parut ; mais celui-ci prétend que la plupart de ceux qui s'en étaient mêlés, s'en étaient mal acquittés. Il n'était point éloigné de se croire le seul qui l'eut jamais bien entendu. Cependant les savants ont remarqué qu'il lui donne assez souvent de fausses interprétations.
Les défauts de Galien sont trop connus de tous les habiles médecins, pour m'arrêter à les exposer ; on ne peut cependant disconvenir que son système ne soit la production d'un homme d'esprit, doué d'une imagination des plus brillantes. Il montre ordinairement beaucoup de lumières et de sagacité, quand il commente quelques points de la doctrine d'Hippocrate sur la connaissance ou la cure des maladies ; mais il fait pitié quand il nous entretient des quatre éléments, des qualités premières, des esprits, des facultés, et des causes occultes.
Pour ce qui regarde son anatomie, il a laissé sur cette matière, deux ouvrages qui l'ont immortalisé. L'un que nous n'avons pas complet, est intitulé, administration anatomique ; l'autre a pour titre de l'usage des parties du corps humain ; c'est un livre admirable, digne d'être étudié par tous les physiciens. On voit en parcourant ces deux traités, que leur auteur infatigable possédait toutes les découvertes anatomiques des siècles qui l'avaient précédé, et que trompé seulement par la ressemblance extérieure de l'homme avec le singe, il a souvent attribué à l'homme ce qui ne regardait que le singe ; c'est presque le seul reproche qu'on puisse lui faire.
Les médecins grecs qui vinrent après lui, suivirent généralement sa doctrine, et s'en tinrent au gros de la méthode de leur prédécesseur. Les plus distingués d'entr'eux sont Oribase, Aètius, Alexandre Trallian, Paul Eginete, Actuarius et Myrepsus. Nous parlerons de tous sous le mot MEDECIN, quoiqu'il n'y ait presque rien de nouveau qui leur appartienne en propre dans leurs écrits. Quelques autres encore moins estimables, quoique nommés par les historiens, n'ont été que les sectateurs aveugles de ceux-ci, et ne méritent pas même d'être placés à côté d'eux. Presque tous, au lieu de se piquer de recherche et d'industrie, ont employé leur temps à décrire et à vanter un nombre infini de compositions ridicules. La Médecine en a été surchargée ; la pratique en est devenue plus incertaine, et ses progrès en ont été retardés.
Ce qu'on vient de dire des derniers médecins grecs, n'est pas moins vrai des médecins arabes. Ceux-ci ont toutefois la réputation d'avoir introduit dans la Médecine l'usage de quelques plantes, et particulièrement de quelques purgatifs les plus doux, tels que la manne, les tamarins, la casse, les mirobolans, la rhubarbe et le séné qui est un cathartique plus fort. Ils firent encore entrer le sucre dans les compositions médicinales ; d'où il arriva, qu'elles se reproduisirent sous une infinité de formes inconnues aux anciens, et d'un très-petit avantage à leurs successeurs. C'est à eux que la Médecine doit les syrops, les juleps, les conserves et les confections. Ils ont aussi transmis à la Médecine l'usage du musc, de la muscade, du macis, des clous de gérofle, et de quelqu'autres aromates dont se sert la cuisine, et qui sont d'un usage aussi peu nécessaire à la Médecine, que celui des pierres précieuses pilées, et des feuilles d'or et d'argent. Enfin, ils ont eu connaissance de la chimie et de l'alchimie ; mais ils méritent par quelque endroit d'être lus, je veux dire pour avoir décrit avec une grande exactitude quelques maladies que les anciens n'ont pas connues ; telles que la petite-vérole, la rougeole et le spina ventosa.
Il est certain que dans la décadence des lettres en Europe, les Arabes ont cultivé toutes les sciences ; qu'ils ont traduit les principaux auteurs, et qu'il y en a quelques-uns qui étant perdus en grec, ne se retrouvent que dans les traductions arabes. Ce fut le calife Almansor qui donna le premier à ses sujets le goût des sciences ; mais Almamon cinquième calife, favorisa plus qu'aucun autre les gens de lettres, et anima dans sa nation, la vive curiosité d'apprendre les sciences, que les Grecs avaient si glorieusement cultivées.
Alors les Arabes firent un grand cas de la médecine étrangère, et écrivirent plusieurs ouvrages sur cette science. Parmi ceux qui s'y distinguèrent, on compte Joanna fils de Mésuach, qui mourut l'an de J. C. 819, Haly-Abbas, Rhasès, Ezarharagni, Etrabarani, Avicenne, Mésuach ou Mesué, Thograi, Ibnu-Thophail, Ibnu-Zohar, Ibnu-El-Baitar, Avenzoar, Averrhoès et Albucasis. Jean Léon l'africain peut fournir aux curieux l'abrégé historique de leur vie, car je ne dirai qu'un mot de chacun sous l'article MEDECINS.
Si des régions du monde que les Arabes éclairaient, nous passons à la partie occidentale de l'Asie, nous serons affligés de la barbarie qui s'y trouvait, et qui y règne sans interruption, depuis que tout ce pays est soumis à l'empire des Turcs, avec les îles de l'Archipel autrefois si florissantes.
En effet, que penser de la médecine d'un état, où l'on admet à peine le premier médecin du prince pour traiter des femmes qui sont à l'agonie ? Encore ce docteur ne peut-il les voir ni en être Ve ; il ne lui est permis de tâter le pouls qu'au travers d'une gaze ou d'un crêpe, et bien souvent il ne saurait distinguer si c'est l'artère qui bat, ou le tendon qui est en contraction : les femmes même qui prennent soin de ces malades ne sauraient lui rendre compte de ce qui est arrivé dans le cours de la maladie, car elles s'enfuient bien vite, quand il vient, et il ne reste autour du lit que les eunuques pour empêcher le médecin de regarder la malade, et pour lever seulement les coins du pavillon de son lit, autant qu'ils le jugent nécessaire pour laisser passer le bras de cette moribonde. Si le médecin demandait à voir le bout de la langue ou à tâter quelque partie, il serait poignardé sur le champ. Hippocrate avec toute sa science eut été bien embarrassé, s'il eut eu à traiter des musulmanes ; pour moi qui ai été nourri dans son école, et suivant ses maximes, écrivait M. de Tournefort, dans le dernier siècle, je ne savais quel parti prendre chez les grands Seigneurs du levant, quand j'y étais appelé, et que je traversais les appartements de leurs femmes qui sont faits comme les dortoirs de nos religieuses, je trouvais à chaque porte un bras couvert de gaze qui avançait par un trou fait exprès. Dans les premières visites, continue-t-il, je croyais que c'étaient des bras de bois ou de cuivre destinés pour éclairer la nuit ; mais je fus bien surpris quand on m'avertit qu'il fallait guérir les personnes à qui ces bras appartenaient.
Revenons donc à notre Europe, et voyons si la médecine des Arabes qui vint à s'y introduire sur la fin des siècles d'ignorance, nous a été plus avantageuse. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle a occasionné dans la suite des temps, la plus grande révolution qui soit arrivée, tant dans la théorie, que dans la pratique de cette science.
M. Boerhaave a pensé qu'après que les Arabes eurent gouté la chimie et l'alchimie, ils portèrent dans ces sciences leur façon métaphorique de s'exprimer, donnant aux moyens de perfectionner les métaux, les noms de différentes médecines : aux métaux imparfaits des noms de maladies ; et à l'or celui d'homme vigoureux et sain. Les ignorants prenant à la lettre ces expressions figurées, supposèrent que par des préparations chimiques, on pouvait changer les métaux en or, et rendre la santé au corps. Ils firent d'autant plus aisément cette supposition, qu'ils s'aperçurent que les scories des plus vils métaux étaient désignées dans les auteurs arabes par le mot de lèpre, une des plus incurables maladies. On appela du nom de pierre philosophale ou de Don-Azoth, cette préparation chimique capable de produire ces merveilleux effets ; et ceux qui en possédaient le secret furent nommés adeptes.
Vers le commencement du treizième siècle, la chimie vint à pénétrer en Europe, soit par le retour des croisés, soit par la traduction que l'empereur Fréderic II. fit faire dans ce temps-là de quelques livres arabes en latin.
Albert le grand, né dans la Souabe, et Roger Bacon né dans la province de Sommerset, en Angleterre en 1214, goutèrent cette science, tentèrent de l'introduire en Europe, et ils y réussirent ; mais ce ne fut que sur la fin du même siècle, qu'Arnauld de Villeneuve, né, dit-on, dans l'île de Maïorque en 1235, fit servir la Chimie à la Médecine. Il trouva l'esprit de vin, l'huîle de térébenthine, et quelqu'autres compositions. Il s'aperçut que son esprit-de-vin était susceptible du goût et de l'odeur des végétaux ; et de-là vinrent toutes les eaux composées dont les boutiques de nos Apothicaires sont pleines, et dont on peut dire en général, qu'elles sont plus lucratives pour les distillateurs, que salutaires aux malades.
Basîle Valentin, moine bénédictin, qui fleurissaient au commencement du quinzième siècle, établit le premier comme principe chimique des mixtes, le sel, le mercure et le soufre. Il a décrit le sel volatil huileux dont Sylvius Dele-Boè a parlé avec tant d'éloges, et dont il s'est fait honneur, ainsi que de quelqu'autres découvertes moins anciennes. Le même Basîle Valentin est le premier qui ait donné l'antimoine intérieurement, et qui ait trouvé le secret de le préparer.
Sur la fin du même siècle, parut en Europe ce fatal présent qui nait de la communication des amours de gens gâtés. Au retour de Christophe Colomb, dont les soldats et les matelots apportèrent cette maladie d'Hispaniola en 1492, elle fit en Europe des progrès si rapides, qu'elle devint en peu d'années la plus commune parmi les peuples, et la plus lucrative pour les médecins.
Cependant cette maladie si remarquable dans l'histoire de la médecine par sa naissance, l'est encore par la multitude des remèdes nouveaux ou préparés d'une façon nouvelle, dont l'art s'est enrichi à son occasion. Tels sont le gayac, dont on commença à se servir en 1517 ; la squine, qu'on ne connut en Europe qu'en 1535, et la salsepareille : mais le remède le plus important et qui changea, pour ainsi dire, la face des choses, ce fut le mercure.
Ce minéral fut connu dans toute l'Europe en 1498, et fut employé presque aussi-tôt dans la cure des maux vénériens. On l'appliqua extérieurement à l'exemple des Arabes, qui avaient prescrit l'usage du vif-argent dans les maladies cutanées, longtemps avant qu'il fût question de la maladie d'Amérique. Comme cette maladie attaquait aussi la peau cruellement, on conjectura qu'on pourrait employer contre elle le mercure avec quelques succès. Paracelse fut un des premiers qui ait eu le secret de l'administrer intérieurement, et d'opérer des cures surprenantes avec ce seul remède.
Tous les Médecins connaissent plus ou moins Paracelse, il naquit près de Zurich en 1493, et se fit pendant sa vie la plus haute réputation dans l'exercice de son art. On le comprendra d'autant plus aisément, que le langage de la médecine était encore en Europe un composé barbare, de latin, de grec et d'arabe. Galien commandait aussi despotiquement dans les écoles médicinales, qu'Aristote sur les bancs de la Philosophie. La théorie de l'art était uniquement fondée sur les qualités, leurs degrés, et les tempéraments. Toute la pratique se bornait à saigner, purger, faire vomir, et donner des clystères ; c'est tout ce qu'on sut adopter des écrits du médecin de Pergame.
Paracelse, éclairé sur les propriétés du mercure et de l'opium, guérissait avec ces deux arcanes, les maux vénériens, ceux de la peau, la lèpre, la gale, les hydropisies légères, les diarrhées invétérées, et d'autres maladies incurables pour ses contemporains qui ne connaissaient point le premier de ces remèdes, et qui regardaient l'autre comme un réfrigérant du quatrième degré.
D'ailleurs, il avait voyagé par toute l'Europe, en Russie, dans le levant, avait assisté à des sièges et à des combats, et avait suivi des armées en qualité de médecin : il professa pendant deux ans la médecine à Bâle, et composa plusieurs ouvrages qu'on vanta d'autant plus qu'ils étaient intelligibles. Il est vrai que les écrits qui portent son nom, sont en si grand nombre et d'un caractère si différent entr'eux, qu'on ne peut s'empêcher d'en attribuer la plus grande partie à ses disciples. Mais on regarde généralement comme originaux, le traité des minéraux, celui de la peste, celui de longâ vitâ et l'Archidoxa medicinae. Le dernier de ces livres contient quelques découvertes, dont les Chimistes qui lui succédèrent immédiatement se firent honneur. Le lithontriptique et l'alcahest de Van-Helmont en sont visiblement tirés. On met encore au nombre des écrits de Paracelse, les livres de arte rerum naturalium.
Je me garderai bien de faire l'analyse des ouvrages de cet homme extraordinaire. Ceux qui auront la patience de les parcourir, s'apercevront bientôt qu'il avait l'imagination déréglée, et la tête remplie d'idées chimériques. Il donna dans les réveries de l'astrologie, de la géomancie, de la chiromancie, et de la cabale, tous arts dont l'ignorance des temps où il vivait, entretenait la vogue. Il n'a rien obmis de tout ce qui pouvait le faire passer pour un magicien, un sorcier ; mais il a joué de malheur, on ne l'a pris que pour un fourbe. Il se vantait d'un remède universel, et malgré la promesse qu'il avait faite de prolonger sa vie à une durée égale à celle de Mathusalem, par le moyen de son élixir, il mourut au cabaret, dans la quarante-huitième année de son âge, au bout d'une maladie de quelques jours.
Cependant entre les absurdités dont ses ouvrages sont remplis, on trouve quelques bonnes choses, et qui ont servi aux progrès de la Médecine. On ne peut disconvenir qu'il n'ait attaqué avec succès les qualités premières, le chaud, le sec, le froid, et l'humide ; c'est lui qui a commencé à détromper les Médecins, et à leur ouvrir les yeux sur les faux d'un système qu'on suivait depuis le temps de Galien. Il osa le premier traiter la philosophie d'Aristote, de fondement de bois ; et l'on peut dire qu'en découvrant le peu de solidité de cette base, il donna lieu à ses successeurs d'en poser une plus solide.
Son opinion touchant les semences qu'il suppose avoir toutes existé dès le commencement, est adopté aujourd'hui par de très-habiles gens, qui n'ont que le mérite de l'avoir exposée d'une manière plus vraisemblable. Ce qu'il a avancé sur les principes chimiques, le sel, le souffre, et le mercure, a ses usages dans la physique et dans la Médecine. On ne peut encore disconvenir qu'il n'eut une grande connaissance de la matière médicale, et qu'il n'eut travaillé sur les végétaux et les minéraux. Il avait fait un grand nombre d'expériences ; mais il eut la vanité ridicule de cacher les découvertes auxquelles elles l'avaient conduit, et de se vanter de secrets qu'il ne posséda jamais.
La censure que le chancelier Bacon a portée de ce personnage singulier et de ses sectateurs, est très-juste. Si les Paracelsistes, dit-il, s'accordent à l'exemple de leur maître, dans les promesses qu'ils firent au monde, c'est qu'ils étaient unis ensemble par un même esprit de vertige qui les dominait. Cependant en errant en aveugle, à-travers les dédales de l'expérience, ils tombèrent quelquefois sur des découvertes utiles ; ils cherchaient en tâtonnant (car la raison n'avait aucune part dans leurs opérations), et le hasard leur mit sous la main des choses précieuses. Ils ne s'en tinrent pas là : tous couverts de la cendre et de la fumée de leurs laboratoires, ils se mirent à former des théories. Ils tentèrent d'élever sur leurs fourneaux un système de philosophie ; ils s'imaginèrent que quelques expériences de distillations leur suffisaient pour cet édifice immense ; ils crurent que des séparations et des mélanges ; la plupart du temps impossibles, étaient les seuls matériaux dont ils avaient besoin ; plus imbéciles que des enfants qui s'amusent à construire des châteaux de cartes.
Le fameux Van-Helmont parut 90 ans après Paracelse, et marcha sur ses traces, mais en homme savant, qui d'ailleurs avait employé sa vie à examiner par la chimie les fossiles et les végétaux. Ses opinions se répandirent promptement dans toute l'Europe. La Médecine ne connut d'autres remèdes que ceux que la Chimie préparait ; et les productions de cet art passèrent pour les seuls moyens qu'on put employer avec succès à conserver la vie et la santé. Ce qui acheva de mettre les préparations chimiques en réputation, furent les leçons que Sylvius de le Boè dicta peu de temps après à Leyde à un auditoire fort nombreux. Ce professeur prenant à tâche d'accréditer cet art, ne cessait de vanter ses merveilles ; son éloquence, son exemple, et son autorité, firent toute l'impression qu'il en pouvait attendre. Otho Tachénius, partisan enthousiaste du mérite de la Chimie, défendit sa gloire par trois traités aussi travaillés que profonds, et la Chimie n'eut plus d'adversaires.
Tout le monde se tint pour convaincu que la nature opère en chimiste ; que la vie de l'homme est son ouvrage ; que les parties du corps sont ses instruments ; en un mot qu'elle produit par des voies purement chimiques tout ce que la variété infinie des mouvements fait éclore dans le corps humain. Les écoles des universités ne retentissaient que de ces propositions, et les écrits des Médecins en étaient remplis.
C'est, disaient-ils, par leur acidité que de certaines liqueurs corrodent les métaux ; c'est donc un acide qui dissout les aliments dans l'estomac. Les acides sont extraits par le feu, et si on les mêle avec les huiles des aromates qui sont extrêmement âcres, il se fait une violente effervescence ; l'acidité du chyle produira donc la chaleur naturelle, en se mêlant avec le baume du sang ; s'il arrive que le chyle et le sang soient l'un et l'autre fort âcres, alors il y aura fièvre ardente.
On sait que le nitre, le sel marin, et particulièrement le sel ammoniac, refroidissent l'eau ; c'est donc ajoutait-on, à ces matières qu'il faut attribuer le frisson de la fièvre. Les exhalaisons du vin en ébullition, en se portant dans un vaisseau placé au-dessus d'elles, nous offrent, continuaient-ils, une image de la génération des esprits dans notre corps. Les acides mêlés avec les alkalis, produisent une fermentation d'une violence capable de briser les vaisseaux qui les contiennent ; c'est ainsi que le chyle occasionne par son mélange avec le sang des effervescences dans les ventricules du cœur, et produit toutes les maladies aiguës et chroniques. Ce système extravagant qui devint le fondement de plusieurs pratiques fatales au genre humain, regnait encore dans les écoles françaises il n'y a pas longtemps ; on craignait pour sa vie le duel des acides et des alkalis dans le corps, autant qu'un combat sur mer contre les Anglais.
Comme un beau soleil dissipe les brouillards qui sont tombés sur l'horizon, de même au commencement du XVIIIe siècle Guillaume Harvey dissipa tous les vains fantômes de la Médecine, par sa découverte immortelle de la circulation du sang. Elle a seule répandu la lumière sur la vie, la santé, le plus grand nombre de maladies, et a jeté dans le monde les vrais fondements de l'art de guérir.
Depuis que les Médecins ont connu cette circulation, ainsi que la route du chyle, ils sont mieux en état d'expliquer la transformation des aliments en sang, et l'origine des maladies. La démonstration des vaisseaux lymphatiques, des veines lactées, du canal thorachique, répand du jour sur les maladies qui naissent du vice des glandes, de la lymphe, ou d'une mauvaise nutrition. Les découvertes de Malpighi sur les poumons, et celles de Bellini sur les reins, peuvent servir à mieux entendre l'origine et les causes des maladies dont ces parties sont attaquées ; telles que la phtisie, l'hydropisie, et les douleurs néphrétiques. Le travail de Glisson, de Bianchi, et de Morgagni, sur la structure du foie, conduit au traitement éclairé des maladies de cet organe.
Les recherches aussi belles que curieuses de Sanctorius sur la Médecine statique, ont dévoilé les mystères de la transpiration insensible, ses avantages, et les maladies de sa diminution, de sa suppression, dont on n'avait auparavant aucune connaissance.
Depuis que les Médecins sont instruits de la manière dont le sang circule dans les canaux tortueux de l'utérus, les maladies de cette partie, de même que celles qui proviennent de l'irrégularité des règles, sont plus faciles à comprendre et à traiter. La connaissance de la distribution des nerfs et de leur communication, a jeté de la lumière sur l'intelligence des affections spasmodiques, hypocondriaques et hystériques, dont les symptômes terribles effraient un peu moins.
Depuis que Swammerdam et de Graaf, après eux Cowper, Morgagny, Sanctorini, et une infinité d'autres habiles gens ont examiné la structure des parties de la génération de l'un et de l'autre sexe, les maladies qui y surviennent ont été, pour ainsi dire, soumises aux jugements de nos sens, et leurs causes rendues assez palpables.
Enfin, personne n'ignore les avantages que retire la Physiologie des travaux de plusieurs autres modernes, comme, par exemple, des traités de Lower, de Lancisi, et de Sénac sur le cœur ; des descriptions de Duverney et de Valsalva sur l'organe de l'ouie ; des belles observations d'Havers sur les os, et surtout des ouvrages admirables de Ruysch.
Mais c'est à Boerhaave qu'est dû. la gloire d'avoir posé, au commencement de ce siècle, les vrais et durables fondements de l'art de guérir. Ce génie profond et sublime, nourri de la doctrine des anciens, éclairé par ses veilles des découvertes de tous les âges, également versé dans la connaissance de la Mécanique, de l'Anatomie, de la Chimie et de la Botanique, a porté, par ses ouvrages dans la Médecine, des lumières qui en fixent les principes, et qui lui donnent un éclat que l'espace de trois mille ans n'avait pu lui procurer.
Cependant les nations savantes de l'Europe ne pratiquent pas toutes cette Médecine avec la même gloire. Déja l'Italie, qui la première a retiré cette science des ténèbres, et qui l'a illustrée par le plus grand nombre d'excellents ouvrages, semble se reposer sur les lauriers qu'elle a moissonnés. Les Hollandais sont encore plus intéressés par la nature de leur climat à cultiver noblement une science qu'ils tiennent de leur illustre compatriote, mais la facilité que tout le monde a dans les sept Provinces-Unies d'exercer la profession de Médecine, l'avilissement où elle est à divers égards, les faibles émoluments qu'en retirent ceux qui la pratiquent avec honneur, donnent lieu de craindre que sa beauté n'y soit ternie du matin au soir, comme une fleur de leurs jardins que flétrit le premier brouillard.
On aime beaucoup la Médecine en Allemagne, mais on aime encore davantage les remèdes chimiques et pharmaceutiques qu'elle dédaigne : on travaille, on imprime sans cesse dans les académies germaniques des écrits sur la Médecine ; mais ils manquent de gout, et sont chargés d'un fatras d'érudition inutîle et hors d'œuvre.
La France est éclairée des lumières de l'Anatomie et de la Chirurgie, deux branches essentielles de l'art qui y sont poussées fort loin : ce pays devrait encore être animé à la culture de la Médecine par l'exemple des Jacotius, des Durets, des Holliers, des Baillous, des Fernels, des Quesnays ; car il est quelquefois permis de citer les vivants. Cependant peu de médecins de ce grand royaume marchent sur les traces de ces hommes célèbres qui les ont précédés. Je crois entrevoir que la fausse méthode des académies, des écoles medicinales, l'exemple, la facilité d'une routine qui se borne à trois remèdes ; la mode, le goût des plaisirs, le manque de confiance de la part des malades ; l'envie qu'ils ont de guérir promptement ; les manières et le beau langage qu'on préfère à l'étude et au savoir ; la vanité, le luxe d'imitation, le désir de faire une fortune rapide.... je ne veux point développer toutes les causes morales et physiques de cette triste décadence.
C'est donc en Angleterre ou, pour mieux parler, dans les trois royaumes de la Grande-Bretagne, que la Médecine fleurit avec le plus de gloire : elle y est perfectionnée par la connaissance des autres sciences qui y concourent ; par la nature du gouvernement, par le goût de la nation ; par son génie naturel et studieux ; par les voyages, par l'honneur qu'on attache à cette profession ; par les émoluments qui l'accompagnent ; par l'aisance de ceux qui s'y destinent ; enfin, par la vraie théorie de Boerhaave, qui a formé tous les médecins des îles Britanniques. Puissent-ils ne point changer cette théorie en empirisme, ne point s'écarter de la pratique de leur maître, et de la conduite du vertueux Sydenham leur compatriote !
O mes fils, gardez-vous de suivre d'autres lois !
Je serais fort aise si je pouvais inspirer quelque passion pour l'honnête profession d'une science utîle et nécessaire : les sages ont dit que tel était l'éclat de la vérité, que les hommes en étaient éblouis lorsqu'elle se montrait à eux toute nue ; mais ce n'est point la Médecine qui se présente ainsi. On cherchera vainement les moyens de la perfectionner, tant que sa véritable théorie ne sera pas cultivée, et tant que ceux qui en exerceront la pratique la corrompront par leur ignorance ou leur avarice.
L'étendue de cette théorie, dit très-bien M. Quesnay, dont je vais emprunter les réflexions, demande de la part des Médecins une étude continuelle et des recherches pénibles ; mais ces travaux sont si longs et si difficiles, que la plupart les négligent, et qu'ils tâchent d'y suppléer par des conjectures qui rendent souvent l'art de guérir plus nuisible aux hommes qu'il ne leur est utile.
Les Médecins peu intelligens ou peu instruits, ne distinguent pas assez les effets des remèdes d'avec ceux de la nature ; et les événements qu'ils interpretent diversement, règlent ou favorisent les différentes méthodes qui se sont introduites dans la Médecine. Il y a des praticiens qui, trop frappés des bons ou des mauvais succès, et trop dominés par leurs propres observations, restent assujettis à l'empirisme, et ne suivent de méthode que celle qu'il leur suggère. Il y en a d'autres, encore plus nombreux, qui moins attentifs ou même moins sensibles au sort des malades, s'abandonnent aveuglément aux pratiques les plus communes et les plus adoptées par leurs confrères et par le public.
Toutes les nations ont de ces pratiques vulgaires autorisées par des succès apparents, et plus encore par des préjugés qui les perpétuent et qui en voilent les imperfections. On craint en Allemagne de verser le sang, on le prodigue en France : on pensait différemment autrefois : toutes les nations de l'Europe suivaient unanimement la pratique d'Hippocrate ; mais le public séduit par la réputation de quelques médecins entreprenans qui introduisent de nouvelles méthodes, s'y prête, s'y accoutume, et même y applaudit. Une telle prévention subjugue les praticiens peu éclairés, peu courageux, ou peut-être trop mercénaires, et les assujettit à des pratiques qui ne sont autorisées que par l'usage et par la réputation des médecins qui les suivent, et dont l'expérience parait les confirmer.
On ne saurait comprendre combien ces préjugés ont retardé les progrès de la Médecine ; ils sont si dominans en tout pays, qu'on entreprendrait en vain de les dissiper. On ne doit donc pas se proposer de réformer les opinions populaires qui décident de la pratique de la Médecine et du mérite des Médecins. Ainsi je n'aurai en vue que quelques hommes de probité qui veulent exercer dignement leur profession, sans se laisser entraîner par l'exemple, la renommée et l'amour des richesses.
L'exercice le plus multiplié ne nous assure ni du mérite ni de la capacité des Médecins. La variété et l'inconstance de leur pratique est au contraire une preuve décisive de l'insuffisance de cet exercice pour leur procurer des connaissances. En effet, le long exercice d'un praticien qui ne peut acquérir par l'étude les lumières nécessaires pour l'éclairer dans la pratique, qui se règle par les événements, ou se fixe à la méthode la plus accréditée dans le public ; qui toujours distrait par la multitude des malades, par la diversité des maladies, par les importunités des assistants, par les soins qu'il donne à sa réputation, ne peut qu'entrevoir confusément les malades et les maladies. Un médecin privé de connaissances, toujours dissipé par tant d'objets différents, a-t-il le temps, la tranquillité, les lumières pour observer et pour découvrir la liaison qu'il y a entre les effets des maladies et leurs causes ?
Fixé à une pratique habituelle, il l'exerce avec une facilité que les malades attribuent à son expérience : il les entretient dans cette opinion favorable par des raisonnements conformes à leurs préjugés, et par le récit de ses succès ; il parvient même à les persuader que la capacité d'un praticien dépend d'un long exercice, et que le savoir ne peut former qu'un médecin spéculatif ou, pour parler leur langage, un médecin de cabinet.
Il y a des auteurs instruits dans la théorie, et qui, étant attentifs à des observations répétées où ils ont remarqué constamment les mêmes faits dans quelque point de pratique, sont parvenus à former des dogmes particuliers qu'on trouve dispersés dans leurs ouvrages : tels sont les Hilden, les Mercatus, les Rivière, etc. mais ces dogmes sont ordinairement peu exacts et peu lumineux.
D'autres ont porté plus loin leurs travaux ; ils ont rassemblé les connaissances que leur érudition, leur propre expérience et la physique de leur temps ont pu leur fournir, pour enrichir les différentes matières qu'ils ont traitées : tels sont plus ou moins les Celse, les Aeginetes, les Avicennes, les Albucasis, les Chauliac, les Paré, les Aquapendente, les Duret, les Houllier, les Sennert, etc. Mais dans les temps que ces grands maîtres s'appliquaient à étendre la théorie par les connaissances qui naissent de la pratique, les autres sciences qui doivent éclairer ces connaissances faisaient peu de progrès. Ainsi les productions de ces médecins devaient être fort imparfaites.
Quelques auteurs se sont attachés à étendre et à perfectionner la théorie de certaines maladies : tels ont été les Baillou, les Pison, les Engalenus, les Bennet, les Magatus, les Severinus, les Wepfer, etc. qui, par leurs recherches et par leurs travaux, ont enrichi de nouvelles connaissances la théorie des maladies qu'ils ont traitées. Il semble même qu'en n'embrassant ainsi que des parties de la théorie, on pourrait davantage en hâter les progrès ; mais toutes les maladies ont entr'elles tant de liaison, que l'accroissement des connaissances sur une maladie dépend souvent entièrement du concours de celles que l'on acquiert de nouveau sur les autres maladies, et cet accroissement dépend aussi du progrès des sciences qui peuvent éclairer cette théorie.
Enfin, il y a une autre classe de grands maîtres, qui est d'un ordre supérieur à celles dont nous venons de parler, et qui se réduit à un très-petit nombre d'hommes. Elle comprend les vrais instituteurs de la théorie de la Médecine qui cultivent en même temps les différentes sciences nécessaires pour former cette théorie, et qui rassemblent et concilient de nouveau les connaissances qu'elles peuvent leur fournir pour former les principes d'une doctrine plus étendue, plus exacte et plus lumineuse ; ce sont des architectes qui commencèrent l'édifice dès les fondements ; qui ne se servent des productions des autres que comme des matériaux déjà préparés ; qui ne s'en rapportent pas simplement au jugement de ceux qui les ont fournis ; qui en examinent eux-mêmes toute la solidité, toute la valeur et toutes les propriétés ; qui en rassemblent beaucoup d'autres qu'on n'a pas encore employé, et qui par des recherches générales et une grande pénétration, en découvrent eux-mêmes un grand nombre, dont l'utilité règle et détermine l'usage des autres. C'est par de tels travaux qu'Hippocrate, Arétée, Galien et Boerhaave ont formé la théorie de la Médecine, ou l'ont fait reparaitre dans un plus grand jour, et l'ont élevée successivement à de plus hauts degrés de perfection.
C'est par ces productions plus ou moins étendues de tant d'auteurs qui ont concouru aux progrès de la théorie de la Médecine, que nous reconnaissons tous les avantages de l'expérience : nous y voyons par-tout que ses progrès dépendent de l'accroissement des connaissances qu'on peut puiser dans la pratique de cet art ; que ces connaissances doivent être éclairées par la physique du corps humain ; que cette physique tire elle-même des lumières d'autres sciences qui naissent aussi de l'expérience ; et qu'ainsi l'avancement de la théorie qui peut guider dans la pratique, dépend de l'accroissement de tous ces différents genres de connaissances, et des travaux des maîtres qui cultivent la Médecine avec gloire.
Mais les praticiens de routine, assujettis sans discernement aux méthodes vulgaires, loin de contribuer à l'avancement de la Médecine, ne font qu'en retarder les progrès ; car le public les présente ordinairement aux autres médecins comme des modèles qu'ils doivent imiter dans la pratique ; et ce suffrage aveugle et dangereux vient à bout de séduire des hommes sages. Extr. de la préf. du Dict. de Méd. traduite par M. Diderot, de l'angl. du D. James. (D.J.)
MEDECINE, parties de la, (Science) La Médecine, comme je l'ai déjà dit, est l'art de conserver la santé présente et de rétablir celle qui est altérée ; c'est la définition de Galien.
Les modernes divisent généralement la Médecine en cinq parties : 1°. la Physiologie, qui traite de la constitution du corps humain, regardé comme sain et bien disposé. Voyez PHYSIOLOGIE.
2°. La Pathologie, qui traite de la constitution de nos corps considérés dans l'état de maladie. Voyez PATHOLOGIE.
3°. La Sémiotique, qui rassemble les signes de la santé ou de la maladie. Voyez SEMIOTIQUE.
4°. L'Hygiene, qui donne des règles du régime qu'on doit garder pour conserver sa santé. Voyez HYGIENE.
5°. La Thérapeutique, qui enseigne la conduite et l'usage de la diete ainsi que des remèdes, et qui comprend en même-temps la Chirurgie. Voyez THERAPEUTIQUE.
Cette distribution est aussi commode pour apprendre que pour enseigner ; elle est conforme à la nature des choses qui forment la science médicinale, et d'ailleurs est usitée depuis longtemps par tous les maîtres de l'art. M. Boerhaave l'a suivie dans des institutions de Médecine, qui comprennent toute la doctrine générale de cette science.
Il expose d'abord dans cet ouvrage admirable, 1°. les parties, ou la structure du corps humain ; 2°. en quoi consiste la vie ; 3°. ce que c'est que la santé ; 4°. les effets qui en résultent. Cette première partie s'appelle Physiologie ; et les objets de cette partie qu'on vient de détailler, se nomment communément choses naturelles, ou conformes aux lois de la nature.
Dans la seconde partie de son ouvrage, il fait mention 1°. des maladies du corps humain vivant ; 2°. de la différence des maladies ; 3°. de leurs causes ; 4°. de leurs effets. On nomme cette partie Pathologie, en tant qu'elle contient la description des maladies ; Aethiologie pathologique, lorsqu'elle traite de leurs causes ; Nosologie, quand elle explique leurs différences ; enfin, Symptomatologie, toutes les fois qu'elle expose les symptômes, les effets, ou les accidents des maladies. Cette partie a pour objet les choses contraires aux lois de la nature.
Il examine dans la troisième partie, 1°. quels sont les signes des maladies ; 2°. quel usage on en doit faire ; 3°. comment on peut connaître par des signes dans un corps sain et dans un corps malade, les divers degrés de la santé ou de la maladie. On appelle cette partie Sémiotique. Elle a pour objets les choses naturelles, non-naturelles, et contre-nature.
Il indique dans la quatrième partie, 1°. les remèdes ; 2°. leur usage. Comme c'est par ces remèdes qu'on peut conserver la vie et la santé, on donne pour cette raison à cette quatrième partie de la Médecine, le nom d'Hygiene. Elle a pour objet principalement les choses qu'on appelle non-naturelles.
M. Boerhaave donne dans la cinquième partie, 1°. la matière médicale ; 2°. la préparation des remèdes ; 3°. la manière de s'en servir pour rétablir la santé et guérir les maladies. Cette cinquième partie de la Médecine, se nomme Thérapeutique, et elle comprend la diete, la Pharmacie, la Chirurgie, et la méthode curative.
Enfin l'auteur développe dans des aphorismes particuliers les causes et la cure des maladies ; mes deux ouvrages renferment toute la science d'Esculape en deux petits volumes in -12, scientiâ graves, qui joints aux beaux commentaires de MM. Haller et Van-Swieten, forment une bibliothèque médicale presque complete :
Apolline nati,
Nocturnâ versate manu, versate diurnâ.
Tum diros aegro pelletis è corpore morbos. (D.J.)