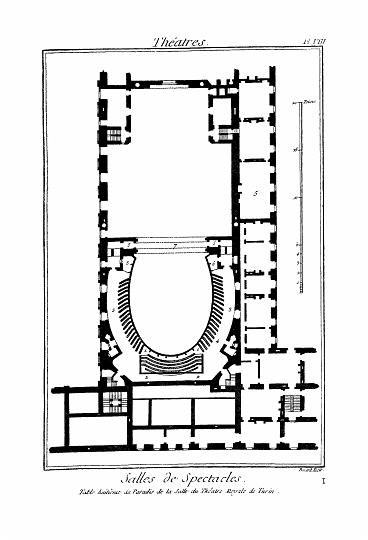S. f. (Belles Lettres) Ce mot qui vient du latin eloqui, parler, signifie proprement et à la rigueur le caractère du discours ; et en ce sens il ne s'emploie guère qu'en parlant de la conversation, les mots style et diction étant consacrés aux ouvrages ou aux discours oratoires. On dit d'un homme qui parle bien, qu'il a une belle élocution ; et d'un écrivain ou d'un orateur, que sa diction est correcte, que son style est élégant, etc. Voyez ECRIRE, STYLE. Voyez aussi AFFECTATION et CONVERSATION.
ELOCUTION, dans un sens moins vulgaire, signifie cette partie de la Rhétorique qui traite de la diction et du style de l'orateur ; les deux autres sont l'invention et la disposition. Voyez ces deux mots. Voyez aussi ORATEUR, DISCOURS.
J'ai dit que l'élocution avait pour objet la diction et le style de l'orateur ; car il ne faut pas croire que ces deux mots soient synonymes : le dernier a une acception beaucoup plus étendue que le premier. Diction ne se dit proprement que des qualités générales et grammaticales du discours, et ces qualités sont au nombre de deux, la correction et la clarté. Elles sont indispensables dans quelqu'ouvrage que ce puisse être, soit d'éloquence, soit de tout autre genre ; l'étude de la langue et l'habitude d'écrire les donnent presqu'infailliblement, quand on cherche de bonne foi à les acquérir. Style au contraire se dit des qualités du discours, plus particulières, plus difficiles et plus rares, qui marquent le génie et le talent de celui qui écrit ou qui parle : telles sont la propriété des termes, l'élégance, la facilité, la précision, l'élévation, la noblesse, l'harmonie, la convenance avec le sujet, etc. Nous n'ignorons pas néanmoins que les mots style et diction se prennent souvent l'un pour l'autre, surtout par les auteurs qui ne s'expriment pas sur ce sujet avec une exactitude rigoureuse ; mais la distinction que nous venons d'établir, ne nous parait pas moins réelle. On parlera plus au long au mot STYLE, des différentes qualités que le style doit avoir en général, et pour toutes sortes de sujets : nous nous bornerons ici à ce qui regarde l'orateur. Pour fixer nos idées sur cet objet, il faut auparavant établir quelques principes.
Qu'est-ce qu'être éloquent ? Si on se borne à la force du terme, ce n'est autre chose que bien parler ; mais l'usage a donné à ce mot dans nos idées un sens plus noble et plus étendu. être éloquent, comme je l'ai dit ailleurs, c'est faire passer avec rapidité et imprimer avec force dans l'âme des autres, le sentiment profond dont on est pénétré. Cette définition parait d'autant plus juste, qu'elle s'applique à l'éloquence même du silence et à celle du geste. On pourrait définir autrement l'éloquence, le talent d'émouvoir ; mais la première définition est encore plus générale, en ce qu'elle s'applique même à l'éloquence tranquille qui n'émeut pas, et qui se borne à convaincre. La persuasion intime de la vérité qu'on veut prouver est alors le sentiment profond dont on est rempli, et qu'on fait passer dans l'âme de l'auditeur. Il faut cependant avouer, selon l'idée la plus généralement reçue, que celui qui se borne à prouver et qui laisse l'auditeur convaincu, mais froid et tranquille, n'est point proprement éloquent, et n'est que disert. Voyez DISERT. C'est pour cette raison que les anciens ont défini l'éloquence le talent de persuader, et qu'ils ont distingué persuader de convaincre, le premier de ces mots ajoutant à l'autre l'idée d'un sentiment actif excité dans l'âme de l'auditeur, et joint à la conviction.
Cependant, qu'il me soit permis de le dire, il s'en faut beaucoup que la définition de l'éloquence, donnée par les anciens, soit complete : l'éloquence ne se borne pas à la persuasion. Il y a dans toutes les langues une infinité de morceaux très-éloquents, qui ne prouvent et par conséquent ne persuadent rien, mais qui sont éloquents par cela seul qu'ils émeuvent puissamment celui qui les entend ou qui les lit. Il serait inutîle d'en rapporter des exemples.
Les modernes, en adoptant aveuglément la définition des anciens, ont eu bien moins de raison qu'eux. Les Grecs et les Romains, qui vivaient sous un gouvernement républicain, étaient continuellement occupés de grands intérêts publics : les orateurs appliquaient principalement à ces objets importants le talent de la parole ; et comme il s'agissait toujours en ces occasions de remuer le peuple en le convainquant, ils appelèrent éloquence le talent de persuader, en prenant pour le tout la partie la plus importante et la plus étendue. Cependant ils pouvaient se convaincre dans les ouvrages mêmes de leurs philosophes, par exemple, dans ceux de Platon et dans plusieurs autres, que l'éloquence était applicable à des matières purement spéculatives. L'éloquence des modernes est encore plus souvent appliquée à ces sortes de matières, parce que la plupart n'ont pas, comme les anciens, de grands intérêts publics à traiter : ils ont donc eu encore plus de tort que les anciens, lorsqu'ils ont borné l'éloquence à la persuasion.
J'ai appelé l'éloquence un talent, et non pas un art, comme ont fait tant de rhéteurs ; car l'art s'acquiert par l'étude et l'exercice, et l'éloquence est un don de la nature. Les règles ne rendront jamais un ouvrage ou un discours éloquent ; elles servent seulement à empêcher que les endroits vraiment éloquents et dictés par la nature, ne soient défigurés et déparés par d'autres, fruits de la négligence ou du mauvais gout. Shakespear a fait sans le secours des règles, le monologue admirable d'Hamlet ; avec le secours des règles il eut évité la scène barbare et dégoutante des Fossoyeurs.
Ce que l'on conçoit bien, a dit Despréaux, s'énonce clairement : j'ajoute, ce que l'on sent avec chaleur, s'énonce de même, et les mots arrivent aussi aisément pour rendre une émotion vive, qu'une idée claire. Le soin froid et étudié que l'orateur se donnerait pour exprimer une pareille émotion, ne servirait qu'à l'affoiblir en lui, à l'éteindre même, ou peut-être à prouver qu'il ne la ressentait pas. En un mot, sentez vivement, et dites tout ce que vous voudrez, voilà toutes les règles de l'éloquence proprement dite. Qu'on interroge les écrivains de génie sur les plus beaux endroits de leurs ouvrages, ils avoueront que ces endroits sont presque toujours ceux qui leur ont le moins couté, parce qu'ils ont été comme inspirés en les produisant. Prétendre que des préceptes froids et didactiques donneront le moyen d'être éloquent, c'est seulement prouver qu'on est incapable de l'être.
Mais comme pour être clair il ne faut pas concevoir à demi, il ne faut pas non plus sentir à demi pour être éloquent. Le sentiment dont l'orateur doit être rempli, est, comme je l'ai dit, un sentiment profond, fruit d'une sensibilité rare et exquise, et non cette émotion superficielle et passagère qu'il excite dans la plupart de ses auditeurs ; émotion qui est plus extérieure qu'interne, qui a pour objet l'orateur même, plutôt que ce qu'il dit, et qui dans la multitude n'est souvent qu'une impression machinale et animale, produite par l'exemple ou par le ton qu'on lui a donné. L'émotion communiquée par l'orateur, bien loin d'être dans l'auditeur une marque certaine de son impuissance à produire des choses semblables à ce qu'il admire, est au contraire d'autant plus réelle et d'autant plus vive, que l'auditeur a plus de génie et de talent : pénétré au même degré que l'orateur, il aurait dit les mêmes choses : tant il est vrai que c'est dans le degré seul du sentiment que l'éloquence consiste. Je renvoye ceux qui en douteront encore, au paysan du Danube, s'ils sont capables de penser et de sentir ; car je ne parle point aux autres.
Tout cela prouve suffisamment, ce me semble, qu'un orateur vivement et profondément pénétré de son objet, n'a pas besoin d'art pour en pénétrer les autres. J'ajoute qu'il ne peut les en pénétrer, sans en être vivement pénétré lui-même. En vain objecterait-on que plusieurs écrivains ont eu l'art d'inspirer par leurs ouvrages l'amour des vertus qu'ils n'avaient pas : je réponds que le sentiment qui fait aimer la vertu, les remplissait au moment qu'ils en écrivaient ; c'était en eux dans ce moment un sentiment très-pénétrant et très-vif, mais malheureusement passager. En vain objecterait-on encore qu'on peut toucher sans être touché, comme on peut convaincre sans être convaincu. Premièrement, on ne peut réellement convaincre sans être convaincu soi-même : car la conviction réelle est la suite de l'évidence ; et on ne peut donner l'évidence aux autres, quand on ne l'a pas. En second lieu, on peut sans-doute faire croire aux autres qu'ils voient clairement ce qu'ils ne voient point, c'est une espèce de fantôme qu'on leur présente à la place de la réalité ; mais on ne peut les tromper sur leurs affections et sur leurs sentiments, on ne peut leur persuader qu'ils sont vivement pénétrés, s'ils ne le sont pas en effet : un auditeur qui se croit touché, l'est donc véritablement : or on ne donne point ce qu'on n'a point ; on ne peut donc vivement toucher les autres sans être touché vivement soi-même, soit par le sentiment, soit au moins par l'imagination, qui produit en ce moment le même effet.
Nul discours ne sera éloquent s'il n'élève l'âme : l'éloquence pathétique a sans-doute pour objet de toucher ; mais j'en appelle aux âmes sensibles, les mouvements pathétiques sont toujours en elles accompagnés d'élévation. On peut donc dire qu'éloquent et sublime sont proprement la même chose ; mais on a réservé le mot de sublime pour désigner particulièrement l'éloquence qui présente à l'auditeur de grands objets ; et cet usage grammatical, dont quelques littérateurs pédants et bornés peuvent être la dupe, ne changent rien à la vérité.
Il résulte de ces principes que l'on peut être éloquent dans quelque langue que ce sait, parce qu'il n'y a point de langue qui se refuse à l'expression vive d'un sentiment élevé et profond. Je ne sai par quelle raison un grand nombre d'écrivains modernes nous parlent de l'éloquence des choses, comme s'il y avait une éloquence des mots. L'éloquence n'est jamais que dans le sujet ; et le caractère du sujet, ou plutôt du sentiment qu'il produit, passe de lui-même et nécessairement au discours. J'ajoute que plus le discours sera simple dans un grand sujet, plus il sera éloquent, parce qu'il représentera le sentiment avec plus de vérité. L'éloquence ne consiste donc point, comme tant d'auteurs l'ont dit d'après les anciens, à dire les choses grandes d'un style sublime, mais d'un style simple ; car il n'y a point proprement de style sublime, c'est la chose qui doit l'être ; et comment le style pourrait-il être sublime sans elle, ou plus qu'elle.
Aussi les morceaux vraiment sublimes sont toujours ceux qui se traduisent le plus aisément. Que vous reste-t-il ? moi.... Comment voulez-vous que je vous traite ? en roi.... Qu'il mourut.... Dieu dit : que la lumière se fasse, et elle se fit.... et tant d'autres morceaux sans nombre, seront toujours sublimes dans toutes les langues. L'expression pourra être plus ou moins vive, plus ou moins précise, selon le génie de la langue ; mais la grandeur de l'idée subsistera toute entière. En un mot on peut être éloquent en quelque langue et en quelque style que ce sait, parce que l'élocution n'est que l'écorce de l'éloquence, avec laquelle il ne faut pas la confondre.
Mais, dira-t-on, si l'éloquence véritable et proprement dite a si peu besoin des règles de l'élocution, si elle ne doit avoir d'autre expression que celle qui est dictée par la nature, pourquoi donc les anciens dans leurs écrits sur l'éloquence ont-ils traité si à fond de l'élocution ? Cette question mérite d'être approfondie.
L'éloquence ne consiste proprement que dans des traits vifs et rapides ; son effet est d'émouvoir vivement, et toute émotion s'affoiblit par la durée. L'éloquence ne peut donc régner que par intervalles dans un discours de quelque étendue, l'éclair part et la nue se referme. Mais si les ombres du tableau sont nécessaires, elle ne doivent pas être trop fortes ; il faut sans-doute et à l'orateur et à l'auditeur des endroits de repos, dans ces endroits l'auditeur doit respirer, non s'endormir, et c'est aux charmes tranquilles de l'élocution à le tenir dans cette situation douce et agréable. Ainsi (ce qui semblera paradoxe, sans en être moins vrai) les règles de l'élocution n'ont lieu à proprement parler, et ne sont vraiment nécessaires que pour les morceaux qui ne sont pas proprement éloquents, que l'orateur compose plus à froid, et où la nature a besoin de l'art. L'homme de génie ne doit craindre de tomber dans un style lâche, bas et rampant, que lorsqu'il n'est point soutenu par le sujet, c'est alors qu'il doit songer à l'élocution, et s'en occuper. Dans les autres cas, son élocution sera telle qu'elle doit être sans qu'il y pense. Les anciens, si je ne me trompe, ont senti cette vérité, et c'est pour cette raison qu'ils ont traité principalement de l'élocution dans leurs ouvrages sur l'art oratoire. D'ailleurs des trois parties de l'orateur, elle est presque la seule dont on puisse donner des préceptes directs, détaillés et positifs : l'invention n'a point de règles, ou n'en a que de vagues et d'insuffisantes ; la disposition en a peu, et appartient plutôt à la logique qu'à la rhétorique. Un autre motif a porté les anciens rhéteurs à s'étendre beaucoup sur les règles de l'élocution : leur langue était une espèce de musique, susceptible d'une mélodie à laquelle le peuple même était très-sensible. Des préceptes sur ce sujet, étaient aussi nécessaires dans les traités des anciens sur l'éloquence, que le sont parmi nous les règles de la composition musicale dans un traité complet de musique. Il est vrai que ces sortes de règles ne donnent ni à l'orateur ni au musicien du talent et de l'oreille, mais elles sont propres à l'aider. Ouvrez le traité de Cicéron intitulé Orator, et dans lequel il s'est proposé de former ou plutôt de peindre un orateur parfait, vous verrez non-seulement que la partie de l'élocution est celle à laquelle il s'attache principalement, mais que de toutes les qualités de l'élocution, l'harmonie qui résulte du choix et de l'arrangement des mots, est celle dont il est le plus occupé. Il parait même avoir regardé cet objet comme très-essentiel dans des morceaux très-frappans par le fond des choses, et où la beauté de la pensée semblait dispenser du soin d'arranger les mots. Je n'en citerai que cet exemple : " J'étais présent, dit Cicéron, lorsque C. Carbon s'écria dans une harangue au peuple : O Marce Druse, patrem appelo ; tu dicère solebas, sacram esse rempublicam ; quicumque eam violavissent, ab omnibus esse ei poenas persolutas ; patris dictum sapiens, temeritas filii comprobavit ; ce dichorée comprobavit, ajoute Cicéron, excita par son harmonie un cri d'admiration dans toute l'assemblée. " Le morceau que nous venons de citer renferme une idée si noble et si belle, qu'il est assurement très-éloquent par lui-même, et je ne crains point de le traduire pour le prouver. O Marcus Drusus (c'est au père que je m'adresse), tu avais coutume de dire que la patrie était un dépôt sacré ; que tout citoyen qui l'avait violé en avait porté la peine ; la témérité du fils a prouvé la sagesse des discours du père. Cependant Cicéron parait ici encore plus occupé des mots que des choses. " Si l'orateur, dit-il, eut fini sa période ainsi ; comprobavit filii temeritas ; IL N'Y AUROIT PLUS RIEN ; JAM NIHIL ERIT " Voilà pour le dire en passant, de quoi ne se seraient pas doutés nos prétendus latinistes modernes, qui prononcent le latin aussi mal qu'ils le parlent. Mais cette preuve suffit pour faire voir combien les oreilles des anciens étaient délicates sur l'harmonie. La sensibilité que Cicéron témoigne ici sur la diction dans un morceau éloquent, ne contredit nullement ce que nous avons avancé plus haut, que l'éloquence du discours est le fruit de la nature et non pas de l'art. Il s'agit ici non de l'expression en elle-même, mais de l'harmonie des mots, qui est une chose purement artificielle et mécanique ; cela est si vrai que Cicéron en renversant la phrase pour en dénaturer l'harmonie, en conserve tous les termes. L'expression du sentiment est dictée par la nature et par le génie ; c'est ensuite à l'oreille et à l'art à disposer les mots de la manière la plus harmonieuse. Il en est de l'orateur comme du musicien, à qui le genie seul inspire le chant, et que l'oreille et l'art guident dans l'enchainement des modulations.
Cette comparaison tirée de la Musique, conduit à une autre idée qui ne parait pas moins juste. La Musique a besoin d'exécution, elle est muette et nulle sur le papier ; de même l'éloquence sur le papier est presque toujours froide et sans vie, elle a besoin de l'action et du geste ; ces deux qualités lui sont encore plus nécessaires que l'élocution ; et ce n'est pas sans raison que Démosthène reduisait à l'action toutes les parties de l'orateur. Nous ne pouvons lire sans être attendris les peroraisons touchantes de Ciceron, pro Fonteio, pro Sextio, pro Plancio, pro Flacco, pro Sylla ; qu'on imagine la force qu'elles devaient avoir dans la bouche de ce grand homme : qu'on se représente Cicéron au milieu du barreau, animant par ses pleurs et par une voix touchante le discours le plus pathétique, tenant le fils de Flaccus entre ses bras, le présentant aux juges, et implorant pour lui l'humanité et les lois ; on ne sera point surpris de ce qu'il nous rapporte lui-même, qu'il remplit en cette occasion le barreau de pleurs, de gémissements et de sanglots. Quel effet n'eut point produit la peroraison pro Milone, prononcée par ce grand orateur !
L'action fait plus que d'animer le discours : elle peut même inspirer l'orateur, surtout dans les occasions où il s'agit de traiter sur le champ et sur un grand théâtre, de grands intérêts, comme autrefois à Athènes et à Rome, et quelquefois aujourd'hui en Angleterre. C'est alors que l'éloquence débarrassée de toute contrainte et de toutes règles, produit ses plus grands miracles. C'est alors qu'on éprouve la vérité de ce passage de Quintilien, lib. VII. cap. Xe Pectus est quod disertos facit, et vis mentis, ideòque imperitis quoque, si modò sunt aliquo affectu concitati, verba non desunt. Ce passage d'un si grand maître servirait à confirmer tout ce que nous avons dit dans cet article sur l'élocution considérée par rapport à l'éloquence, si des vérités aussi incontestables avaient besoin d'autorité.
Nous croyons qu'on nous saura gré à cette occasion, de fixer la vraie signification du mot disertus ; il ne répond certainement pas à ce que nous appelons en français disert ; M. Diderot l'a très-bien prouvé au mot DISERT, par le passage même que nous venons de citer, et par la définition exacte de ce que nous entendons par disert. On peut y joindre ce passage d'Horace, epist. I. vers. xjx. Faecundi calices quem non fecêre disertum ! qu'assurément on ne traduira point ainsi, quel est celui que le vin n'a pas rendu disert ! Disertus chez les Latins signifiait toujours ou presque toujours, ce que nous entendons par éloquent, c'est-à-dire celui qui possède dans un souverain degré le talent de la parole, et qui par ce talent sait frapper, émouvoir, attendrir, intéresser, persuader. Diserti est, dit Cicéron dans ses dialogues de oratore, liv. I. cap. lxxxj. ut oratione persuadere possit. Disertus est donc celui qui a le talent de persuader par le discours, c'est-à-dire qui possède ce que les anciens appelaient eloquentia. Ils appelaient éloquents celui qui joignait à la qualité de disertus la connaissance de la philosophie et des lois ; ce qui formait selon eux le parfait orateur. Si idem homo, dit à cette occasion M. Gesner dans son Thesaurus linguae latinae, disertus est et doctus et sapiens, is demùm eloquents. Dans le I. livre de oratore, Cicéron fait dire à Marc Antoine l'orateur : eloquentem vocavi, qui mirabiliùs et magnificentiùs augère posset atque ornare quae vellet, OMNESQUE OMNIUM RERUM QUAE AD DICENDUM PERTINERENT FONTES ANIMO AC MEMORIA CONTINERET. Qu'on lise le commencement du traité de Cicéron intitulé Orator, on verra qu'il appelait diserti, les orateurs qui avaient eloquentiam popularem, ou comme il l'appelle encore, eloquentiam forensem, ornatam verbis atque sententiis sine doctrinâ, c'est-à-dire le talent complet de la parole, mais destitué de la profondeur du savoir et de la philosophie : dans un autre endroit du même ouvrage, Cicéron pour relever le mérite de l'action, dit qu'elle a fait réussir des orateurs sans talent, infantes, et que des orateurs éloquents, diserti, n'ont point réussi sans elle ; parce que, ajoute-t-il tout de suite, eloquentia sine actione, nulla ; haec autem sine eloquentiâ permagna est. Il est évident que dans ce passage, disertus répond à eloquentia. Il faut pourtant avouer que dans l'endroit déjà cité des dialogues sur l'orateur, où Cicéron fait parler Marc Antoine, disertus semble avoir à-peu-près la même signification que disert en français : disertos, dit Marc Antoine, me cognosse non-nullos scripsi, eloquentem adhuc neminem, quòd eum statuebam disertum, qui posset satis acutè atque dilucidè apud mediocres homines, ex communi quâdam hominum opinione dicère ; eloquentem vero, qui mirabiliùs, etc. comme ci-dessus. Ciceron cite au commencement de son Orator, ce même mot de l'orateur Marc Antoine : Marcus Antonius... scripsit, disertos se vidisse multos (dans le passage précèdent il y a non-nullos, ce qu'il n'est pas inutîle de remarquer), eloquentem omninò neminem. Mais il parait par tout ce qui précède dans l'endroit cité, et que nous avons rapporté ci-dessus, que Cicéron dans cet endroit donne à disertus le sens marqué plus haut. Je crois donc qu'on ne traduirait pas exactement ce dernier passage, en faisant dire à Marc Antoine qu'il avait Ve bien des hommes diserts, et aucun d'éloquent ; mais qu'on doit traduire, du moins en cet endroit, qu'il avait Ve beaucoup d'hommes doués du talent de la parole, et aucun de l'éloquence parfaite, OMNINO. Dans le passage précédent au contraire, on peut traduire, que Marc Antoine avait Ve quelques hommes diserts, et aucun éloquent. Au reste on doit être étonné que Cicéron dans le passage de l'Orator, substitue multos à non-nullos qui se trouve dans l'autre passage, où il fait dire d'ailleurs à Marc Antoine la même chose : il semble que multos serait mieux dans le premier passage, et non-nullos dans le second ; car il y a beaucoup plus d'hommes diserts, c'est-à-dire diserti dans le premier sens, qu'il n'y en a qu'on puisse appeler diserti dans le second ; or Marc Antoine, suivant le premier passage, ne connaissait qu'un petit nombre d'hommes diserts, à plus forte raison n'en connaissait-il qu'un très-petit nombre de la seconde espèce. Pourquoi donc cette disparate dans les deux passages ? sans-doute multos dans le second ne signifie pas un grand nombre absolument, mais seulement un grand nombre par opposition à neminem, c'est-à-dire quelques-uns, ou non-nullos.
Après cette discussion sur le vrai sens du mot disertus, discussion qui nous parait mériter l'attention des lecteurs, et qui appartient à l'article que nous traitons, donnons en peu de mots d'après les grands maîtres et d'après nos propres réflexions, les principales règles de l'élocution oratoire.
La clarté, qui est la loi fondamentale du discours oratoire, et en général de quelque discours que ce sait, consiste non-seulement à se faire entendre, mais à se faire entendre sans peine. On y parvient par deux moyens, en mettant les idées chacune à sa place dans l'ordre naturel, et en exprimant nettement chacune de ces idées. Les idées seront exprimées facilement et nettement, en évitant les tours ambigus, les phrases trop longues, trop chargées d'idées incidentes et accessoires à l'idée principale, les tours épigrammatiques, dont la multitude ne peut sentir la finesse ; car l'orateur doit se souvenir qu'il parle pour la multitude. Notre langue par le défaut de déclinaisons et de conjugaisons, par les équivoques fréquentes des ils, des elles, des qui, des que, des son, sa, ses, et de beaucoup d'autres mots, est plus sujette que les langues anciennes à l'ambiguité des phrases et des tours. On doit donc y être fort attentif, en se permettant néanmoins (quoique rarement) les équivoques legeres et purement grammaticales, lorsque le sens est clair d'ailleurs par lui même, et lorsqu'on ne pourrait lever l'équivoque sans affoiblir la vivacité du discours. L'orateur peut même se permettre quelquefois la finesse des pensées et des tours, pourvu que ce soit avec sobriété et dans les sujets qui en sont susceptibles, ou qui l'autorisent, c'est-à-dire qui ne demandent ni simplicité, ni élévation, ni véhémence : ces tours fins et délicats échapperont sans-doute au vulgaire, mais les gens d'esprit les saisiront et en sauront gré à l'orateur. En effet, pourquoi lui refuserait-on la liberté de réserver certains endroits de son ouvrage aux gens d'esprit, c'est-à-dire aux seules personnes dont il doit réellement ambitionner l'estime.
Je n'ai rien à dire sur la correction, sinon qu'elle consiste à observer exactement les règles de la langue, mais non avec assez de scrupule, pour ne pas s'en affranchir lorsque la vivacité du discours l'exige. La correction et la clarté sont encore plus étroitement nécessaires dans un discours fait pour être lu, que dans un discours prononcé ; car dans ce dernier cas, une action vive, juste, animée, peut quelquefois aider à la clarté et sauver l'incorrection.
Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la clarté et de la correction grammaticales, qui appartiennent à la diction : il est aussi une clarté et une correction non moins essentielles, qui appartiennent au style, et qui consistent dans la propriété des termes. C'est principalement cette qualité qui distingue les grands écrivains d'avec ceux qui ne le sont pas : ceux-ci sont, pour ainsi dire, toujours à côté de l'idée qu'ils veulent présenter ; les autres la rendent et la font saisir avec justesse par une expression propre. De la propriété des termes naissent trois différentes qualités ; la précision dans les matières de discussion, l'élegance dans les sujets agréables, l'énergie dans les sujets grands ou pathétiques. Voyez ces mots.
La convenance du style avec le sujet, exige le choix et la propriété des termes ; elle dépend outre cela de la nature des idées que l'orateur emploie. Car, nous ne saurions trop le redire, il n'y a qu'une sorte de style, le style simple, c'est-à-dire celui qui rend les idées de la manière la moins détournée, et la plus sensible. Si les anciens ont distingué trois styles, le simple, le sublime, et le tempéré ou l'orné, ils ne l'ont fait qu'eu égard aux différents objets que peut avoir le discours : le style qu'ils appelaient simple, est celui qui se borne à des idées simples et communes ; le style sublime peint les idées grandes, et le style orné les idées riantes et agréables. En quoi consiste donc la convenance du style au sujet ? 1°. à n'employer que des idées propres au sujet, c'est-à-dire simples dans un sujet simple, nobles dans un sujet élevé, riantes dans un sujet agréable : 2°. à n'employer que les termes les plus propres pour rendre chaque idée. Par ce moyen l'orateur sera précisément de niveau à son sujet, c'est-à-dire ni au-dessus ni au-dessous, soit par les idées, soit par les expressions. C'est en quoi consiste la véritable éloquence, et même en général le vrai talent d'écrire, et non dans un style qui déguise par un vain coloris des idées communes. Ce style ressemble au faux bel esprit, qui n'est autre chose que l'art puéril et méprisable, de faire paraitre les choses plus ingénieuses qu'elles ne sont.
De l'observation de ces règles résultera la noblesse du style oratoire ; car l'orateur ne devant jamais, ni traiter de sujets bas, ni présenter des idées basses, son style sera noble dès qu'il sera convenable à son sujet. La bassesse des idées et des sujets est à la vérité trop souvent arbitraire ; les anciens se donnaient à cet égard beaucoup plus de liberté que nous, qui, en bannissant de nos mœurs la délicatesse, l'avons portée à l'excès dans nos écrits et dans nos discours. Mais quelque arbitraires que puissent être nos principes sur la bassesse et sur la noblesse des sujets, il suffit que les idées de la nation soient fixées sur ce point, pour que l'orateur ne s'y trompe pas et pour qu'il s'y conforme. En vain le génie même s'efforcerait de braver à cet égard les opinions reçues ; l'orateur est l'homme du peuple, c'est à lui qu'il doit chercher à plaire ; et la première loi qu'il doit observer pour réussir, est de ne pas choquer la philosophie de la multitude, c'est-à-dire les préjugés.
Venons à l'harmonie, une des qualités qui constituent le plus essentiellement le discours oratoire. Le plaisir qui résulte de cette harmonie est-il purement arbitraire et d'habitude, comme l'ont prétendu quelques écrivains, ou y entre-t-il tout à la fois de l'habitude et du réel ? ce dernier sentiment est peut-être le mieux fondé. Car il en est de l'harmonie du discours, comme de l'harmonie poétique et de l'harmonie musicale. Tous les peuples ont une musique, le plaisir qui nait de la mélodie du chant a donc son fondement dans la nature : il y a d'ailleurs des traits de mélodie et d'harmonie qui plaisent indistinctement et du premier coup à toutes les nations ; il y a donc du réel dans le plaisir musical : mais il y a d'autres traits plus détournés, et un style musical particulier à chaque peuple, qui demandent que l'oreille y soit plus ou moins accoutumée : il entre donc dans ce plaisir de l'habitude. C'est ainsi, et d'après les mêmes principes, qu'il y a dans tous les Arts un beau absolu, et un beau de convention ; un goût réel, et un goût arbitraire. On peut appuyer cette réflexion par une autre. Nous sentons dans les vers latins en les prononçant une espèce de cadence et de mélodie ; cependant nous prononçons très-mal le latin ; nous estropions très-souvent la prosodie de cette langue, nous scandons même les vers à contre-sens, car nous scandons ainsi :
Arma vi, rumque ca, no Tro, jae qui, primus ab, oris,
en nous arrêtant sur des breves à quelques-uns des endroits marqués par des virgules, comme si ces breves étaient longues ; au lieu qu'on devrait scander :
Ar, mavirum, que cano, Trojae, qui pri, mus ab o, ris ;
car on doit s'arrêter sur les longues et passer sur les breves, comme on fait en Musique sur des croches, en donnant à deux breves le même temps qu'à une longue. Cependant malgré cette prononciation barbare, et ce renversement de la mélodie et de la mesure, l'harmonie des vers latins nous plait, parce que d'un côté nous ne pouvons détruire entièrement celle que le poète y a mise, et que de l'autre nous nous faisons une harmonie d'habitude. Nouvelle preuve du mélange de réel et d'arbitraire qui se trouve dans le plaisir produit par l'harmonie.
L'harmonie est sans-doute l'âme de la poésie, et c'est pour cela que les traductions des Poètes ne doivent être qu'en vers ; car traduire un poète en prose, c'est le dénaturer tout à fait, c'est à-peu-près comme si l'on voulait traduire de la musique italienne en musique française. Mais si la poésie a son harmonie particulière qui la caractérise, la prose dans toutes les langues a aussi la sienne ; les anciens l'avaient bien Ve ; ils appelaient le nombre pour la prose, et celui du vers. Quoique notre poésie et notre prose soient moins susceptibles de mélodie que ne l'étaient la prose et la poésie des anciens, cependant elles ont chacune une mélodie qui leur est propre ; peut-être même celle de la prose a-t-elle un avantage en ce qu'elle est moins monotone, et par conséquent moins fatiguante ; la difficulté vaincue est le grand mérite de la poésie. Ne serait-ce point pour cette raison qu'il est rare de lire, sans être fatigué, bien des vers de suite, et que le plaisir causé par cette lecture, diminue à mesure qu'on avance en âge ?
Quoi qu'il en sait, ce sont les poètes qui ont formé les langues ; c'est aussi l'harmonie de la poésie, qui a fait naître celle de la prose : Malherbe faisait parmi nous des odes harmonieuses, lorsque notre prose était encore barbare et grossière ; c'est à Balzac que nous avons l'obligation de lui avoir le premier donné de l'harmonie. " L'éloquence, dit très-bien M. de Voltaire, a tant de pouvoir sur les hommes, qu'on admira Balzac de son temps, pour avoir trouvé cette petite partie de l'art ignorée et nécessaire, qui consiste dans le choix harmonieux des paroles, et même pour l'avoir souvent employée hors de sa place ". Isocrate, selon Cicéron, est le premier qui ait connu l'harmonie de la prose parmi les anciens. On ne remarque, dit encore Cicéron, aucune harmonie dans Hérodote, ni dans ses contemporains, ni dans ses prédécesseurs. L'orateur romain compare le style de Thucydide, à qui il ne manque rien que l'harmonie, au bouclier de Minerve par Phidias, qu'on aurait mis en pièces.
Deux choses charment l'oreille dans le discours, le son et le nombre : le son consiste dans la qualité des mots ; et le nombre, dans leur arrangement. Ainsi l'harmonie du discours oratoire consiste à n'employer que des mots d'un son agréable et doux ; à éviter le concours des syllabes rudes, et celui des voyelles, sans affectation néanmoins (sur quoi voyez l'article ELISION) ; à ne pas mettre entre les membres des phrases trop d'inégalité, surtout à ne pas faire les derniers membres trop courts par rapport aux premiers ; à éviter également les périodes trop longues et les phrases trop courtes, ou, comme les appelle Cicéron, à demi écloses ; le style qui fait perdre haleine, et celui qui force à chaque instant de la reprendre, et qui ressemble à une sorte de marqueterie ; à savoir entremêler les périodes soutenues et arrondies, avec d'autres qui le soient moins et qui servent comme de repos à l'oreille. Cicéron blâme avec raison Théopompe, pour avoir porté jusqu'à l'excès le soin minutieux d'éviter le concours des voyelles ; c'est à l'usage, dit ce grand orateur, à procurer seul cet avantage sans qu'on le cherche avec fatigue. L'orateur exercé aperçoit d'un coup d'oeil la succession la plus harmonieuse des mots, comme un bon lecteur voit d'un coup d'oeil les syllabes qui précèdent et celles qui suivent.
Les anciens, dans leur prose, évitaient de laisser échapper des vers, parce que la mesure de leurs vers était extrêmement marquée ; le vers ïambe était le seul qu'ils s'y permissent quelquefois, parce que ce vers avait plus de licences qu'aucun autre, et une mesure moins invariable : nos vers, si on leur ôte la rime, sont à quelques égards dans le cas des vers ïambes des anciens ; nous n'y avons attention qu'à la multitude des syllabes, et non à la prosodie ; douze syllabes longues ou douze syllabes breves, douze syllabes réelles et physiques ou douze syllabes de convention et d'usage, font également un de nos grands vers ; les vers français sont donc moins choquans dans la prose française (quoiqu'ils ne doivent pas y être prodigués, ni même y être trop sensibles), que les vers latins ne l'étaient dans la prose latine. Il y a plus : on a remarqué que la prose la plus harmonieuse contient beaucoup de vers, qui étant de différente mesure, et sans rime, donnent à la prose un des agréments de la poésie, sans lui en donner le caractère, la monotonie, et l'uniformité. La prose de Moliere est toute pleine de vers. En voici un exemple tiré de la première scène du Sicilien :
Chut, n'avancez pas davantage,
Et demeurez en cet endroit
Jusqu'à ce que je vous appele.
Il fait noir comme dans un four,
Le ciel s'est habillé ce soir en scaramouche,
Et je ne vois pas une étoîle
Qui montre le bout de son nez.
Sotte condition que celle d'un esclave !
De ne vivre jamais pour soi,
Et d'être toujours tout entier
Aux passions d'un maître ! &c.
On peut remarquer en passant, que ce sont les vers de huit syllabes qui dominent dans ce morceau, et ce sont en effet ceux qui doivent le plus fréquemment se trouver dans une prose harmonieuse.
M. de la Motte, dans une des dissertations qu'il a écrites contre la Poésie, a mis en prose une des scènes de Racine sans y faire d'autre changement que de renverser les mots qui forment les vers : Arbate, on nous faisait un rapport fidèle. Rome triomphe en effet, et Mithridate est mort. Les Romains ont attaqué mon père vers l'Euphrate, et trompé sa prudence ordinaire dans la nuit, etc. Il observe que cette prose nous parait beaucoup moins agréable que les vers qui expriment la même chose dans les mêmes termes ; et il en conclut que le plaisir qui nait de la mesure des vers, est un plaisir de convention et de préjugé, puisqu'à l'exception de cette mesure, rien n'a disparu du morceau cité. M. de la Motte ne faisait pas attention, qu'outre la mesure du vers, l'harmonie qui résulte de l'arrangement des mots avait aussi disparu, et que si Racine eut voulu écrire ce morceau en prose, il l'aurait écrit autrement, et choisi des mots dont l'arrangement aurait formé une harmonie plus agréable à l'oreille.
L'harmonie souffre quelquefois de la justesse et de l'arrangement logique des mots, et réciproquement : c'est alors à l'orateur à concilier, s'il est possible, l'une avec l'autre, ou à décider lui-même jusqu'à quel point il peut sacrifier l'harmonie à la justesse. La seule règle générale qu'on puisse donner sur ce sujet, c'est qu'on ne doit ni trop souvent sacrifier l'une à l'autre, ni jamais violer l'une ou l'autre d'une manière trop choquante. Le mépris de la justesse offensera la raison, et le mépris de l'harmonie blessera l'organe ; l'une est un juge sévère qui pardonne difficilement, et l'autre un juge orgueilleux qu'il faut ménager. La réunion de la justesse et de l'harmonie, portées l'une et l'autre au suprême degré, était peut-être le talent supérieur de Démosthène : ce sont vraisemblablement ces deux qualités qui, dans les ouvrages de ce grand orateur, ont produit tant d'effet sur les Grecs, et même sur les Romains, tant que le grec a été une langue vivante et cultivée ; mais aujourd'hui quelque satisfaction que ses harangues nous procurent encore par le fond des choses, il faut avouer, si on est de bonne foi, que la réputation de Démosthène est encore au-dessus du plaisir que nous fait sa lecture. L'intérêt vif que les Athéniens prenaient à l'objet de ces harangues, la déclamation sublime de Démosthène, sur laquelle il nous est resté le témoignage d'Eschine même son ennemi, enfin l'usage sans-doute inimitable qu'il faisait de sa langue pour la propriété des termes et pour le nombre oratoire, tout ce mérite est ou entièrement ou presque entièrement perdu pour nous. Les Athéniens, nation délicate et sensible, avaient raison d'écouter Démosthène comme un prodige ; notre admiration, si elle était égale à la leur, ne serait qu'un enthousiasme déplacé. L'estime raisonnée d'un philosophe honore plus les grands écrivains, que toute la prévention des pédants.
Ce que nous appelons ici harmonie dans le discours, devrait s'appeler plus proprement mélodie : car mélodie en notre langue est une suite de sons qui se succedent agréablement ; et harmonie est le plaisir qui résulte du mélange de plusieurs sons qu'on entend à la fais. Les anciens qui, selon les apparences, ne connaissaient point la Musique à plusieurs parties, du moins au même degré que nous, appelaient harmonia ce que nous appelons mélodie. En transportant ce mot au style, nous avons conservé l'idée qu'ils y attachaient, et en le transportant à la Musique, nous lui en avons donné un autre. C'est ici une observation purement grammaticale, mais qui ne nous parait pas inutile.
Cicéron, dans son traité intitulé Orator, fait consister une des principales qualités du style simple en ce que l'orateur s'y affranchit de la servitude du nombre, sa marche étant libre et sans contrainte, quoique sans écarts trop marqués. En effet, le plus ou le moins d'harmonie est peut-être ce qui distingue le plus réellement les différentes espèces du style.
Mais quelque harmonie qui se fasse sentir dans le discours, rien n'est plus opposé à l'éloquence qu'un style diffus, trainant et lâche. Le style de l'orateur doit être serré ; c'est par-là surtout qu'a excellé Démosthène. Or en quoi consiste le style serré ? A mettre, comme nous l'avons dit, chaque idée à sa véritable place, à ne point omettre d'idées intermédiaires trop difficiles à suppléer, à rendre enfin chaque idée par le terme propre : par ce moyen on évitera toute répétition et toute circonlocution, et le style aura le rare avantage d'être concis sans être fatiguant, et développé sans être lâche. Il arrive souvent qu'on est aussi obscur en fuyant la briéveté, qu'en la cherchant ; on perd sa route en voulant prendre la plus longue. La manière la plus naturelle et la plus sure d'arriver à un objet, c'est d'y aller par le plus court chemin, pourvu qu'on y aille en marchant, et non pas en sautant d'un lieu à un autre. On peut juger de-là combien est opposée à l'éloquence véritable, cette loquacité si ordinaire au barreau, qui consiste à dire si peu de choses avec tant de paroles. On prétend, il est vrai, que les mêmes moyens doivent être présentés différemment aux différents juges, et que par cette raison on est obligé dans un plaidoyer de tourner de différents sens la même preuve. Mais ce verbiage prétendu nécessaire deviendra évidemment inutile, si on a soin de ranger les idées dans l'ordre convenable ; il résultera de leur disposition naturelle une lumière qui frappera infailliblement et également tous les esprits, parce que l'art de raisonner est un, et qu'il n'y a pas plus deux logiques, que deux géométries. Le préjugé contraire est fondé en grande partie sur les fausses idées qu'on acquiert de l'éloquence dans nos colléges ; on la fait consister à amplifier et à étendre une pensée ; on apprend aux jeunes gens à délayer leurs idées dans un déluge de périodes insipides, au lieu de leur apprendre à les resserrer sans obscurité. Ceux qui douteront que la concision puisse subsister avec l'éloquence, peuvent lire pour se désabuser les harangues de Tacite.
Il ne suffit pas au style de l'orateur d'être clair, correct, propre, précis, élégant, noble, convenable au sujet, harmonieux, vif, et serré ; il faut encore qu'il soit facile, c'est-à-dire que la gêne de la composition ne s'y laisse point apercevoir. Le style naturel, dit Paschal, nous enchante avec raison ; car on s'attendait de trouver un auteur, et on trouve un homme. Le plaisir de l'auditeur ou du lecteur diminuera à mesure que le travail et la peine se feront sentir. Un des moyens de se préserver de ce défaut, c'est d'éviter ce style figuré, poétique, chargé d'ornements, de métaphores, d'antithèses, et d'épithetes, qu'on appele, je ne sai par quelle raison, style académique. Ce n'est assurément pas celui de l'académie Française ; il ne faut, pour s'en convaincre, que lire les ouvrages et les discours même des principaux membres qui la composent. C'est tout au plus le style de quelques académies de province, dont la multiplication excessive et ridicule est aussi funeste aux progrès du bon gout, que préjudiciable aux vrais intérêts de l'état ; depuis Pau jusqu'à Dunkerque, tout sera bien-tôt académie en France.
Ce style académique ou prétendu tel, est encore celui de la plupart de nos prédicateurs, du moins de plusieurs de ceux qui ont quelque réputation ; n'ayant pas assez de génie pour présenter d'une manière frappante, et cependant naturelle, les vérités connues qu'ils doivent annoncer, ils croient les orner par un style affecté et ridicule, qui fait ressembler leurs sermons, non à l'épanchement d'un cœur pénétré de ce qu'il doit inspirer aux autres, mais à une espèce de représentation ennuyeuse et monotone, où l'acteur s'applaudit sans être écouté. Ces fades harangueurs peuvent se convaincre par la lecture réfléchie des sermons du P. Massillon, surtout de ceux qu'on appelle le petit carême, combien la véritable éloquence de la chaire est opposée à l'affectation du style : nous ne citerons ici que le sermon qui a pour titre de l'humanité des grands, modèle le plus parfait que nous connaissions en ce genre, discours plein de vérité, de simplicité, et de noblesse, que les princes devraient lire sans-cesse pour se former le cœur, et les orateurs chrétiens pour se former le gout.
L'affectation du style parait surtout dans la prose de la plupart des poètes : accoutumés au style orné et figuré, ils le transportent comme malgré eux dans leur prose ; ou s'ils font des efforts pour l'en bannir, leur prose devient trainante et sans vie : aussi avons-nous très-peu de poètes qui aient bien écrit en prose. Les préfaces de Racine sont faiblement écrites, celles de Corneille sont aussi excellentes pour le fond des choses, que défectueuses du côté du style ; la prose de Rousseau est dure, celle de Despréaux pesante, celle de la Fontaine insipide ; celle de la Motte est à la vérité facîle et agréable, mais aussi la Motte ne tient pas le premier rang parmi les Versificateurs. M. de Voltaire est presque le seul de nos grands poètes dont la prose soit du moins égale à ses vers ; cette supériorité dans deux genres si différents, quoique si voisins en apparence, est une des plus rares qualités de ce grand écrivain.
Telles sont les principales lois de l'élocution oratoire. On trouvera sur ce sujet un plus grand détail dans les ouvrages de Cicéron, de Quintilien, etc. surtout dans l'ouvrage du premier de ces deux écrivains qui a pour titre Orator, et dans lequel il traite à fond du nombre et de l'harmonie du discours. Quoique ce qu'il en dit soit principalement relatif à la langue latine qui était la sienne, on peut néanmoins en tirer des règles générales d'harmonie pour toutes les langues.
Nous ne parlerons point ici des figures, sur lesquelles tant de rhéteurs ont écrit des volumes : elles servent sans-doute à rendre le discours plus animé, mais si la nature ne les dicte, elles sont froides et insipides. Elles sont d'ailleurs presque aussi communes, même dans le discours ordinaire, que l'usage des mots, pris dans un sens figuré, est commun dans toutes les langues. Voyez LANGUE, DICTIONNAIRE, FIGURE, TROPE, ELOQUENCE. Tant pis pour tout orateur qui fait avec réflexion et avec dessein une métonymie, une catachrèse, et d'autres figures semblables.
Sur les qualités du style en général dans toutes sortes d'ouvrages, voyez ELEGANCE, STYLE, GRACE, GOUT, etc.
Je finis cet article par une observation, qu'il me semble que la plupart des rhéteurs modernes n'ont point assez faite, leurs ouvrages, calqués pour ainsi dire sur les livres de rhétorique des anciens, sont remplis de définitions, de préceptes, et de détails, nécessaires peut-être pour lire les anciens avec fruit, mais absolument inutiles, et contraires même au genre d'éloquence que nous connaissons aujourd'hui. " Dans cet art, comme dans tous les autres, dit très-bien M. Freret (hist. de l'acad. des Belles-Lettres, Tome XVIII. pag. 461.), il faut distinguer les beautés réelles, de celles qui étant arbitraires dépendent des mœurs, des coutumes, et du gouvernement d'une nation, quelquefois même du caprice de la mode, dont l'empire s'étend à tout, et a toujours été respecté jusqu'à un certain point ". Du temps de la république romaine, où il y avait peu de lais, et où les juges étaient souvent pris au hasard, il suffisait presque toujours de les émouvoir, ou de les rendre favorables par quelqu'autre moyen ; dans notre barreau, il faut les convaincre : Cicéron eut perdu à la grand-chambre la plupart des causes qu'il a gagnées, parce que ses cliens étaient coupables ; osons ajouter que plusieurs endroits de ses harangues, qui plaisaient peut-être avec raison aux Romains, et que nos latinistes modernes admirent sans savoir pourquoi, ne seraient aujourd'hui que médiocrement goutés. (O)