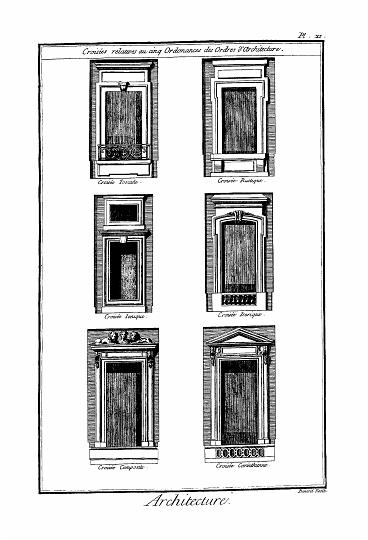S. m. (Peinture) artiste qui sait représenter toutes sortes d'objets par le secours des couleurs du pinceau.
Le bonheur d'un peintre est d'être né avec du génie. Le génie est ce feu qui élève les peintres au-dessus d'eux-mêmes, qui leur fait mettre de l'âme dans leurs figures, et du mouvement dans leurs compositions. L'expérience prouve suffisamment que tous les hommes ne naissent pas avec un génie propre à les rendre peintres. Nous avons Ve des hommes d'esprit qui avaient copié plusieurs fois ce que la peinture a produit de plus sublime, vieillir le pinceau et la palette à la main, sans s'élever au-dessus du rang de coloristes médiocres, et de serviles dessinateurs d'après les figures d'autrui. Les esprits les plus communs sont capables d'être peintres, mais jamais grands peintres.
Il ne suffit pas aux peintres, d'avoir du génie, de concevoir des idées nobles, d'imaginer les compositions les plus élégantes et de trouver les expressions les plus pathétiques, il faut encore que leurs mains aient été rendues dociles à se fléchir avec précision en cent manières différentes, pour se trouver capables de tirer avec justesse la ligne que l'imagination leur demande. Le génie a, pour ainsi dire, les bras liés dans un artiste dont la main n'est pas dénouée.
Il en est de l'oeil comme de la main, il faut que l'oeil d'un peintre soit accoutumé de bonne heure à juger par une opération sure et facile, en même temps, quel effet doit faire un certain mélange, ou bien une certaine opposition de couleurs ; quel effet doit faire une figure d'une certaine hauteur dans un grouppe ; et quel effet un certain grouppe fera dans le tableau après que le tableau sera colorié. Si l'imagination n'a pas à sa disposition une main et un oeil capables de la seconder à son gré, il ne résulte des plus belles idées qu'enfante cette imagination, qu'un tableau grossier, et que dédaigne l'artiste même qui l'a peint, tant il trouve l'œuvre de sa main au-dessous de l'œuvre de son esprit.
L'étude nécessaire pour perfectionner l'oeil et la main ne se fait point en donnant quelques heures distraites à un travail interrompu. Cette étude demande une attention entière, et une persévérance continuée durant plusieurs années. On sait la maxime qui défend aux peintres de laisser écouler un jour entier, sans donner quelques coups de pinceau, maxime qu'on applique communément à toutes les professions, tant on la trouve judicieuse : nulla dies sine lineâ.
Le seul temps de la vie qui soit bien propre à faire acquérir leur perfection à l'oeil et à la main, est le temps où nos organes, tant intérieurs qu'extérieurs, achevent de se former : c'est le temps qui s'écoule depuis l'âge de quinze ans jusqu'à trente. Les organes contractent sans peine durant ces années toutes les habitudes, dont leur première conformation les rend susceptibles. Mais si l'on perd ces années précieuses, si on les laisse écouler sans les mettre à profit, la docilité des organes se passe sans que nos efforts puissent jamais la rappeller. Quoique notre langue soit un organe bien plus souple que notre main, cependant nous prononçons toujours mal une langue étrangère que nous apprenons après 30 ans.
Un peintre doit connaître à quel genre de peinture il est propre, et se borner à ce genre. Tel demeure confondu dans la foule, qui serait au rang des illustres maîtres, s'il ne se fut point laissé entraîner par une émulation aveugle, qui lui a fait tenter de se rendre habîle dans des genres de peinture pour lesquels il n'était point né, et qui lui a fait négliger ceux auxquels il était très-propre. Les ouvrages qu'il a essayé de faire sont, si l'on veut, d'une classe supérieure, mais ne vaut-il pas mieux être cité pour être un des premiers faiseurs de portraits de son temps, que pour un misérable arrangeur de figures ignobles et estropiées ?
Les jeunes peintres qui ont à cœur de réussir doivent encore se garder des passions violentes, en particulier de l'impatience, de la précipitation et du dégout. Que ceux qui se trouvent dans une fortune étroite ne désespèrent point de l'améliorer par l'application ; l'opulence détourne du travail et de l'exercice de la main : la fortune est plus nuisible aux talents qu'elle ne leur est utîle ; mais d'un autre côté les distinctions, les honneurs et les récompenses sont nécessaires dans un état pour y encourager la culture des beaux arts, et y former des artistes supérieurs. Un peintre en Grèce était un homme célèbre aussi-tôt qu'il méritait de l'être. Ce genre de mérite faisait d'un homme du commun un personnage, et il l'égalait à ce qu'il y avait de plus grand et de plus important dans l'état ; les portiques publics où les peintres exposaient leurs tableaux étaient les lieux où ce qu'il y avait de plus illustre dans la Grèce se rendait de temps en temps pour en juger. Les ouvrages des grands-maîtres n'étaient point alors regardés comme des meubles ordinaires, destinés pour embellir les appartements d'un particulier ; on les réputait les joyaux d'un état et un trésor du public, dont la jouïssance était due à tous les citoyens. Qu'on juge donc de l'ardeur que les artistes avaient alors pour perfectionner leurs talents, par l'ardeur que nous voyons dans nos contemporains pour amasser du bien, ou pour faire quelque chose de plus noble pour parvenir aux grands emplois d'un état.
Quoique la réputation du peintre soit plus dépendante du suffrage des experts que celle des poètes, néanmoins ils ne sont pas les juges uniques de leur mérite. Aucun d'eux ne parviendrait que longtemps après la mort à la distinction qui lui est dû., si la destinée demeurait toujours au pouvoir des autres peintres. Heureusement ses rivaux compatriotes n'en sont les maîtres que pour un temps. Le public qu'on éclaire tire peu-à-peu le procès à son tribunal, et rend à chacun la justice qui lui est dû.. Mais en particulier un peintre qui traite de grands sujets, qui peint des coupoles et des voutes d'église, ou qui fait de grands tableaux destinés pour être placés dans tous les lieux où tous les hommes ont coutume de se rassembler, est plutôt connu pour ce qu'il est, que le peintre qui travaille à des tableaux de chevalet destinés pour être renfermés dans des appartements de particuliers.
De plus il est des lieux, des temps, des pays où le mérite d'un peintre est plutôt reconnu qu'ailleurs. Par exemple, les tableaux exposés dans Rome seront plutôt appréciés à leur juste valeur, que s'ils étaient exposés dans Londres et dans Paris. Le goût naturel des Romains pour la Peinture, les occasions qu'ils ont de s'en nourrir, si je puis parler ainsi, leurs mœurs, leur inaction, l'occasion de voir perpétuellement dans les églises et dans les palais des chefs-d'œuvres de peinture ; peut-être aussi la sensibilité de leurs organes rend cette nation plus capable qu'aucune autre d'apprécier le mérite de leurs peintres sans le concours des gens du métier. Enfin un peintre s'est fait une juste réputation, quand ses ouvrages ont un prix chez les étrangers ; ce n'est point assez d'avoir un petit parti qui les vante, il faut qu'ils soient achetés et bien payés ; voilà la pierre de touche de leur valeur.
Ce qui resserre quelquefois les talents des peintres dit à ce sujet M. de Voltaire, et ce qui semblerait devoir les éteindre, c'est le goût académique, c'est la manière qu'ils prennent d'après ceux qui président à cet art. Les académies sont sans doute très-utiles pour former des élèves, surtout quand les directeurs travaillent dans le grand goût ; mais si le chef a le goût petit, si la manière est aride et léchée, si ses figures grimacent, si ses expressions sont insipides, si son coloris est faible, les élèves subjugués par l'imitation, ou par envie de plaire à un mauvais maître, perdent entièrement l'idée de la belle nature. Donnez-moi un artiste tout occupé de la crainte de ne pas saisir la manière de ses confrères, ses productions seront compassées et contraintes. Donnez-moi un homme d'un esprit libre, plein de la belle nature qu'il copie, cet homme réussira. Presque tous les artistes sublimes ont fleuri avant les établissements des académies, ou ont travaillé dans un goût différent de celui qui regnait dans ces sociétés ; presque aucun ouvrage qu'on appelle académique, n'a été encore dans aucun genre un ouvrage de génie.
Si présentement le lecteur est curieux de connaître les célèbres peintres modernes, il en trouvera la liste générale sous les artistes des différentes ÉCOLES ; mais comme les noms et le caractère des anciens peintres méritent encore plus d'être recueillis dans cet ouvrage, voyez PEINTRES anciens. (Le chevalier DE JAUCOURT )
PEINTRES GRECS, (Peint. antiq.) ils sont si célèbres dans les écrits de l'antiquité, et leurs ouvrages sont si liés à la connaissance de la Peinture, que les détails qui les regardent appartiennent essentiellement à l'Encyclopédie. D'ailleurs ils intéressent presque également les littérateurs, les curieux et les gens de métier.
Les peintres de la Grèce qui ont pratiqué les premiers cet art, sont, selon Pline, Ardicès de Corinthe, et Téléphanès de Sycione ; ensuite parurent Cléophante de Corinthe, l'auteur de la peinture monochrome, auquel succedèrent Hygiemon, Dinias, Charmidas, Eumarus d'Athènes et Cimon de Cléone ; mais l'histoire n'a point fixé le temps où ils ont vécu, et Pline ne nous dit que quelques particularités des deux derniers.
Ludius peintre d'Ardéa, diffèrent du Ludius d'Auguste qui fit quelque peinture à Coeré ville d'Etrurie, parait avoir été postérieur à Cléophante, à Cimon, auteur des premières beautés de l'art. Si donc on place la fondation de Rome en l'an 753 avant l'ère chrétienne, il en résulterait assez vraisemblablement que Ludius aurait vécu pour le plus tard vers l'an 765 avant Jesus-Christ, l'anonyme de Coeré vers l'an 680, Cimon vers l'an 795, Eumarus vers l'an 810, Charmidas, Dinias et Hygiemon vers l'an 825, et Cléophante l'ancien vers l'an 840.
Bularque qui le premier introduisit l'usage de plusieurs couleurs dans un seul ouvrage de peinture, et qui était contemporain du roi Candaule, vécut vers l'an 730 avant Jesus-Christ. Nous n'avons point la suite des peintres grecs depuis Bularque, c'est-à-dire depuis l'an environ 730 jusqu'à la bataille de Marathon qui se donna l'an 490.
Panée ou Panaenus peignit cette bataille, et comme de son temps l'usage de concourir pour le prix de Peinture fut établi à Corinthe et à Delphes, il se mit sur les rangs le premier pour concourir avec Timagoras de Chalcis l'an 474 avant Jesus-Christ.
Après Panaenus, et avant la 90 olympiade, parut Polygnote de Thasos, fils d'Aglaophon, et surnommé quelquefois Athénien, parce qu'Athènes le mit au nombre de ses citoyens. Il eut pour contemporain le peintre Micon, Nesias de Thasos, Démophîle qui fit des ouvrages avec Gorganus dans un temple de Rome.
Vers la même 90e olympiade, c'est-à-dire l'an 420 avant Jesus-Christ, parurent un autre Aglaophon différent du père de Polygnote, Céphissodore dont le nom a été commun à différents sculpteurs, Phrylus et Evenos d'Ephèse. Vers le même temps doivent être placés deux autres peintres qu'Aristote a mis à la suite de Polygnote, l'un est Pauson et l'autre Denys de Colophon, tous deux antérieurs à l'an 404, qui fut l'époque des grands peintres de la Grèce. Polygnote, en peignant les hommes, les rehaussa ; Pauson les avilit ; et Denys les représenta ce qu'ils ont coutume d'être.
Vers l'an 415 vécurent Nicanor et Arcésilaus, tous les deux de Paros, et Lysippe d'Egine ; ils sont après Polygnote, et sont les trois plus anciens peintres encaustiques. Briétés, autre peintre encaustique, les suivit de près ; il eut pour fils et pour élève Pausias célèbre vers l'an 376.
A la 94e olympiade l'an 404, Apollodore d'Athènes ouvrit une nouvelle carrière, et donna naissance au beau siècle de la peinture. La quatrième année de la 95e olympiade l'an 397, Zeuxis de la ville d'Héraclée entra dans la carrière qu'Apollodore avait ouverte, et y fit de nouveaux progrès.
Parrhasius d'Ephèse, Timanthe de Cythnos, Androcyde de Cyzique, Euxénidas et Eupompe de Sicyone ont tous été contemporains de Zeuxis, et la plupart enrichirent l'art de quelques nouvelles beautés. Eupompe en particulier donna le commencement à une troisième classe de peintres à l'école sycionienne, différente de l'ionienne ou asiatique, et de l'athénienne ou helladique.
Aristophon dont Pline rapporte différents ouvrages sans déterminer le temps où il vivait, parce que c'était un peintre du second rang, doit avoir suivi de fort près les artistes précédents, et s'être fait connaître vers l'an 390. Il était fils d'Aglaophon, célèbre en l'an 420 avant l'ère chrétienne.
En l'an 380 commença la 100e olympiade, après laquelle Pline met Pausias de Sycione, dont la célébrité appartient à la 101e olympiade vers l'an 376 ; il fut, à proprement parler, l'auteur de la belle encaustique ; il inventa la ruption de la couleur dans le noir, comme Zeuxis l'avait fait dans le blanc.
Pamphîle de Macédoine ayant été l'élève d'Eupompe et le maître d'Apelle, fleurissait vers l'an 364, à la 104e. olympiade, avec Ctésydeme peintre du second rang, Euphranor natif de l'Isthme de Corinthe, et Cydias de Cythnos. Calades qui composa de petits sujets, doit être placé un peu après.
A la 107e olympiade, l'an 352, Echion et Térimachus, habiles statuaires, se firent encore honneur par leur pinceau, ainsi qu'Aristolaus et Méchopane peintres encaustiques, celui-là fils, celui-ci élève de Pausias. Antidotus, autre peintre encaustique, les suivit de près, et appartient environ à l'an 348. On doit placer Calliclès environ dans le même temps.
La 112e olympiade, autrement l'an 332, nous présente sous le règne d'Alexandre, Apelle, Antiphyle, Aristide le Thébain, Asclépiodore, Théomneste, Nicomaque, Mélanthius, Amphion, Nicophane, Aetion, Nicias d'Athènes, enfin Protogène et quelqu'autres peintres du premier mérite.
Tels ont été dans l'ordre chronologique les principaux peintres qui ont illustré la Grèce ; il s'agit maintenant d'entrer dans des détails plus intéressants, je veux dire, de faire connaître leurs caractères, leurs talents et leurs ouvrages. Je n'oublierai rien à tous ces égards pour satisfaire la curiosité des lecteurs, et pour leur commodité je vais suivre l'ordre alphabétique.
Aetion est fameux par sa belle et grande composition qui représentait le mariage d'Alexandre et de Roxane. Lucien décrit avec admiration ce chef-d'œuvre de l'art, et sur sa description on ne peut s'empêcher de convenir que ce tableau devait surpasser infiniment pour les grâces de l'invention et pour l'élégance des allégories, ce que nos plus aimables peintres et ce que l'Albane lui-même a fait de plus riant dans le genre des compositions galantes. Empruntons la traduction de M. l'abbé du Bos : elle est faite avec autant de goût et de choix d'expressions, que Pline en a mis en parlant du tombeau d'Aristide.
Roxane était couchée sur un lit ; la beauté de cette fille relevée encore par la pudeur lui faisait baisser les yeux à l'approche d'Alexandre, et fixait sur elle les premiers regards du spectateur. On la reconnaissait sans peine pour la figure principale du tableau. Les amours s'empressaient à la servir. Les uns prenaient ses patins et lui ôtaient ses habits, un autre amour relevait son voile, afin que son amant la vit mieux ; et par un sourire qu'il adressait à ce prince, il le félicitait sur les charmes de sa maîtresse. D'autres amours saisissaient Alexandre, et le tirant par sa cotte-d'armes, ils l'entrainaient vers Roxane dans la posture d'un homme qui voulait mettre son diadème aux pieds de l'objet de sa passion ; Ephestion, le confident de l'intrigue, s'appuyait sur l'hyménée, pour montrer que les services qu'il avait rendus à son maître avaient eu pour but de ménager entre Alexandre et Roxane une union légitime. Une troupe d'amours en belle humeur badinait dans un des coins du tableau avec les armes de ce prince.
L'énigme n'était pas bien difficîle à comprendre, et il serait à souhaiter que les peintres modernes n'eussent jamais inventé d'allégories plus obscures. Quelques-uns de ces amours portaient la lance d'Alexandre, et ils paraissaient courbés sous un fardeau trop pesant pour eux : d'autres se jouaient avec son bouclier : ils y avaient fait asseoir celui d'entr'eux qui avait fait le coup, et ils le portaient en triomphe tandis qu'un autre amour qui s'était mis en embuscade dans la cuirasse d'Alexandre, les attendait au passage pour leur faire peur. Cet amour embusqué pouvait bien ressembler à quelqu'autre maîtresse d'Alexandre, ou bien à quelqu'un des ministres de ce prince qui avait voulu traverser le mariage de Roxane.
Un poète dirait, ajoute M. l'abbé du Bos, que le dieu de l'hyménée se crut obligé de récompenser le peintre qui avait célébré si galamment un de ses triomphes. Cet artiste ingénieux ayant exposé son tableau dans la solennité des jeux olympiques, Pronéséides, qui devait être un homme de grande considération, puisque cette année-là il avait l'intendance de la fête, donna sa fille en mariage au peintre. Raphaël n'a pas dédaigné de crayonner le sujet décrit par Lucien. Son dessein a été gravé par un des disciples du célèbre Marc-Antoine. Enfin la poésie même s'en est parée. M. de Voltaire en a emprunté divers traits pour embellir la position d'Henri IV. et de Gabrielle d'Estrée dans le palais de l'amour. On sait par cœur les vers charmants qu'il a imités de l'ordonnance du tableau d'Aetion, ces vers qui peignent si bien la vertu languissante d'Henri IV.
Les folâtres plaisirs dans le sein du repos,
Les amours enfantins désarmaient ce héros ;
L'un tenait sa cuirasse encor de sang trempée,
L'autre avait détaché sa redoutable épée,
Et riait de tenir dans ses débiles mains
Ce fer l'appui du trône et l'effroi des humains.
Mais il faut convenir que c'est ici un des sujets où le peintre peut faire des impressions beaucoup plus touchantes que le poète. Il est aussi d'autres sujets plus avantageux pour le poète que pour le peintre.
Agatharque de Samos travailla le premier à la sollicitation d'Eschile, aux embellissements de la scène, selon les règles de la perspective sur laquelle il composa même un traité pour faire des décorations en ce genre. Plutarque, Vitruve et Suidas nous apprennent en même temps qu'il fleurissait vers la 75 olympiade, c'est-à-dire 480 ans avant J. C.
Aglaophon ; Athénée cite deux tableaux d'Aglaophon. Dans l'un Alcibiade revenant des jeux olympiques, était représenté, couronné par les mains d'une olympiade et d'une pythiade, c'est-à-dire par les déesses qui présidaient à ces jeux ; et dans l'autre il était couché sur le sein de la courtisanne Némea, comme se délassant de ses travaux. Ce dernier tableau d'Alcibiade nous rappelle celui que Lucrèce fait de Mars couché sur le sein de Vénus, morceau de poésie comparable aux plus beaux morceaux d'Homère. La grande gloire d'Aglaophon est d'avoir eu pour fils et pour élève le célèbre Polygnote.
Antidotus, élève d'Euphranor, diligentior quam numerosior, et in coloribus severus, dit Pline. Il fut plus soigneux que fécond, et très-exact dans sa couleur, c'est-à-dire qu'il observa la couleur locale, et qu'il ne s'écarta point de la vérité. Cet Antidotus eut pour élève Nicias, athénien, qui peignit si parfaitement les femmes, et dont il y aura de plus grands éloges à rapporter ; car il conserva avec soin la vérité de la lumière et celle des ombres, lumen et umbras custodivit ; c'est-à-dire qu'il y a mieux entendu le clair obscur ; et par une suite nécessaire, les figures de ses tableaux prenaient un grand relief, et les corps paraissaient saillans.
Antiphîle né en Egypte, contemporain de Nicias et d'Apelle, se montra fort étendu dans son art, et réussit également dans les grands et les petits sujets. Il peignit Philippe, et Alexandre encore enfant ; mais il s'acquit beaucoup plus de gloire par le portrait d'un jeune garçon qui soufflait le feu, dont la lueur éclairait un appartement d'ailleurs fort orné, et faisait briller la beauté du jeune homme. Pline loue cet ouvrage de nuit, et avec raison ; car il n'en faut pas davantage pour prouver que cette partie de la Peinture, qui consiste dans la belle entente des reflets et du clair-obscur, était connue de l'ingénieux Antiphile, quoique M. Perrault en ait refusé l'intelligence aux anciens.
Le même Antiphîle a été l'inventeur du grotesque ; il représenta dans ce goût Gryllus, apparemment l'olympionique de ce nom, que Diodore place à la cent douzième olympiade ; et le nom de Grillus fut conservé dans la suite à tous les tableaux que l'on voyait à Rome, et dont l'objet pouvait être plaisant ou ridicule. C'est ainsi que l'on a nommé en Italie depuis le renouvellement des arts, bambochades, les petites figures faites d'après le peuple, et que Pierre Van Laïr, hollandais, surnommé Bamboche par un sobriquet que méritait sa figure, avait coutume de peindre. C'est encore ainsi que nous disons une figure à Calot, quand elle est chargée de quelque ridicule, ou de quelque imperfection donnée par la nature, ou survenue par accident ; non que cet habîle dessinateur n'ait fait comme Antiphilus, des ouvrages d'un autre genre ; mais il est singulier de voir combien le monde se répète dans les opérations, dans celles même qui dépendent le plus de l'esprit.
Apaturius ; ce prestige de la Peinture qui consiste à éloigner des objets dans un tableau, faire fuir les uns et rapprocher les autres, est un prestige que connaissaient les anciens ; Apaturius en donna des preuves dans une décoration de théâtre qu'il fit à Tralles, ville de Lydie. Nous en parlerons au mot PERSPECTIVE. C'est Vitruve seul, liv. VII. chap. Ve qui nous a conservé le souvenir du peintre Apaturius, sans nous apprendre ni sa patrie, ni dans quel temps il vivait.
Apelle né l'an du monde 3672 ; il eut au degré le plus éminent la grâce et l'élégance pour caractériser son génie, le plus beau coloris pour imiter parfaitement la nature, le secret unique d'un vernis pour augmenter la beauté de ses couleurs, et pour conserver ses ouvrages. Il se décéla à Protogène par sa justesse dans le dessein, en traçant des contours d'une figure (lineas) sur une toile. Il inventa l'art du profil pour cacher les défauts du visage. Il fournit aux Astrologues par ses portraits, le secours de tirer l'horoscope, sans qu'ils vissent les originaux. Il mit le comble à sa gloire par son tableau de la calomnie, et par sa Vénus Anadyomène, que les Poètes ont tant célébrée, et qu'Auguste acheta cent talents, c'est-à-dire selon le P. Bernard, environ vingt mille guinées, ou selon Mrs. Belley et Barthelemi, 470000 liv. de notre monnaie. Enfin Apelle contribua lui seul plus que tous les autres artistes ensemble, à la perfection de la Peinture par ses ouvrages et par ses écrits, qui subsistaient encore du temps de Pline. Contemporain d'Aristote et d'Alexandre, l'un le plus grand philosophe, l'autre le plus grand conquérant qu'il y ait jamais eu dans le monde, Apelle est aussi le plus grand peintre.
Il vivait vers la cent douzième olympiade ; il était de Cos selon Ovide, d'Ephese suivant Strabon ; et si l'on en croit Suidas, il était originaire de Colophon, et devint citoyen d'Ephese par adoption. Cette diversité de sentiments semble indiquer que plusieurs villes se disputaient l'honneur d'avoir donné naissance à ce grand peintre, comme d'autres villes se sont disputé l'honneur d'être la patrie d'Homère.
Les habitants de Pergame achetèrent des deniers publics, un palais ruiné, où il y avait quelques peintures d'Apelle, non-seulement, dit Solin, pour empêcher les araignées de tendre leurs toiles dans une maison que les ouvrages de cet excellent artiste rendaient respectable, mais encore pour les garantir des ordures des oiseaux. Les citoyens de Pergame firent plus, ils y suspendirent le corps d'Apelle dans un reseau de fil d'or. On pourrait expliquer ce passage en imaginant qu'ils firent couvrir et réparer ce vieux palais, qui sans doute était inhabité, et dont nous dirions aujourd'hui que c'était un nid de chauve-souris, etc. Par cette explication, le récit de Solin n'aurait rien de ridicule ; mais il n'importe, il suffit de croire que tous les soins qu'on prit, eurent pour objet l'illustration de la mémoire d'Apelle, et la conservation de ses ouvrages ; leur beauté n'ôtait rien à la ressemblance, ce qui fit dire à Appion d'un métoposcope, qu'il dressait des jugements certains sur le front d'une tête tirée de la main d'Apelle.
C'est le peintre sur lequel Pline, ainsi que tous les auteurs, s'est le plus étendu, et dont il a le mieux parlé. Voici un de ses passages : Pinxit et quae pingi non possunt, tonitrua, fulgura, fulgetraque, bronten, astrapen : ceraunobolian appelant : inventa ejus, et caeteris proficère in arte. Toutes ces différences de noms données autrefois à la foudre, ne conviennent plus à la simplicité de nos principes physiques ; mais il semble que l'art devait être bien resserré dans les grands effets de la nature avant Apelle, si elle lui a l'obligation dont parle Pline.
Il avait représenté Alexandre ayant le foudre en main : digiti eminere videntur, et fulmen extrà tabulam esse. Cette attitude indique un raccourci des plus nobles et des plus heureux, et cette description est vraiment faite par un homme de l'art, car Raphaël ne se serait pas exprimé autrement, en parlant d'un tableau de Michel-Ange : " la main était saillante, et le foudre paraissait hors de la toile. "
On ne peut se résoudre à quitter Apelle ; cet homme qui a réuni tant de qualités du cœur et de l'esprit, qui a joint l'élevation du talent à celle du génie, et qui a été enfin assez grand pour se louer sans partialité, et pour se blâmer avec vérité ; on ne peut, dis-je, le quitter sans parler de l'idée que donne la description d'un de ses ouvrages. C'est le tableau de Diane et de ses nymphes, dont Pline dit : quibus vicisse Homeri versus videtur idipsum describentis. L'admiration que l'on a pour Homère, lui que Phidias voulut prendre pour son seul guide dans l'exécution de Jupiter, qui lui fit un honneur immortel, la supériorité que l'antiquité accorde à Apelle, enfin la réunion de ces deux grands hommes fera toujours regretter ce tableau.
Pline parle fort noblement de la Vénus d'Apelle, que la mort l'empêcha d'achever, et que personne n'osa finir. " Elle causait plus d'admiration, dit-il, que si elle avait été terminée, car on voit dans les traits qui restent, la pensée de l'auteur ; et le chagrin que donne ce qui n'est point achevé, redouble l'intérêt ".
Le même Pline, pour caractériser encore plus particulièrement Apelle, dit de lui, praecipua ejus in arte venustas fuit. La manière qui le rendit ainsi supérieur, consistait dans la grâce, le gout, la fonte, le beau choix, et pour faire usage d'un mot qui réunisse une partie des idées que celui de venustas nous donne, dans la morbidezza, terme dont les Italiens ont enrichi la langue des artistes. Quoiqu'il soit difficîle de refuser des talents supérieurs à quelques-uns des peintres qui ont précédé celui-ci, il faut convenir que toute l'antiquité s'est accordée pour faire son éloge ; la justesse de ses idées, la grandeur de son âme, son caractère enfin, doivent avoir contribué à un rapport unanime. Il recevait le sentiment du public pour se corriger, et il l'entendait sans en être Ve ; sa réponse au cordonnier devint sans peine un proverbe, parce qu'elle est une leçon pour tous les hommes ; ils sont trop portés à la décision, et sont en même temps trop paresseux pour étudier.
Enfin Apelle fut in aemulis benignus, et ce sentiment lui fit d'autant plus d'honneur, qu'il avait des rivaux d'un grand mérite. Il trouvait qu'il manquait dans tous les ouvrages qu'on lui présentait, unam Venerem, quam Graeci charita vocant ; caetera omnia contigisse : sed hac solâ sibi neminem parem. Il faut qu'il y ait eu une grande vérité dans ce discours, et qu'Apelle ait possédé véritablement les grâces, pour avoir forcé tout le monde d'en convenir, après l'aveu qu'il en avait fait lui-même. Cependant lorsqu'il s'accordait si franchement ce qui lui était dû. il disait avec la même vérité, qu'Amphion le surpassait pour l'ordonnance, et Asclépiodore pour les proportions ou la correction. C'est ainsi que Raphaël, plein de justesse, de grandeur et de grâces, parvenu au comble de la gloire, reconnaissait dans Michel-Ange une fierté dans le goût du dessein qu'il chercha à faire passer dans sa manière ; et cette circonstance peut servir au parallèle de Raphaël et d'Apelle.
Apollodore, athénien, vivait dans la quatre-vingt-quatorzième olympiade, l'an du monde 3596. Il fut le premier qui représenta la belle nature, qui à la correction du dessein, mit l'entente du coloris, cette magie de l'art qui ne permet point à un spectateur de passer indifféremment, mais qui le rappelle et le force pour ainsi dire, de s'arrêter ; Apollodore par son intelligence dans la distribution des ombres et des lumières, porta la Peinture à un degré de force et de douceur, où elle n'était point parvenue avant lui. On admirait encore du temps de Plutarque, le prêtre prosterné, et l'Ajax foudroyé de ce grand maître. Pline le jeune avait un vieillard debout de la main de cet artiste, qu'il ne se lassait point de considérer. En un mot, dit-il dans la description qu'il en fait, tout y est d'une beauté à fixer les yeux des maîtres de l'art, et à charmer les yeux des plus ignorants.
Apollodore profita des lumières de ceux qui l'avaient précédé. Pline en parle en ces termes, liv. XXXV. ch. ix. Hic primus species exprimère instituit, primusque gloriam, penicillo jure contulit : ce que M. de Caylus traduit ainsi : " Il fut le premier qui exprima la couleur locale, et qui établit une réputation sur la beauté de son pinceau ". On voit par-là, que du temps de Pline, et sans doute dans la Grèce, la couleur et le pinceau étaient synonymes, comme ils le sont aujourd'hui. Avant Apollodore, aucun tableau ne mérita d'être regardé, ou de fixer la vue, quae teneat oculos. En un mot, Apollodore ouvrit une nouvelle carrière, donna naissance au beau siècle de la Peinture, et fut le premier dont les tableaux aient arrêté et tenu comme immobiles les yeux des spectateurs.
Arcésilas ; il y a eu deux anciens peintres de ce nom, et un statuaire. Le plus illustre des peintres était de Paros, et vivait à peu-près dans le même temps que Polygnote, vers la quatre-vingt-dixième olympiade. C'est au rapport de Pline, un des plus anciens peintres qui aient peint sur la cire et sur l'émail. Pausanias nous apprend qu'entre les choses curieuses qu'on voyait au Pirée, était un tableau d'Arcésilas qui représentait Léosthene et ses enfants ; c'est ce Léosthene qui commandant l'armée des Athéniens, remporta deux grandes victoires ; l'une en Béotie ; l'autre au-delà des Thermopiles, auprès de la ville de Lamia.
Aristide, natif de Thebes, contemporain d'Apelle, est un peu plus ancien. Quoiqu'il n'eut pas ses grâces et son coloris, ses ouvrages étaient d'un prix immense. La bataille qu'il peignit des Grecs contre les Perses, où il fit entrer dans un seul cadre jusqu'à cent personnages, fut achetée plus de 78000 liv. de notre monnaie, par le tyran Mnason. Aristide excella surtout à exprimer également les passions douces, et les passions fortes de l'âme. Attale donna cent talents, environ vingt mille louis, d'un tableau où il ne s'agissait que de la seule expression d'une passion languissante. Le même prince offrit six mille grands sesterces, c'est-à-dire environ 750000 liv. d'un autre tableau qui se trouvait dans le butin que Mummius fit à Corinthe ; le général romain sans connaître le prix des beaux arts, fut si surpris de cette offre splendide, qu'il soupçonna une vertu secrète dans le tableau, et le porta à Rome ; mais cette vertu secrète n'était autre chose que le touchant et le pathétique qui régnait dans ce chef-d'œuvre de l'art. En effet, on ne peut voir certaines situations, sans être ému jusqu'au fond de l'âme. Ce chef-d'œuvre qui représentait un Bacchus était si célèbre dans la Grèce, qu'il avait passé en proverbe, ou plutôt il servait de comparaison, car on disait beau comme le Bacchus.
Pline parle à sa manière, c'est-à-dire comme Rubens aurait pu faire d'un tableau de Raphael ; Pline, dis-je, parle avec les couleurs d'un grand maître d'un autre tableau, où le célèbre artiste de Thebes avait représenté dans le sac d'une ville, une femme qui expire d'un coup de poignard qu'elle a reçu dans le sein. Un enfant, dit-il, à côté d'elle, se traine à sa mamelle, et Ve chercher la vie entre les bras de sa mère mourante : le sang qui l'inonde ; le trait qui est encore dans son sein ; cet enfant que l'instance de la nature jette entre ses bras ; l'inquiétude de cette femme sur le sort de son malheureux fils, qui vient au lieu du lait sucer avidement le sang tout pur ; enfin le combat de la mère contre une mort cruelle ; tous ces objets représentés avec la plus grande vérité, portaient le trouble et l'amertume dans le cœur des personnes les plus indifférentes. Ce tableau était digne d'Alexandre, il le fit transporter à Pella, lieu de sa naissance.
Aristolaus, fils et élève de Pausias, severissimis pictoribus fuit, fut un des peintres qui prononça le plus son dessein, et dont la couleur fut la plus fière, ou plutôt la plus austère ; car ce terme de severus, si souvent répété par Pline, parait consacré à la Peinture, et parait répondre pleinement à celui d'austère, que nous employons ce me semble, en cas pareil.
Asclépiodore, excellent peintre, et dont les tableaux étaient si recherchés, que Mnason tyran d'Elatée, homme vraiment curieux, lui paya trois cent mines, vingt-trois mille cinq cent livres, pour chaque figure de divinités qu'il avait peintes au nombre de douze ; ce qui fait en tout, trois mille six cent mines, deux cent quatre-vingt-deux mille livres. Le même tyran donna encore à Théomneste autre artiste, cent mines, ou plus de sept mille huit cent livres, pour chaque figure de héros ; et s'il y en avait aussi douze, c'était quatre-vingt-quatorze mille livres. Asclépiodore et Théomneste paraissent donc se rapporter au temps d'Aristide, et avoir été un peu plus anciens qu'Apelle. On peut placer vers le même temps Amphion, dont Apelle reconnaissait la supériorité pour l'ordonnance, comme il reconnaissait la supériorité d'Asclépiodore pour la justesse des proportions.
Athénion de Maronée, était élève de Glaucion de Corinthe : voici, dit Pline, son caractère quant à la peinture : Austerior colore et in austeritate jucundior, ut in ipsâ picturâ eruditio eluceat. Fier, exact, et un peu sec dans sa couleur, cependant agréable à cause du savoir et de l'esprit qu'il mettait dans ses compositions. Nos peintres devraient bien profiter de cet exemple, pour ne pas négliger les belles-Lettres, dont la connaissance est si propre à rendre leurs travaux recommandables. Nous avons peu de peintres savants et instruits comme l'étaient les Grecs ; on peut nommer parmi les Italiens, Léonard de Vinci, le Ridotti, Baglione, Lomazzo, Armenini, Scaramucia, Vazari, et plusieurs autres ; mais les François n'en comptent que trois ou quatre, Dufresnoy, Antoine, et Charles Coypel.
Bularque, fleurissait du temps de Candaule roi de Lydie, qui lui acheta au poids de l'or un tableau de la défaite des Magnetes ; or Candaule mourut dans la dix-huitième olympiade, l'an 708 avant l'ère chrétienne. Ainsi Bularchus a vécu postérieurement à l'ère de Rome, et vers l'an 730 avant J. C. Pline, en disant que les peintres monochromes avaient précédé Bularque, fait clairement entendre que ce fut ce peintre qui le premier introduisit l'usage de plusieurs couleurs dans un seul ouvrage de peinture. C'est donc à-peu-près vers l'an 730 avant J. C. qu'on peut établir l'époque de la peinture polychrome, et vraisemblablement l'époque de la représentation des batailles dans des ouvrages de peinture. Ce fut aussi l'époque du clair obscur ; Pline assure qu'au moyen de la pluralité des couleurs qui se firent mutuellement valoir, l'art jusques-là trop uniforme se diversifia, et inventa les lumières et les ombres ; mais puisqu'il ajoute que l'usage du coloris, le mélange, et la dégradation des couleurs, ne furent connus que dans la suite, il faut que le clair obscur de Bularchus ait été fort imparfait, comme il arrive dans les commencements d'une découverte.
Caladès vécut à-peu-près dans la cent-sixième olympiade, et peignit de petits sujets que l'on mettait sur la scène dans les comédies, in comicis tabellis ; mais l'usage de ces tableaux nous est inconnu ; peut-être qu'à ce terme comicis, répond le titre , donné par Elien, var. hist. 43. à des peintres, qui pour apprêter à rire, représentèrent Timothée, général des Athéniens endormi dans sa tente, et par-dessus sa tête la Fortune emportant des villes d'un coup de filet. Dans la pluralité de ces peintres, pour un seul sujet de peinture, on découvre d'abord la catachrèse d'un pluriel pour un singulier. C'était un seul peintre , qui avait ainsi donné la comédie aux dépens de Timothée, et le peintre borné à ces sortes de tableaux comiques, comicis tabellis, était Caladès. M. de Caylus donne à l'expression de Pline une autre idée, mais qu'il ne propose que comme un doute. Il croit que les ouvrages de Caladès pouvaient être la représentation des principales actions des comédies que l'on devait donner. C'est un usage que les Italiens pratiquent encore aujourd'hui ; car on voit sur la porte de leurs théâtres, les endroits les plus intéressants de la pièce qu'on doit jouer ce même jour ; et cette espèce d'annonce représentée en petites figures coloriées sur des bandes de papier, est exposée dès le matin. Le motif aujourd'hui est charlatan ; chez les anciens il avait d'autres objets ; l'instruction du peuple, pour le mettre plus au fait de l'action, le désir de le prévenir favorablement ; enfin, l'envie de l'occuper quelques moments de plus par des peintures faites avec soin.
Calliclès peignit en petit, selon Pline, de même que Caladès, parva et Callicles fecit. Ses tableaux, disait Varron, n'avaient pas plus de quatre pouces de grandeur, et il ne put jamais parvenir à la sublimité d'Euphranor. Il fut donc postérieur à ce dernier ; ce qui détruit l'idée où était le père Hardouin, que le peintre Calliclès a pu être le même que le sculpteur Calliclès, qui fit la statue de Diagoras, vainqueur aux jeux olympiques, en l'an 464 avant l'ère chrétienne.
Cimon cléonien ; il trouva la manière de faire voir les figures en raccourci, et de varier les attitudes des têtes. Il fut aussi le premier qui représenta les jointures des membres, les veines du corps, et les différents plis des draperies. C'est ce qu'en dit Pline, liv. XXXV. ch. VIIIe entrons avec M. de Caylus, dans des détails de l'art que Cimon fit connaître.
La Peinture était bornée dans son premier âge à former une tête, un portrait ; on ne représentait encore les têtes que dans un seul aspect, c'est-à-dire de profil. Cimon hasarda le premier d'en dessiner dans toutes sortes de sens contraires à celui-ci ; et il mit par ce moyen une grande variété dans la représentation des têtes. Celles qu'il dessinait, regardaient tantôt le spectateur, c'est-à-dire, qu'elles se présentaient de face : quelquefois il leur faisait tourner la vue vers le ciel, et d'autres fois il les faisait regarder en-bas. Il ne s'agissait cependant encore que de positions, et non d'expressions et de sentiments. Le grand art de Cimon consistait donc à avoir, pour ainsi dire, ouvert le premier la porte au raccourci ; ce premier pas était d'une grande importance, et il méritait bien qu'on lui en fit honneur. Peut-être fit-il passer dans les attitudes de ses figures la même variété de position qu'il avait imaginé d'introduire dans ses têtes, quoique Pline n'en dise rien, et qu'il faille en effet ne point trop donner aux Artistes dans ces premiers commencements de la Peinture, où tout doit marcher pas à pas.
Quant aux autres progrès que Cimon avait fait faire à la Peinture, ils n'étaient pas moins importants. Il entendit mieux que ceux qui l'avaient précédé, les attachements sans quoi les figures paraissent un peu roides, et d'une seule pièce ; défaut ordinaire des Artistes qui ont paru dans tous les temps. Lorsque la Peinture était encore dans son enfance, les mains et les bras, les pieds et les jambes, les cuisses et les hanches, la tête et le col, etc. tout cela dans leurs ouvrages était comme on dit, tout d'une venue, et les figures n'avaient aucun mouvement. Cimon avait entrevu la nécessité de leur en prêter : il avait commencé par donner à ses têtes des mouvements diversifiés ; il étendit cet art aux autres parties de ses figures ; ce qui ne pouvait se faire qu'en attachant avec justesse chaque membre ensemble.
Venas protulit, dit Pline : il fit paraitre les veines, c'est-à-dire, que s'étant aperçu des effets que le mouvement produit sur le naturel, en changeant la situation des muscles toutes les fois que la figure prend une nouvelle situation, il essaya d'en enrichir la Peinture ; il commença par la représentation des veines ; il était bien près de connaître l'usage et l'office des muscles. Comme l'art de la Peinture n'avait point fait ce même progrès dans la couleur que dans le dessein, il n'est pas vraisemblable que le mot venae soit ici une expression figurée de Pline, pour signifier que Cimon avait animé la couleur, et qu'il y avait pour ainsi dire mis du sang.
Praeter ea, in veste et rugas et sinus invenit, ajoute Pline. Avant Cimon tout était comme l'on voit extrêmement informe dans la Peinture : les figures vues de profil, ne savaient se présenter que dans un seul aspect ; les habillements étaient exprimés tout aussi simplement ; une draperie n'était qu'un simple morceau d'étoffe qui n'offrait qu'une surface unie. Entre les mains de Cimon, cette draperie prend un caractère ; il s'y forme des plis ; on y voit des parties enfoncées, d'autres parties éminentes qui forment des sinuosités, telles que la nature les donne, et que doit prendre une étoffe jetée sur un corps qui a du relief.
Pline a écrit de la Peinture, comme aurait pu faire un homme de l'art qui aurait eu son génie. Il s'attache moins à donner l'énumération et la description des ouvrages, qu'à établir le caractère de chaque maître ; et quoiqu'il le fasse avec une extrême concision, chaque peintre est caractérisé et rendu reconnaissable. Voici tout le passage de Pline : Hic Cimon, catagrapha invenit, hoc est obliquas imagines, et variè formare vultus, respicientes, suscipientes, et despicientes ; articulis etiam membra distinxit, venas protulit, praeterque in veste et rugas et sinus invenit. Il faut donc entendre par le mot grec catagrapha, et en latin obliquas imagines, non des visions ou des figures de profil, comme le père Hardouin le croit, mais des têtes vues en raccourci. Le mot imago ne doit point être pris ici pour une figure mais seulement pour une tête, un portrait.
Cléophante de Corinthe, est l'inventeur de la peinture monochrome, ou proprement dite. Il débuta par colorier les traits du visage avec de la terre cuite et broyée ; ainsi la couleur rouge, comme la plus approchante de la carnation, fut la première en usage. Les autres peintres monochromes, et peut-être Cléophante lui-même, varièrent de temps en temps dans le choix de la couleur des figures, différente de la couleur du fond. Peut-être aussi qu'ils mirent quelquefois la même couleur pour le fond, et pour les figures ; on peut le présumer par l'exemple de quelques-uns de nos camayeux, pourvu qu'on n'admette point dans les leurs l'usage du clair obscur, dont la découverte accompagna l'introduction de la peinture polychrome, ou de la pluralité des couleurs.
Clésidès vivait vers l'an du monde 3700. On rapporte que voulant se vanger de la reine Stratonice, femme d'Antiochus I. du nom, roi de Syrie, il la représenta dans une attitude indécente, et exposa son tableau en public : mais cette princesse était peinte avec tant de charmes dans ce tableau de Clésidès, que sa vanité, ou peut-être son bon caractère, lui persuada de pardonner à la témérité de l'artiste, de le récompenser, et de laisser son ouvrage où il l'avait placé. Quoiqu'il en sait, elle montra beaucoup de grandeur et de sagesse, en ne punissant point Clésidès qui l'avait peinte entre les bras d'un pêcheur qu'on l'accusait d'aimer, et qui avait exposé son tableau sur le port d'Ephèse. Michel-Ange, Paul Veronese, le Zuchero, et quelques autres modernes, n'ont que trop imité Clésidès, pour satisfaire leur vengeance.
Craterus d'Athènes, avait un talent particulier pour peindre merveilleusement le grotesque, et il orna de ses ouvrages en ce genre le Panthéon d'Athènes, cet édifice superbe où l'on faisait tous les préparatifs pour la célébration des fêtes solennelles. Craterus est le Teniers des Athéniens.
Ctésiloque, disciple d'Apelle, petulanti picturâ innotuit, se fit connaître par la fougue du pinceau, obéissant à la vivacité du génie ; c'est ainsi que M. de Caylus traduit ce passage, un peu en amateur de peinture ; mais il reconnait avec raison que l'on peut lui donner un autre sens, car Pline ajoute tout de suite, Jove Liberum parturiente depicto mitrato et muliebriter ingemiscente inter obstetricia dearum. Cette peinture ridicule pour un dieu comme Jupiter, est forte pour un payen, et peut être surement traitée d'insolente ; car peut-on penser autrement d'un tableau qui représente le maître des dieux accouchant de Bacchus, et coèffé en femme, avec les contorsions de celles qui sont en travail, et avec le cortege des déesses pour accoucheuses ? Cléside, avons-nous dit ci-dessus, peignit une reine d'Egypte dans une attitude encore plus indécente ; mais ce n'était qu'une reine, et il la peignit très-belle. Pline dans son histoire, met en contraste ces peintres téméraires avec Habron, qui peignit la Concorde et l'Amitié, avec Nicéarque qui représenta Hercule confus, humilié de ses accès de rage, et avec d'autres artistes qui avaient consacré leurs ouvrages à la gloire de la vertu ou de la religion.
Cydias de Cytnos, était contemporain d'Euphranor, et comme lui peintre encaustique ; il fit entr'autres ouvrages un tableau des Argonautes.
Damophîle et Gorgasus sont joints ensemble dans Pline ; c'étaient deux habiles ouvriers en plastique, et en même temps ils étaient peintres. Ils mirent des ornements de l'un et l'autre genre au temple de Cérès, ornements de plastique au haut de l'édifice, et ornements de peinture à fresque sur les murs intérieurs, avec une inscription en vers grecs, qui marquait que le côté droit était l'ouvrage de Damophile, et le côté gauche l'ouvrage de Gorgasus. Avant l'arrivée de ces deux peintres grecs à Rome, les temples de la ville n'avaient eu, suivant la remarque de Pline, que des ornements de goût étrusque, c'est-à-dire des ouvrages de plastique et de sculpture à l'ancienne façon des Etrusques, et non des ouvrages de peinture, qui dans l'Etrurie même étaient d'un goût grec. On peut donc placer au temps de Damophîle et de Gorgasus l'introduction et l'époque de la Peinture dans la ville de Rome, vers l'an 424 avant l'ère chrétienne.
Démon, natif d'Athènes, vivait du temps de Parrhasius et de Socrate, vers la 93 olympiade, et environ 408 ans avant J. C. Il s'attachait fort à l'expression, et fit plusieurs tableaux qu'on estima beaucoup. Il y en avait entr'autres un à Rome qui représentait un prêtre de Cybele, que Tibere acheta 60 grands sesterces. Démon fit aussi un tableau d'Ajax en concurrence avec Timanthe, mais l'Ajax de Timanthe fut préféré.
Denys ou plutôt Dionysius, de Colophone, ne fit que des portraits, et jamais des tableaux, d'où lui vint à juste titre, dit Pline, liv. XXXV. ch. Xe le surnom d'antropographus, c'est-à-dire, peintre d'hommes. Nous avons eu dans le XVIe siècle, un peintre flamand semblable en cela de fait et de nom (car on le nommait en latin Dionysius) au peintre de Pline, et les deux Denys ne sont pas les seuls qui aient préféré ce genre de peinture à tout autre, par la raison qu'il est le plus lucratif : mais ce n'est pas le plus honorable.
Erigonus, broyeur de couleur de Néalcis, devint un très-bon peintre, et eut pour élève Pausias, qui se rendit célèbre ; c'est ainsi que Polidore, après avoir porté le mortier aux disciples de Raphael, se sentit en quelque sorte inspiré à la vue des merveilles qui s'opéraient sous ses yeux, étudia la Peinture, dessina l'antique, et devint à son tour élève de Raphael, et eut le plus de part à l'exécution des loges de ce grand maître.
Eumarus d'Athènes, peintre monochrome, est nommé dans Pline avec Cimon de Cléone. Eumarus marqua le premier dans la peinture la différence de l'homme et de la femme, dont on ne peignait auparavant que la tête et le buste ; il osa aussi ébaucher toutes sortes de figures, les autres peintres s'étant toujours bornés à celle de l'homme. Cimon enchérit sur les découvertes d'Eumarus, il inventa les divers aspects du visage, distingua l'emmanchement des membres, fit paraitre les veines à-travers la peau, et trouva même le jet des draperies. Voyez son article.
Euphanor, natif des environs de Corinthe dans l'isthme, fleurissait dans la cent quatrième olympiade, et fut en même temps célèbre statuaire, et célèbre peintre encaustique. On trouve les deux genres réunis dans les artistes de l'antiquité, comme ils ont été depuis dans Michel-Ange à la renaissance de la Peinture. Euphranor fut le premier qui donna dans ses tableaux un air frappant de grandeur à ses têtes de héros et à toute leur personne, et le premier qui employa dans l'encaustique, la justesse des proportions que Parrhasius avait introduite dans la peinture ordinaire.
Pline parlant d'Euphranor, en dit tout ce qu'on en peut dire de flatteur pour un artiste. Voici ses paroles : Docilis ac laboriosus, et in quocumque genere excellents, ac sibi aequalis. Si ces épithetes se rapportaient à l'art, Le Dominiquain pourrait lui servir de comparaison. Docîle aux leçons de la nature, le travail ne l'effrayait point ; une persévérance et une étude constante de cette même nature, l'ont élevé au-dessus des autres artistes. Pline regarde Euphranor le premier qui a donné aux héros un caractère qui leur fut convenable, hic primus videtur expressisse dignitates heroum. Il serait aisé d'en conclure que tous les héros représentés avant lui, n'auraient pas mérité les éloges que Pline lui-même a donnés aux artistes plus anciens ; cependant l'on ne doit reprocher à l'historien naturaliste qu'une façon de parler trop générale, et un peu trop répétée ; on peut dire sur le cas présent, qu'il y a plusieurs degrés dans l'excellence. Titien est un grand peintre de portraits : Vandick a mis dans ce genre plus de finesse, de délicatesse et de vérité. Titien n'en est pas pour cela un peintre médiocre. Mais ce dont il faut savoir un très-grand gré à Pline, c'est la critique dont il accompagne assez souvent les éloges ; car après avoir dit d'Euphranor, usurpasse symmetriam, c'est-à-dire qu'il s'était fait une manière dont il ne sortait point ; il ajoute : sed fuit universitate corporum exilior, capitibus, articulisque grandior. Cette manière était apparemment dans le goût de celle que nous a laissé le Parmesan ; je sais qu'elle est peut-être blâmée, mais elle est bien élégante. Il est vrai qu'on ne peut reprocher au peintre moderne d'avoir fait comme Euphranor, ses têtes sont trop fortes, et ses emmanchements trop nourris.
Euphranor a écrit plusieurs traités sur les proportions et les couleurs. Il est singulier qu'un peintre qui a mérité qu'on le reprit sur les proportions, ait écrit sur cette matière ; cependant la même chose est arrivée depuis le renouvellement des arts à Albert Durer.
Gorgasus et Damophile, habiles ouvriers en plastique, et en même temps peintres, sont joints ensemble dans Pline. Voyez ci-dessus Damophîle et Gorganus.
Ludius, peintre d'Ardéa, parait avoir vécu pour le plus tard vers l'an 765 avant l'ère chrétienne. Il ne faut pas oublier, dit Pline, liv. XXXV. ch. Xe le peintre du temple d'Ardéa, ville du Latium, surtout puisqu'elle l'honora, continue-t-il, du droit de bourgeoisie, et d'une inscription en vers qu'on joignit à son ouvrage. Comme l'inscription et la peinture à fresque se voyaient encore sur les ruines du temple au temps de Pline, il nous a conservé l'inscription en quatre anciens vers latins ; elle porte que le peintre était Ludius, originaire d'Etolie. Oui, dit-il ailleurs, il subsiste encore aujourd'hui dans le temple d'Ardéa des peintures plus anciennes que la ville de Rome, et il n'y en a point qui m'étonnent comme celles-ci, de se conserver si longtemps avec leur fraicheur, sans qu'il y ait de tait qui les couvre.
Il parle ensuite de quelques peintures du même Ludius extrêmement belles, et également bien conservées à Lanuvium, autre ville du Latium, et d'autres peintures encore plus anciennes, qu'on voyait à Caeré ville d'Etrurie. Quiconque voudra, conclut-il, les examiner avec attention, conviendra qu'il n'y a point d'art qui se soit perfectionné plus vite, puisqu'il parait que la Peinture n'était point encore connue du temps de la guerre de Troie. Ce raisonnement suppose une origine grecque aux peintures de Caeré, comme à celles d'Ardéa ; à la peinture étrusque, comme à la peinture latine.
Lysippe d'Egine, peintre encaustique, vécut entre Polygnote et le sculpteur Aristide, c'est-à-dire, entre l'an 430 et l'an 400 avant l'ère chrétienne. Un de ses tableaux qu'on voyait à Rome, portait pour inscription Lysippe m'a fait avec le feu ; c'est la plus ancienne des trois inscriptions, un tel m'a fait, qui paraissent à Pline des inscriptions singulières dans l'antiquité, au lieu de la formule plus modeste, un tel me faisait. Les deux autres inscriptions étaient l'une au bas d'une table qu'on voyait à Rome au comice, et qu'on donnait à Nicias, l'autre qui lui servait de pendant, était l'ouvrage de Philocharès : voici présentement la remarque de Pline sur ces trois inscriptions dans sa préface de l'histoire naturelle.
" Vous trouverez, dit-il, dans la suite de cette histoire, que les maîtres de l'art, après avoir travaillé et terminé des chefs-d'œuvres de peinture et de sculpture, que nous ne pouvons nous lasser d'admirer, y mettaient pour toute inscription les paroles suivantes, qui pouvaient marquer des ouvrages imparfaits : Apelle ou Polyclete faisait cela. c'était donner leur travail comme une ébauche, se ménager une ressource contre la critique, et se réserver jusqu'à la mort, le droit de retoucher et de corriger ce qu'on aurait pu y trouver de défectueux ; conduite pleine de modestie et de sagesse, d'avoir employé partout des inscriptions pareilles, comme si chaque ouvrage particulier eut été le dernier de leur vie, et que la mort les eut empêchés d'y mettre la dernière main. Je crois que l'inscription précise et déterminée un tel l'a fait, n'a eu lieu qu'en trois occasions. Plus cette dernière formule annonçait un homme content de la bonté de ses ouvrages, plus elle lui attirait de censeurs et d'envieux. "
Ainsi parle Pline, dont les yeux, peut-être quelquefois trop délicats, étaient blessés des plus petites apparences de vanité et d'amour propre.
Méchopane était élève de Pausias : sunt quibus placeat diligentiâ quam intelligant soli artifices, alias durus in coloribus, et sîle multus. Ces termes veulent dire que sa couleur a été crue, et qu'il a trop donné dans le jaune : les modernes offrent sans peine de pareils exemples ; mais l'intelligence, les soins ou la précision, qui ne sont connus que des seuls artistes, présentent une vue bien délicate et bien vraie.
Mélanthius. Plutarque rapporte que Aratus, qui aimait la peinture, et qui s'y connaissait, ayant délivré Sycione sa patrie des tyrants qui l'opprimaient, résolut de détruire les monuments qui rappelaient leur souvenir. Il y avait dans la ville un tableau fameux, où Mélanthius aidé de ses élèves, parmi lesquels était Apelle, avait représenté Aristrate, l'un de ces tyrants, monté sur un char de triomphe.
Dans le premier moment Aratus ordonna de le détruire, mais se rendant bientôt aux raisons de Néalque, peintre habile, qui demandait grâce pour une aussi belle peinture, et qui lui faisait entendre que la guerre qu'il avait déclarée aux tyrants, ne devait pas s'étendre aux arts, il le fit consentir que la seule figure d'Aristrate serait effacée ; ainsi on laissa subsister celle de la Victoire et le char ; et Néalque qui s'était chargé de cette opération, mit seulement une palme à la place de la figure, et cela par respect pour un ouvrage sur lequel il ne croyait pas que personne osât mettre la main.
Dans ce dernier passage on voit deux témoignages bien précis de la considération dans laquelle étaient chez les Grecs les ouvrages des grands maîtres. Un prince fait céder des raisons d'état et de politique à la conservation d'un tableau dont la mémoire était odieuse, mais qui n'en était pas moins admirable par la beauté de son exécution. Un peintre habîle en connait l'excellence, et préfère la gloire d'avoir contribué à sa conservation, à celle qu'il aurait pu acquérir en le peignant de nouveau, ou du moins en y mettant une nouvelle figure de sa façon.
Au reste, Pline nomme Mélanthius au nombre des peintres dont les chefs-d'œuvres avaient été faits avec quatre couleurs seulement. Plutarque ajoute que dans le tableau du tyran de Sicyone, Mélanthius y travailla conjointement avec les autres de sa volée, mais que Apelle, qui était du nombre, n'y toucha que du bout du doigt, c'est apparemment parce qu'il était encore trop jeune.
Métrodore fut choisi par les Athéniens pour être envoyé à Paul Emile, qui après avoir pris Persée, roi de Macédoine, leur avait demandé deux hommes de mérite, l'un pour l'éducation de ses enfants, et l'autre pour peindre son triomphe. Il témoigna souhaiter ardemment que le précepteur fût un excellent philosophe. Les Athéniens lui envoyèrent Metrodore qui excellait tout ensemble, et dans la Philosophie, et dans la peinture. Paul Emîle fut très-content à ces deux égards, de leur choix : c'est Pline qui raconte ce fait, liv. XXXV. ch. XIe mais sans entrer dans d'autres détails sur les ouvrages de Métrodore ; ce qu'on peut dire de certain, c'est que s'il a réussi dans ses tableaux, comme dans son élève P. Scipion, il faut le regarder comme un des grands peintres de l'antiquité. Le P. Hardouin n'a commis que des erreurs au sujet de ce philosophe et de cet artiste, qui fleurissait dans la 150e. olympiade.
Micon était contemporain, rival et ami de Polygnote. Pline nous apprend que tous les deux furent les premiers qui firent usage de l'ocre jaune, et que tous deux peignirent à fresque ce célèbre portique d'Athènes, qui de la variété de ses peintures, fut nommé le Poecîle ; mais Micon se fit payer de son travail, au lieu que Polygnote ne voulut d'autre récompense que l'honneur d'avoir réussi.
Néalcès s'acquit une très grande réputation par la beauté de ses ouvrages, et entr'autres par son tableau de Vénus. Il était également ingénieux et solide dans son art. Il représenta la bataille navale des Egyptiens contre les Perses ; et comme il voulait faire connaître que l'action s'était passée sur le Nil, dont les eaux sont semblables à celles de la mer, il peignit sur le bord de l'eau un âne qui buvait, et tout auprès un crocodîle qui le guettait pour se jeter sur lui. Secondé comme Protogène par le hasard, il ne vint à-bout à ce qu'on dit de représenter l'écume d'un cheval échauffé, qu'en jetant de dépit son pinceau sur son ouvrage ; Pline parle beaucoup de Néalcès dans son hist. nat. liv. XXXV. ch. XIe
Nicias d'Athènes, habîle peintre encaustique, élève d'Antidotus, vivait comme Apelle à la cent douzième olympiade, l'an 332 avant l'ère chrétienne. Il se distingua parmi les célèbres artistes de ce temps florissant de la Peinture. Il fut le premier qui employa parmi ses couleurs, la céruse brulée. On dit qu'il excellait en particulier à peindre les femmes. On avait de lui un grand nombre de tableaux extrêmement estimés, entr'autres celui où il avait peint la descente d'Ulysse aux enfers. Il refusa d'un de ses tableaux 60 talents, 282000 l. que le roi Ptolomée lui offrait.
Praxitele faisait un si grand cas de la composition dont Nicias avait le secret, et qu'il appliquait sur les statues de marbre, que celle de ses statues où Nicias avait mis la main, méritaient, selon lui, la préférence sur toutes autres. Voilà ce que dit le texte de Pline, liv. XXXV. chap. XIe Nous ne connaissons plus cette pratique ; et comme nous n'imaginons pas que des vernis ou quelqu'autre préparation semblable, puisse être appliquée sur une statue de marbre sans lui nuire, nous croyons trouver dans ce passage quelque chose d'absurde ; cependant il s'agit ici d'un vernis qui était peut-être une composition de cire préparée.
Mais il y a de bien plus grands éloges à faire de Nicias, car lumen et umbras custodivit ; il conserva avec soin la vérité de la lumière et celle des ombres ; c'est-à-dire qu'il a parfaitement entendu le clair obscur, et par une suite nécessaire, les figures de ses tableaux prenaient un grand relief, et les corps paraissant saillans, atque ut eminèrent è tabulis picturae, maxime curavit. On croirait que Pline, dans ce passage ferait l'éloge de Polydore.
Nicias joignit à ces grandes parties, celle de bien rendre les quadrupedes, et principalement les chiens. Nos modernes ne nous fournissent aucun objet de comparaison ; car ceux qui ont excellé à peindre les animaux, n'ont ordinairement choisi ce genre de travail, que par la raison qu'ils étaient faibles dans l'expression des figures, et pour ainsi dire incapables de traiter les sujets de l'histoire et les grandes passions. Il est vrai que Rubens se plaisait à peindre des animaux, et c'est à ses leçons que nous devons le fameux Sneyders ; mais ces sortes d'exemples sont rares.
Parmi les tableaux les plus estimés de Nicias, on admirait surtout celui où il avait peint la descente d'Ulysse aux enfers. Il refusa de ce tableau 60 talents, 282000 liv. que le roi Ptolomée lui offrait, et en fit présent à sa patrie.
Les Athéniens par reconnaissance, élevèrent un tombeau à sa gloire, et lui accordèrent les honneurs de la sépulture aux dépens du public, comme à Conon, à Timothée, à Miltiade, à Cimon, à Harmodius, à Aristogiton. On trouvera d'autres détails assez étendus sur cet admirable peintre dans Pline, Aelien, Pausanias, Stobée et Plutarque.
Nicomaque, fils et élève d'Aristodeme, était un peu plus ancien qu'Apelle. On achetait ses tableaux pour leur grande beauté, des sommes immenses ; tabulae singulae oppidorum vaenebant opibus, dit Pline ; et cependant personne n'avait plus de facilité et de promptitude dans l'exécution. Aristote tyran de Sicyone, l'avait choisi pour orner de tableaux un monument qu'il faisait élever au poète Teleste, et il était convenu du prix avec Nicomaque, à condition néanmoins que l'ouvrage serait achevé dans un temps fixe. Nicomaque ne se rendit sur le lieu pour y travailler, que peu de jours avant celui où il devait livrer l'ouvrage. Le tyran irrité allait le faire punir, mais le peintre tint parole, et dans ce peu de jours, il acheva ses tableaux avec un art admirable et une merveilleuse célérité ; celeritate et arte mirâ, ajoute le même Pline. Les tableaux de Nicomaque, et les vers d'Homère, dit Plutarque, dans la vie de Timoléon, outre les perfections et les grâces dont ils brillaient, ont encore cet avantage, qu'ils paraissent n'avoir couté ni travail, ni peine à leur auteur.
Il fut le premier qui peignit Ulysse avec un bonnet, et tel qu'on le retrouve dans des médailles de la famille Mamilia, rapportées par Vaillant, Famil. Boman. Mamilia, 2. 3. 4. aux années 614 et 626 de Rome, environ deux cent ans après les ouvrages de Nicomachus.
Nicophanes, dit Pline, fut si élégant, si précis, que peu de peintres ont égalé ses agréments, et jamais il ne s'est écarté de la dignité ni de la noblesse de l'art. Nicophanes elegans et concinnus, ita ut venustate ei pauci comparentur. Cothurnus ei, et gravitas artis.
Pamphile, de Macédoine, élève d'Eupompus, et contemporain de Zeuxis, et de Parrhasius qu'on place ensemble vers la 115e. olympiade, c'est-à-dire vers l'an du monde 3604, fut le premier peintre versé dans tous les genres de Science et de Littérature. Il a mérité que Pline dit de lui : Primus in picturâ omnibus litteris eruditus, praecipuè arithmeticae et geometricae sine quibus negabat artem perfici posse. Il avait bien raison, puisque les règles de la Perspective dont les Peintres font continuellement usage, et celles de l'Architecture qu'ils sont quelquefois obligés d'employer, appartiennent les unes et les autres à la Géométrie. Or, la nécessité de la Géometrie la plus simple et la plus élémentaire, entraîne la nécessité de l'Arithmétique, pour le calcul des angles et des côtés des figures.
Pamphîle fut primus in picturâ, mais d'une façon dont nos Peintres devraient tâcher d'approcher ; c'est qu'étant savant dans son art, il fut omnibus litteris eruditus. Il eut le crédit d'établir à Sicyone, ensuite dans toute la Grèce, une espèce d'académie où les seuls enfants nobles et de condition libre, qui auraient quelque disposition pour les beaux Arts, seraient instruits soigneusement avec ordre de commencer par prendre les principes du dessein sur des tablettes de bouis, et défenses aux esclaves d'exercer le bel art de la Peinture.
Enfin, Pamphîle mit cet art in primum gradum liberalium ; Pline l'appelle aussi un art noble et distingué qui avait excité l'empressement des rois et des peuples. Il aime qu'elle fasse briller l'érudition au préjudice même du coloris ; il joint avec complaisance au titre de peintre celui de philosophe dans la personne de Métrodore, et celui d'écrivain dans Parrhasius, dans Euphranor, dans Apelle et dans les autres. Quelquefois même il semble préférer la Peinture à la Poésie, la Diane d'Apelle au milieu de ses nymphes qui sacrifient, parait, dit-il, l'emporter sur la Diane d'Homère, lequel a décrit le même spectacle. Si les vers grecs qui subsistaient à la louange de la Vénus Anadyomene du même Apelle, avaient prévalu sur le tableau qui ne subsistait plus, ils rendaient toujours hommage à sa gloire.
Cependant il semble que nos artistes pensent bien différemment, et qu'ils secouent la littérature et les sciences comme un joug pénible, pour se livrer entièrement aux opérations de l'oeil et de la main. Leur préjugé contre l'étude parait bien difficîle à déraciner, parce que malheureusement presque tous ceux qui ont eu des lettres, n'ont pas excellé dans l'art ; mais l'exemple de Léonard de Vinci et de quelques autres modernes suffirait, indépendamment de l'exemple des anciens, pour justifier qu'il est possible à un grand peintre d'être savant. Enfin, sans savoir comme Hippias, tous les Arts et toutes les Sciences ; il y a des degrés entre cet éloge, et une ignorance que l'on ne peut jamais pardonner.
Au reste, Pamphîle après avoir élevé des espèces d'académies dans la Grèce, ne prit point d'élèves, qu'à raison de dix ans d'apprentissage, et d'un talent soit par année, soit pour les dix années de leçon ; car le texte de Pline est susceptible de ces deux sens. Il est cependant vraisemblable qu'il faut entendre un talent attique par chaque année. Le talent attique est évalué par MM. Belley et Barthélemy à environ quatre mille sept cent livres de notre monnaie actuelle 1760 ; le docteur Bernard l'évalue à deux cent six livres sterlings cinq shellings. Ce fut à ce prix qu'Apelle entra dans l'école de Pamphile, et ce fut un nouveau surcrait de gloire pour le maître. Il eut encore l'avantage d'avoir Mélanthius pour disciple, ce Mélanthius dont Pline dit que les tableaux étaient hors de prix. Pausanias fut aussi son élève ; nous n'oublirons pas son article.
On admirait plusieurs ouvrages de Pamphile, entr'autres son Ulysse dans une barque ; son tableau de la confédération des Grecs ; celui de la bataille de Phlius au midi de Sicyone, aujourd'hui Phoica ; celui de la victoire des Athéniens contre les Perses, etc. Ajoutons-y un portrait de famille dont Pline parle, c'est-à-dire un grouppe ou une ordonnance de plusieurs parents ; c'est le seul exemple de cette espèce rapporté par les anciens, non que la chose n'ait été facîle et naturelle ; mais parce qu'elle n'était point en usage du-moins chez les Romains, qui remplissaient leur atrium ou le vestibule de leurs maisons de simples bustes.
Panée ou Panoenus, comme dit Pausanias, frère du fameux Phidias, fleurissait dans la 55e. olympiade, ou l'an du monde 3560. Il peignit avec grande distinction la fameuse journée de Marathon, où les Athéniens défirent en bataille rangée toute l'armée des Perses. Les principaux chefs de part et d'autre étaient dans ce tableau de grandeur naturelle, et d'après une exacte ressemblance ; c'est de-là que Pline infère les progrès et la perfection de l'art, qui néanmoins se perfectionna beaucoup dans la suite.
Ce fut de son temps que les concours pour le prix de la Peinture furent établis à Corinthe et à Delphes, tant les Grecs étaient déjà attentifs à entretenir l'émulation des beaux arts par tous les moyens les plus propres à les faire fleurir. Panoenus se mit le premier sur les rangs avec Timagoras de Chalcis ; pour disputer le prix à Delphes dans les jeux Pythiens. Timagoras demeura vainqueur ; c'est un fait, ajoute Pline, prouvé par une pièce de vers du même Timagoras, qui est fort ancienne ; elle a dû précéder d'environ cinq cent cinquante ans le temps où Pline écrivait, si nous plaçons la victoire de Timagoras vers la xxviij. pythiade, en l'an 474 avant Jesus-Christ.
Panoenus devait même être assez jeune l'an 474, seize ans après la bataille de Marathon, puisqu'il est encore question de lui à la lxxxiij. olympiade, l'an 448 ; qu'il peignit à Elis la partie concave du bouclier d'une Minerve, statue faite par Colotès, disciple de Phidias. Si ce mélange de Peinture et de Sculpture dans un même ouvrage révolte aujourd'hui notre délicatesse ; si nous condamnons comme inutiles et comme cachés à la vue du spectateur, des ornements qui ont pu cependant être presque aussi visibles en-dedans qu'en dehors d'un bouclier, du-moins gardons-nous bien d'étendre nos reproches jusqu'à l'historien, ce serait le blâmer de son attention nous transmettre les anciens usages, et d'une exactitude qui fait son mérite et sa gloire.
Panoenus fit encore des peintures à fresque à un temple de Minerve dans l'Elide, et Phidias son frère, ce sculpteur si célèbre, avait aussi exercé l'art de la Peinture, il avait peint dans Athènes, l'olympien, c'est-à-dire Périclès, olympium Periclem, dignum cognomine, pour me servir des termes de Pline. Histoire naturelle liv. XXXIV. chap. VIIIe
Parrhasius, natif d'Ephèse, fils et disciple d'Evenor, contemporain et rival de Zeuxis, fleurissait dans les beaux jours de la Peinture, vers l'an du monde 3564, environ quatre cent ans avant Jesus-Christ. Ce fameux artiste réussissait parfaitement dans le dessein, dans l'observation exacte des proportions, dans la noblesse des attitudes, l'expression des passions, le finissement et l'arrondissement des figures, la beauté et le moèlleux des contours ; en tout cela, dit Pline, il a surpassé ses prédécesseurs, et égalé tous ceux qui l'ont suivi.
Le tableau allégorique que cet homme célèbre fit du peuple d'Athènes brillait de mille traits ingénieux, et montrait dans le peintre une richesse d'imagination inépuisable : car ne voulant rien oublier touchant le caractère de cette nation, il la représenta d'un côté bizarre, colere, injuste, inconstante ; et de l'autre humaine, docile, et sensible à la pitié, dans certain temps, fière, hardie, glorieuse, et d'autres fois basse, lâche, et timide, voilà un tableau d'après nature.
C'est dommage que Parrhasius ait déshonoré son pinceau, en représentant par délassement les objets les plus infâmes : ubique celeber, comme dit Pline d'Arellius, nisi flagitiis insignem corrupisset artem ; ce que fit en effet le peintre d'Ephèse par sa peinture licencieuse d'Atalante avec Méléagre son époux, dont Tibere donna cent cinquante mille livres de notre monnaie, et plaça cette peinture dans son appartement favori.
C'est encore dommage que cet homme si célèbre ait montré dans sa conduite trop d'orgueil et de présomption. On le blame peut-être à tort de sa magnificence sur toute sa personne. On peut aussi lui passer son bon mot dans sa dispute avec Timanthe ; il s'agissait d'un prix en faveur du milieu du tableau, dont le sujet était Ajax outré de colere contre les Grecs, de ce qu'ils avaient accordé les armes d'Achille à Ulysse. Le prix fut adjugé à Timanthe. " Je lui cede volontiers la victoire, dit le peintre d'Ephèse, mais je suis fâché que le fils de Télamon ait reçu de nouveau le même outrage qu'il essuya jadis fort injustement ".
On voit par ce propos que Parrhasius était un homme de beaucoup d'esprit ; mais c'était sans doute un artiste du premier ordre, puisque Pline commence son éloge par ces mots remarquables, qui disent tant de choses : primus symmetriam picturae dedit ; ces paroles signifient, que les airs de tête de ce peintre étaient piquans, qu'il ajustait les cheveux avec autant de noblesse que de légèreté ; que ses bouches étaient aimables, et que son trait était aussi coulant que ses contours étaient justes ; c'est le sublime de la peinture : haec est in picturâ sublimitas ; hanc ei gloriam concessêre Antigonus et Xenocrates, qui de picturâ scripsêre. Dans son tableau de deux enfants, on trouvait l'image même de la sécurité et de la simplicité de l'âge, securitas et simplicitas aetatis. Il faut que ces enfants aient été bien rendus, pour avoir inspiré des expressions qui peignaient à leur tour cette peinture. C'est dommage que dans un artiste de cet ordre, nemo insolentius et arrogantius sit usus gloriâ artis. Il se donna le nom d'abrodictos, le délicat, le voluptueux, en se déclarant le prince d'un art qu'il avait presque porté à sa perfection. En effet, on ne lit point sans plaisir tout ce que disent de ce grand maître, Pline, Diodore de Sicile, Xénophon, Athénée, Elien, Quintilien, et parmi les modernes Carlo-Dati mais on n'est point fâché de voir l'orgueil de Parrhasius puni, quand il fut vaincu par Timanthe, dans le cas dont j'ai parlé ci-dessus ; cas d'autant plus important à sa gloire, que les juges établis pour le concours des arts dans la Grèce ; ne pouvaient être soupçonnés d'ignorance ou de partialité.
Pausias, natif de Sicyone, fils de Britès et son éleve, fleurissait vers la cj. olympiade. Il se distingua dans la peinture encaustique, et en décora le premier les voutes et les lambris, pinxit et ille penicillo parietes Thespiis, dit Pline, c. XIe C'était peut-être le temple des Muses que l'on voyait à Thespies, au-bas de l'Hélicon. Polygnote avait orné avant lui ce même lieu de ses ouvrages ; le temps les avait apparemment dégradés ou effacés. On chargea Pausias de les refaire, et ces tableaux perdirent beaucoup à la comparaison, quoniam non suo genere certasset ; mais il décora le premier les murs intérieurs des appartements avec un succès distingué ; c'est ce genre que Ludius fit ensuite connaître à Rome. Pausias y apportait la plus grande facilité, car il peignit un tableau de ce genre en un jour ; il est vrai que ce tableau représentait un enfant, dont les chairs mollettes, rondes, et pleines de lait, n'exigent qu'une forme générale sans aucun détail intérieur, sans aucune expression composée, enfin sans aucune étude de muscles et d'emmanchements.
Quand l'occasion le demandait, Pausias terminait ses beaux ouvrages avec beaucoup de mouvement dans sa composition et d'effet dans la couleur. On admirait de sa main, dans les portiques de Pompée, un tableau représentant un sacrifice de bœufs, parmi lesquels était un bœuf de front, dont on voyait toute la longueur : on y remarquait surtout la hardiesse avec laquelle il les avait peints absolument noirs : enfin les sacrifices de Pausias indiquaient, non-seulement l'art du raccourci, mais une intelligence complete de la perspective.
Il devint dans sa jeunesse amoureux de Glycère ; cette belle vendeuse de fleurs le rendit excellent dans l'imitation de la plus légère et de la plus agréable production de la nature. Comme elle excellait dans l'art de faire des couronnes de fleurs qu'elle vendait, Pausias, pour lui plaire imitait avec le pinceau ces couronnes, et son art égalait le fini, et l'éclat de la nature. Ce fut alors qu'il représenta Glycère assise, composant une guirlande de fleurs, tableau dont Lucullus acheta la copie deux talents (neuf mille quatre cent livres) ; combien aurait-il payé l'original, qu'on nomma stéphanoplocos, la faiseuse de couronnes ? Horace n'a pas oublié cette circonstance.
Vel cum Pausiaca torpes, insane, tabella,
Qui peccas minus, atque ego cum, &c.
Le prix excessif que Lucullus mit au tableau de Pausias, ne doit pas néanmoins étonner ceux qui ont Ve donner de nos jours des sommes pareilles pour les bouquets de fleurs peints par Van-Huysum, tandis que peut-être ils n'auraient pas donné le même prix d'un tableau de Raphaël. On pourrait comparer Baptiste, pour cette partie seulement, au célèbre Pausias, dans la belle imitation des fleurs, à laquelle il joignait une grande facilité.
Cependant le chef-d'œuvre de Pausias était une femme ivre peinte avec un tel esprit, que l'on apercevait à-travers un vase qu'elle vuidait, tous les traits de son visage enluminé, dit Pausanias, l. XXI. M. Scaurus transporta à Rome tous les tableaux du peintre de Sicyone ; il mérite doublement ce nom, car outre que c'était sa patrie, il y avait fixé son séjour. Scaurus orna des tableaux de cet artiste, le superbe théâtre qu'il fit construire, dans le dessein d'immortaliser son édilité, laquelle en effet acheva la ruine et le renversement des mœurs des Romains.
Philocharès, ne nous est connu que par ce que Pline en dit en parlant des tableaux étrangers exposés dans Rome. " Le second tableau, dit-il présente un sujet d'admiration dans la ressemblance d'un fils encore jeune avec son père déjà vieux, malgré la différence des deux âges clairement exprimée : un aigle vole au-dessus, et tient un lion dans ses serres. Philocharès y a marqué que c'était son ouvrage, preuve éclatante, continue Pline, du pouvoir immense de l'art, quand on n'envisagerait que ce seul tableau, puisque le sénat et le peuple romain y contemplent depuis tant de siècles, en considération de Philocharès, deux personnages d'ailleurs très-obscurs, Glaucion et son fils Aristippe ".
Il ne faut pas croire que Pline reproche aux Romains de s'être dégradés, en portant leurs regards sur un portrait de deux personnes abjectes ; ce sens répugne, et à l'objet présent de l'auteur, et à tous ses principes de philosophie ; et à la manière dont il nous offre plusieurs autres tableaux où les sujets étaient vils ou inconnus. Il ne prétend pas plus censurer les admirateurs de Glaucion et d'Aristippe, que les panégyristes de ce malade qu'Aristide avait peint, aegrum sine fine laudatum ; comme c'était sur la finesse de l'exécution du peintre que tombaient les admirations et les louanges, le philosophe s'en servait pour faire connaître les charmes de l'art, et le citoyen pour les faire aimer.
Philoxène d'Erythrée, élève de Nicomachus, suivit la manière de son maître. Pline dit de lui, cujus tabula nulli post ferenda ; c'est un éloge assez singulier. Il ajoute qu'il trouva des chemins plus courts encore pour peindre promptement. Il travaillait donc, dit M. de Caylus, comme le Pellegrini, qui avait peint la banque à Paris, et comme Paul Mathéi qui a fait un si grand nombre d'ouvrages chez M. Crozat l'ainé ; l'un et l'autre faisaient ordinairement par jour une figure grande comme nature ; mais la promptitude et la facilité étaient leur seul mérite.
Polygnote de Thase, île de la mer Egée, était fils d'Aglaophon dont nous avons parlé, et qui vivait avant la quatre-vingt-dixième olympiade, temps où la peinture n'avait pas encore fait de grands progrès. Il fut élève de son père ; mais comme il est arrivé depuis à Raphaël et à beaucoup d'autres, le disciple surpassa bientôt son maître. Guidé par son propre génie, il osa quitter l'ancienne manière qui était dure, seche, et contrainte. Il porta tout-d'un-coup son art de l'enfance presque à la perfection. Jusqu'alors les Peintres ne s'étaient servi que d'une seule couleur, ce qui faisait donner à leurs ouvrages le nom peu avantageux de ou , que Quintilien nous rend par les mots de simplex color.
Polygnote employa quatre couleurs, par le mélange desquelles il donna aux femmes une parure brillante qui charma les yeux. Il eut la gloire de trouver le secret des couleurs vives, des draperies éclatantes, et de multiplier avec dignité le nombre des ajustements. Par cette nouveauté il éleva les merveilles de la Peinture à un degré qui n'était pas encore connu. Pline nous apprend que Polygnote et Micon furent les premiers qui firent usage de l'ocre jaune, et que tous deux peignirent à fresque ce célèbre portique d'Athènes, qui de la variété de ses peintures fut nommé le Poecile. Mais Micon, comme je l'ai déjà dit, se fit payer de son travail, au-lieu que Polygnote ne voulut d'autre récompense que l'honneur d'avoir réussi ; ce beau procédé le mit en un si haut degré d'estime, que les Athéniens lui donnèrent droit de bourgeoisie dans leur ville, et les Amphyctions le droit d'hospitalité dans toutes les villes de la Grèce, pour tout le reste de sa vie : des récompenses aussi flatteuses pour l'amour-propre, et telles que les Grecs les savaient accorder, ne sont plus en usage ; il faut croire que si elles existaient, nous verrions plusieurs de nos artistes décorer des temples sans recevoir aucune rétribution, ou plutôt les décorer pour en avoir d'aussi distinguées.
On voyait à Rome, du temps de Pline, un tableau de Polygnote, qui représentait un jeune homme armé de son bouclier, dans une attitude qui laissait en doute s'il montait ou s'il descendait. Pline en fait beaucoup d'éloges, parce qu'il se trouve une beauté réelle dans une attitude indécise, et dans une contenance mal assurée, qui peint l'irrésolution de l'esprit. Il arrive très-souvent qu'un soldat qui escalade, ou qui s'avance à l'ennemi, s'arrête tout-à-coup sans savoir d'abord s'il poursuivra, s'il continuera de monter, ou s'il prendra le parti de descendre. Or ces sortes de positions vacillantes sont difficiles à être bien représentées par un peintre. L'habîle artiste dont nous parlons avait pourtant saisi celle-ci, et l'habîle écrivain de la nature a eu soin d'avertir qu'on en voyait à Rome le tableau sous le portique de Pompée.
Polygnote fit encore plusieurs autres ouvrages vantés dans l'histoire ; tels sont en particulier les deux tableaux que Pausanias a décrits ; l'un représentait la prise de Troie et le rembarquement des Grecs ; l'autre la descente d'Ulysse aux enfers avec une image de ces lieux souterrains, sujets magnifiques, et qui ne prêtent pas moins à la Peinture qu'à la Poésie, voyez les Mém. des Inscr. tom. VI. in-4°. Il fut le premier qui sut varier l'air du visage, sec et dur dans l'ancienne peinture, qui donna des draperies fines et légères à ses figures de femmes, et le premier qui les coèffa d'une mitre de différentes couleurs. Aussi heureux en galanterie que noble dans ses actions, il sut plaire à Elpinice, sœur de Cimon, et fille de Miltiade, ce grand capitaine, dont la gloire ne fut égalée que par celle de son fils. Polygnote vivait quatre cent vingt années avant l'ère chrétienne ; ainsi les tableaux dont parle Pausanias avaient, du temps de cet auteur, cinq ou six cent ans d'antiquité.
Protogène, né à Caunium en Carie, ville qui dépendait de Rhodes, était contemporain d'Apelles : il commença par peindre des navires, et vécut longtemps dans une honnête pauvreté, la sœur, je dirai mieux, la mère du bon esprit. Il peignit ensuite des portraits et quelques sujets simples, mais auxquels il donna un si beau fini, qu'ils firent l'admiration des Athéniens, c'est-à-dire du peuple le plus éclairé qui fût au monde. Tous les Historiens parlent de ce fameux tableau qui lui couta sept ans de travail, de l'Iabise, chasseur célèbre, petit-fils du soleil, et qui passait pour le fondateur de Rhodes.
Protogène, jaloux de la durée de ses ouvrages, et voulant faire passer le tableau d'Iabise à la postérité la plus reculée, le repeignit à quatre fais, mettant couleurs sur couleurs, qui prenant par ce moyen plus de corps, devaient se conserver plus longtemps dans leur éclat, sans jamais disparaitre ; car elles étaient disposées pour se remplacer, pour ainsi dire, l'une l'autre. C'est ainsi que Pline s'explique, comme le remarque M. le comte de Caylus, pour caractériser le coloris de ce célèbre artiste.
On admirait en particulier dans ce tableau l'écume qui sortait de la gueule du chien ; ce qui n'était pourtant, dit-on, qu'un coup de hasard et de désespoir du peintre. On faisait aussi grand cas de son satyre appuyé contre une colonne. Protogène y travaillait dans le temps même du siège de Rhodes par Démétrius. Il était alors logé à la campagne dans une maison près de la ville. Démétrius fit venir Protogène dans son camp ; et lui ayant demandé comment il pouvait s'occuper à son beau tableau sans crainte, et s'imaginer être en sûreté au milieu des ennemis, Protogène lui répondit spirituellement, qu'il savait que Démétrius ne faisait pas la guerre aux arts ; réponse qui plut extrêmement au monarque, et qui sauva Rhodes. C'est Aulugelle, liv. XV. ch. IIIe qui rapporte ce fait, un des plus frappans que l'histoire nous ait conservé. Cet événement d'un tableau qui opère le salut d'une ville, est d'autant plus singulier, que le peintre vivait encore ; et l'on sait assez que d'ordinaire les hommes attendent la mort des auteurs en tout genre, pour leur donner les éloges les plus mérités, soit qu'un sentiment d'envie les conduise, soit qu'ils ne prisent que ce qu'ils n'ont pas la liberté de faire exécuter, le plaisir de voir naître sous leurs yeux, et que leur estime soit produite par le regret.
Apelle fit connaître aux Rhodiens le mérite des ouvrages de ce laborieux artiste ; car ayant offert d'acheter très-chèrement tous ses tableaux, les compatriotes de Protogène ouvrirent les yeux sur cette offre qui était sérieuse, et payèrent ses ouvrages comme ils le méritaient. Aristote, amateur des beaux arts autant que des sciences, et de plus ami de Protogène dont il estimait les talents, voulut l'engager aux plus grandes compositions et aux plus nobles sujets d'histoire, comme à peindre les batailles d'Alexandre ; mais Protogène résista toujours à cette amorce dangereuse, et continua sagement de s'en tenir aux peintures de son goût et de son génie.
On sait qu'Apelle et Protogène travaillèrent ensemble à un tableau qui fut conservé précieusement. Ce tableau avait été regardé comme un miracle de l'art ; et quels étaient ceux qui le considéraient avec le plus de complaisance ? C'étaient des gens du métier, gens en effet plus en état que les autres de sentir les beautés d'un simple dessein, d'en apercevoir les finesses, et d'en être affectés. Ce tableau, ou, si l'on veut, ce dessein avait mérité de trouver place dans le palais des Césars. Pline, qui parle sur le témoignage des personnes dignes de foi, qui avaient Ve ce tableau avant qu'il eut péri dans le premier incendie qui consuma le palais du temps d'Auguste, dit qu'on n'y remarquait que trois traits, et même qu'on les apercevait avec assez de peine ; la grande antiquité de ce tableau ne permettait pas que cela fût autrement.
Il est à remarquer que s'il n'offrait à la vue que de simples lignes coupées dans leur longueur par d'autres lignes, ainsi que M. Perrault se l'était imaginé, on en devait compter cinq, et non pas trois. Le calcul est aisé à faire ; la première ligne refendue par une seconde ligne, et celle-ci par une troisième encore, cela fait bien cinq lignes toutes distinctes, par la précaution qu'on avait prise en les traçant, d'employer différentes couleurs. Une telle méprise dans une chose de fait, n'est que trop propre à faire sentir l'erreur de ceux qui cherchent sans cesse à rabaisser le mérite de l'antiquité.
Nous ne dirons rien de plus de la vie et des actions de ce grand peintre, sinon qu'il joignit, comme tant d'autres, l'exercice de la Sculpture avec celui de la Peinture. Du reste, Apelle lui reprochait quelquefois de trop fatiguer ses ouvrages, et de ne savoir pas les quitter. Ce défaut a souvent jeté dans le froid quelques-uns de nos modernes. Apelle disait à son ami, le trop de soin est dangereux ; mais la Peinture n'est pas la seule opération de l'esprit qui doit faire attention à ce précepte.
Pyreïcus, dit Pline, arte paucis post ferendus, et surtout du côté de la beauté du pinceau ; mais il a dégradé son mérite, tonstrinas sutrinasque pinxit ; aussi fut-il nommé rhyparo graphos, c'est-à-dire bas et ignoble. Nous pouvons donner cette épithète à presque tous les peintres des Pays-bas. Il parait que les Romains étaient sensibles à la séduction que causaient ces petits genres, et qu'ils pardonnaient aux sujets en faveur de la belle couleur, qui véritablement est attrayante.
Sérapion était un peintre de décoration. Les Grecs et les Romains ont eu de grands décorateurs de théâtre ; leurs dépenses en ce genre, et leur goût pour les spectacles, ont dû produire des hommes très-habiles dans cette partie, et nous pouvons imaginer par conséquent, que la facilité du génie et de l'exécution, devait être nécessairement appuyée en eux par la connaissance exacte de la perspective. Plus un trait est rapporté dans le grand, et plus il exige d'exactitude et de vérité ; et la perspective aérienne éprouve les mêmes nécessités. Sérapion se distingua dans l'art des décorations ; Pline après en avoir parlé sur ce ton, ajoute qu'il ne pouvait peindre la figure, c'est une chose toute ordinaire. A la réserve de Jean Paul Panini, qui a su allier plusieurs parties de la Peinture, Bibiena, Servandoni, et tous ceux qui les ont précédés, n'ont jamais su représenter une figure, ni même l'indiquer en petit, sur le plan le plus éloigné. Si Sérapion ne pouvait faire aucune figure, Dionysius au contraire ne savait peindre que des figures ; ces partages se rencontrent tous les jours ; cependant les Dionysius seront plus aisément Sérapions, que les Sérapions ne seront Dionysius ; car un peintre d'histoire exprimera toujours ses pensées : le dessein de la figure conduit à tout, et rend tout facile.
Socrate est peint dans ces deux mots de Pline, jure omnibus placet ; cet artiste fut bienheureux ; il se trouvait du goût de tout le monde. On peut dire qu'il eut un sort bien différent du divin philosophe dont il portait le nom. C'est au peintre que nous devons la composition suivante, et qu'un philosophe aurait pu imaginer. Pour exprimer un négligent qui fait des choses inutiles, il peignit un homme assis par terre, travaillant une natte mangée par un âne, à mesure qu'il la terminait. D'autres prétendent que Socrate avait voulu représenter un mari imbécile, dont l'économie fournit aux dépenses de sa femme ; quoiqu'il en sait, le sujet était si bien peint, qu'il passa en proverbe. Ocnus spartum torquents quod asellus arrodit.
Théomneste, contemporain d'Asclépiodore et d'Aristide, et un peu plus ancien qu'Apelle, reçut de Mnason, le prince de son temps le plus curieux en peinture, cent mines, c'est-à-dire près de 8000 livres de notre monnaie, pour chaque figure de héros qu'il avait représentée ; et s'il y en avait douze, pour répondre aux douze divinités d'Asclépiodore, comme il y a beaucoup d'apparence, cet ouvrage lui fut payé environ 96000 livres.
Timagoras de Chalcide fleurissait dans la quatre-vingt-deuxième olympiade. Il disputa le prix de la Peinture contre Panée dans les jeux Pythiens, le vainquit, et composa sur sa victoire un poème qu'on avait encore du temps de Pline.
Timanthe était natif de Sycione, ou selon d'autres, de Cythné. Cet artiste si renommé avait en partage le génie de l'invention, ce don précieux de la nature qui caractérise les talents supérieurs, et que le travail le plus opiniâtre, ni toutes les ressources de l'art ne peuvent donner. C'est Timanthe qui est l'auteur de ce fameux tableau du sacrifice d'Iphigénie, que tant d'écrivains ont célébré, et que les grands-maîtres ont regardé comme un chef-d'œuvre de l'art. Personne n'ignore que pour mieux donner à comprendre l'excès de la douleur du père de la victime, il imagina de le représenter la tête voilée, laissant aux spectateurs à juger de ce qui se passait au fond du cœur d'Agamemnon. Velavit ejus caput, dit Pline, et sibi cuique animo dedit aestimandum. Tout le monde sait encore combien cette idée a été heureusement employée dans le Germanicus de Poussin. Les grands hommes, et surtout les Peintres, parlent tous, pour ainsi dire, le même langage, et le tableau de Timanthe ne subsistait plus quand le Poussin fit le sien.
Pline, liv. XXXV. ch. Xe en caractérisant les divers mérites des peintres grecs, dit au sujet de Timanthe, que dans ses ouvrages on découvrait plus de choses qu'il n'en prononçait ; qu'étant grand par son art, il était encore plus grand par son génie, et que s'il représentait un héros, il employait tout ce que la Peinture avait de force. Plutarque parle avec de grands éloges d'un tableau que ce peintre avait fait du combat d'Aratus contre les Etoliens ; ce n'est pas, dit Plutarque, un tableau, c'est la chose même que l'on voit ; il est singulier que Pline ait oublié d'en faire mention, car il n'a pas manqué de nous raconter d'autres détails sur Timanthe, comme sa dispute contre Parrhasius, qui se passa à Samos, et où ce dernier fut vaincu. Cette même histoire, dont j'ai déjà parlé, se retrouve dans Athénée ; mais Pline a loué Timanthe en des termes qui disent tout, artem ipsam complexus viros pingendi. Il pratiqua l'art dans tout son entier pour peindre les hommes. Nous avons eu quelques modernes qui n'ont jamais pu rendre la délicatesse et les grâces que la nature a répandues dans les femmes.
Timomaque, natif de Bizance, vivait du temps de Jules-César. Il mit au jour, entr'autres productions, un Ajax et une Médée que le conquérant des Gaules plaça dans le temple de Vénus, et qu'il acheta 80 talents, c'est-à-dire au-delà de seize mille quatre cent louis. Timomaque n'avait pas mis la dernière main à sa Médée, et c'était néanmoins ce qui la faisait encore plus estimer, au rapport de Pline, qui ne peut s'empêcher d'admirer ce caprice du goût des hommes. La pitié entre-t-elle dans ce sentiment ? se fait-elle un devoir de chérir les choses à cause de l'infortune qu'elles ont eu de perdre leur auteur, avant que d'avoir reçu leur perfection de sa main ? cela peut être ; mais il arrive aussi quelquefois qu'on se persuade avec raison, que de grands maîtres altèrent l'excellence de leurs ouvrages par le trop grand fini dont ils sont idolâtres.
Quoi qu'il en sait, le morceau de peinture dont il s'agit ici était admirable par l'expression, genre particulier qui caractérisait Timomaque ; car c'est par-là qu'Ausone, dans sa traduction de quelques épigrammes de l'Anthologie sur ce sujet, vante principalement ce magnifique tableau, où la fille d'Oetus, si fameuse par ses crimes, était peinte dans l'instant qu'elle levait le poignard sur ses enfants. On voit, dit le poète, la rage et la compassion mêlées ensemble sur son visage ; à-travers la fureur qui Ve commettre un meurtre abominable, on aperçoit encore des restes de la tendresse maternelle.
Immanem exhausit rerum in diversa laborem
Pingeret affectum, matris in ambiguum,
Ira subest lacrymis, miseratio non caret irâ ;
Alterutrum videat, ut sit in alterutro.
Cependant cette Médée, si louée par les auteurs grecs et latins, si bien payée par Jules-César, n'était pas le chef-d'œuvre du célèbre artiste de Bizance : l'on n'estimait pas moins son Iphigénie et son Oreste, et l'on mettait sa Gorgone au-dessus de toutes ses compositions.
Zeuxis, était natif d'Héraclée, soit d'Héraclée en Macédoine, ou d'Héraclée près de Crotone en Italie, car les avis sont partagés ; il fleurissait 400 ans avant Jesus-Christ, vers la quatre-vingt-quinzième olympiade. Il fut le rival de Timanthe, de Parrhasius, et d'Apollodore, dont il avait été le disciple ; mais il porta à un plus haut degré que son maître la pratique du coloris et du clair obscur ; ces parties essentielles, que Pline nomme la porte de l'art, et qui en font proprement la magie, firent rechercher les ouvrages de Zeuxis avec empressement, ce qui mit bien-tôt ce célèbre artiste dans une telle opulence, qu'il ne vendait plus ses tableaux, parce que, disait-il, aucun prix n'était capable de les payer ; discours qu'il devait laisser tenir à ses admirateurs.
Dans le nombre de ses productions pittoresques, tous les auteurs s'étendent principalement sur celle de ses raisins, et du rideau de Parrhasius. Ce n'est point cependant dans ces sortes de choses que consiste le sublime et la perfection de l'art ; de semblables tromperies arrivent tous les jours dans nos peintures modernes, qu'on ne vante pas davantage par cette seule raison. Des oiseaux se sont tués contre le ciel de la perspective de Ruel en voulant passer outre, sans que cela soit beaucoup entré dans la louange de cette perspective. Un tableau de M. le Brun, sur le devant duquel était un grand chardon bien représenté, trompa un âne qui passait, et qui, si on ne l'eut empêché, aurait mangé le chardon ; je dis avec M. Perrault mangé, parce que le chardon étant nouvellement fait, l'âne aurait infailliblement léché toute la peinture avec sa langue. Quelquefois nos cuisiniers ont porté la main sur des perdrix et sur des chapons naïvement représentés pour les mettre à la broche ; on en a ri, et le tableau est demeuré à la cuisine.
Mais des tableaux beaucoup plus importants de Zeuxis étaient, par exemple, son Hélene, qu'on ne voyait d'abord qu'avec de l'argent, d'où vint que les railleurs nommèrent ce portrait Hélene la courtisanne. On ne sait point si cette Hélene de Zeuxis était la même qui était à Rome du temps de Pline, ou celle que les Crotoniates le chargèrent de représenter, pour mettre dans le temple de Junon. Quoi qu'il en sait, il peignit son Hélene d'après nature sur les cinq plus belles filles de la ville, en réunissant les charmes et les grâces particulières à chacune, pour en former la plus belle personne du monde, que son pinceau rendit à ravir.
On vantait encore extrêmement son Hercule dans le berceau, étranglant des dragons à la vue de sa mère épouvantée. Il prisait lui-même singulièrement son Lutteur ou son Athlete, dont il s'applaudissait comme d'un chef-d'œuvre inimitable. Il y a de l'apparence qu'il estimait aussi beaucoup son Athalante, puisqu'il la donna aux Agrigentins ; qu'il n'estimait pas moins son Pan, dont il fit présent à Archelaus, roi de Macédoine, dans le temps qu'il employait son pinceau pour l'embellissement du palais de ce monarque ; je ne dirai rien de son Centaure femelle, il a été décrit par Lucien.
Zeuxis ne se piquait point d'achever promptement ses ouvrages ; et comme quelqu'un lui reprochait sa lenteur, il répondit, " qu'à la vérité il était longtemps à peindre, mais qu'il peignait aussi pour longtemps ".
Pline parle de sa Pénélope, in quâ pinxisse mores videtur : on ne peut donner une idée plus délicate de son esprit et de son pinceau ; car il ne faut pas regarder ce trait comme une métaphore, semblable à celle où le même auteur, pour exprimer les peintures des vaisseaux, et faire entendre les dangers de la navigation, dit si noblement, pericula expingimus ; cette belle expression, mores pinxisse videtur, doit être prise ici pour une véritable définition. Raphaël parmi les modernes, a semblablement peint les mœurs, et a su plus d'une fois les exprimer. On sait quelle réunion de grandeur, de simplicité, et de noblesse cet illustre moderne a mis dans les têtes des vierges, mores pinxit. On peut encore peut-être mieux comparer Léonard de Vinci à Zeuxis, à cause du terminé auquel il s'appliquait.
Pline ajoute en finissant le portrait de Zeuxis, deprehenditur tamen Zeuxis grandior in capitibus articulisque ; ces mots deprehenditur tamen, indiquent-ils un reproche de faire des têtes et des attachements trop forts ? ou le mot de grandior qui suit, marque-t-il un éloge, et Pline veut-il dire que Zeuxis faisait ces parties d'un grand caractère, d'autant qu'il le loue de travailler avec soin, et d'après la nature ? car il ajoute, alioqui tantus diligentiâ. Je ne décide point l'explication de cette phrase latine.
Verrius Flaccus, cité par Festus, rapporte que le dernier tableau de Zeuxis fut le portrait d'une vieille, qui le fit tant rire qu'il en mourut ; mais si le fait était vrai, comment aurait-il échappé à tous les autres auteurs ? Je supprime ici beaucoup de choses sur ce grand maître en Peinture, parce qu'on les trouve dans Junius et dans la vie de Zeuxis, de Parrhasius, d'Apelle, et de Protogène, donnée en italien par Carlo-Dati, et imprimée à Florence en 1667, in-12.
Enfin, pour complete r cet article, je ne dois pas taire quelques femmes qui ont exercé la Peinture dans la Grèce ; telles sont Timarete, fille de Micon, et qui a excellé ; Irène, fille et élève de Cratinus ; Calypso, Alcisthène, Aristarete qui s'était formée dans son art sous son père Néarchus ; Lala de Cizique, perpetua virgo, épithète singulière pour ce temps, si elle ne veut pas dire tout simplement qu'elle ne fut point mariée. Cette fille exerça la Peinture à Rome, selon M. Varron, cité par Pline ; non-seulement elle peignit, mais elle fit des ouvrages cestro in ebore, ce que M. de Caylus traduit généralement, en disant qu'elle grava sur l'ivoire : elle fit le portrait de beaucoup de femmes, et le sien même dans le miroir, nec ullius in picturâ velocior manus fuit, personne n'eut le pinceau aussi léger, ou bien, ne montra une aussi grande légèreté d'outil, pour m'exprimer dans la langue des artistes ; Pline fait encore mention d'une Olympias.
Plusieurs de ces femmes ont fait de bons élèves, et laissé de grands ouvrages. Je ne puis opposer, avec M. de Caylus, à ces femmes illustres qu'une seule moderne ; non que les derniers siècles n'en aient produits qui pourraient trouver ici leur place ; mais la célèbre Rosalba Carieri a fait des choses si remplies de cette charis qu'Apelle s'était accordée, qu'on peut la comparer, à divers égards, aux femmes peintres de la Grèce. Les sujets qu'elle a faits n'ont cependant jamais été fort étendus, car elle n'a travaillé qu'en mignature et en pastel. (D.J.)
PEINTRES ROMAINS, (Peint. ant.) Pline ne compte de peintres romains que les suivants, rangés ici dans l'ordre chronologique. Fabius, surnommé Pictor, et qui était de l'illustre famille des Fabius, Pacuvius, Sopolis, Dionysius, Philiscus, Arellius, Ludius, qui fleurissait sous Auguste, Quintus-Pedius, Antistius-Labéo, Amulius, Tripilius, Cornelius Pinus, Accius-Priscus : nous indiquerons leurs caractères et leurs ouvrages dans le même ordre que nous venons de suivre au mot PEINTURE des Romains.
PEINTRE de batailles, (Peint. moderne) on nomme ainsi le peintre qui s'adonne particulièrement à cette sorte d'ouvrage. Il faut que dans une composition de ce genre, il paraisse beaucoup de feu et d'action dans les figures et dans les chevaux. C'est pourquoi on y doit préférer une manière forte et vigoureuse, des touches libres, un goût heurté à un travail fini, à un pinceau délicat, à un dessein trop terminé. Voici les peintres célèbres en ce genre.
Castelli (Valerio), né à Gènes en 1625, mort dans la même ville en 1659, montra de bonne heure son inclination à peindre des batailles, et eut un grand succès en ce genre.
Courtais (Jacques), surnommé le Bourguignon, né à S. Hippolite l'an 1621, mort à Rome en 1676, suivit pendant trois ans une armée, en dessina les campements, les siéges, les marches et les combats dont il était témoin. Michel-Ange ayant Ve de ses tableaux de bataille, publia partout ses talents. Il règne dans ses ouvrages beaucoup de feu, et ses compositions sont soutenues par le coloris.
Michel-Ange des batailles reçut ce surnom de son habileté singulière à représenter ces sortes de sujets, dans lesquels il mettait une imagination vive, une grande prestesse de main, et beaucoup de force. On a gravé quelques-unes de ses batailles dans le Strada de Rome, où il mourut en 1660.
Parocel (Joseph), élève du Bourguignon, a excellé à représenter des batailles, faisant tout de génie, sans avoir jamais été dans des camps ni suivi des armées. Cependant il a mis dans ses tableaux un mouvement et un fracas prodigieux. Il a peint avec la dernière vérité la fureur du soldat. Aucun peintre, suivant son expression, n'a su mieux tuer son homme. Son fils (Charles), mort en 1752, brillait aussi dans le genre de son père.
Le Primatice, disciple de Jules Romain, a fait avec succès, sur les desseins de son maître, des batailles de stuc en bas-relief ; c'était le temps où l'on commençait seulement à quitter en France la manière gothique et barbare.
Rosa (Salvator), né à Naples en 1615, fit des tableaux d'histoire peu estimés, mais réussit à peindre des combats et des figures de soldats, dont il saisissait admirablement l'air et la contenance.
Van Huchtenburg, né à Harlem, est connu par dix tableaux qui représentent dix batailles célèbres du prince Eugène : 1°. celle de Zanta contre les Turcs, en 1697 ; 2°. celle de Chiari en Italie contre les deux couronnes, en 1701 ; 3°. celle de Luzara, en 1702. 4°. celle de Hochstedt, en 1704 ; 5°. celle de Cassano en Italie contre le duc de Vendôme, en 1705 ; 6°. celle de Turin, en 1706 ; 7°. celle d'Oudenarde, en 1708 ; 8°. celle de Malplaquet, en 1709 ; 9°. celle de Peterwaradin en Hongrie contre les Turcs, en 1716 ; 10°. enfin celle de Belgrade, en 1717.
Van-der-Veld (Guillaume), avait un talent particulier pour représenter des vues et des combats de mer. On rapporte que l'amour pour son art l'engagea à s'embarquer avec l'amiral Ruyter, et que dans le feu du combat, il dessinait tranquillement à l'écart l'action qui se passait sous ses yeux ; mais son fils Guillaume le jeune l'a encore surpassé par ses talents en ce genre. Ce fils mourut à Londres en 1707, comblé des bienfaits de la nation ; ses tableaux sont portés à un très-haut prix.
Van-der-Mulen (Antoine-Français), a pris pour sujets ordinaires de ses tableaux des chasses, des siéges, des combats, des marches, ou des campements d'armées ; ils font l'ornement de Marly, et des autres maisons royales.
Verschuur (Henri), né à Gorcum en 1627, mort en 1690, avait un goût dominant pour représenter des batailles. Il suivit l'armée des Etats en 1672, pour peindre les divers campements, les marches, les combats, les retraites. Né avec un génie vif et facile, il a mis dans ses tableaux tout le feu que requiert ce genre de composition.
Vroom (Henri Corneille), né à Harlem en 1566, avait un rare génie pour représenter des batailles navales. L'Angleterre et les princes d'Orange l'occupèrent à peindre les victoires que ces deux puissances avaient remportées sur mer contre les Espagnols. Enfin on exécuta de très-belles tapisseries d'après les ouvrages de cet artiste.
PEINTRE de fleurs et de fruits, (Peinture) on appelle ainsi les artistes qui se sont attachés particulièrement à ce goût de peinture ; c'est un genre qui veut être traité d'une manière supérieure. Il requiert un choix élégant dans les fleurs et dans les fruits, l'art de les groupper et de les assortir, une touche légère, un coloris frais, brillant, et surtout une parfaite imitation de la belle nature. Entre les artistes qui se sont distingués dans l'art de peindre les fleurs et les fruits, on nomme Van-Huysum, Mignon, De Heem, Nuzzi, Monnoyer et Fontenay. J'ai parlé des trois premiers à l'article ÉCOLE, je ne dirai ici qu'un mot des trois autres.
Mario Nuzzi, plus connu sous le nom de Mario di Fiori, né à Penna dans le royaume de Naples, mort à Rome en 1673, peignit les fleurs et les fruits avec cette vérité qui charme et séduit les sens ; aussi Smith en a-t-il gravé plusieurs pots d'après lui.
Monnoyer (Jean-Baptiste), né à Lille en 1635, mort à Londres en 1699, a peint des tableaux de fleurs qui sont précieux par la fraicheur, l'éclat et la vérité qui y brillent.
Fontenay (Jean-Baptiste Blain de), né à Caen en 1654, mort en 1715, avait un talent éminent à réprésenter des fleurs et des fruits, les groupper avec art, et varier l'esprit de sa composition. Les insectes paraissent vivre dans ses tableaux ; les fleurs n'y perdent rien de leur beauté, les fruits de leur fraicheur. On croit voir découler la rosée des tiges, on est tenté d'y porter la main. (D.J.)
PEINTRE, marchand, s. m. (Communauté) les maîtres peintres composent à Paris une communauté dont le commerce comprend tout ce qui se peut faire en Peinture et en Sculpture, soit doré, soit argenté, soit cuivré, en détrempe et à l'huile. Leurs ouvrages de dorure, s'ils sont ordinaires, sont dorés d'un or qu'on appelle or pâle ; et si l'on veut qu'ils soient propres, on y emploie de l'or jaune. Les ouvrages argentés s'argentent les uns en blanc, et les autres en jaune. Les ouvrages cuivrés sont ceux où l'on ne se sert que d'or faux, c'est-à-dire de cuivre battu en feuille et mis en œuvre comme l'or fin.