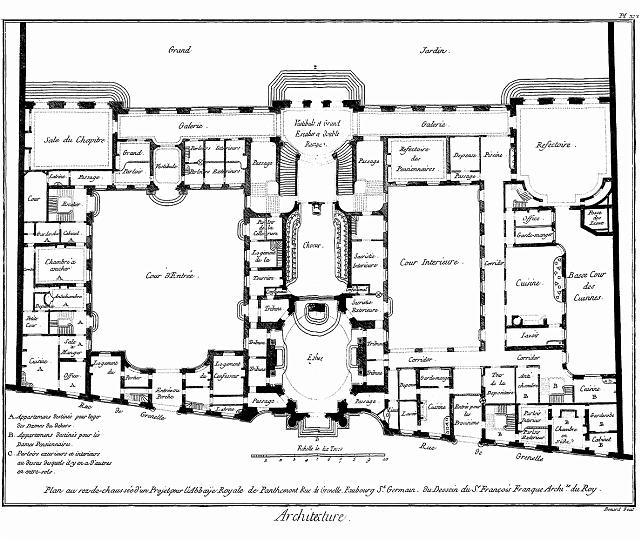S. m. (Poésie). Un poème est une imitation de la belle nature, exprimé par le discours mesuré.
La vraie poésie consistant essentiellement dans l'imitation, c'est dans l'imitation même que doivent se trouver ses différentes divisions.
Les hommes acquièrent la connaissance de ce qui est hors d'eux-mêmes, par les yeux ou par les oreilles, parce qu'ils voient les choses eux-mêmes, ou qu'ils les entendent raconter par les autres. Cette double manière de connaître produit la première division de la Poésie, et la partage en deux espèces, dont l'une est dramatique, où nous entendons les discours directs des personnes qui agissent ; l'autre épique, où nous ne voyons ni n'entendons rien par nous-mêmes directement, où tout nous est raconté.
Aut agitur res in scenis, aut acta refertur.
Si de ces deux espèces on en forme une troisième qui soit mixte, c'est-à-dire mêlée de l'épique et du dramatique, où il y ait du spectacle et du récit ; toutes les règles de cette troisième espèce seront contenues dans celles des deux autres.
Cette division, qui n'est fondée que sur la manière dont la Poésie montre les objets, est suivie d'une autre qui est prise dans la qualité des objets mêmes que traite la Poésie.
Depuis la divinité jusqu'aux derniers insectes, tout ce à quoi on peut supposer de l'action, est soumis à la Poésie, parce qu'il l'est à l'imitation. Ainsi, comme il y a des dieux, des rais, de simples citoyens, des bergers, des animaux, et que l'art s'est plu à les imiter dans leurs actions vraies ou vraisemblables, il y a aussi des opéra, des tragédies, des comédies, des pastorales, des apologues ; et c'est la seconde division dont chaque membre peut être encore sous-divisé, selon la diversité des objets, quoique dans le même genre.
Ces diverses espèces de poèmes ont leur style et leurs règles particulières dont il est parlé sous chaque article : c'est assez d'observer ici que tous les poèmes sont destinés à instruire ou à plaire, c'est-à-dire que dans les uns l'auteur se propose principalement d'instruire, et dans les autres de plaire, sans qu'un objet exclue l'autre. L'utîle domine dans le premier genre, l'agrément dans le second ; mais dans l'un l'utîle a besoin d'être paré de quelqu'agrément ; et dans l'autre l'agrément doit être soutenu par l'utile, sans quoi le premier parait dur, sec et triste, l'autre fade, insipide et vide. (D.J.)
POEME BUCOLIQUE, voyez PASTORALE, Poésie.
POEME COMIQUE, voyez COMEDIE COMIQUE, et POETE COMIQUE.
POEME CYCLIQUE, (Poésie) il y en a de trois sortes. Le premier est lorsque le poète pousse son sujet depuis un certain temps jusqu'à un autre, comme depuis le commencement du monde jusqu'au retour d'Ulysse, et qu'il lie tous les événements par une enchainure indissoluble, de manière que l'on puisse remonter de la fin au commencement, comme on est allé du commencement à la fin. C'est de cette manière que les métamorphoses d'Ovide sont un poème cyclique, perpetuum carmen, parce que la première fable est la cause de la seconde ; que la seconde produit la troisième, que la quatrième nait de celle-ci ; et ainsi des autres. C'est pourquoi Ovide a donné ce nom à son poème dès l'entrée.
Primaque ab origine mundi
In mea perpetuum deducite tempora carmen.
A cette sorte de poème était directement opposée la composition que les Grecs nommaient atacte, c'est-à-dire, sans liaison, parce qu'on y voyait plusieurs histoires sans ordre, comme dans la mopsonie d'Euphorion qui contenait presque tout ce qui s'était passé dans l'Attique.
L'autre espèce de poème cyclique est, lorsque le poète prend un seul sujet et une seule action pour lui donner une étendue raisonnable dans un certain nombre de vers ; dans ce sens l'Iliade et l'Enéide sont aussi des poèmes cycliques, dont l'un a en vue de chanter la colere d'Achille, fatale aux Troie.s, et l'autre l'établissement d'Enée en Italie.
On compte encore une troisième espèce de poème cyclique, lorsque le poète traite une histoire depuis son commencement jusqu'à la fin : comme par exemple l'auteur de la théseide dont parle Aristote ; car il avait ramassé dans ce seul poème tout ce qui était arrivé à son héros ; comme Antimaque, qui avait fait la thébaïde, qui a été appelée cyclique par les anciens, et celui dont parle Horace dans l'art poétique.
Nec sic incipies ut scriptor cyclicus olim,
Fortunam Priami cantabo et nobîle lethum.
Ce poète n'avait pas seulement parlé de la guerre de Troie dès son commencement ; mais il avait épuisé toute l'histoire de ce prince, sans oublier aucune de ses aventures, ni la moindre particularité de sa vie ; il nous reste aujourd'hui un poème dans ce goût : c'est l'achilléide de Stace ; car ce poète y a chanté Achille tout entier. Homère en avait laissé à dire plus qu'il n'en avait dit ; mais Stace n'a voulu rien oublier. C'est cette dernière espèce de poème qu'Aristote blâme, avec raison, à cause de la multiplication vicieuse de fables, qui ne peut être excusée par l'unité du héros.
Il résulte de ce détail, que les poètes cycliques sont ceux qui, sans emprunter de la poésie cet art de déplacer les événements pour les faire naître les uns des autres avec plus de merveilleux, en les rapportant tous à une seule et même action, suivaient dans leurs poèmes l'ordre naturel et méthodique de l'histoire ou de la fable, et se proposaient, par exemple, de mettre en vers tout ce qui s'était passé depuis un certain temps jusqu'à un autre, ou la vie entière de quelque prince, dont les aventures avaient quelque chose de grand et de singulier. (D.J.)
POEME DIDACTIQUE, (Poésie) poème où l'on se propose par des tableaux d'après nature, d'instruire, de tracer les lois de la raison, du bon sens, de guider les arts, d'orner et d'embellir la vérité, sans lui faire rien perdre de ses droits. Ce genre est une sorte d'usurpation que la poésie a fait sur la prose.
Le fond naturel de celle-ci est l'instruction. Comme elle est plus libre dans ses expressions et dans ses tours, et qu'elle n'a point la contrainte de l'harmonie poétique, il lui est plus aisé de rendre nettement les idées, et par conséquent de les faire passer telles qu'elles sont dans l'esprit de ceux qu'on instruit. Aussi les récits de l'histoire, les sciences, les arts sont-ils traités en prose. La raison en est simple : quand il s'agit d'un service important, on en prend le moyen le plus sur et le plus facîle ; et ce moyen en fait d'instruction est sans contredit la prose.
Cependant, comme il s'est trouvé des hommes qui réunissaient en même temps les connaissances et le talent de faire des vers, ils ont entrepris de joindre dans leurs ouvrages ce qui était joint dans leur personne, et de revétir de l'expression et de l'harmonie de la poésie, des matières qui étaient de pure doctrine. C'est de-là que sont venus les ouvrages et les jours d'Hésiode, les sentences de Théognis, la thérapeutique de Nicandre, la chasse et la pêche d'Oppien ; et pour parler des Latins, les poèmes de Lucrèce sur la nature, les géorgiques de Virgile, la pharsale de Lucain et quelques autres.
Mais dans tous ces ouvrages, il n'y a de poétique que la forme. La matière était faite ; il ne s'agissait que de la revétir. Ce n'est point la fiction qui a fourni les choses, selon les règles de l'imitation, c'est la vérité même. Aussi l'imitation ne porte-t-elle ses règles que sur l'expression. C'est pourquoi le poème didactique en général peut se définir : la vérité mise en vers : et par opposition, l'autre espèce de poésie : la fiction mise en vers. Voilà les deux extrémités : le didactique pur, et le poétique pur.
Entre ces deux extrémités, il y a une infinité de milieux, dans lesquels la fiction et la vérité se mélent et s'entr'aident mutuellement ; et les ouvrages qui s'y trouvent renfermés sont poétiques ou didactiques, plus ou moins, à proportion qu'il y a plus ou moins de fiction ou de vérité. Il n'y a presque point de fiction pure, même dans les poèmes proprement dits ; et réciproquement il n'y a presque point de vérité sans quelque mélange de fiction dans les poèmes didactiques. Il y en a même quelquefois dans la prose. Les interlocuteurs des dialogues de Platon, ceux des livres philosophiques de Cicéron sont faits ; et leur caractère soutenu est poétique. Il en est de même des discours dont Tite-Live a embelli son histoire. Ils ne sont guère plus vrais que ceux de Junon ou d'Enée dans le poème de Virgile. Il n'y a entr'eux de différence qu'en ce que Tite-Live a tiré les siens des faits historiques ; au lieu que Virgile les a tirés d'une histoire fabuleuse. Ils sont les uns et les autres également de la façon de l'écrivain.
Le poème didactique peut traiter autant d'espèces de sujets que la vérité a de genres : il peut être historique ; telle est la pharsale de Lucain ; voyez POEME HISTORIQUE, POEME PHILOSOPHIQUE. Il peut donner des préceptes pour régler les opérations dans un art, comme dans l'agriculture, dans la poésie, et telles sont les géorgiques de Virgile, et l'art poétique d'Horace, qu'on nomme simplement poème didactique.
Mais toutes ces espèces de poèmes ne sont pas tellement séparées, qu'elles ne se prêtent quelquefois un secours mutuel. Les sciences et les arts sont frères et sœurs ; c'est un principe qu'on ne saurait trop répéter dans cette matière. Leurs biens sont communs entr'eux ; et ils prennent partout ce qui peut leur convenir. Ainsi, dans la poésie philosophique il entre quelquefois des faits historiques, et des observations tirées des arts. Pareillement dans les poèmes historiques et didactiques, il entre souvent des raisonnements et des principes. Mais ces emprunts ne constituent pas le fond du genre. Ils n'y viennent que comme auxiliaires, ou quelquefois comme délassements, parce que la variété est le repos de l'esprit. Quand l'esprit est las d'un genre, d'une couleur, on lui en offre une autre qui exerce une autre faculté, et qui donne à celle qui était fatiguée le temps de réparer ses forces.
Il y a plus ; car quelles libertés ne se donnent pas les Poètes ? Quelquefois ils se laissent emporter au gré de leur imagination ; et las de la vérité, qui semble leur faire porter le joug, ils prennent l'essor, s'abandonnent à la fiction, et jouissent de tous les droits du génie. Alors ils cessent d'être historiens, philosophes, artistes. Ils ne sont plus que poètes. Ainsi Virgile cesse d'être agriculteur quand il raconte les fables d'Aristée et d'Orphée. Il quitte la vérité pour le vraisemblable ; il est maître et créateur de sa matière. Ce qui pourtant n'empêche pas que la totalité de son poème ne soit dans le genre didactique. Son épisode est dans son poème, ce qu'une statue est dans une maison ; c'est-à-dire un morceau de pur ornement dans un édifice fait pour l'usage.
Les poèmes didactiques ont, comme tous les ouvrages, dès qu'ils sont achevés et finis, un commencement, un milieu et une fin. On propose le sujet, on le traite, on l'acheve. Voilà qui peut suffire sur la matière du poème didactique ; venons à la forme.
Les Muses savent tout, non-seulement ce qui est, mais encore ce qui peut être, sur la terre, dans les enfers, au ciel, dans tous les espaces soit réels, soit possibles. Par conséquent si les poètes, quand ils ont voulu feindre des choses qui n'étaient pas, ont pu les mettre dans la bouche des Muses, pour leur donner par-là plus de crédit ; ils ont pu à plus forte raison, y mettre les choses vraies et réelles, et leur faire dicter des vers soit sur les sciences, soit sur l'histoire, soit sur la manière d'élever et de perfectionner les arts. C'est là-dessus qu'est fondée la forme poétique qui constitue le poème didactique ou de doctrine.
Il a toujours été permis à tout auteur de choisir la forme de son ouvrage ; et loin de lui faire un crime d'employer quelque tour adroit pour rendre le sujet qu'il traite plus agréable, on lui en sait gré, quand il soutient le ton qu'il a pris, et qu'il est fidèle à son plan.
Les poètes didactiques n'ont pas jugé à-propos de faire parler de simples mortels. Ils ont invoqué les divinités. Et comme ils se sont supposés exaucés, ils ont parlé en hommes inspirés, et à-peu-près comme ils s'imaginaient que les dieux l'auraient fait. C'est sur cette supposition que sont fondées toutes les règles générales du poème didactique quant à la forme. Voici ses règles générales.
1°. Les poètes didactiques cachent l'ordre jusqu'à un certain point. Ils semblent se laisser aller à leur génie, et suivre la matière telle qu'elle se présente, sans s'embarrasser de la conduire par une sorte de méthode qui avouerait l'art. Ils évitent tout ce qui aurait l'air compassé et mesuré. Ils ne mettront cependant point la mort d'un héros avant sa naissance, ni la vendange avant l'été. Le désordre qu'ils se permettent n'est que dans les petites parties, où il parait un effet de la négligence et de l'oubli plutôt que de l'ignorance. Dans les grandes, ils suivent ordinairement l'ordre naturel.
2°. La seconde règle est une suite de la première. En vertu du droit que se donnent les poètes, de traiter les matières en écrivains libres et supérieurs, ils mêlent dans leurs ouvrages des choses étrangères à leur sujet, qui n'y tiennent que par occasion ; et cela pour avoir le moyen de montrer leur érudition, leur supériorité, leur commerce avec les muses. Tels sont les épisodes d'Aristée et d'Orphée, les métamorphoses de quelque nymphe en souci, en rivière, en rocher.
3°. La troisième regarde l'expression. Ils s'arrogent tous les privilèges du style poétique. Ils chargent les idées en prenant des termes métaphoriques, au lieu des termes propres, en y ajoutant des idées accessoires par les épithètes qui fortifient, augmentent, modifient les idées principales. Ils emploient des tours hardis, des constructions licencieuses, des figures de mots et de pensées qu'ils placent d'une façon singulière. Ils sement des traits d'une érudition détournée et peu commune. Enfin, ils prennent tous les moyens de persuader à leurs lecteurs, que c'est un génie qui leur parle, afin d'étonner par-là leur esprit, et de maitriser leur attention.
La quatrième règle et la plus importante à suivre, est de rendre le poème didactique le plus intéressant qu'il est possible. Tous les auteurs de goût qui ont composé de tels poèmes, et qui ont employé les vers à nous donner des leçons, se sont conduits sur ce principe. Afin de soutenir l'attention du lecteur, ils ont semé leurs vers d'images qui peignent des objets touchants ; car les objets, qui ne sont propres qu'à satisfaire notre curiosité, ne nous attachent pas autant que les objets qui sont capables de nous attendrir. S'il m'est permis de parler ainsi, l'esprit est d'un commerce plus difficîle que le cœur.
Quand Virgile composa les géorgiques, qui sont un poème didactique, dont le titre nous promet des instructions sur l'agriculture et sur les occupations de la vie champêtre, il eut attention à le remplir d'imitations faites d'après des objets qui nous auraient attachés dans la nature. Virgile ne s'est pas même contenté de ces images répandues avec un art infini dans tout l'ouvrage. Il place dans un de ses livres une dissertation faite à l'occasion des présages du soleil, et il y traite avec toute l'invention dont la poésie est capable, le meurtre de Jules-César, et le commencement du règne d'Auguste. On ne pouvait pas entretenir les Romains d'un sujet qui les intéressât davantage.
Virgile met dans un autre livre la fable miraculeuse d'Aristée, et la peinture des effets de l'amour. Dans un autre c'est un tableau de la vie champêtre qui forme un paysage riant et rempli des figures les plus aimables. Enfin, il insere dans cet ouvrage l'aventure tragique d'Orphée et d'Euridice, capable de faire fondre en larmes ceux qui la verraient véritablement.
Il est si vrai que ce sont ces images qui sont cause qu'on se plait tant à lire les géorgiques, que l'attention se relâche sur les vers qui donnent les préceptes que le titre a promis. Supposé même que l'objet qu'un poème didactique nous présente fût si curieux qu'on le lut une fois avec plaisir, on ne le relirait pas avec la même satisfaction qu'on relit une églogue. L'esprit ne saurait jouir deux fois du plaisir d'apprendre la même chose ; mais le cœur peut jouir deux fois du plaisir de sentir la même émotion. Le plaisir d'apprendre est consommé par le plaisir de savoir.
Les poèmes didactiques, que leurs auteurs ont dédaigné d'embellir par des tableaux pathétiques assez fréquents, ne sont guère entre les mains du commun des hommes. Quel que soit le mérite de ces poèmes, on en regarde la lecture comme une occupation sérieuse, et non pas comme un plaisir. On les aime moins, et le public n'en retire guère que les vers qui contiennent des tableaux pareils à ceux dont on loue Virgile d'avoir enrichi les géorgiques.
Il n'est personne qui n'admire le génie et la verve de Lucrèce, l'énergie de ses expressions, la manière hardie dont il peint des objets pour lesquels le pinceau de la poésie ne paraissait point fait, enfin sa dextérité pour mettre en vers des choses que Virgile lui-même aurait peut-être désesperé de pouvoir dire en langage des dieux : mais Lucrèce est bien plus admiré qu'il n'est lu. Il y a plus à profiter dans son poème de natura rerum, que dans l'énéide de Virgile : cependant tout le monde lit et relit Virgile ; et peu de personnes font de Lucrèce leur livre favori. On ne lit son ouvrage que de propos délibéré. Il n'est point, comme l'énéide, un de ces livres sur lesquels un attrait insensible fait d'abord porter la main quand on veut lire une heure ou deux. Qu'on compare le nombre des traductions de Lucrèce avec le nombre des traductions de Virgile dans toutes les langues polies, et l'on trouvera quatre traductions de l'énéide de Virgile, contre une traduction du poème de natura rerum. Les hommes aimeront toujours mieux les livres qui les toucheront que les livres qui instruiront. Comme l'ennui leur est plus à charge que l'ignorance, ils préfèrent le plaisir d'être émus, au plaisir d'être instruits. (D.J.)
POEME DRAMATIQUE, (Poésie) représentation d'actions merveilleuses, héroïques ou bourgeoises.
Le poème dramatique est ainsi nommé du mot grec , qui vient de l'éolique, ou , lequel signifie agir ; parce que dans cette espèce de poème, on ne raconte point l'action comme dans l'épopée, mais qu'on la montre elle-même dans ceux qui la représentent. L'action dramatique est soumise aux yeux, et doit se peindre comme la vérité : or le jugement des yeux, en fait de spectacle, est infiniment plus redoutable que celui des oreilles. Cela est si vrai, que dans les drames mêmes, on met en récit ce qui serait peu vraisemblable en spectacle. On dit qu'Hippolyte a été attaqué par un monstre et déchiré par les chevaux, parce que si on eut voulu représenter cet événement plutôt que de le raconter, il y aurait eu une infinité de petites circonstances qui auraient trahi l'art et changé la pitié en risée. Le précepte d'Horace y est formel ; et quand Horace ne l'aurait point dit, la raison le dit assez.
On y exige encore non-seulement que l'action soit une, mais qu'elle se passe toute en un même jour, en un même lieu. La raison de tout cela est dans l'imitation.
Comme toute action se passe en un lieu, ce lieu doit être convenable à la qualité des acteurs. Si ce sont des bergers, la scène est en paysage : celle des rois est un palais, ainsi du reste.
Pourvu qu'on conserve le caractère du lieu, il est permis de l'embellir de toutes les richesses de l'art ; les couleurs et la perspective en font toute la dépense. Cependant il faut que les mœurs des acteurs soient peintes dans la scène même ; qu'il y ait une juste proportion entre la demeure et le maître qui l'habite ; qu'on y remarque les usages des temps, des pays, des nations. Un américain ne doit être ni vétu, ni logé comme un français ; ni un français comme un ancien romain ; ni même comme un espagnol moderne. Si on n'a point de modèle, il faut s'en figurer un, conformément à l'idée que peuvent en avoir les spectateurs.
Les deux principales espèces de poèmes dramatiques sont la tragédie et la comédie, ou comme disaient les anciens, le cothurne et le brodequin.
La tragédie partage avec l'épopée la grandeur et l'importance de l'action, et n'en diffère que par le dramatique seulement. Elle imite le beau, le grand ; la comédie imite le ridicule. L'une élève l'âme et forme le cœur ; l'autre polit les mœurs, et corrige le dehors. La tragédie nous humanise par la compassion, et nous retient par la crainte, : la comédie nous ôte le masque à demi, et nous présente adroitement le miroir. La tragédie ne fait pas rire, parce que les sottises des grands sont presque des malheurs publics.
Quidquid delirant reges, plectuntur achivi.
La comédie fait rire, parce que les sottises des petits ne sont que des sottises : on n'en craint point les suites. La tragédie excite la terreur et la pitié, ce qui est signifié par le nom même de la tragédie. La comédie fait rire, et c'est ce qui la rend comique ou comédie.
Au reste, la poésie dramatique fit plus de progrès depuis 1635 jusqu'en 1665 ; elle se perfectionna plus en ces 30 années-là, qu'elle ne l'avait fait dans les trois siècles précédents. Rotrou parut en même temps que Corneille ; Racine, Moliere et Quinaut vinrent bientôt après. Quels progrès a fait depuis parmi nous cette même poésie dramatique ? aucun. Mais il est inutîle d'entrer ici dans de plus grands détails. Voyez COMEDIE, TRAGEDIE, DRAME, DRAMATIQUE, OPERA, etc. (D.J.)
POEME EPIQUE, (Poésie) récit poétique de quelque grande action qui intéresse des peuples entiers, ou même tout le genre humain. Les Homère et les Virgile en ont fixé l'idée jusqu'à ce qu'il vienne des modèles plus accomplis.
Le poème épique est bien différent de l'histoire, quoiqu'il ait avec elle une ressemblance apparente. L'histoire est consacrée à la vérité, mais l'épopée peut ne vivre que de mensonges ; elle ne connait d'autres bornes que celles de la possibilité.
Quand l'histoire, continue M. le Batteux, a rendu son témoignage, tout est fait pour elle, on ne lui demande rien au-delà. On veut au contraire que l'épopée charme de lecteur, qu'elle excite son admiration, qu'elle occupe en même temps la raison, l'imagination, l'esprit ; qu'elle touche les cœurs, étonne les sens, et fasse éprouver à l'âme une suite de situations délicieuses, qui ne soient interrompues quelques instants que pour les renouveller avec plus de vivacité.
L'histoire présente les faits sans songer à plaire par la singularité des causes ou des moyens. C'est le portrait des temps et des hommes ; par conséquent l'image de l'inconstance et du caprice, de mille variations qui semblent l'ouvrage du hasard et de la fortune. L'épopée ne raconte qu'une action, et non plusieurs. Cette action est essentiellement intéressante ; ses parties sont concertées ; les causes sont vraisemblables : les acteurs ont des caractères marqués, des mœurs soutenues ; c'est un tout entier, proportionné, ordonné, parfaitement lié dans toutes ses parties.
Enfin l'histoire ne montre que les causes naturelles ; elle marche, ses mémoires et ses dates à la main ; ou si, guidée par la philosophie, elle Ve quelquefois dans le cœur des hommes chercher les principes secrets des événements, que le vulgaire attribue à d'autres causes ; jamais elle ne remonte au-delà des forces, ni de la prudence humaine. L'épopée est le récit d'une muse, c'est-à-dire d'une intelligence céleste, laquelle a Ve non-seulement le jeu de toutes les causes naturelles, mais encore l'action des causes surnaturelles, qui préparent les ressorts humains, qui leur donnent l'impulsion et la direction pour produire l'action qui est l'objet du poème.
La première idée qui se présente à un poète qui veut entreprendre cet ouvrage, c'est d'immortaliser son génie, c'est la fin de l'ouvrier ; cette idée le conduit naturellement au choix d'un sujet qui intéresse un grand nombre d'hommes, et qui soit en même temps capable de porter le merveilleux : ce sujet ne peut être qu'une action.
Pour en dresser toutes les parties et les rédiger en un seul corps, il fait comme les hommes qui agissent, il se propose un but où se portent tous les efforts de ceux qu'il fait agir : c'est la fin de l'ouvrage.
Toutes les parties étant ainsi ordonnées vers un seul terme marqué avec précision, le poète fait valoir tous les privilèges de son art. Quoique son sujet soit tiré de l'histoire, il s'en rend le maître ; il ajoute, il retranche, il transpose, il crée, il dresse les machines à son gré, il prépare de loin des ressorts secrets, des forces mouvantes ; il dessine d'après les idées de la belle nature les grandes parties ; il détermine les caractères de ses personnages ; il forme le labyrinthe de l'intrigue ; il dispose tous ses tableaux selon l'intérêt de l'ouvrage, et conduisant son lecteur de merveilles en merveilles, il lui laisse toujours apercevoir dans le lointain une perspective plus charmante, qui séduit sa curiosité, et l'entraîne malgré lui jusqu'au dénouement et à la fin du poème.
Il est vrai que ni la société ni l'histoire ne lui offrent point de tableaux si parfaits et si achevés. Mais il suffit qu'elles lui en montrent les parties, et qu'il ait lui en soi les principes qui doivent le guider dans la composition du tout.
Le plan de toute l'action étant dressé de la sorte, il invoque la muse qui doit l'inspirer : aussi-tôt après cette invocation il devient un autre homme.
.... Cui talia fanti
.... Subito non vultus, non color unus ;
Et rabie fera corda tument, majorque videri,
Nec mortale sonans, afflatur numine quandò
Jam propiore dei.... Tros Anchisiade....
Il est autant dans le ciel que sur la terre : il parait tout pénétré de l'esprit divin ; ses discours ressemblent moins au témoignage d'un historien scrupuleux qu'à l'extase d'un prophète. Il appelle par leurs noms les choses qui n'existent pas encore : il voit plusieurs siècles auparavant la mer Caspienne qui frémit, et les sept embouchures du Nil qui se troublent dans l'attente d'un héros.
Ce ton majestueux se soutient : tout s'annoblit dans sa bouche ; les pensées, les expressions, les tours, l'harmonie, tout est rempli de hardiesse et de pompe. Ce n'est point le tonnerre qui gronde par intervalle, qui éclate et qui se tait ; c'est un grand fleuve qui roule ses flots avec bruit, et qui étonne le voyageur qui l'entend de loin dans une vallée profonde : en un mot, c'est un dieu qui fait récit à des dieux.
Je ne discuterai point ici ce qui concerne le plan de l'épopée, son choix, son action, son nœud, son dénouement, ses épisodes, ses personnages et son style : toutes ces choses ont été traitées profondément au mot EPOPEE. J'y renvoye le lecteur, et je me borne aux remarques générales les plus importantes qu'on trouvera ingénieusement détaillées dans un discours de M. de Voltaire sur cette matière.
Que l'action du poème épique soit simple ou complexe, dit ce beau génie ; qu'elle s'acheve dans un mois ou dans une année, ou qu'elle dure plus longtemps ; que la scène soit fixée dans un seul endroit, comme dans l'Iliade ; que le héros voyage de mers et en mers, comme dans l'Odyssée ; qu'il soit heureux ou infortuné, furieux comme Achille, ou pieux comme Enée ; qu'il y ait un principal personnage ou plusieurs ; que l'action se passe sur la terre ou sur la mer, sur le rivage d'Afrique comme dans la Luziada, dans l'Amérique comme dans l'Araucana, dans le ciel, dans l'enfer, hors des limites de notre monde, comme dans le paradis de Milton : il n'importe, le poème sera toujours un poème épique, un poème héroïque, à-moins qu'on ne lui trouve un nouveau titre proportionné à son mérite.
Si vous faites scrupule, disait le célèbre M. Adisson, de donner le titre de poème épique au paradis perdu de Milton, appelez-le, si vous voulez, un poème divin ; donnez lui tel nom qu'il vous plaira, pourvu que vous confessiez que c'est un ouvrage aussi admirable en son genre que l'Enéide ; ne disputons jamais sur les noms, c'est une puérilité impardonnable.
Mais le point de la question et de la difficulté est de savoir sur quoi les nations polies se réunissent, et sur quoi elles différent. Un poème épique doit par-tout être fondé sur le jugement, et embelli par l'imagination ; ce qui appartient au bon sens, appartient également à toutes les nations du monde. Toutes vous diront qu'une action, une et simple qui se développe aisément et par degré, et qui ne coute point une attention fatiguante, leur plaira davantage qu'un amas confus d'aventures monstrueuses. On souhaite généralement que cette unité si sage soit ornée d'une variété d'épisodes, qui soient comme les membres d'un corps robuste et proportionné.
Plus l'action sera grande, plus elle plaira à tous les hommes dont la faiblesse est d'être séduits par tout ce qui est au-delà de la vie commune. Il faudra surtout que cette action soit intéressante ; car tous les cœurs veulent être remués, et un poème parfait d'ailleurs, s'il ne touchait point, serait insipide en tout temps et en tout pays. Elle doit être entière, parce qu'il n'y a point d'homme qui puisse être satisfait, s'il ne reçoit qu'une partie du tout qu'il s'est promis d'avoir.
Telles sont à-peu-près les principales règles que la nature dicte à toutes les nations qui cultivent les lettres ; mais la machine du merveilleux, l'intervention d'un pouvoir céleste, la nature des épisodes, tout ce qui dépend de la tyrannie de la coutume et de cet instrument qu'on nomme goût ; voilà sur quoi il y a mille opinions, et point de règles générales.
Nous devons admirer ce qui est universellement beau chez les anciens, nous devons nous prêter à ce qui était beau dans leur langue et dans leurs mœurs, mais ce serait s'égarer étrangement que de les vouloir suivre en tout à la piste. Nous ne parlons point la même langue ; la religion qui est presque toujours le fondement de la poésie épique, est parmi nous l'opposé de leur mythologie. Nos coutumes sont plus différentes de celles des héros du siege de Troie que de celles des Américains. Nos combats, nos sieges, nos flottes n'ont pas la moindre ressemblance ; notre philosophie est en tout le contraire de la leur. L'invention de la poudre, celle de la boussole, de l'Imprimerie, tant d'autres arts qui ont été apportés récemment dans le monde, ont, en quelque façon, changé la face de l'univers, en sorte qu'un poète épique entouré de tant de nouveautés doit avoir un génie bien stérile, ou bien timide, s'il n'ose pas être neuf lui-même.
Qu'Homère nous représente ses dieux s'enyvrant de nectar, et riant sans fin de la mauvaise grâce dont Vulcain leur sert à boire, cela était bon de son temps, où les dieux étaient ce que les fées sont dans le nôtre. Mais assurément personne ne s'avisera aujourd'hui de représenter dans un poème une troupe d'anges et de saints buvant et riant à table. Que dirait-on d'un auteur qui irait, après Virgile, introduire des harpies enlevant le diner de son héros ?
En un mot, admirons les anciens ; mais que notre admiration ne soit pas une superstition aveugle : ne faisons pas cette injustice à la nature humaine et à nous-mêmes, de fermer nos yeux aux beautés qu'elle répand autour de nous, pour ne regarder et n'aimer que ses anciennes productions dont nous ne pouvons pas juger avec autant de sûreté.
Il n'y a point de monuments en Italie qui méritent plus l'attention d'un voyageur que la Jérusalem du Tasse ; Milton fait presque autant d'honneur à l'Angleterre que le grand Newton. Le Camoèns est en Portugal ce que Milton est en Angleterre.
C'est sans doute un grand plaisir pour un homme qui pense de lire attentivement tous ces poèmes épiques de différente nature nés en des siècles et dans des pays éloignés les uns des autres. En les examinant impartialement, on n'ira point demander à Aristote ce qu'il faut penser d'un auteur anglais ou portugais, ni à M. Perrault, comme on doit juger de l'Iliade. On ne se laissera point tyranniser par Scaliger et par le Bossu, mais on tirera ses règles de la nature et des exemples frappans, et pour-lors on jugera entre les dieux d'Homère et le vrai Dieu chanté par Milton, entre Calypso et Didon, Armide et Eve.
De beaux génies et de grands maîtres de l'art se sont ainsi conduits pour juger sainement les poètes épiques ; &, comme j'ai leurs écrits sous les yeux, je puis aisément poncer ici quelques-uns des principaux traits de leurs desseins. Commençons par Homère.
Ce grand poète vivait probablement environ 850 ans avant l'ère chrétienne. Il était contemporain d'Hésiode, et fleurissait trois générations après la guerre de Troie ; ainsi il pouvait avoir Ve dans son enfance quelques vieillards qui avaient été à ce siege ; et il devait avoir parlé souvent à des Grecs d'Europe et d'Asie, qui avaient Ve Ulysse et Ménélas. Quand il composa l'Iliade et l'Odyssée, il ne fit donc que mettre en vers une partie de l'histoire et des fables de son temps.
Les Grecs n'avaient alors que des poètes pour historiens et pour théologiens ; ce ne fut même que 400 ans après Hésiode et Homère qu'on se réduisit à écrire l'histoire en prose. Cet usage qui paraitra bien ridicule à beaucoup de lecteurs, était très-raisonnable. Un livre en ces temps-là était une chose aussi rare qu'un bon livre l'est aujourd'hui : loin de donner au public l'histoire in-folio de chaque village, comme on a fait à-présent, on ne transmettait à la postérité que les grands événements qui devaient l'intéresser. Le culte des dieux et l'histoire des grands hommes étaient les seuls sujets de ce petit nombre d'écrits : on les composa longtemps en vers chez les Egyptiens et chez les Grecs, parce qu'ils étaient destinés à être retenus par cœur et à être chantés : telle était la coutume de ces peuples si différents de nous. Il n'y eut jusqu'à Hérodote d'autre histoire parmi eux qu'en vers, et ils n'eurent dans aucun temps de poésie sans musique.
Celle d'Homère se chantait par morceaux détachés, auxquels on donnait des titres particuliers, comme le combat des vaisseaux, le Patroclée, la grotte de Calypso ; on les appelait rapsodies, et ceux qui les chantaient rapsodistes. Ce fut Pisistrate, roi d'Athènes, qui rassembla ces morceaux, qui les arrangea dans leur ordre naturel, et qui en composa les deux corps de poésie que nous avons sous le nom d'Iliade et d'Odyssée. On en fit ensuite plusieurs éditions fameuses. Aristote en fit une pour Alexandre le Grand, qui la mit dans une précieuse cassette qu'il avait trouvée parmi les dépouilles de Darius, et qu'on nomma l'édition de la cassette. Enfin Aristarque, que Ptolomée Philométor avait fait gouverneur de son fils Evergetes, en fit une si correcte et si exacte, que son nom est devenu celui de la saine critique. On dit un Aristarque pour dire un bon juge en matière de goût ; c'est son édition qu'on prétend que nous avons aujourd'hui.
Autant les ouvrages d'Homère sont connus, autant est-on dans l'ignorance sur sa personne. Tout ce qu'on sait de vrai, c'est que longtemps après sa mort on lui a érigé des statues et élevé des temples. Sept villes puissantes se sont disputé l'honneur de l'avoir Ve naître ; mais la commune opinion est que de son vivant il fut exposé aux injures de la fortune, qu'il avait à peine un domicile, et que celui dont la postérité a fait un dieu, a vécu pauvre et misérable, deux choses très-compatibles, et que plusieurs grands hommes ont éprouvé dans tous les temps et dans tous les lieux. On admire les qualités de son cœur qu'il a peint dans ses écrits, sa modestie, sa droiture, la simplicité et l'élévation de ses sentiments.
L'Iliade qui est son grand ouvrage, est plein de dieux et de combats. Ces sujets plaisent naturellement aux hommes ; ils aiment ce qui leur parait terrible ; ils sont comme les enfants qui écoutent avidement ces contes de sorciers qui les effraient. Il y a des fables pour tout âge, et il n'y a point de nation qui n'ait eu les siennes.
De ces deux sujets qui remplissent l'Iliade naissent les deux grands reproches que l'on fait à Homère, on lui impute l'extravagance de ses dieux et la grossiereté de ses héros ; c'est reprocher à un peintre d'avoir donné à ses figures des habillements de son temps. Homère a peint les dieux tels qu'on les croyait, et les hommes tels qu'ils étaient. Ce n'est pas un grand mérite de trouver de l'absurdité dans la théologie payenne, mais il faudrait être bien dépourvu de goût pour ne pas aimer certaines fables d'Homère. Si l'idée des trois grâces qui doivent toujours accompagner la déesse de la beauté, si la ceinture de Vénus sont de son invention, quelles louanges ne lui doit-on pas pour avoir ainsi orné cette religion que nous lui reprochons ? Et si ces fables étaient déjà reçues avant lui, peut-on mépriser un siècle qui avait trouvé des allégories si justes et si charmantes ?
Quant à ce qu'on appelle grossiereté dans les héros d'Homère, on peut rire tant qu'on voudra, de voir Patrocle préparer le diner avec Achille. Achille et Patrocle ne perdent rien à cela de leur héroïsme ; et la plupart de nos généraux qui portent dans un camp tout le luxe d'une cour efféminée, n'égaleront jamais ces héros qui faisaient leur cuisine eux-mêmes. On peut se moquer de la princesse Nausica, qui, suivie de ses femmes, Ve laver ses robes et celles du roi et de la reine. Cette simplicité si respectable, vaut bien mieux que la vaine pompe et l'oisiveté dans lesquelles les personnes d'un haut rang sont nourries.
Ceux qui reprochent à Homère d'avoir tant loué la force de ses héros, ne savent pas qu'avant l'invention de la poudre, la force du corps décidait de tout dans les batailles. Ils ignorent que cette force est l'origine de tout pouvoir chez les hommes, et que c'est par cette supériorité seule, que les nations du Nord ont conquis notre hémisphère, depuis la Chine jusqu'au mont Atlas. Les anciens se faisaient une gloire d'être robustes ; leurs plaisirs étaient des exercices violents ; ils ne passaient point leurs jours à se faire trainer dans des chars mollement suspendus, à couvert des influences de l'air, pour aller porter languissamment, d'une maison dans une autre, leur ennui et leur inutilité. En un mot, Homère avait à représenter un Ajax et un Hector, non un courtisan de Versailles ou de Saint-James.
Je ne prétens pas cependant justifier Homère de tout défaut ; mais j'aime la manière dont Horace le juge ; c'est un soupçon, plutôt qu'une accusation ; et il est même fâché d'avoir ce soupçon. Les beautés de ses ouvrages sont si grandes, que j'oublie les moments où il me parait sommeiller. On retrouve partout dans ses poésies un génie créateur, une imagination riche et brillante, un enthousiasme presque divin. Il a réuni toutes les parties ; le gracieux, le riant, le grave et le sublime ; et à ce dernier égard il est bien supérieur à Virgile.
Je ne m'attacherai point à montrer son talent dans l'invention, son goût dans la disposition, sa force et sa justesse dans l'expression ; on peut lire tout ce qu'en dit l'auteur des principes de la Littérature. Je me contenterai seulement de remarquer, que le plus grand mérite d'Homère, est de porter par-tout l'empreinte du génie. Nous ne sommes plus en état de juger de son élocution, que toute l'antiquité grecque et latine admirait. Nous savons tout au plus la valeur des mots : nous ne pouvons juger s'ils sont nobles, et à quel point ils le sont ; si chaque mot était le mot unique dans l'endroit où il est placé. Nous ne sommes point surs de la prononciation ; notre organe n'y est point fait : de sorte que si Homère nous enchante, nous n'en avons presque obligation qu'à la beauté des choses, et à l'énergie de ses traits, qui, quoiqu'à demi effacés pour nous, nous paraissent encore plus beaux que la plupart des modernes, dont le coloris est si frais.
S'il décrit une armée en marche, " c'est un feu dévorant, qui poussé par les vents, consume la terre devant lui. " Si c'est un dieu qui se transporte d'un lieu à un autre, " il fait trois pas, et au quatrième, il arrive au bout du monde ". On entend dans les descriptions des combats, le bruit de guerre, le cliquetis des armes, le fracas de la mêlée, le tonnerre de Jupiter qui gronde, la terre qui retentit sous les pieds des combattants. On n'est point avec le poète, on est au milieu de ses héros. On ne lit point son ouvrage ; on croit être présent à tout ce qu'il raconte. L'esprit, l'imagination, le cœur, toute la capacité de l'âme est remplie par la grandeur des intérêts, par la vivacité des images, et par la marche harmonieuse de la poésie et du style.
Quand il décrit la ceinture de Vénus, il n'y a point de tableau de l'Albane qui approche de cette peinture riante. Veut-il fléchir la colere d'Achille, il personnifie les Prières. " Elles sont filles du maître des dieux, elles marchent tristement, le front couvert de confusion, les yeux trempés de larmes, et ne pouvant se soutenir sur leurs pieds chancelans, elles suivent de loin l'Injure, l'Injure altière qui court sur la terre d'un pied léger, levant sa tête audacieuse ".
Si quelques-unes des comparaisons d'Homère ne nous paraissent pas assez nobles, la plupart n'ont pas ce défaut. Une armée couverte de ses boucliers, descend de la montagne ; c'est une forêt en feu ; elle s'avance, et fait lever la poussière ; c'est une nuée qui apporte l'orage. Un jeune combattant est atteint d'un trait mortel ; c'est un pavot vermeil qui laisse tomber sa tête mourante. En un mot, l'Iliade est un édifice enrichi de figures majestueuses, riantes, agréables, naïves, touchantes, tendres, délicates. Plus on la lit, plus on admire l'étendue, la profondeur, et la grandeur du génie de l'architecte.
Il n'est plus permis aujourd'hui de révoquer toutes ces choses en doute. Il n'est plus question, dit fort bien Despréaux, de savoir si Homère, Platon, Cicéron, Virgile, sont des hommes merveilleux. C'est une chose sans contestation, puisque vingt siècles en sont convenus ; et après des suffrages si constants, il y aurait non-seulement de la témérité, mais même de la folie, à douter du mérite de ces écrivains.
Passons à Virgile, le prince des poètes latins, et l'auteur de l'Enéïde.
En lisant Homère, dit M. le Batteux, nous nous figurons ce poète dans son siècle, comme une lumière unique au milieu des ténèbres, seul avec la seule nature, sans conseil, sans livres, sans sociétés de savants, abandonné à son seul génie, ou instruit uniquement par les muses.
En ouvrant Virgile, nous sentons au contraire, que nous entrons dans un monde éclairé, que nous sommes chez une nation où règne la magnificence et le gout, où tous les arts, la Sculpture, la Peinture, l'Architecture ont des chefs-d'œuvres, où les talents sont réunis avec les lumières.
Il y avait dans le siècle d'Auguste, une infinité de gens de lettres, de philosophes, qui connaissaient la nature et les arts, qui avaient lu les auteurs anciens et les modernes, qui les avaient comparés, qui en avaient discuté, et qui en discutaient tous les jours les beautés de vive voix et par écrit. Virgile devait profiter de ces avantages, et on sent en le lisant, qu'il en a réellement profité. On y remarque le soin d'un auteur qui connait des règles, et qui craint de les blesser ; qui polit et repolit sans fin, et qui appréhende la censure des connaisseurs. Toujours riche, toujours correct, toujours élégant ; ses tableaux ont un coloris aussi brillant que juste ; en artiste instruit, il aime mieux se tenir sur les bords, que de s'exposer à l'orage. Homère, plein de sécurité, se laisse aller à son génie. Il peint toujours en grand, au risque de passer quelquefois les bornes de l'art ; la nature seule le guide.
Le premier pas que devait faire Virgile, entreprenant un poème épique, était de choisir un sujet qui put en porter l'édifice ; un sujet voisin des temps fabuleux, presque fabuleux lui-même, et dont on n'eut que des idées vagues, demi-formées, et capables par-là de se prêter aux fictions épiques. En second lieu, il fallait qu'il y eut un rapport intéressant entre ce sujet, et le peuple pour qui il entreprenait de le traiter. Or ces deux points se réunissent parfaitement dans l'arrivée d'Enée en Italie. Ce prince passait pour être fils d'une déesse. Son histoire se perdait dans la fable. D'ailleurs les Romains prétendaient qu'il était le fondateur de leur nation, et le père de leur premier roi. Virgile a donc fait un bon choix en prenant pour sujet l'établissement d'Enée en Italie.
Pour jeter encore un nouvel intérêt dans cette matière, le poète usant des droits de son art, a jugé à propos de faire entrer dans son poème plusieurs traits à la louange du prince et de la nation, et de présenter des tableaux allégoriques où ils pussent se reconnaître avec plaisir. Tout le monde fut enchanté de son poème dès qu'il vit le jour. Les suffrages et l'amitié d'Auguste, de Mécène, de Tucca, de Pollion, d'Horace, de Gallus ne servirent pas peu, sans doute, à diriger les jugements de ses contemporains, qui peut-être sans cela ne lui auraient pas rendu si-tôt justice. Quoi qu'il en sait, telle était la vénération qu'on avait pour lui à Rome, qu'un jour comme il vint paraitre au théâtre après qu'on y eut récité quelques-uns des vers de l'Enéide, tout le peuple se leva avec de grandes acclamations, honneur qu'on ne rendait alors qu'à l'empereur.
La critique la plus vraie, la plus générale et la mieux fondée qu'on puisse faire de l'Enéide, c'est que les six derniers chants sont bien inférieurs aux six premiers ; cependant on y reconnait par-tout la main de Virgile, et l'on doit convenir que ce que la force de son art a tiré de ce terrain ingrat est presque incroyable. Il est vrai que ce grand poète n'avait voulu réciter à Auguste que le premier, le second, le quatrième et le sixième livres, qui sont effectivement la plus belle partie de son poème. C'est-là que Virgile a épuisé tout ce que l'imagination a de plus grand dans la descente d'Enée aux enfers, ou, si l'on veut, dans le tableau des mystères d'Eleusis. Il a dit tout au cœur dans les amours de Didon. La terreur et la compassion ne peuvent aller plus loin que dans sa description du siege, de la prise et de la ruine de Troie. De cette haute élévation où il était parvenu au milieu de son vol, il était bien difficîle de ne pas descendre.
Mais il est assez vraisemblable que Virgile sentait lui-même que cette dernière partie de son ouvrage avait besoin d'être retouchée. On sait qu'il ordonna par son testament que l'on brulât son Enéide dont il n'était point satisfait ; mais Auguste se donna bien de garde d'obéir à sa dernière volonté, et de priver le monde du poème le plus touchant de l'antiquité. Il tient aujourd'hui la balance presque égale avec l'Iliade : on trouve quelquefois dans Homère des longueurs, des détails qui ne nous paraissent pas assez choisis. Virgile a évité ces petites fautes, et a mieux aimé rester en-deçà que d'aller au-delà.
Enfin les Grecs et les Latins n'ont rien en de plus beau et de plus parfait en leurs langues que les poésies d'Homère et de Virgile ; c'est la source, le modèle et la règle du bon gout. Ainsi il n'y a point d'homme de lettres qui ne doive savoir, et savoir bien les ouvrages de ces deux poètes.
Ils ont tous deux dans l'expression quelque chose de divin. On ne peut dire mieux, avec plus de force, de noblesse, d'harmonie, de précision, ce qu'ils disent l'un et l'autre : et plutôt que de les comparer dans cette partie, il faut prendre la pensée du petit Cyrus et dire : " Mon grand-pere est le plus grand des Medes, et mon père le plus beau des Perses ". Domitius Afer répondit à peu-près la même chose à quelqu'un qui lui demandait son opinion sur le mérite des deux poètes : Virgile, dit-il, est le second, mais plus près du premier que du troisième.
Après avoir levé les yeux vers Homère et Virgile, il est inutîle de les arrêter longtemps sur leurs copistes. Je passerai donc légèrement en revue Statius et Silius Italicus ; l'un inégal et timide, l'autre imitateur encore plus faible de l'Iliade et de l'Enéide.
Stace, ou plutôt Publius Papinius Statius, vivait sous le règne de Domitien. Il obtint les bonnes grâces de cet empereur, et lui dédia sa Thébaïde poème de douze chants. Quelques louanges que lui ait donné Jules Scaliger, tous les gens de goût trouvent qu'il peche du côté de l'art et du génie : sa diction, quoiqu'assez fleurie, est très-inégale ; tantôt il s'élève fort haut, et tantôt il rampe à terre. C'est ce qui a fait dire assez ingénieusement à un moderne, qu'il se représentait sur la cime du Parnasse, mais dans la posture d'un homme qui n'y pouvant tenir, était sur le point de se précipiter. Ses vers cadencent à l'oreille sans aller jamais au cœur. Son poème n'est ni régulier, ni proportionné, ni même épique, car les fictions qui s'y trouvent sentent moins le poète que l'orateur timide, ou l'historien méthodique. Ses sylves, recueil de petites pièces de vers sur différents sujets, plaisent davantage, parce que le style en est pur et naturel. Son Achilléide est le moindre de ses écrits, mais c'est un ouvrage auquel il n'a point mis la dernière main. La mort le surprit vers la centième année de Jesus-Christ, dans le temps qu'il retouchait le second chant. Enfin lui-même reconnait qu'il n'a suivi Virgile que de fort loin, et qu'en baisant ses traces qu'il adorait ; c'est un sentiment de modestie, dont il faut lui tenir compte. Nous avons une belle et bonne édition de ses œuvres faite à Paris en 1618 in-4°. M. de Marolles en a donné une traduction française, mais beaucoup trop négligée et à laquelle il manque les notes d'érudition.
Silius Italicus parvint aux honneurs du consulat, et finit sa vie au commencement du règne de Trajan, âgé de 75 ans. Il se laissa mourir de faim, n'ayant pas la constance de supporter la douleur de ses maux. Son style est à la vérité plus pur que celui de ses contemporains ; mais son ouvrage de la seconde guerre punique est si faible et si prosaïque, qu'il doit plutôt avoir le nom d'histoire écrite en vers, que celui de poème épique.
Lucain (M. Annaeus Lucanus) est digne de nous arrêter davantage que Stace et Silius Italicus qu'il avait précédés. Son génie original ouvrit une route nouvelle. Il n'a rien imité, et ne doit à personne ni ses beautés, ni ses défauts, et mérite par cela seul une grande attention. Voici ce qu'en dit M. de Voltaire.
Lucain était d'une ancienne maison de l'ordre des chevaliers. Il naquit à Cordoue en Espagne sous l'empereur Caligula. Il n'avait encore que huit mois lorsqu'on l'amena à Rome, où il fut élevé dans la maison de Séneque son oncle. Ce fait suffit pour imposer silence à des critiques qui ont révoqué en doute la pureté de son langage. Ils ont pris Lucain pour un espagnol qui a fait des vers latins. Trompés par ce préjugé, ils ont cru trouver dans son style des barbarismes qui n'y sont pas, et qui, supposé qu'ils y fussent, ne peuvent assurément être aperçus par aucun moderne.
Il fut d'abord favori de Néron, jusqu'à ce qu'il eut la noble imprudence de disputer contre lui le prix de la poésie, et l'honneur dangereux de le remporter. Le sujet qu'ils traitèrent tous deux était Orphée. La hardiesse qu'eurent les Juges de déclarer Lucain vainqueur, est une preuve bien forte de la liberté dont on jouissait dans les premières années de ce règne.
Tandis que Néron fit les délices des Romains, Lucain crut pouvoir lui donner des éloges, il le loue même avec trop de flatterie ; et en cela seul il a imité Virgile, qui avait eu la faiblesse de donner à Auguste un encens que jamais un homme ne doit donner à un autre homme tel qu'il sait.
Néron démentit bien-tôt les louanges outrées dont Lucain l'avait comblé. Il força Séneque à conspirer contre lui ; Lucain entra dans cette fameuse conjuration, dont la découverte couta la vie à trois cent romains du premier rang. Etant condamné à la mort, il se fit ouvrir les veines dans un bain chaud, et mourut en récitant des vers de sa Pharsale, qui exprimaient le genre de mort dont il expirait.
Il ne fut pas le premier qui choisit une histoire récente pour le sujet d'un poème épique. Varius, contemporain, ami et rival de Virgile, mais dont les ouvrages ont été perdus, avait exécuté avec succès cette dangereuse entreprise.
La proximité des temps, la notoriété publique de la guerre civile, le siècle éclairé, politique et peu superstitieux où vivaient César et Lucain, la solidité de son sujet ôtaient à son génie toute liberté d'invention fabuleuse.
La grandeur véritable des héros réels qu'il fallait peindre d'après nature, était une nouvelle difficulté. Les Romains, du temps César, étaient des personnages bien autrement importants que Sarpédon, Diomède, Mézence et Turnus. La guerre de Troie était un jeu d'enfants en comparaison des guerres civiles de Rome, où les plus grands capitaines, et les plus puissants hommes qui aient jamais été, disputaient de l'empire de la moitié du monde connu.
Lucain n'a osé s'écarter de l'histoire ; par-là il a rendu son poème sec et aride. Il a voulu suppléer au défaut d'invention par la grandeur des sentiments ; mais il a caché trop souvent la sécheresse sous de l'enflure : ainsi il est arrivé qu'Achille et Enée, qui étaient peu importants par eux-mêmes, sont devenus grands dans Homère et dans Virgile, et que César et Pompée sont quelquefois petits dans Lucain.
Il n'y a dans son poème aucune description brillante, comme dans Homère. Il n'a point connu, comme Virgile, l'art de narrer, et de ne rien dire de trop ; il n'a ni son élégance, ni son harmonie ; mais aussi vous trouvez dans la Pharsale des beautés qui ne sont ni dans l'Iliade, ni dans l'Enéïde. Au milieu de ses déclamations empoulées il y a de ces pensées mâles et hardies, de ces maximes politiques dont Corneille est rempli ; quelques-uns de ces discours ont la majesté de ceux de Tite-Live, et la force de Tacite. Il peint comme Salluste ; en un mot, il est grand partout où il ne veut point être poète. Une seule ligne telle que celle-ci, en parlant de César, nil actum reputants, si quid superesset agendum, vaut une description poétique.
Virgile et Homère avaient fort bien fait d'amener les divinités sur la scène. Lucain a fait tout-aussi-bien de s'en passer. Jupiter, Junon, Mars, Vénus, étaient des embellissements nécessaires aux actions d'Enée et d'Agamemnon. On savait peu de chose de ces héros fabuleux ; ils étaient comme ces vainqueurs des jeux olympiques que Pindare chantait, et dont il n'avait presque rien à dire. Il fallait qu'il se jetât sur les louanges de Castor, de Pollux et d'Hercule. Les faibles commencements de l'empire romain avaient besoin d'être relevés par l'intervention des dieux ; mais César, Pompée, Caton, Labiénus vivaient dans un autre siècle qu'Enée : les guerres civiles de Rome étaient trop sérieuses pour ces jeux d'imagination. Quel rôle César jouerait-il dans la plaine de Pharsale, si Iris venait lui apporter son épée, ou si Vénus descendait dans un nuage d'or à son secours ?
Ceux qui prennent les commencements d'un art pour les principes de l'art même, sont persuadés qu'un poème ne saurait subsister sans divinités, parce que l'Iliade en est pleine ; mais ces divinités sont si peu essentielles au poème, que le plus bel endroit qui soit dans Lucain, et peut-être dans aucun poète, est le discours de Caton, dans lequel ce stoïque ennemi des fables, refuse d'entrer seulement dans le temple de Jupiter Hammon.
Ce n'est donc point pour n'avoir pas fait usage du ministre des dieux, mais pour avoir ignoré l'art de bien conduire les affaires des hommes, que Lucain est si inférieur à Virgile. Faut-il qu'après avoir peint César, Pompée, Caton avec des traits si forts, il soit si faible quand il les fait agir ? Ce n'est presque plus qu'une gazette pleine de déclamations ; il me semble, ajoute M. de Voltaire, que je vois un portique hardi et immense qui me conduit à des ruines.
Le Trissin (Jean-George) naquit à Vicence en 1478, dans le temps que le Tasse était encore au berceau. Après avoir donné la fameuse Sophonisbe, qui est la première tragédie écrite en langue vulgaire, il exécuta le premier dans la même langue un poème épique, Italia liberata, divisé en vingt-sept chants, dont le sujet est l'Italie délivrée des Goths par Bélisaire, sous l'empereur Justinien. Son plan est sage et bien dessiné, mais la poésie du style y est très-foible. Toutefais l'ouvrage réussit, et cette aurore du bon goût brilla pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'elle fut absorbée dans le grand jour qu'apporta le Tasse.
Le Trissin joignait à beaucoup d'érudition une grande capacité. Léon X. l'employa dans plus d'une affaire importante. Il fut ambassadeur auprès de Charles-Quint ; mais enfin il sacrifia son ambition, et la prétendue solidité des affaires publiques à son goût pour les lettres. Il était avec raison charmé des beautés qui sont dans Homère, et cependant sa grande faute est de l'avoir imité ; il en a tout pris hors le génie. Il s'appuie sur Homère pour marcher, et tombe en voulant le suivre : il cueille les fleurs du poème grec, mais elles se flétrissent entre les mains de l'imitateur. Il semble n'avoir copié son modèle que dans le détail des descriptions, et même sans images. Il est très-exact à peindre les habillements et les meubles de ses héros, mais il ne dit pas un mot de leurs caractères. Cependant il a la gloire d'avoir été le premier moderne en Europe qui ait fait un poème épique régulier et sensé, quoique faible, et qui ait osé sécouer le joug de la rime en inventant les vers libres, versi sciolti. De plus, il est le seul des poètes italiens dans lequel il n'y ait ni jeux de mots, ni pointes, et celui de tous qui a le moins introduit d'enchanteurs et de héros enchantés dans ses ouvrages ; ce qui n'était pas un petit mérite.
Tandis que le Trissin en Italie suivait d'un pas timide et faible les traces des anciens, le Camoèns en Portugal, ouvrait une carrière toute nouvelle, et s'acquérait une réputation qui dure encore parmi ses compatriotes, qui l'appellent le Virgile portugais.
Le Camoèns (Luigi) naquit dans les dernières années du règne célèbre de Ferdinand et d'Isabelle, tandis que Jean II. régnait en Portugal. Après la mort de Jean, il vint à la cour de Lisbonne, la première année du règne d'Emmanuel, le grand héritier du trône et des grands desseins du roi Jean. C'était alors les beaux jours du Portugal, et le temps marqué pour la gloire de cette nation.
Emmanuel, déterminé à suivre le projet qui avait échoué tant de fais, de s'ouvrir une route aux Indes orientales par l'Océan, fit partir en 1497 Vasco de Gama avec une flotte pour cette fameuse entreprise, qui était regardée comme téméraire et impraticable parce qu'elle était nouvelle : c'est ce grand voyage qu'a chanté le Camoèns.
La vie et les aventures de ce poète sont trop connues de tout le monde pour en faire le récit ; d'ailleurs j'en ai déjà parlé sous l'article de LISBONNE. On sait qu'il mourut à l'hôpital dans un abandon général, en 1579, âgé d'environ 50 ans.
A peine fut-il mort, qu'on s'empressa de lui faire des épitaphes honorables, et de le mettre au rang des grands hommes. Quelques villes se disputèrent l'honneur de lui avoir donné la naissance ; ainsi il éprouva en tout le sort d'Homère. Il voyagea comme lui, il vécut et mourut pauvre, et n'eut de réputation qu'après sa mort. Tant d'exemples doivent apprendre aux hommes de génie que ce n'est point par le génie qu'on fait sa fortune, et qu'on vit heureux.
Le sujet de la Lusiade traité par un génie aussi vif que le Camoèns, ne pouvait que produire une nouvelle espèce d'épopée. Le fond de son poème n'est ni une guerre, ni une querelle de héros, ni le monde en armes pour une femme ; c'est un nouveau pays découvert à l'aide de la navigation.
Le poète conduit la flotte portugaise à l'embouchure du Gange, décrit en passant les côtes occidentales, le midi et l'orient de l'Afrique, et les différents peuples qui vivent sur cette côte ; il entremêle avec art l'histoire du Portugal. On y voit dans le troisième chant la mort de la célèbre Inès de Castro, épouse du roi dom Pedre, dont l'aventure déguisée a été jouée dans ce siècle sur le théâtre de Paris. C'est le plus beau morceau du Camoèns ; il y a peu d'endroits dans Virgile plus attendrissants et mieux écrits.
Le grand défaut de ce poème est le peu de liaison qui règne dans toutes ses parties. Il ressemble aux voyages dont il est le sujet. Le poète n'a d'autre art que de bien conter le détail des aventures qui se succedent ; mais cet art seul par le plaisir qu'il donne, tient quelquefois lieu de tous les autres. Il est vrai qu'il y a des fictions de la plus grande beauté dans cet ouvrage, et qui doivent réussir dans tous les temps et chez tous les peuples ; mais ces sortes de fictions sont rares, et la plupart sont un mélange monstrueux du paganisme et du christianisme : Bacchus et la Vierge-Marie s'y trouvent ensemble.
Le principal but des Portugais, après l'établissement de leur commerce, est la propagation de la foi, et Vénus se charge du succès de l'entreprise. Un merveilleux si absurde défigure tellement tout l'ouvrage aux yeux des lecteurs sensés, qu'il semble que ce grand défaut eut dû faire tomber ce poème ; mais la poésie du style et l'imagination dans l'expression l'ont soutenu, de même que les beautés de l'exécution ont placé Paul Véronèse parmi les grands peintres.
Le Tasse né à Sorrento en 1544, commença la Gierusalem liberata dans le temps que la Lusiade du Camoèns commençait à paraitre. Il entendait assez le portugais pour lire ce poème, et pour en être jaloux. Il disait que le Camoèns était le seul rival en Europe qu'il craignit. Cette crainte, si elle était sincère, était très-mal fondée ; le Tasse était autant au-dessus du Camoèns, que le portugais était supérieur à ses compatriotes. Il eut eu plus de raison d'avouer qu'il était jaloux de l'Arioste, par qui sa réputation fut si longtemps balancée, et qui lui est encore préféré par bien des italiens. Mais pour ne point trop charger cet article, je parlerai de l'Arioste au lieu de sa naissance qui est Reggio, voyez donc REGGIO, (Géographie moderne)
Ce fut à l'âge de 32 ans que le Tasse donna sa Jérusalem délivrée. Il pouvait dire alors, comme un grand homme de l'antiquité : J'ai vécu assez pour le bonheur et pour la gloire. Le reste de sa vie ne fut plus qu'une chaîne de calamités et d'humiliations. Enveloppé dès l'âge de huit ans dans le bannissement de son père, sans patrie, sans biens, sans famille, persécuté par les ennemis que lui suscitaient ses talents ; plaint, mais négligé par ceux qu'il appelait ses amis ; il souffrit l'exil, la prison, la plus extrême pauvreté, la faim même ; et ce qui devait ajouter un poids insupportable à tant de malheurs, la calomnie l'attaqua et l'opprima.
Il s'enfuit de Ferrare, où le protecteur qu'il avait tant célébré, l'avait fait mettre en prison ; il alla à pied, couvert de haillons, depuis Ferrare jusqu'à Sorrento dans le royaume de Naples, trouver une sœur dont il espérait quelque secours ; mais dont probablement il n'en reçut point, puisqu'il fut obligé de retourner à pied à Ferrare, où il fut encore emprisonné. Le désespoir altéra sa constitution robuste, et le jeta dans des maladies violentes et longues, qui lui ôtèrent quelquefois l'usage de la raison.
Sa gloire poétique, cette consolation imaginaire dans des malheurs réels, fut attaquée par l'académie de la Crusca en 1585, mais il trouva des défenseurs ; Florence lui fit toutes sortes d'accueils ; l'envie cessa de l'opprimer au bout de cinq ans, et son mérite surmonta tout. On lui offrit des honneurs et de la fortune ; ce ne fut toutefois que lorsque son esprit fatigué d'une suite de malheurs était devenu insensible à tout ce qui pouvait le flatter.
Il fut appelé à Rome par le pape Clément VIII. qui dans une congrégation de cardinaux avait resolu de lui donner la couronne de laurier et les honneurs du triomphe, cérémonie qui parait bizarre aujourd'hui surtout en France, et qui était alors très-sérieuse et très-honorable en Italie. Le Tasse fut reçu à un mille de Rome par les deux cardinaux neveux, et par un grand nombre de prélats et d'hommes de toutes conditions. On le conduisit à l'audience du pape : " Je désire, lui dit le pontife, que vous honoriez la couronne de laurier, qui a honoré jusqu'ici tous ceux qui l'ont portée ". Les deux cardinaux Aldobrandins neveux du pape, qui admiraient le Tasse, se chargèrent de l'appareil de ce couronnement ; il devait se faire au capitole ; chose assez singulière, que ceux qui éclairent le monde par leurs écrits triomphent dans la même place que ceux qui l'avaient désolé par leurs conquêtes !
Il tomba malade dans le temps de ces préparatifs ; et comme si la fortune avait voulu le tromper jusqu'au dernier moment, il mourut la veille du jour destiné à la cérémonie, l'an de Jesus-Christ 1595, à l'âge de 51 ans.
Le temps qui sappe la réputation des ouvrages médiocres, a assuré celle du Tasse. La Jérusalem délivrée est aujourd'hui chantée en plusieurs endroits de l'Italie, comme les poèmes d'Homère l'étaient en Grèce.
Si la Jérusalem parait à quelques égards imitée de l'Iliade, il faut avouer que c'est une belle chose qu'une imitation où l'auteur n'est pas au-dessous de son modèle. Le Tasse a peint quelquefois ce qu'Homère n'a fait que crayonner. Il a perfectionné l'art de nuer les couleurs, et de distinguer les différentes espèces de vertus, de vices et de passions, qui ailleurs semblent être les mêmes. Ainsi Godefroi est prudent et modéré. L'inquiet Aladin a une politique cruelle ; la généreuse valeur de Tancrède est opposée à la fureur d'Argan ; l'amour dans Armide est un mélange de coquetterie et d'emportement. Dans Herminie, c'est une tendresse douce et aimable ; il n'y a pas jusqu'à l'hermite Pierre, qui ne fasse un personnage dans le tableau, et un beau contraste avec l'enchanteur Ismene : et ces deux figures sont assurément au-dessus de Calcas et de Taltibius.
Il amène dans son ouvrage les aventures avec beaucoup d'adresse ; il distribue sagement les lumières et les ombres. Il fait passer le lecteur des alarmes de la guerre aux délices de l'amour ; et de la peinture des voluptés, il le ramène aux combats ; il excite la sensibilité par degré ; il s'élève au-dessus de lui-même de livre en livre. Son style est par-tout clair et élégant ; et lorsque son sujet demande de l'élévation, on est étonné comment la mollesse de la langue italienne prend un nouveau caractère sous ses mains, et se change en majesté et en force.
Voilà les beautés de ce poème, mais les défauts n'y sont pas moins grands. Sans parler des épisodes mal-cousus, des jeux de mots, et des concetti puérils, espèce de tribut que l'auteur payait au goût de son siècle pour les pointes, il n'est pas possible d'excuser les fables pitoyables dont son ouvrage est rempli. Ces sorciers chrétiens et mahométants ; ces démons qui prennent une infinité de formes ridicules ; ces princes métamorphosés en poissons ; ce perroquet qui chante des chansons de sa propre composition ; Renaud destiné par la Providence au grand explait d'abattre quelques vieux arbres dans une forêt ; cette forêt qui est le grand merveilleux de tout le poème ; Tancrède qui y trouve sa Clorinde enfermée dans un pin ; Armide qui se présente à-travers l'écorce d'un myrthe ; le diable qui joue le rôle d'un misérable charlatan : toutes ces idées sont autant d'extravagances également indignes d'un poème épique. Enfin, l'auteur y donne imprudemment aux mauvais esprits les noms de Pluton et d'Alecton, confondant ainsi les idées payennes avec les idées chrétiennes.
Sur la fin du seizième siècle, l'Espagne produisit un poème épique, célèbre par quelques beautés particulières qui s'y trouvent, par la singularité du sujet, et par le caractère de l'auteur.
On le nomme don Alonzo d'Ercilla y Cunéga. Il fut élevé dans la maison de Philippe II. suivit le parti des armes, et se distingua par son courage à la bataille de Saint-Quentin. Entendant dire, étant à Londres, que quelques provinces du Chily avaient pris les armes contre les Espagnols leurs conquérants et leurs tyrants, il se rendit dans cet endroit du nouveau monde pour y combattre ces américains.
Sur les frontières du Chily, du côté du sud, est une petite contrée montagneuse, nommée Araucana, habitée par une race d'hommes plus robustes et plus féroces que les autres peuples de l'Amérique. Ils défendirent leur liberté avec plus de courage et plus longtemps que les autres américains.
Alonzo soutint contr'eux une pénible et longue guerre. Il courut des dangers extrêmes ; il vit, et fit des actions étonnantes, dont la seule récompense fut l'honneur de conquérir des rochers, et de réduire quelques contrées incultes sous l'obeissance du roi d'Espagne.
Pendant le cours de cette guerre, Alonzo conçut le dessein d'immortaliser ses ennemis en s'immortalisant lui-même. Il fut en même temps le conquérant et le poète : il employa les intervalles de loisir que la guerre laissait, à en chanter les événements.
Il commence par une description géographique du Chily, et par la peinture des mœurs et des coutumes des habitants. Ce commencement qui serait insupportable dans tout autre poème, est ici nécessaire et ne déplait pas, dans un sujet où la scène est par-delà l'autre tropique, et où les héros sont des sauvages, qui nous auraient été toujours inconnus s'il ne les avait pas conquis et célébrés.
Le sujet qui était neuf a fait naître à l'auteur quelques pensées neuves et hardies. On remarque aussi de l'éloquence dans quelques-uns de ses discours, et beaucoup de feu dans les batailles ; mais son poème peche du côté de l'invention. On n'y voit aucun plan, point de variété dans les descriptions, point d'unité dans le dessein. Enfin, ce poème est plus sauvage que les nations qui en font le sujet. Vers la fin de l'ouvrage, l'auteur qui est un des premiers héros du poème, fait pendant la nuit une longue et ennuyeuse marche, suivi de quelques soldats ; et pour passer le temps, il fait naître entr'eux une dispute au sujet de Virgile, et principalement sur l'épisode de Didon. Alonzo saisit cette occasion pour entretenir ses soldats de la mort de Didon, telle qu'elle est rapportée par les anciens historiens ; et enfin de restituer à la reine de Carthage sa réputation, il s'amuse à en discourir pendant deux chants entiers. Ce n'est pas d'ailleurs un défaut médiocre de son poème d'être composé de trente-six chants : on peut supposer avec raison qu'un auteur qui ne sait, ou qui ne peut s'arrêter, n'est pas propre à fournir une telle carrière.
Milton (Jean) naquit à Londres en 1608. Sa vie est à la tête de ses œuvres, mais il ne s'agit ici que de son poème épique, intitulé : le paradis perdu, the paradise lost. Il employa neuf ans à la composition de cet ouvrage immortel ; mais à-peine l'eut-il commencé qu'il perdit la vue. Il était pauvre, aveugle, et ne fut point découragé. Son nom doit augmenter la liste des grands hommes persécutés de la fortune. Il mourut en 1674, sans se douter de la réputation qu'aurait un jour son poème, sans croire qu'il surpassait de beaucoup celui du Tasse, et qu'il égalait en beautés ceux de Virgile et d'Homère.
Les François riaient quand on leur disait que l'Angleterre avait un poème épique, dont le sujet était le diable combattant contre Dieu, et un serpent qui persuadait à une femme de manger une pomme. Ils imaginaient qu'on ne pouvait faire sur ce sujet que des vaudevilles ; mais ils sont bien revenus de leur erreur. Il est vrai que ce poème singulier a ses taches et ses défauts. Au milieu des idées sublimes dont il est rempli, on en trouve plusieurs de bizarres et d'outrées. La peinture du péché, monstre feminin, qui après avoir violé sa mère, met au monde une multitude d'enfants sortant sans cesse de ses entrailles, pour y rentrer et les déchirer, révolte avec raison les esprits délicats ; c'est manquer au vraisemblable que d'avoir placé du canon dans l'armée de satan, et d'avoir armé d'épées des esprits qui ne pouvaient se blesser. C'est encore se contredire que de mettre dans la bouche de Dieu le père, un ordre à ses anges de poursuivre ses ennemis, de les punir et de les précipiter dans le Tartare : cependant Dieu parle et manque de puissance ; la victoire de ses anges reste indécise, et on vient à leur résister.
Mais enfin ces sortes de défauts sont noyés dans le grand nombre de beautés merveilleuses dont le poème étincelle. Admirez-y les traits majestueux avec lesquels l'auteur peint l'Etre suprême, et le caractère brillant qu'il ose donner au diable. On est enchanté de la description du printemps, de celle du jardin d'Eden, et des amours innocens d'Adam et d'Eve. En effet, il est bien remarquable que dans tous les autres poèmes l'amour est regardé comme une faiblesse ; dans Milton seul l'amour est une vertu. Ce poète a su lever d'une main chaste le voîle qui couvre ailleurs les plaisirs de cette passion. Il transporte le lecteur dans le jardin de délices ; il semble lui faire goûter les voluptés pures dont Adam et Eve sont remplis. Il ne s'élève pas au-dessus de la nature humaine ; mais au-dessus de la nature humaine corrompue ; et comme il n'y a point d'exemple d'un pareil amour, il n'y en a point d'une pareille poésie.
Ce génie supérieur a encore réuni dans son ouvrage, le grand, le beau, l'extraordinaire. Personne n'a mieux su étonner et agir sur l'imagination. Son poème ressemble à un superbe palais bâti de briques, mais d'une architecture sublime. Rien de plus grand que le combat des anges, la majesté du Messie, la taille et la conduite du démon et de ses collègues. Que peut-on se représenter de plus auguste que le pandaemonium (lieu de l'assemblée des démons), le paradis, le ciel, les anges, et nos premiers parents ? Qu'y a-t-il de plus extraordinaire que sa peinture de la création du monde, des différentes métamorphoses des anges apostats, et les aventures qu'éprouve leur chef en cherchant le paradis ? Ce sont-là des scènes toutes neuves et purement idéales ; et jamais poète ne pouvait les peindre avec des couleurs plus vives et plus frappantes. En un mot, le paradis perdu peut être regardé comme le dernier effort de l'esprit humain, par le merveilleux, le sublime, les images superbes, les pensées hardies, la variété, la force et l'énergie de la poésie. Toutes ces choses admirables ont fait dire ingénieusement à Dryden, que la nature avait formé Milton de l'âme d'Homère et de celle de Virgile.
La France n'a point eu de poème épique jusqu'au dixhuitième siècle. Aucun des beaux génies qu'elle a produits n'avait encore travaillé dans ce genre. On n'avait Ve que les plus faibles oser porter ce grand fardeau, et ils y ont succombé. Enfin, M. de Voltaire, âgé de 30 ans, donna la Henriade en 1723 sous le nom de poème de la ligue.
Le sujet de cet ouvrage épique est le siege de Paris, commencé par Henri de Valais et Henri le Grand, et achevé par ce dernier seul. Le lieu de la scène ne s'étend pas plus loin que de Paris à Ivry, où se donna cette fameuse bataille qui décida du sort de la France et de la maison royale.
Le poème est fondé sur une histoire connue, dont l'auteur a conservé la vérité dans les principaux événements. Les autres moins respectables ont été ou retranchés, ou arrangés suivant le vraisemblable qu'exige un poème.
Celui-ci donc est composé d'événements réels et de fictions. Les événements réels sont tirés de l'Histoire ; les fictions forment deux classes. Les unes sont puisées dans le système merveilleux, telles que la prédiction de la conversion d'Henri IV. la protection que lui donne saint Louis, son apparition, le feu du ciel détruisant les opérations magiques qui étaient alors si communes, etc. Les autres sont purement allégoriques : de ce nombre sont le voyage de la Discorde à Rome, la Politique, le Fanatisme personnifiés, le temple de l'Amour, enfin les passions et les vices :
Prenant un corps, une âme, un esprit, un visage.
Telle est l'ordonnance de la Henriade. A-peine eut-elle Ve le jour que l'envie et la jalousie déchirèrent l'auteur par cent brochures calomnieuses. On joua la Henriade sur le théâtre de la comédie italienne et sur celui de la foire ; mais cette cabale et cet odieux acharnement ne purent rien contre la beauté du poème. Le public indigné ne l'admira que davantage. On en fit en peu d'années plus de vingt éditions dans toute l'Europe ; et Londres en particulier publia la Henriade par une souscription magnifique. Elle fut traduite en vers anglais par M. Lockman ; en vers italiens, par MM. Maffei, Ortolani et Nénéi ; en vers allemands, par une aimable muse madame Gotsched ; et en vers hollandais, par M. Faitema. Quoique les actions chantées dans ce poème regardent particulièrement les Français, cependant comme elles sont simples, intéressantes, et peintes avec le plus brillant coloris, il était difficîle qu'elles manquassent de plaire à tous les peuples policés.
L'auteur a choisi un héros véritable au lieu d'un héros fabuleux ; il a décrit des guerres réelles et non des batailles chimériques. Il n'a osé employer que des fictions qui fussent des images sensibles de la vérité ; ou bien il a pris le parti de les renfermer dans les bornes de la vraisemblance et des facultés humaines. C'est pour cette raison qu'il a placé le transport de son héros au ciel et aux enfers dans un songe, où ces sortes de visions peuvent paraitre naturelles et croyables.
Les êtres invisibles sans l'entremise desquels les maîtres de l'art n'oseraient entreprendre un poème épique, comme l'âme de saint Louis et quelques passions humaines personnifiées, sont ici mieux ménagées que dans les autres époques modernes ; et l'ouvrage entier soutient son éclat, sans être chargé d'une infinité d'agens surnaturels.
L'auteur n'a fait entrer dans son poème que le merveilleux convenable à une religion aussi pure que la nôtre, et dans un siècle où la raison est devenue aussi sévère que la religion même.
Tout ce qu'il avance sur la constitution de l'univers, les lois de la nature et de la morale, dévoilent un génie supérieur, aussi sage philosophe qu'excellent physicien. Son ouvrage ne respire que l'amour de l'humanité : on y déteste également la rébellion et la persécution.
La sagesse de la composition, la dignité dans le dessein, le gout, l'élégance, la correction et les plus belles images, y règnent éminemment. Les idées les plus communes y sont ennoblies par le charme de la poésie, comme elles l'ont été par Virgile. Quel poème enfin que la Henriade, dit un de nos collègues (au mot ÉPOPEE), si l'auteur eut connu toutes ses forces lorsqu'il en forma le plan ; s'il y eut déployé le pathétique de Mérope et d'Alzire, l'art des intrigues et des situations ! Mais c'est au temps seul qu'il appartient de confirmer le jugement des vivants, et de transmettre à la postérité les ouvrages dont ils font l'éloge.
Comme je n'ai parlé dans ce discours que des poètes épiques de réputation, je ne devais rien dire de Chapelain et de quelques autres, dont les ouvrages sont promptement tombés dans l'oubli.
Chapelain (Jean), né à Paris en 1595, et l'un des premiers de l'académie française, mourut en 1674. Il fut pensionné par le cardinal de Richelieu, par le duc de Longueville, et par le cardinal Mazarin. Cet homme comblé des présents de la fortune, fut cinq ans à méditer son poème de la Pucelle. Il l'avait divisé en vingt-quatre chants, dont il n'y a jamais eu que les douze premiers chants d'imprimés. Quand ils parurent, ils avaient pour eux les suffrages des gens de lettres, et entr'autres de l'évêque d'Avranches. " Les bienfaits des grands avaient déjà couronné ce poème, et le monde prévenu par ces éloges l'attendait l'encensoir à la main. Cependant si-tôt que le public eut lu la Pucelle, il revint de son préjugé, et la méprisa même avant qu'aucun critique lui eut enseigné par quelle raison elle était méprisable. La réputation prématurée de l'ouvrage, fut cause seulement que le public instruisit ce procès avec plus d'empressement. Chacun apprit sur les premières informations qu'il fit, qu'on bâillait comme lui en la lisant, et la Pucelle devint vieille au berceau ". (D.J.)
POEME HISTORIQUE, (Poésie didactique) espèce de poème didactique qui n'expose que des actions et des événements réels, et tels qu'ils sont arrivés, sans en arranger les parties selon les règles méthodiques, et sans s'élever plus haut que les causes naturelles ; tels sont les cinquante livres de Nonnus sur la vie et les exploits de Bacchus, la Pharsale de Lucain, la Guerre punique de Silius Italicus, et quelques autres.
Les poèmes historiques ont des actions, des passions et des acteurs, aussi bien que les poèmes de fiction. Ils ont le droit de marquer vivement les traits, de les rendre hardis et lumineux. Les objets doivent être peints d'un coloris brillant, c'est une divinité qui est censée peindre. Elle voit tout sans obscurité, sans confusion, et son pinceau le rend de même. Il lui est aisé de remonter aux causes, d'en développer les ressorts ; quelquefois même elle s'élève jusqu'aux causes surnaturelles. Tite-Live racontant la guerre punique, en a montré les événements dans le récit, et les causes politiques dans les discours qu'il fait tenir à ses acteurs ; mais il a dû rester toujours dans les bornes des connaissances naturelles, parce qu'il n'était qu'historien, Silius Italicus qui est poète, raconte de même que le fait Tite-Live ; mais il peint par-tout ; il tâche toujours de montrer les objets eux-mêmes, au lieu que l'historien se contente souvent d'en parler et de les désigner.
Le poème de la Guerre civîle de Pétrone, peint les événements de l'histoire avec ce style mâle et nerveux que l'amour de la liberté fait aimer. M. le président Bouhier a traduit ce poème en vers français, et c'est ainsi qu'il faut rendre les Poètes. (D.J.)
POEME LYRIQUE, s. m. (Littérature) les Italiens ont appelé le poème lyrique ou le spectacle en musique, Opera, ce mot a été adopté en français.
Tout art d'imitation est fondé sur un mensonge : ce mensonge est une espèce d'hypothèse établie et admise en vertu d'une convention tacite entre l'artiste et ses juges. Passez-moi ce premier mensonge, a dit l'artiste, et je vous mentirai avec tant de vérité que vous y serez trompés, malgré que vous en ayez. Le poète dramatique, le peintre, le statuaire, le danseur ou pantomime, le comédien, tous ont une hypothèse particulière sous laquelle ils s'engagent de mentir, et qu'ils ne peuvent perdre de vue un seul instant, sans nous ôter de cette illusion qui rend notre imagination complice de leurs supercheries ; car ce n'est point la vérité, mais l'image de la vérité qu'ils nous promettent ; et ce qui fait le charme de leurs productions, n'est point la nature, mais l'imitation de la nature. Plus un artiste en approche dans l'hypothèse qu'il a choisie, plus nous lui accordons de talent et de génie.
L'imitation de la nature par le chant a dû être une des premières qui se soient offertes à l'imagination. Tout être vivant est sollicité par le sentiment de son existence à pousser en de certains moments des accens plus ou moins mélodieux, suivant la nature de ses organes : comment au milieu de tant de chanteurs l'homme serait-il resté dans le silence ? La joie a vraisemblablement inspiré les premiers chants ; on a chanté d'abord sans paroles ; ensuite on a cherché à adapter au chant quelques paroles conformes au sentiment qu'il devait exprimer ; le couplet et la chanson ont été ainsi la première musique.
Mais l'homme de génie ne se borna pas longtemps à ces chansons, enfants de la simple nature ; il conçut un projet plus noble et plus hardi, celui de faire du chant un instrument d'imitation. Il s'aperçut bientôt que nous élevons notre voix, et que nous mettons dans nos discours plus de force et de mélodie, à mesure que notre âme sort de son assiette ordinaire. En étudiant les hommes dans différentes situations, il les entendit chanter réellement dans toutes les occasions importantes de la vie ; il vit encore que chaque passion, chaque affection de l'âme avait son accent, ses inflexions, sa mélodie et son chant propres.
De cette découverte naquit la musique imitative et l'art du chant qui devint une sorte de poésie, une langue, un art d'imitation, dont l'hypothèse fut d'exprimer par la mélodie et à l'aide de l'harmonie toute espèce de discours, d'accent, de passion, et d'imiter quelquefois jusqu'à des effets physiques. La réunion de cet art, aussi sublime que voisin de la nature, avec l'art dramatique, a donné naissance au spectacle de l'Opéra, le plus noble et le plus brillant d'entre les spectacles modernes.
Ce n'est point ici le lieu d'examiner si le caractère du spectacle en musique a été connu de l'antiquité ; pour peu qu'on réfléchisse sur l'importance des spectacles chez les anciens, sur l'immensité de leurs théâtres, sur les effets de leurs représentations dramatiques sur un peuple entier, on aura de la peine à regarder ces effets comme l'ouvrage de la simple déclamation et du discours ordinaire, dépouillés de tout prestige. Il n'y a guère aujourd'hui d'homme de gout, ni de critique judicieux, qui doute que la mélopée ne fût une espèce de récitatif noté.
Mais sans nous embarrasser dans des recherches qui ne sont point de notre sujet, nous ne parlerons ici que du spectacle en musique, tel qu'il est aujourd'hui établi en Europe, et nous tâcherons de savoir quelle sorte de poème a dû résulter de la réunion de la Poésie avec la Musique.
La Musique est une langue. Imaginez un peuple d'inspirés et d'enthousiastes, dont la tête serait toujours exaltée, dont l'âme serait toujours dans l'ivresse et dans l'extase ; qui avec nos passions et nos principes, nous seraient cependant supérieurs par la subtilité, la pureté et la délicatesse des sens, par la mobilité, la finesse, et la perfection des organes, un tel peuple chanterait au lieu de parler, sa langue naturelle serait la musique. Le poème lyrique ne représente pas des êtres d'une organisation différente de la nôtre, mais seulement d'une organisation plus parfaite. Ils s'expriment dans une langue qu'on ne saurait parler sans génie, mais qu'on ne saurait non plus entendre sans un goût délicat, sans des organes exquis et exercés. Ainsi ceux qui ont appelé le chant le plus fabuleux de tous les langages, et qui se sont moqués d'un spectacle où les héros meurent en chantant, n'ont pas eu autant de raison qu'on le croirait d'abord ; mais comme ils n'aperçoivent dans la musique, que tout au plus un bruit harmonieux et agréable, une suite d'accords et de cadences, ils doivent le regarder comme une langue qui leur est étrangère ; ce n'est point à eux d'apprécier le talent du compositeur ; il faut une oreille attique pour juger de l'éloquence de Démosthène.
La langue du musicien a sur celle du poète l'avantage qu'une langue universelle a sur un idiome particulier ; celui-ci ne parle que la langue de son siècle et de son pays, l'autre parle la langue de toutes les nations et de tous les siècles.
Toute langue universelle est vague par sa nature ; ainsi en voulant embellir par son art la représentation théâtrale, le musicien a été obligé d'avoir recours au poète. Non-seulement il en a besoin pour l'invention de l'ordonnance du drame lyrique, mais il ne peut se passer d'interprete dans toutes les occasions où la précision du discours devient indispensable, où le vague de la langue musicale entraînerait le spectateur dans l'incertitude. Le musicien n'a besoin d'aucun secours pour exprimer la douleur, le désespoir, le délire d'une femme menacée d'un grand malheur ; mais son poète nous dit : cette femme éplorée que vous voyez, est une mère qui redoute quelque catastrophe funeste pour un fils unique... Cette mère est Sara, qui ne voyant pas revenir son fils du sacrifice, se rappelle le mystère avec lequel ce sacrifice a été préparé, et le soin avec lequel elle en a été écartée ; se porte à questionner les compagnons de son fils, conçoit de l'effroi de leur embarras et de leur silence, et monte ainsi par degrés des soupçons à l'inquiétude, de l'inquiétude à la terreur, jusqu'à en perdre la raison. Alors dans le trouble dont elle est agitée, ou elle se croit entourée lorsqu'elle est seule, ou elle ne reconnait plus ceux qui sont avec elle.... tantôt elle les presse de parler, tantôt elle les conjure de se taire.
Deh, parlate : che forze tacendo
Par pitié parlez : peut-être qu'en vous taisant,
Men pietosi, più barbari siete.
Vous êtes moins compatissants que barbares.
Ah v'intendo. Tacete, tacete,
Ah, je vous entends ! Taisez-vous, taisez-vous,
Non mi dite che'l figlio morì.
Ne me dites point que mon fils est mort.
Après avoir ainsi nommé le sujet et créé la situation, après l'avoir préparée et fondée par ses discours, le poète n'en fournit plus que les masses qu'il abandonne au génie du compositeur ; c'est à celui-ci à leur donner toute l'expression et à développer toute la finesse des détails dont elles sont susceptibles.
Une langue universelle frappant immédiatement nos organes et notre imagination, est aussi par sa nature la langue du sentiment et des passions. Ses expressions allant droit au cœur, sans passer pour ainsi dire par l'esprit, doivent produire des effets inconnus à tout autre idiome, et ce vague même qui l'empêche de donner à ses accens la précision du discours, en confiant à notre imagination le soin de l'interpretation, lui fait éprouver un empire qu'aucune langue ne saurait exercer sur elle. C'est un pouvoir que la musique a de commun avec le geste, cette autre langue universelle. L'expérience nous apprend que rien ne commande plus impérieusement à l'âme, ni ne l'émeut plus fortement que ces deux manières de lui parler.
Le drame en musique doit donc faire une impression bien autrement profonde que la tragédie et la comédie ordinaires. Il serait inutîle d'employer l'instrument le plus puissant, pour ne produire que des effets médiocres. Si la tragédie de Mérope m'attendrit, me touche, me fait verser des larmes, il faut que dans l'Opéra les angoisses, les mortelles alarmes de cette mère infortunée passent toutes dans mon âme ; il faut que je sois effrayé de tous les fantômes dont elle est obsédée, que sa douleur et son délire me déchirent et m'arrachent le cœur. Le musicien qui m'en tiendrait quitte pour quelques larmes, pour un attendrissement passager, serait bien au-dessous de son art. Il en est de même de la comédie. Si la comédie de Térence et de Moliere enchante, il faut que la comédie en musique ravisse. L'une représente les hommes tels qu'ils sont, l'autre leur donne un grain de verve et de génie de plus ; ils sont tout près de la folie : pour sentir le mérite de la première, il ne faut que des oreilles et du bon sens ; mais la comédie chantée parait être faite pour l'élite des gens d'esprit et de goût ; la musique donne aux ridicules et aux mœurs un caractère d'originalité, une finesse d'expression, qui pour être saisis exigent un tact prompt et délicat, et des organes très-exercés.
Mais la passion a ses repos et ses intervalles, et l'art du théâtre veut qu'on suive en cela la marche de la nature. On ne peut pas au spectacle toujours rire aux éclats, ni toujours fondre en larmes. Oreste n'est pas toujours tourmenté par les Euménides ; Andromaque au milieu de ses alarmes aperçoit quelques rayons d'espérance qui la calment ; il n'y a qu'un pas de cette sécurité au moment affreux où elle verra périr son fils ; mais ces deux moments sont différents, et le dernier ne devient que plus tragique par la tranquillité du précédent. Les personnages subalternes, quelque intérêt qu'ils prennent à l'action, ne peuvent avoir les accens passionnés de leurs héros ; enfin la situation la plus pathétique ne devient touchante et terrible que par degrés ; il faut qu'elle soit préparée, et son effet dépend en grande partie de ce qui l'a précédé et amené.
Voilà donc deux moments bien distincts du drame lyrique ; le moment tranquille, et le moment passionné ; et le premier soin du compositeur a dû consister à trouver deux genres de déclamation essentiellement différents et propres, l'un à rendre le discours tranquille, l'autre à exprimer le langage des passions dans toute sa force, dans toute sa vérité, dans tout son désordre. Cette dernière déclamation porte le nom de l'air, aria ; la première a été appelée le récitatif.
Celui-ci est une déclamation notée, soutenue et conduite par une simple basse, qui se faisant entendre à chaque changement de modulation, empêche l'acteur de détonner. Lorsque les personnages raisonnent, délibèrent, s'entretiennent et dialoguent ensemble, ils ne peuvent que réciter. Rien ne serait plus faux que de les voir discuter en chantant, ou dialoguer par couplets, en sorte qu'un couplet devint la réponse de l'autre. Le récitatif est le seul instrument propre à la scène et au dialogue ; il ne doit pas être chantant. Il doit exprimer les veritables inflexions du discours par des intervalles un peu plus marqués et plus sensibles que la déclamation ordinaire ; du reste, il doit en conserver et la gravité et la rapidité, et tous les autres caractères. Il ne doit pas être exécuté en mesure exacte ; il faut qu'il soit abandonné à l'intelligence et à la chaleur de l'acteur qui doit le hâter ou le ralentir suivant l'esprit de son rôle et de son jeu. Un récitatif qui n'aurait pas tous ces caractères, ne pourrait jamais être employé sur la scène avec succès. Le récitatif est beau pour le peuple, lorsque le poète a fait une belle scène, et que l'acteur l'a bien jouée ; il est beau pour l'homme de gout, lorsque le musicien a bien saisi, non-seulement le principal caractère de la déclamation, mais encore toutes les finesses qu'elle reçoit de l'âge, du sexe, des mœurs, de la condition, des intérêts de ceux qui parlent et agissent dans le drame.
L'air et le chant commencent avec la passion ; dès qu'elle se montre, le musicien doit s'en emparer avec toutes les ressources de son art. Arbace explique à Mandane les motifs qui l'obligent de quitter la capitale avant le retour de l'aurore, de s'éloigner de ce qu'il a de plus cher au monde : cette tendre princesse combat les raisons de son amant ; mais lorsqu'elle en a reconnu la solidité, elle consent à son éloignement, non sans un extrême regret ; voilà le sujet de la scène et du récitatif. Mais elle ne quittera pas son amant sans lui parler de toutes les peines de l'absence, sans lui recommander les intérêts de l'amour le plus tendre, et c'est-là le moment de la passion et du chant.
Conservati fedele :
Conserve-toi fidéle,
Pensa ch'io resto e peno ;
Songe que je reste et que je peine ;
E qualche volta almeno
Et quelquefois du moins
Ricordati di me.
Ressouviens-toi de moi.
Il eut été faux de chanter durant l'entretien de la scène ; il n'y a point d'air propre à peser les raisons de la nécessité d'un départ ; mais quelque simple et touchant que soit l'adieu de Mandane, quelque tendresse qu'une habîle actrice mit dans la manière de déclamer ces quatre vers, ils ne seraient que froids et insipides, si l'on se bornait à les réciter.
C'est qu'il est évident qu'une amante pénétrée qui se trouve dans la situation de Mandane, répétera à son amant, au moment de la séparation, de vingt manières passionnées et différentes, les mots : Conservati fedele. Ricordati di me. Elle les dira tantôt avec un attendrissement extrême, tantôt avec résignation et courage, tantôt avec l'espérance d'un meilleur sort, tantôt dans la confiance d'un heureux retour. Elle ne pourra recommander à son amant de songer quelquefois à sa solitude et à ses peines, sans être frappée elle-même de la situation où elle Ve se trouver dans un moment : ainsi les mots, pensa ch'io resto e peno prendront le caractère de la plainte la plus touchante à laquelle Mandane fera peut-être succéder un effort subit de fermeté, de peur de rendre à Arbace ce moment aussi douloureux qu'il l'est pour elle. Cet effort ne sera peut-être suivi que de plus de faiblesse, et une plainte d'abord peu violente finira par des sanglots et des larmes. En un mot, tout ce que la passion la plus douce et la plus tendre pourra inspirer dans cette position à une âme sensible, composera les éléments de l'air de Mandane ; mais quelle plume serait assez éloquente pour donner une idée de tout ce que contient un air ? Quel critique serait assez hardi pour assigner les bornes du génie ?
J'ai choisi par exemple une passion douce, une situation intéressante, mais tranquille. Il est aisé de juger, d'après ce modèle, ce que sera l'air dans des situations plus pathétiques, dans des moments tragiques et terribles.
Supposons maintenant deux amants dans une situation plus cruelle, qu'ils soient menacés d'une séparation éternelle, au moment où ils s'attendaient à un sort bien différent ; cette circonstance donnerait à l'air un caractère plus pathétique. Il ne serait pas naturel non plus qu'également touchés l'un et l'autre, il n'y en eut qu'un qui chantât. Ainsi l'amant s'adressant à sa maîtresse désolée, lui dirait :
La destra ti thiedo,
Je te demande la main,
Mio dolce sostegno,
O mon doux soutien,
Per ultimo segno
Pour le dernier témoignage
D'amore e di fè.
D'amour et de fidélité !
Un tel adieu prononcé avec une sorte de fermeté, par un amant vivement touché, serait l'écueil du courage de son amante éplorée ; elle fondrait sans doute en larmes, ou frappée d'un témoignage d'amour autrefois si doux, aujourd'hui si cruel, elle s'écrierait :
Ah, questo fu il segno
Ah, ce fut jadis le signe
Del nostro contento :
De notre bonheur ;
Ma sento che adesso
Mais je sens trop qu'à présent
L'istesso non è.
Ce n'est pas la même chose.
Je n'ai pas besoin de remarquer quelle expression forte et touchante ces quatre vers assez faibles prendraient en musique. Le reste de l'air ne serait plus que des exclamations de douleur et de tendresse. L'un s'écrierait :
Mia vita ! Ben mio !
O ma vie ! ô mon bien !
L'autre :
Addio, sposo amato !
Adieu, époux adoré !
A la fin, leur douleur et leurs accens se confondraient sans doute dans cette exclamation si simple et si touchante.
Che barbaro addio !
Quel fatal adieu !
Che fato crudel !
Quel sort cruel !
Le duo ou duetto est donc un air dialogué, chanté par deux personnes animées de la même passion ou de passions opposées. Au moment le plus pathétique de l'air, leurs accens peuvent se confondre ; cela est dans la nature ; une exclamation, une plainte peut les réunir ; mais le reste de l'air doit être en dialogue. Il ne peut jamais être naturel qu'Armide et Hidraot, pour s'animer à la vengeance ; chantent en couplet :
Poursuivons jusqu'au trépas,
L'ennemi qui nous offense ;
Qu'il n'échappe pas
A notre vengeance !
Ils recommenceraient ce couplet dix fois de suite avec un bruit et des mouvements de forcenés, qu'un homme de goût n'y trouverait que la même déclamation fausse fastidieusement répétée.
On voit par cet exemple de quelle manière les airs à deux, à trois et même à plusieurs acteurs peuvent être placés dans le drame lyrique.
On voit aussi par tout ce que nous venons de dire, ce que c'est que l'air ou l'aria, et quel est son génie. Il consiste dans le développement d'une situation intéressante. Avec quatre petits vers que le poète fournit, le musicien cherche à exprimer non-seulement la principale idée de la passion de son personnage, mais encore tous ces accessoires et toutes ses nuances. Mieux le compositeur devinera les mouvements les plus secrets de l'âme dans chaque situation, plus son air sera beau, plus il se montrera lui-même homme de génie. C'est-là où il pourra déployer aussi toute la richesse de son art, en réunissant le charme de l'harmonie au charme de la mélodie, et l'enchantement des voix au prestige des instruments. L'exécution de l'air se partagera entre le chant et le geste ; elle sera l'ouvrage non-seulement d'un habîle chanteur, mais d'un grand acteur ; car le compositeur n'a guère moins d'attention à désigner les mouvements et la pantomime, qu'à marquer les accens de la passion dont son air présente le tableau.
Suivant la remarque d'un philosophe célèbre, l'air est la récapitulation et la peroraison de la scène, et voilà pourquoi l'acteur quitte presque toujours la scène, après avoir chanté ; les occasions de revenir du langage de la passion à la déclamation ordinaire, au simple récitatif, doivent être rares.
Le génie de l'air est essentiellement différent du couplet et de la chanson : celle-ci est l'ouvrage de la gaieté, de la satyre, du sentiment, si vous voulez, mais jamais de la déclamation, ni de la musique imitative. La chanson ne peut donner aux paroles qu'un caractère général, qu'une expression vague ; mais le retour périodique du même chant à chaque couplet, s'oppose à toute expression particulière, à tout développement, et un chant symétriquement arrangé ne peut trouver place dans la musique dramatique que comme un souvenir. Anacréon peut chanter des couplets au milieu de ses convives ; lorsque Lise veut faire entendre à Dorval les sentiments de son cœur, la présence de sa surveillante l'oblige à les renfermer dans une chanson qu'elle feint d'avoir entendu dans son couvent ; cette tournure est ingénieuse et vraie, mais dans tous ces cas les couplets sont historiques ; c'est une chanson qu'on sait par cœur, et qu'on se rappele. Dans la comédie les occasions de placer des couplets peuvent être fréquentes ; je n'en conçais guère dans la tragédie. Pour nous en tenir aux exemples déjà cités, si Mandane eut fait des paroles, conservati fedele, un couplet au lieu d'un air, quelque tendre que fût ce couplet, il eut été froid, insipide et faux. Nous avons déjà remarqué que le comble de l'absurdité et du mauvais goût serait de se servir du couplet pour le dialogue de la scène et l'entretien des acteurs.
L'air, comme le plus puissant moyen du compositeur, doit être réservé aux grands tableaux et aux moments sublimes du drame lyrique. Pour faire tout son effet, il faut qu'il soit placé avec goût et avec jugement : l'imitation de la nature, la vérité du spectacle et l'expérience sont d'accord sur cette loi. Il en est de la musique comme de la peinture. Le secret des grands effets consiste moins dans la force des couleurs que dans l'art de leur dégradation, et les procédés d'un grand coloriste sont différents de ceux d'un habîle teinturier. Une suite d'airs les plus expressifs et les plus variés, sans interruption et sans repos, lasserait bientôt l'oreille la mieux exercée et la plus passionnée pour la musique. C'est le passage du récitatif à l'air, et de l'air au récitatif qui produit les grands effets du drame lyrique ; sans cette alternative l'opéra serait certainement le plus assommant, le plus fastidieux, comme le plus faux de tous les spectacles.
Il serait également faux de faire alternativement parler et chanter les personnages du drame lyrique. Non-seulement le passage du discours au chant et le retour du chant au discours auraient quelque chose de désagréable et de brusque, mais ce serait un mélange monstrueux de vérité et de fausseté. Dans nulle imitation le mensonge de l'hypothèse ne doit disparaitre un instant ; c'est la convention sur laquelle l'illusion est fondée. Si vous laissez prendre à vos personnages une fois le ton de la déclamation ordinaire, vous en faites des gens comme nous, et je ne vois plus de raison pour les faire chanter sans blesser le bon sens.
On peut donc dire que c'est l'invention et le caractère distinctif de l'air et du récitatif qui ont créé le poème lyrique ; quoique celui-ci marche sans le secours des instruments, et ne diffère de la déclamation ordinaire qu'en marquant les inflexions du discours par des intervalles plus sensibles et susceptibles d'être notés, il n'en est pas moins digne de l'attention d'un grand compositeur qui saura y mettre beaucoup de génie, de finesse et de variété. Il pourra même le faire accompagner de l'orchestre, et le couper dans les repos de différentes pensées musicales dans tous les cas où le discours de l'acteur, sans devenir encore chant, s'animera davantage, et s'approchera du moment où la force de la passion le transformera en air.
Cette économie intérieure du spectacle en musique fondée d'un côté sur la vérité de l'imitation, et de l'autre, sur la nature de nos organes, doit servir de poétique élémentaire au poète lyrique. Il faut à la vérité qu'il se soumette en tout au musicien ; il ne peut prétendre qu'au second rôle ; mais il lui reste d'assez beaux moyens pour partager la gloire de son compagnon. Le choix et la disposition du sujet, l'ordonnance et la marche de tout le drame sont l'ouvrage du poète. Le sujet doit être rempli d'intérêt, et disposé de la manière la plus simple, et la plus intéressante. Tout y doit être en action, et viser aux grands effets. Jamais le poète ne doit craindre de donner à son musicien une tâche trop forte. Comme la rapidité est un caractère inséparable de la musique, et une des principales causes de ses prodigieux effets, la marche du poème lyrique doit être toujours rapide. Les discours longs et aisifs ne seraient nulle part plus déplacés.
Semper ad eventum festinat.
Il doit se hâter vers son dénouement, en se développant de ses propres forces, sans embarras et sans intermittence. Rien n'empêchera que le poète ne dessine fortement ses caractères, afin que la musique puisse assigner à chaque personnage le style et le langage qui lui sont propres. Quoique tout doive être en action, ce n'est pas une suite d'actions cousues l'une après l'autre, que le compositeur demande à son poète. L'unité d'action n'est nulle part plus indispensable que dans ce drame ; mais tous ses développements successifs doivent se passer sous les yeux du spectateur. Chaque scène doit offrir une situation, parce qu'il n'y a que les situations qui offrent les véritables occasions de chanter. En un mot, le poème lyrique doit être une suite de situations intéressantes tirées du fond du sujet, et terminées par une catastrophe mémorable.
Cette simplicité et cette rapidité nécessaires à la marche et au développement du poème lyrique sont aussi indispensables au style du poète. Rien ne serait plus opposé au langage musical que ces longues tirades de nos pièces modernes, et cette abondance de paroles que l'usage et la nécessité de la rime ont introduites sur nos théâtres. Le sentiment et la passion sont précis dans le choix des termes. Ils haïssent la profusion des mots. Ils emploient toujours l'expression propre comme la plus énergique. Dans les instants passionnés, ils la répéteraient vingt fois plutôt que de chercher à la varier par de froides périphrases. Le style lyrique doit donc être énergique, naturel et facile. Il doit avoir de la grâce, mais il abhorre l'élégance étudiée. Tout ce qui sentirait la peine, la facture ou la recherche ; une épigramme, un trait d'esprit, d'ingénieux madrigaux, des sentiments alambiqués, des tournures compassées, feraient la croix et le désespoir du compositeur ; car quel chant, quelle expression donner à tout cela ?
Il y a même cette différence essentielle entre le poète lyrique et le poète tragique, qu'à mesure que celui-ci devient éloquent et verbeux, l'autre doit devenir précis et avare de paroles, parce que l'éloquence des moments passionnés appartient toute entière au musicien. Rien ne serait moins susceptible de chant que toute cette sublime et harmonieuse éloquence par laquelle la Clytemnestre de Racine cherche à soustraire sa fille au couteau fatal ; le poète lyrique en plaçant une mère dans une situation pareille, ne pourra lui faire dire que quatre vers.
Rendimi il figlio mio....
Rends-moi mon fils....
Ah, mi si spezza il cor :
Ah, mon cœur se fend :
Non son più madre, oh dio,
Je ne suis plus mère, ô Ciel !
Non ò più figlio !
Je n'ai plus de fils.
Mais avec ces quatre petits vers la musique fera en un instant plus d'effet que le divin Racine n'en pourra jamais produire avec toute la magie de la poésie. Ah, comme le compositeur saura rendre la prière de cette mère pathétique par la variété de la déclamation ! Son ton suppliant me pénetrera jusqu'au fond de l'âme. Ce ton humble augmentera cependant à proportion de l'espérance qu'elle conçoit de toucher celui dont le sort de son fils dépend. Si cette espérance s'évanouit de son cœur, un accès d'indignation et de fureur succedera à la supplique, et dans son délire, ce rendimi il figlio mio, qui était il n'y a qu'un moment une prière touchante, deviendra un cri forcené. Cet instant d'oubli de son état, sera réparé par plus de soumission, et rendimi il figlio mio redeviendra une prière plus humble et plus pressante. Tant d'efforts et de dangers feront enfin tomber cette infortunée dans un état d'angoisse et de défaillance, où sa poitrine oppressée et sa voix à demi éteinte ne lui permettront plus que des sanglots, et où chaque syllabe du vers rendimi il figlio mio sera entrecoupée par des étouffements qui m'oppresseront moi-même, et me glaceront d'effroi et de pitié. Jugeons d'après ce vers ce que le musicien saura faire de l'exclamation douloureuse : non son più madre ! avec quel art il saura varier et mêler tous ces différents cris de douleur et de désespoir ! et s'il y a un cœur assez féroce qui ne se sente déchirer, lorsqu'au comble de ses maux cette mère s'écrie : ah mi si spezza il cor. Voilà une faible esquisse des effets que la musique opère par un seul air ; elle peut défier le plus grand poète, de quelque nation et de quelque siècle qu'il sait, de faire un morceau de poésie qui puisse soutenir cette concurrence.
Il résulte de ces observations, que le poète, quelque talent qu'il ait d'ailleurs, ne pourra guère se flatter de réussir dans ce genre, s'il ne sait lui-même la musique ; il dépend trop d'elle à chaque pas qu'il fait pour en ignorer les éléments, le gout, et les délicatesses. Il faut qu'il distingue dans son poème le récitatif et l'air avec autant de soin que le compositeur ; le plus beau poème du monde où cette distinction fondamentale ne serait point observée, serait le moins lyrique et le moins susceptible de musique. Dans les airs le musicien est en droit d'exiger de son poète un style facile, brisé, aisé à décomposer ; car le désordre des passions entraîne nécessairement la décomposition du discours, qu'une mécanique de vers trop pénible rendrait impraticable. Les vers alexandrins ne seraient pas même propres à la scène et au récitatif, parce que leur rythme est beaucoup trop long, et qu'il occasionne des phrases longues et arrondies que la déclamation musicale abhorre. On conçoit que des vers pleins d'harmonie et de nombre pourraient cependant être très-peu propres à la musique, et qu'il pourrait y avoir telle langue, où par un abus de mots assez étrange, on aurait appelé lyrique ce qu'il y a de moins susceptible d'être chanté.
Trais caractères sont essentiels à la langue dans laquelle le poème lyrique sera écrit.
Il faut qu'elle soit simple, et qu'en employant préférablement le terme propre, elle ne cesse point pour cela d'être noble et touchante.
Il faut donc qu'elle ait de la grâce et qu'elle soit harmonieuse. Une langue où l'harmonie de la poésie consisterait principalement dans l'arrondissement du vers, où le poète ne serait harmonieux qu'à force d'être nombreux, une telle langue ne serait guère propre à la musique.
Il faut enfin que la langue du poème lyrique, sans perdre de son naturel et de sa grâce, se prête aux inversions que l'expression, la chaleur, et le désordre des passions rendent à tout instant indispensables.
Il y a peu de langues qui réunissent trois avantages si rares ; mais il n'y en a aucune que le poète lyrique ne puisse parler avec succès, s'il connait bien la nature de son drame et le génie de la musique.
Dans le cours du dernier siécle l'opéra créé en Italie fut bien-tôt imité dans les autres parties de l'Europe. Chaque nation fit chanter sa langue sur ses théâtres ; il y eut des opéra espagnols, français, anglais, allemands. En Allemagne surtout, il n'y eut point de ville considérable qui n'eut son théâtre d'opéra, et le recueil des poèmes lyriques représentés sur différents théâtres, formerait seul une petite bibliothèque ; mais le pays qui avait Ve naître ce beau et magnifique spectacle, le vit aussi se perfectionner, il y a environ cinquante ans ; toute l'Europe s'est alors tournée vers l'Italie avec l'acclamation :
Graiis musa dedit...
Cette acclamation a été le signal de la chute de tous les spectacles lyriques, et l'opéra italien s'est emparé de tous les théâtres de l'Europe. Cette foule de grands compositeurs qui sont sortis d'Italie et d'Allemagne depuis ce temps-là, n'a plus voulu chanter que dans cette langue, dont la supériorité a été universellement reconnue. La France seule a conservé son opéra, son poème lyrique, et sa musique, mais sans pouvoir la faire goûter des autres peuples de l'Europe, quelque prévention qu'on ait en général pour ses arts, ses gouts et ses modes. Dans ces derniers temps ses enfants même se sont partagés sur sa musique, et la musique italienne a compté des français parmi ses partisans les plus passionnés. Il nous reste donc à examiner ce que c'est que l'opéra français, et ce que c'est que l'opéra italien.
De l'opéra français. Selon la définition d'un écrivain célèbre, l'opéra français est l'épopée mise en action et en spectacle. Ce que la discrétion du poète épique ne montre qu'à notre imagination, le poète lyrique a entrepris en France de le représenter à nos yeux. Le poète tragique prend ses sujets dans l'histoire ; le poète lyrique a cherché les siens dans l'épopée ; et après avoir épuisé toute la mythologie ancienne et toute la sorcellerie moderne ; après avoir mis sur la scène toutes les divinités possibles ; après avoir tout revêtu de forme et de figure, il a encore créé des êtres de fantaisie, et en les douant d'un pouvoir surnaturel et magique, il en a fait le principal ressort de son poème.
C'est donc le merveilleux visible qui est l'âme de l'opéra français ; ce sont les Dieux, les Déesses, les Demi-dieux ; des Ombres, des Génies, des Fées, des Magiciens, des Vertus, des Passions, des idées abstraites, et des êtres moraux personnifiés qui en sont les acteurs. Le merveilleux visible a paru si essentiel à ce drame, que le poète ne croirait pas pouvoir traiter un sujet historique sans y mêler quelques incidents surnaturels et quelques êtres de fantaisie et de sa création.
Pour juger si ce genre peut mériter le suffrage d'une nation éclairée, les critiques et les gens de goût examineront et décideront les questions suivantes.
Ne serait-ce pas une entreprise contraire au bon sens, que le génie a toujours saintement respecté dans les arts d'imitation, que de vouloir rendre le merveilleux susceptible de la représentation théâtrale ? Ce qui dans l'imagination du poète et de ses lecteurs était noble et grand, rendu ainsi visible aux yeux, ne deviendra-t-il point puérîle et mesquin ?
Sera-t-il aisé de trouver des acteurs pour les rôles du genre merveilleux, ou supportera-t-on un Jupiter, un Mars, un Pluton sous la figure d'un acteur plein de défauts et de ridicules ? Ne faudrait-il pas au-moins, pour de telles représentations, des salles immenses, où le spectateur placé à une juste distance du théâtre, serait forcé de laisser au jeu des machines et des masques la liberté de lui en imposer ; où son imagination fortement frappée serait obligée de concourir elle-même aux effets d'un spectacle dont elle ne pourrait saisir que les masses ? La présence des dieux pourra-t-elle être rendue supportable dans un lieu étroit et resserré où le spectateur se trouve, pour ainsi dire, sous le nez de l'acteur, où les plus petits détails, les nuances les plus fines sont remarqués du premier, où le second ne peut masquer ni dérober aucun des défauts de sa voix, de sa démarche, de sa figure ? L'observation d'Horace,
Major è longinquo reverentia,
qui n'est pas moins vraie des lieux que des temps, n'est-elle pas ici d'une application sensible ? Supposons donc qu'on eut pu mettre des dieux sur ces théâtres anciens et immenses qui recevaient un peuple entier pour spectateur, ne serait-ce pas là précisément une raison pour les bannir de nos petits théâtres, qui ne représentent que pour quelques coteries qu'on a appelées le public ?
Si un spectacle rempli de dieux était le fruit du goût naturel d'un peuple, d'une passion nationale pour ce genre, ce peuple ne commencerait-il pas par mettre sur ses théâtres les divinités de sa religion ? Des dieux de tradition, dont il ne connait la mythologie qu'imparfaitement, pourraient-ils l'émouvoir et l'intéresser comme les objets de son culte et de sa croyance ? L'opéra ne deviendrait-il pas nécessairement une fête religieuse ?
N'exigerait-on pas du-moins d'un tel peuple d'être connaisseur profond et passionné du nud, des belles formes, de l'énergie et de la beauté de la nature ; et que faudrait-il penser de son goût s'il pouvait souffrir sur ses théâtres un Hercule en taffetas couleur de chair, un Apollon en bas blancs et en habit brodé ?
Si le précepte d'Horace,
Nec Deus intersit
est fondé dans la raison, que penser d'un spectacle où les dieux agissent à tort et à travers, où ils arrangent et dérangent tout selon leur caprice, où ils changent incontinent de projets et de volonté ? Qu'on se rappelle avec quelle discrétion les tragiques anciens emploient les dieux dans des piéces, qui après tout étaient des actes de religion ! Ils montraient le dieu un instant, au moment décisif, tandis que notre poète lyrique ne craint point de le tenir sans cesse sous nos yeux. En en usant ainsi, ne risque-t-il pas d'avilir la condition divine, si l'on peut s'exprimer ainsi ? Pour qu'un dieu nous imprime une idée convenable de sa grandeur, ne faut-il pas qu'il parle peu, et qu'il se montre aussi rarement que ces monarques d'Asie, dont l'apparition est une chose si auguste et si solennelle, que personne n'ose lever les yeux sur eux, dans la seule occasion où il est permis de les envisager ? Serait-il possible de conserver ce respect pour un Apollon qui se montrerait trois heures de suite sous la figure et avec les talents de M. Muguet ?
Quand il serait possible de représenter d'une manière noble, grande et vraie les divinités de l'ancienne Grèce, qui sont après tout des personnages historiques, quoique fabuleux ; le bon goût et le bon sens permettraient-ils de personnifier également tous les êtres que l'imagination des poètes a enfantés ? Un génie aérien, un jeu, un ris, un plaisir, une heure, une constellation, tous ces êtres allégoriques et bizarres, dont on lit avec étonnement la nomenclature dans les programmes des Opéra français, pourraient-ils paraitre sur la scène lyrique avec autant de droit et de succès qu'un Bacchus, qu'un Mercure, qu'une Diane ? et quelles seraient les bornes de cette étrange licence ?
Qu'on examine sans prévention les deux tableaux suivants qui sont du même genre ; dans l'un, le poète nous montre Phèdre en proie à une passion insurmontable pour le fils de son époux, luttant vainement contre un penchant funeste, et succombant enfin, malgré elle, dans le délire et dans des convulsions, à un amour effréné et coupable que son succès même ne rendrait que plus criminel. Voilà le tableau de Racine. Dans l'autre, Armide, pour triompher d'un amour involontaire que sa gloire et ses intérêts désavouent également, a recours à son art magique. Elle évoque la Haine : à sa voix, la Haine sort de l'enfer, et parait avec sa suite dans cet accoutrement bizarre, qui est de l'étiquette de l'Opéra français. Après avoir fait danser et voltiger ses suivants longtemps autour d'Armide, après avoir fait chanter par d'autres suivants qui ne savent pas danser, un couplet en chœur qui assure que
Plus on connait l'amour, et plus on le déteste,
Et quand on veut bien s'en défendre,
Qu'on peut se garantir de ses indignes fers.
Après toutes ces cérémonies sans but, sans goût et sans noblesse, la Haine se met à conjurer l'Amour dans les formes, de sortir du cœur d'Armide, et de lui céder la place, précisément comme nos prêtres n'aguerre avaient la coutume d'exorciser le diable. Voilà le tableau de Quinault. Nous ne dirons point qu'il n'y a qu'un homme de génie qui puisse réussir dans le premier, et qu'un homme ordinaire peut se tirer du second avec succès ; mais nous nous en rapporterons à la bonne foi de ceux qui ont Ve la représentation des deux piéces. Qu'ils nous disent si cette Haine avec sa perruque de viperes, avec son autre paquet de serpens en sa main droite, avec ses gants et ses bas rouges à coins étincelans de paillettes d'argent, les a jamais fait frémir de terreur ou de pitié pour Armide, et si Phèdre mourante d'amour et de honte, seule dans les bras de sa vieille nourrice, ne déchire pas tous les cœurs ? Le destin dont la main invisible règle le sort des mortels irrévocablement, ce destin qu'aucun grand poète n'a osé tirer des ténèbres dont il s'est enveloppé ; n'est-il pas bien autrement effrayant et terrible que ce destin à barbe blanche que le poète de l'Opéra français nous montre si indiscrettement, et qui nous avertit en plein-chant que toutes les puissances du ciel et de la terre lui sont soumises ?
Le merveilleux visible ainsi représenté, n'aurait-il pas banni tout intérêt de la scène lyrique ? Un Dieu peut étonner, il peut paraitre grand et redoutable ; mais peut-il intéresser ? Comment s'y prendra-t-il pour me toucher ? Son caractère de divinité ne rompt-il pas toute espèce de liaison et de rapport entre lui et moi ? Que me font ses passions, ses plaintes, sa joie, son bonheur, ses malheurs ? Supposé que sa colere ou sa bienveillance influe sur le sort d'un héros, d'une illustre héroïne du drame, lesquels ayant les mêmes affections, les mêmes faiblesses, la même nature que moi, ont droit de m'intéresser à leur sort, quelle part pourrais-je prendre à une action où rien ne se passe en conséquence de la nature et de la nécessité des choses, où la situation la plus déplorable peut devenir en un clin d'oeil, par un coup de baguette, par un changement de volonté soudain et imprévu, la situation la plus heureuse, et par un autre caprice redevenir funeste ? Ne serait-ce pas-là des jeux propres, tout au plus, à émouvoir des enfants ?
L'unité d'action essentielle à tout drame, et sans laquelle aucun ouvrage de l'art ne saurait plaire, ne serait-elle pas continuellement blessée dans l'Opéra merveilleux ? Des êtres qui sont au-dessus des lois de notre nature, qui peuvent changer à leur gré le cours des événements, ne dissoudraient-ils pas tout le nœud dans les pièces de ce genre ? Un Opéra ne serait donc qu'une suite d'incidents qui se succedent les uns aux autres sans nécessité, et par conséquent sans liaison véritable. Le poète pourrait les allonger, abréger, supprimer à sa fantaisie, sans que son sujet en souffrit. Il pourrait changer ses actes de place, faire du premier le troisième, du quatriéme le second, sans aucun bouleversement considérable de son plan. Il pourrait dénouer sa pièce au premier acte, sans que cela l'empêchât de faire suivre cet acte de quatre autres où il dénouerait et renouerait, autant de fois qu'il lui plairait : ou pour parler plus exactement, il n'y aurait dans le fait, ni nœud, ni dénouement. Tout sujet de cette espèce ne peut-il pas être traité en un acte, en trois, en cinq, en dix, en vingt, selon le caprice et l'extravagance du poète lyrique ?
Si ce genre n'a pu enfanter que des drames dénués de tout intérêt et de toute vérité, n'aurait-il pas ainsi empêché les progrès de la musique en France, tandis que cet art a été porté au plus haut degré de perfection dans les autres parties de l'Europe ? Comment le style musical se serait-il formé dans un pays où l'on ne fait chanter que des êtres de fantaisie dont les accens n'ont nul modèle dans la nature ? Leur déclamation étant arbitraire et indéterminée, n'aurait-elle pas produit un chant froid et soporifique, une monotonie insupportable auxquels personne n'aurait résisté sans le secours des ballets ? Toute l'expression musicale ne se serait-elle pas ainsi réduite à jouer sur le mot, en sorte qu'un acteur ne pourrait prononcer le mot larmes, sans que le musicien ne le fit pleurer, quoiqu'il n'eut aucun sujet d'affliction, et que dans la situation la plus triste il ne pourrait parler d'un état brillant sans que le musicien ne se crut en droit de faire briller sa voix aux dépens de la disposition de son âme ? Ne serait-il pas résulté de cette méthode un dictionnaire des mots reputés lyriques, dictionnaire dont un compositeur habîle ne manquerait pas de faire present à son poète, afin qu'il eut, en un seul recueil, tous les mots dont la musique ne saurait rien faire, et qu'il ne faut jamais employer dans le poème lyrique ?
Si vous choisissez deux compositeurs, que vous donniez à l'un à exprimer le désespoir d'Andromaque lorsqu'on arrache Astyanax du tombeau où sa piété l'avait caché, ou les adieux d'Iphigénie qui Ve se soumettre au couteau de Calchas, ou bien les fureurs de sa mère éperdue au moment de cet affreux sacrifice ; et que vous disiez à l'autre, faites-moi une tempête, un tremblement de terre, un chœur d'aquilons, un débordement de Nil, une descente de Mars, une conjuration magique, un sabat infernal, n'est-ce pas dire à celui-ci, je vous choisis pour faire peur ou plaisir aux enfants, et à l'autre, je vous choisis pour être l'admiration des nations et des siécles ? N'est-il pas évident que l'un a dû rester barbare, et sans musique, sans style, sans expression, sans caractère, et que l'autre a dû. ou renoncer à son projet, ou, s'il y a réussi, devenir sublime ?
Deux poètes qu'on aurait ainsi employés, ne seraient-ils pas dans le même cas ? L'un n'aurait-il pas appris à parler le langage du sentiment, des passions, de la nature ; l'autre ne serait-il pas resté faible, froid et maniéré ? Quand il aurait eu le talent de la poésie, son faux genre l'aurait trompé sur l'emploi qu'il en faut faire. La pompe épique aurait pris dans son style la place du naturel de la poésie dramatique. Au lieu de scènes naturellement dialoguées, nous aurions eu des recueils de maximes, de madrigaux, d'épigrammes, de tournures et de cliquetis de mots pour lesquels la musique n'a jamais connu d'expression. Le goût se serait si peu formé qu'on n'aurait point senti la différence de l'harmonie poétique et de l'harmonie musicale, ni compris que le plus beau morceau de Tibulle serait déplacé dans le poème lyrique, précisément par ce qui le rend si beau et si précieux. On aurait Ve enfin l'étrange phénomène d'un poète lyrique, plein de douceur et de nombre, plein de charme à la lecture, et dont il serait cependant impossible de mettre les pièces en musique.
Ce faux genre où rien ne rappelle à la nature, n'aurait-il pas empêché le musicien français de connaître et de sentir cette distinction fondamentale de l'air et du récitatif ? Un chant lourd et trainant, semblable au chant gothique de nos églises, serait devenu le récitatif de l'opéra. Pour lui donner de l'expression, on l'aurait surchargé de ports de voix, de trilles, de chevrottements ; et malgré ces laborieux efforts, on ne se serait pas seulement douté de l'art de ponctuer le chant, de faire une interrogation, une exclamation en chantant. La lenteur insoutenable de ce récitatif, son caractère contraire à toute espèce de déclamation, auraient d'ailleurs rendu l'exécution d'une véritable scène impossible sur ce théâtre. L'air, cette autre partie principale du drame en musique, serait encore si peu trouvé que le mot même ne s'entendrait que des pièces que le musicien fait pour la danse, ou des couplets dans lesquels le poète renferme des maximes qu'il fait servir au dialogue de la scène, et dont le compositeur fait des chansons que l'acteur chante avec une sorte de mouvement. On aurait pu ajouter aux divertissements de ce spectacle, des ariettes, mais qui ne sont jamais en situation, qui ne tiennent point au sujet, et dont la dénomination même indique la pauvreté et la puérilité. Ces ariettes auraient encore merveilleusement contribué à retarder les progrès de la musique ; car il vaut sans doute mieux que la musique n'exprime rien que de la voir se tourmenter autour d'une lance, d'un murmure, d'un voltige, d'un enchaine, d'un triomphe, &c.
Par l'idée d'exposer aux yeux ce qui ne peut agir que sur l'imagination, et ne faire de l'effet qu'en restant invisible, le poète n'aurait-il pas entrainé le décorateur dans des écarts et dans des bizarreries qui lui auraient fait méconnaître le véritable emploi d'un art si précieux à la représentation théâtrale ? Quel modèle un jardin enchanté, un palais de fée, un temple aérien, etc. a-t-il dans la nature ? Que peut-on blamer ou louer dans le projet et l'exécution d'une telle décoration, à moins que le décorateur ne paraisse sublime à proportion qu'il est extravagant ? Ne lui faut-il pas cent fois plus de goût et de génie pour nous montrer un grand et bel édifice, un beau paysage, une belle ruine, un beau morceau d'architecture ? Serait-ce une entreprise bien sensée de vouloir imiter dans les décorations les phénomènes physiques et la nature en mouvement ? Les agitations, les révolutions, celles qui attachent et qui effraient, ne doivent-elles pas plutôt être dans le sujet de l'action et dans le cœur des acteurs que dans le lieu qu'ils occupent ?
Quand il serait possible de représenter avec succès les phénomènes de la nature, et tout ce qui accompagnerait l'apparition d'un dieu sur un théâtre de grandeur convenable, l'hypothèse d'un spectacle où les personnages parlent quoiqu'en chantant, n'est-elle pas beaucoup trop voisine de notre nature pour être employée dans un drame dont les acteurs sont des dieux ? Le bon goût n'ordonnerait-il pas de réserver de tels sujets au spectacle de la danse et de la pantomime, afin de rompre entre les acteurs et le spectateur, le lien de la parole qui les rapprocherait trop, et qui empêcherait celui-ci de croire les autres d'une nature supérieure à la sienne ? Si cette observation était juste, il faudrait confier le genre merveilleux à l'éloquence muette et terrible du geste, et faire servir la musique dans ces occasions à la traduction, non des discours, mais des mouvements.
Voilà quelques-unes des questions qu'il faudrait éclaircir sans prévention, avant de prononcer sur le mérite du genre appelé merveilleux, et avant d'entreprendre la poétique de l'Opéra français. Les arts et le goût public ne pourraient que gagner infiniment à une discussion impartiale.
De l'Opéra italien. Après la renaissance des Lettres, l'art dramatique s'est rapidement perfectionné dans les différentes contrées de l'Europe. L'Angleterre a eu son Shakespeare ; la France a eu d'un côté son immortel Moliere, et de l'autre, son Corneille, son Racine et son Voltaire. En Italie, on s'est aussi bientôt débarrassé de ce faux genre appelé merveilleux, que la barbarie du goût avait introduit dans le siécle dernier sur tous les théâtres de l'Europe ; et dès qu'on a voulu chanter sur la scène, on a senti qu'il n'y avait que la tragédie et la comédie qui pussent être mises en musique. Un heureux hasard ayant fait naître au même instant le poète lyrique le plus facile, le plus simple, le plus touchant, le plus énergique, l'illustre Metastasio, et ce grand nombre de musiciens de génie que l'Italie et l'Allemagne ont produits, et à la tête desquels la postérité lira en caractères ineffaçables, les noms de Vinci, de Hasse et de Pergolesi ; le drame en musique a été porté en ce siécle au plus haut degré de perfection. Tous les grands tableaux, les situations les plus intéressantes, les plus pathétiques, les plus terribles ; tous les ressorts de la tragédie, tous ceux de la véritable comédie ont été soumis à l'art de la Musique, et en ont reçu un degré d'expression et d'enthousiasme, qui a par-tout entrainé et les gens d'esprit et de gout, et le peuple. La Musique ayant été consacrée en Italie dès sa naissance à sa véritable destination, à l'expression du sentiment et des passions, le poète lyrique n'a pu se tromper sur ce que le compositeur attendait de lui ; il n'a pu égarer celui-ci à son tour, et lui faire quitter la route de la nature et de la vérité.
En revanche, il ne faut pas s'étonner que dans la patrie du goût et des arts, la tragédie sans musique ait été entièrement négligée. Quelque touchante que soit la représentation tragique, elle paraitra toujours faible et froide à côté de celle que la musique aura animée ; et en vain la déclamation voudrait-elle lutter contre les effets du chant et de ses impressions. Pour se consoler de n'avoir point égalé ses voisins en Musique, la France doit se dire que ses progrès dans cet art l'auraient peut-être empêché d'avoir son Racine.
Pourquoi donc l'Opéra italien avec des moyens si puissants n'a-t-il pas renouvellé de nos jours ces terribles effets de la tragédie ancienne dont l'histoire nous a conservé la mémoire ? Comment a-t-on pu assister à la représentation de certaines scènes, sans craindre d'avoir le cœur trop douloureusement déchiré, et de tomber dans un état trop pénible et trop voisin de la situation déplorable des heros de ce spectacle ? Ce n'est ni le poète ni le compositeur qu'un critique éclairé accusera dans ces occasions d'avoir été au-dessous du sujet : il faut donc examiner de quels moyens on s'est servi pour rendre tant de sublimes efforts du génie, ou inutiles, ou de peu d'effet.
Lorsqu'un spectacle ne sert que d'amusement à un peuple aisif, c'est-à-dire à cette élite d'une nation, qu'on appelle la bonne compagnie, il est impossible qu'il prenne jamais une certaine importance ; et quelque génie que vous accordiez au poète, il faudra bien que l'exécution théâtrale, et mille détails de son poème se ressentent de la frivolité de sa destination. Sophocle en faisant des tragédies, travaillait pour la patrie, pour la religion, pour les plus augustes solennités de la république. Entre tous les poètes modernes, Metastasio a peut-être joui du sort le plus doux et le plus heureux ; à l'abri de l'envie et de la persécution, qui sont aujourd'hui assez volontiers la récompense du génie, comme elles l'étaient quelquefois chez les anciens, des vertus et des services rendus à l'état, les talents du premier poète d'Italie ont été constamment honorés de la protection de la maison d'Autriche : que son rôle à Vienne est cependant différent de celui de Sophocle à Athènes ! Chez les anciens, le spectacle était une affaire d'état ; chez nous, si la police s'en occupe, c'est pour lui faire mille petites chicanes, c'est pour le faire plier à mille convenances bizarres. Le spectateur, les acteurs, les entrepreneurs, tous ont usurpé sur le poème lyrique, un empire ridicule ; et ses créateurs, le poète et le musicien, eux-mêmes victimes de cette tyrannie, ont été le moins consultés sur son exécution.
Tout le monde sait qu'en Italie, le peuple ne s'assemble pas seulement aux théâtres pour voir le spectacle ; mais que les loges sont devenues autant de cercles de conversation qui se renouvellent plusieurs fois pendant la durée de la représentation. L'usage est de passer cinq ou six heures à l'Opéra, mais ce n'est pas pour lui donner cinq ou six heures d'attention. On n'exige du poète que quelques situations très-pathétiques, quelques scènes très-belles, et l'on se rend facîle sur le reste. Quand le musicien a réussi de rendre ces fameux morceaux que tout le monde sait par cœur, d'une manière neuve et digne de son art, on est ravi, on s'extasie, on s'abandonne à l'enthousiasme, mais la scène passée, on n'écoute plus. Ainsi deux ou trois airs, un beau duetto, une scène extrêmement belle, suffisent au succès d'un Opéra, et l'on est indifférent sur la totalité du drame, pourvu qu'il ait donné trois ou quatre instants ravissants, et qu'il dure d'ailleurs le temps qu'on s'est destiné à passer à la salle de l'Opéra.
Chez une nation passionnée pour le chant, qui fait au charme de la voix le plus grand des sacrifices, et où le chant est devenu un art qui exige, outre la plus heureuse disposition des organes, l'étude la plus longue et la plus opiniâtre, le chanteur a dû bien-tôt usurper un empire illégitime sur le compositeur et sur le poète. Tout a été sacrifié à ses talents et à ses caprices. On s'est peu choqué des imperfections de l'action théâtrale, pourvu que le chant fût exécuté avec cette supériorité qui séduit et enchante. Le chanteur, sans s'occuper de la situation et du caractère de son rôle, a borné tous ses soins à l'expression du chant ; la scène a été récitée et jouée avec une négligence honteuse. Le public, de spectateur qu'il doit être, n'est resté qu'auditeur. Il a fermé les yeux, et ouvert les oreilles, et laissant à son imagination le soin de lui montrer la véritable attitude, le vrai geste, les traits et la figure de la veuve d'Hector, ou de la fondatrice de Carthage, il s'est contenté d'en entendre les véritables accens.
Cette indulgence du public a laissé d'un côté l'action théâtrale dans un état très-imparfait, et de l'autre, elle a rendu le chanteur, maître de ses maîtres. Pourvu que son rôle lui donnât occasion de développer les ressources de son art, et de faire briller sa science, peu lui importait que ce rôle fût d'ailleurs ce que le drame voulait qu'il fût. Le poète fut obligé de quitter le style dramatique, de faire des tableaux, de coudre à son poème quelques morceaux postiches de comparaisons et de poésie épique ; et le musicien, d'en faire des airs dans le style le plus figuré, et par conséquent le plus opposé à la musique théâtrale, et pour déterminer le chanteur à se charger de quelques airs simples et vraiement sublimes que la situation rendait indispensables au fond du sujet, il fallut acheter sa complaisance par ces brillans écarts, aux dépens de la vérité et de l'effet général. L'abus fut porté au point que lorsque le chanteur ne trouvait pas ses airs à sa fantaisie, il leur en substituait d'autres qui lui avaient déjà valu des applaudissements dans d'autres pièces et sur d'autres théâtres, et dont il changeait les paroles comme il pouvait, pour les approcher de sa situation et de son rôle, le moins mal qu'il était possible.
Enfin l'entrepreneur de l'Opéra devint de tous les tyrants du poète, le plus injuste et le plus absurde. Ayant étudié le goût du public, sa passion pour le chant, son indifférence pour les convenances et l'ensemble du spectacle, voici à-peu-près le traité qu'il proposa au poète lyrique, en conséquence de ses découvertes.
" Vous êtes l'homme du monde dont j'ai le moins besoin pour le succès de mon spectacle : après vous, c'est le compositeur. Ce qui m'est essentiel, c'est d'avoir un ou deux sujets que le public idolâtre : il n'y a point de mauvais Opéra avec un Caffarelli, avec une Gabrieli. Mon métier est de gagner de l'argent. Comme je suis obligé d'en donner prodigieusement à mes chanteurs, vous sentez qu'il ne m'en reste que très-peu pour le compositeur, et encore moins pour vous : songez que votre partage est la gloire ".
" Voici quelques conditions fondamentales sous lesquelles je consens de hasarder votre poème, de le faire mettre en musique, et de le faire exécuter par mes chanteurs ".
" 1. Votre poème doit être en trois actes, et ces trois actes ensemble doivent durer au-moins cinq heures, y compris quelques ballets que je ferai exécuter dans les entr'actes ".
" 2. Au milieu de chaque acte il me faut un changement de scène et de lieu, en sorte qu'il y ait deux décorations par acte. Vous me direz que c'est proprement demander un poème en six actes, puisqu'il faut laisser la scène vide au moment de chaque changement ; mais ce sont des subtilités de métier dont je ne me mêle point.
3. Il faut qu'il y ait dans votre pièce six rôles, jamais moins de cinq, ni plus de sept : savoir un premier acteur et une première actrice, un second acteur et une seconde actrice ; ce qui fera deux couples d'amoureux qui chanteront le soprano, ou dont un seul, soit homme, soit femme, pourra chanter le contralto. Le cinquième rôle est celui de tyran, de roi, de père, de gouverneur, de vieillard ; il appartient à l'acteur qui chante le tenore. Au surplus vous pouvez employer encore à des rôles de confident un ou deux acteurs subalternes.
4. Suivant cet arrangement judicieux et consacré d'ailleurs par l'usage, il vous faut un double amour. Le premier acteur doit être amoureux de la première actrice, le second de la seconde. Vous aurez soin de former l'intrigue de toutes vos pièces sur ce plan-là, sans quoi je ne pourrai m'en servir. Je n'exige point que la première actrice réponde précisément à l'amour du premier acteur ; au contraire, je vous permettrai toute combinaison et toute liberté à cet égard, car je n'aime pas à faire le difficîle sans sujet ; et pourvu que l'intrigue soit double, afin que mes seconds acteurs ne disent pas que je leur fais jouer des rôles subalternes, je ne vous chicanerai point sur le reste. Chaque acteur chantera deux fois dans chaque acte, excepté peut-être au troisième, où l'action se hâtant vers sa fin, ne vous permettra plus de placer autant d'airs que dans les actes précédents. L'acteur subalterne pourra aussi moins chanter que les autres.
6. Je n'ai besoin que d'un seul duetto : il appartient de droit au premier acteur et à la première actrice ; les autres acteurs n'ont pas de privilège de chanter ensemble. Il ne faut pas que ce duetto soit placé au troisième acte ; il faut tâcher de le mettre à la fin du premier ou du second, ou bien au milieu d'un de ces actes, immédiatement avant le changement de la décoration.
7. Il faut que chaque acteur quitte la scène immédiatement après avoir chanté son air. Ainsi lorsque l'action les aura rassemblés sur le théâtre, ils défileront l'un après l'autre, après avoir chanté chacun à son tour. Vous voyez que le dernier qui reste a beau jeu de chanter un air brillant qui contienne une réflexion, une maxime, une comparaison relative à sa situation ou à celle des autres personnages.
8. Avant de faire chanter à un acteur son second air, il faut que tous les autres aient chanté leur premier ; et avant qu'il puisse chanter son troisième, il faut que tous les autres aient chanté leur second, et ainsi de suite jusqu'à la fin ; car vous sentez qu'il ne faut pas confondre les rangs, ni blesser les droits d'aucun acteur ".
A ces étranges articles on peut ajouter celui que l'aversion de l'empereur Charles VI. pour les catastrophes tragiques, rendit d'une observation indispensable. Ce prince voulut que tout le monde sortit de l'Opéra content et tranquille, et Metastasio fut obligé de racommoder tout si bien que vers le dénouement tous les acteurs du drame fussent heureux. On pardonnait aux mécans, les bons renonçaient à la passion qui avait causé leur malheur ou celui des autres dans le cours du drame, ou bien d'autres obstacles disparaissaient : chaque acteur se prêtait un peu, et tout était pacifié à la fin de l'Opéra.
Voilà les principes sur lesquels on fonda la poétique de l'Opéra italien. Le poète lyrique fut traité à-peu-près comme un danseur de corde à qui on lie les pieds, afin de rendre son métier plus difficile, et ses tours de force plus éclatants.
Si Metastasio, malgré ses entraves, a pu conserver encore à ses pièces du naturel et de la vérité, on en est justement surpris ; mais l'ensemble du poème lyrique a dû nécessairement se ressentir de ces lois bizarres et absurdes ; la force des mœurs a dû disparaitre avec celle de l'intrigue ; le second couple d'amoureux a dû entraîner cet amour épisodique qui dépare presque tous les opéra d'Italie. De cette manière, le poème lyrique est devenu un problême où il s'agissait de couper toutes les pièces sur le même patron, de traiter tous les sujets historiques et tragiques à-peu-près avec les mêmes personnages.
L'Opéra-comédie ou bouffon n'a pas été sujet, à la vérité, à toutes ces entraves ; mais il n'a été traité en revanche que par des farceurs ou des poètes médiocres, qui ont tout sacrifié à la saillie du moment. Ces pièces sont ordinairement pleines de situations comiques, parce que la nécessité de placer l'air produit la nécessité de créer la situation ; mais pourvu qu'elle fût originale et plaisante, on pardonnait au poète l'extravagance du plan et de l'ensemble, et les moyens pitoyables dont il se servait pour amener les situations.
Ce qu'il faut avouer à la gloire du poète et du compositeur, c'est qu'ils ne se sont jamais trompés un instant sur leur vocation ni sur la destination de leur art ; et si l'Opéra italien est rempli de défauts qui en affoiblissent l'impression et l'effet, heureusement il n'y en a aucun qu'on ne puisse retrancher sans toucher au fond et à l'essence du poème lyrique.
De quelques accessoires du poème lyrique. Nous avons dit ce qu'il faut penser des couplets, des duo, et de la manière dont on peut faire chanter deux ou plusieurs acteurs ensemble sans blesser le bon sens et la vraisemblance ; il nous reste à parler des chœurs, qui sont très-fréquents dans les Opéra français, et très-rares dans les Opéra italiens. Celui-ci est ordinairement terminé par un couplet que tous les acteurs réunis chantent en chœur, et qui ne tenant point au sujet, disparaitra dès qu'il sera permis au poète de dénouer sa pièce comme le sujet l'exige. Il n'y a pas moyen de coudre un couplet au chœur après l'Opéra de Didon abandonnée. Dans l'Opéra français chaque acte a son divertissement, et chaque divertissement consiste en danses et en chœurs chantants ; et les partisans de ce spectacle ont toujours compté les chœurs parmi ses principaux avantages.
Pour juger quel cas il en faut faire, on n'a qu'à se souvenir de ce qui a été dit plus haut au sujet du couplet, que le bon goût n'a jamais permis de regarder comme une partie de la musique théâtrale. S'il est contre le bon sens qu'un acteur réponde à l'autre par une chanson, avec quelle vraisemblance une assemblée entière ou tout un peuple pourra-t-il manifester son sentiment, en chantant ensemble et en chœur le même couplet, les mêmes paroles, le même air ? Il faudra donc supposer qu'ils se sont concertés d'avance, et qu'ils sont convenus entr'eux de l'air et des paroles, par lesquels ils exprimeraient leur sentiment sur ce qui fait le sujet de la scène, et ce qu'ils ne pouvaient savoir auparavant ? Que dans une cérémonie religieuse le peuple assemblé chante une hymne à l'honneur de quelque divinité, je le conçais ; mais ce couplet est un cantique sacré que tout le peuple sait de tout temps par cœur ; et dans ces occasions les chœurs peuvent être augustes et beaux. Tout un peuple témoin d'une scène intéressante, peut pousser un cri de joie, de douleur, d'admiration, d'indignation, de frayeur, etc. Ce chœur qui ne sera qu'une exclamation de quelques mots, et plus souvent qu'un cri inarticulé, pourra être du plus grand effet. Voilà à-peu-près l'emploi des chœurs dans la tragédie ancienne ; mais que ces chœurs sont différents de ces froids et bruyans couplets que débitent les choristes de l'Opéra français sans action, les bras croisés, et avec un effort de poumons à étourdir l'oreille la plus aguerrie !
Le bon goût proscrira donc les chœurs du poème lyrique, jusqu'à ce que l'Opéra se soit assez rapproché de la nature pour exécuter les grands tableaux et les grands mouvements avec la vérité qu'ils exigent. A ce beau moment pour les Arts, qu'on m'amène l'homme de génie qui sait la langue des passions et la science de l'harmonie, et je serai son poète, et je lui donnerai les paroles d'un chœur que personne ne pourra entendre sans frissonner. Supposons un peuple opprimé, avili sous le règne d'un odieux tyran. Supposons que ce tyran soit massacré, ou qu'il meure dans son lit (car qu'importe après tout le sort d'un méchant ?), et que le peuple ivre de la joie la plus effrénée de s'en voir délivré, s'assemble pour lui proclamer un successeur. Pour que mon sujet devienne historique, j'appellerai le tyran Commode, et son successeur à l'empire, Pertinax ; et voici le chœur que je propose au musicien de faire chanter au peuple romain.
" Que l'on arrache les honneurs à l'ennemi de la patrie.... l'ennemi de la patrie ! le parricide ! le gladiateur !.. Qu'on arrache les honneurs au parricide.... qu'on traine le parricide.... qu'on le jette à la voirie.... qu'il soit déchiré.... l'ennemi des dieux ! le parricide du sénat !... à la voirie, le gladiateur !... l'ennemi des dieux ! l'ennemi du sénat ! à la voirie, à la voirie !... Il a massacré le sénat, à la voirie !... Il a massacré le sénat, qu'il soit déchiré à coups de crocs !... Il a massacré l'innocent : qu'on le déchire.... qu'on le déchire, qu'on le déchire.... Il n'a pas épargné son propre sang ; qu'on le déchire.... Il avait médité ta mort ; qu'on le déchire.... Tu as tremblé pour nous, tu as tremblé avec nous ; tu as partagé nos dangers.... O Jupiter, si tu veux notre bonheur, conserve nous Pertinax !... Gloire à la fidélité des prétoriens !... aux armées romaines !... à la piété du sénat !... Pertinax, nous te le demandons, que le parricide soit trainé.... qu'il soit trainé, nous te le demandons.... Dis avec nous, que les délateurs soient exposés aux lions.... Dis, aux lions le gladiateur... Victoire à jamais au peuple romain !... liberté ! victoire !... Honneur à la fidélité des soldats !... aux cohortes prétoriennes !... Que les statues du tyran soient abattues !... partout, partout !... Qu'on abatte le parricide, le gladiateur !... Qu'on traine l'assassin des citoyens.... qu'on brise ses statues.... Tu vis, tu vis, tu nous commandes, et nous sommes heureux... ah oui, oui, nous le sommes.... nous le sommes vraiment, dignement, librement.... nous ne craignons plus. Tremblez, délateurs !... notre salut le veut.... Hors du sénat, les délateurs !.. à la hache, aux verges, les délateurs !.. aux lions, les délateurs !.. aux verges, les délateurs !.. Périsse la mémoire du parricide, du gladiateur !... périssent les statues du gladiateur !... à la voirie, le gladiateur !... César, ordonne les crocs... que le parricide du sénat soit déchiré... ordonne, c'est l'usage de nos ayeux... Il fut plus cruel que Domitien... plus impur que Néron... qu'on lui fasse comme il a fait !... Réhabilite les innocens... rends honneur à la mémoire des innocens.... Qu'il soit trainé, qu'il soit trainé !... ordonne, ordonne, nous te le demandons tous... Il a mis le poignard dans le sein de tous. Qu'il soit trainé !... Il n'a épargné ni âge, ni sexe ; ni ses parents, ni ses amis. Qu'il soit trainé !... Il a dépouillé les temples. Qu'il soit trainé !... Il a violé les testaments. Qu'il soit trainé !... Il a ruiné les familles. Qu'il soit trainé !... Il a mis les têtes à prix. Qu'il soit trainé !... Il a vendu le sénat. Qu'il soit trainé !... Il a spolié l'héritier. Qu'il soit trainé !... Hors du sénat, ses espions !... hors du sénat, ses délateurs !... hors du sénat, les corrupteurs d'esclaves !... Tu as tremblé avec nous... tu sais tout... tu connais les bons et les mécans. Tu sais tout... punis qui l'a mérité. Répare les maux qu'on nous a faits... nous avons tremblé pour toi... nous avons rampé sous nos esclaves... Tu règnes. Tu nous commandes. Nous sommes heureux... oui, nous le sommes... Qu'on fasse le procès au parricide !... ordonne, ordonne son procès... Viens, montre-toi, nous attendons ta présence... Hélas, les innocens sont encore sans sépulture !... que le cadavre du parricide soit trainé !... Le parricide a ouvert les tombeaux. Il en a fait arracher les morts... que son cadavre soit trainé " !
Voilà un chœur. Voilà comme il convient de faire parler un peuple entier quand on ose le montrer sur la scène. Qu'on compare cette acclamation du peuple romain à l'élévation de l'empereur Pertinax, avec l'acclamation des peuples des Zéphirs, lorsqu'Atys est nommé grand sacrificateur de Cybele :
Que devant vous tout s'abaisse et tout tremble.
Vivez heureux, vos jours sont notre espoir :
Rien n'est si beau que de voir ensemble
Un grand mérite avec un grand pouvoir.
Que l'on bénisse
Le ciel propice,
Qui dans vos mains
Met le sort des humains.
Ou, qu'on lui compare cet autre chœur d'une troupe de dieux de fleuves :
Que l'on chante, que l'on danse,
Rions tous, lorsqu'il le faut :
Ce n'est jamais trop-tôt
Que le plaisir commence.
On trouve bien-tôt la fin
Des jours de réjouissance ;
On a beau chasser le chagrin,
Il revient plutôt qu'on ne pense.
Quel peuple a jamais exprimé ses transports les plus vifs d'une manière aussi plate et aussi froide ? Qu'on se rappelle maintenant l'air encore plus plat que Lully a fait sur ces couplets, et l'on trouvera que le musicien a surpassé son poète de beaucoup.
Que les gens de goût décident entre ces chœurs et celui que je propose, et ils seront forcés de m'adjuger le rang sur le premier poète lyrique de France. C'est que le tendre Quinault a cherché ses chœurs dans un genre insipide et faux ; et moi, j'ai pris le mien dans la vérité et dans l'Histoire où Lampride nous l'a conservé mot pour mot.
Ce chœur pourra paraitre long, mais ce ne sera pas à un compositeur habîle qui sentira au premier coup d'oeil avec quelle rapidité tous ces cris doivent se succéder et se répéter. Il me reprochera plutôt d'avoir empiété sur ses droits ; et au lieu de m'en tenir, comme le poète le doit, à une simple esquisse des principales idées, dont l'interprétation appartient à la Musique, d'avoir déjà mis dans mon cœur toute sorte de déclamations, tout le désordre, tout le tumulte, toute la confusion d'une populace effrénée ; d'avoir distribué, pour ainsi dire, tous les rôles et toute la partition ; d'avoir marqué les cris qui ne sont poussés que par une seule voix, tandis qu'un autre reproche part d'un autre côté, ou qu'une imprécation est interrompue par une acclamation de joie ; ou qu'on se met à rappeler tous les forfaits du tyran l'un après l'autre ; que l'un commence, il n'a épargné ni âge, ni sexe ; qu'un autre ajoute, ni ses parents : qu'un troisième acheve, ni ses amis ; que tous se réunissent à crier : qu'il soit trainé ! voilà des entreprises dignes d'un homme de génie. Quel tableau ! je me sens frappé des cris d'un million d'hommes ivres de fureur et de joie ; je frémis à l'aspect de l'image la plus effrayante et la plus terrible de l'enthousiasme populaire.
De la danse. La danse est devenue dans tous les pays la compagne du spectacle en Musique.
En Italie et sur les autres théâtres de l'Europe, on remplit les entr'actes du poème lyrique par des ballets qui n'y ont aucun rapport. Si cet usage est barbare, il est encore de ceux qu'on peut abolir, sans toucher au fond du spectacle ; et cela arrivera dès que le poème lyrique sera délivré de ses épisodes, et serré comme son esprit et sa constitution l'exigent.
En France, on a associé le ballet immédiatement avec le chant et avec le fond de l'opéra. Arrive-t-il quelque incident heureux ou malheureux, aussi-tôt il est célébré par des danses, et l'action est suspendue par le ballet. Cette partie postiche est même devenue en ces derniers temps la principale du poème lyrique ; chaque acte a besoin d'un divertissement, terme qui n'a jamais été pris dans une acception plus propre et plus stricte, et le succès d'un opéra dépend aujourd'hui, non pas précisément de la beauté des ballets, mais de l'habileté des danseurs qui l'exécutent.
Rien, ce semble, ne dépose plus fortement contre le poème et la musique de l'opéra français, que le besoin continuel et urgent de ces ballets. Il faut que l'action de ce poème soit dénuée d'intérêt et de chaleur, puisque nous pouvons souffrir qu'elle soit interrompue et suspendue à tout instant par des menuets et des rigaudons ; il faut que la monotonie du chant soit d'un ennui insupportable, puisque nous n'y tenons qu'autant qu'il est coupé dans chaque acte par un divertissement.
Suivant cet usage, l'opéra français est devenu un spectacle où tout le bonheur et tout le malheur des personnages se réduit à voir danser autour d'eux.
Pour juger si cet usage mérite l'approbation des gens de gout, et si c'est un avantage inestimable, comme on l'entend dire sans cesse, que l'opéra français a sur tous les spectacles lyriques, de réunir la danse à la Poésie et à la Musique, il sera nécessaire de réfléchir sur les observations suivantes.
La danse, ainsi que le couplet, peut quelquefois être historique dans le poème lyrique. Roland arrive au rendez-vous que la perfide Angélique lui a donné. Après l'avoir vainement attendue pendant quelque temps, il voit venir une troupe de jeunes gens qui, en chantant et en dansant, célebrent le bonheur de Médor et d'Angélique qu'ils viennent de conduire au port. C'est par ces expressions de joie d'une jeunesse innocente et vive que Roland apprend son malheur et la trahison de sa maîtresse. Cette situation est très-belle, et c'est avec raison qu'on a regardé cet acte comme le chef-d'œuvre du théâtre lyrique en France. Voyons si l'exécution et la représentation théâtrale répondent à l'idée sublime du poète, et si Quinault n'a pas été obligé lui-même de la gâter pour se conformer à l'usage de l'opéra. Roland, après avoir attendu longtemps, après avoir examiné les chiffres et les inscriptions, et réprimé les soupçons que son cœur jaloux en a conçus, entend une musique champêtre. C'est la jeunesse qui revient sur ses pas, après avoir conduit Médor et Angélique. Roland, dans l'espérance de trouver sa maîtresse parmi cette troupe joyeuse, quitte la scène et Ve au-devant du bruit. A l'instant même la jeunesse dansante et chantante parait. Roland devrait reparaitre avec elle ; mais apparemment qu'il s'est déjà aperçu qu'Angélique n'y est point. Ainsi il Ve la chercher dans les lieux d'alentour, et abandonne la place aux danseurs et aux choristes. Ce n'est qu'après que ceux-ci nous ont diverti pendant une demi-heure par leurs couplets et leurs rigaudons, que le héros revient et s'éclaircit sur son malheur. Il est évident qu'en ne consultant sur ce ballet que le bon gout, la jeunesse ne fera autre chose que traverser le théâtre en dansant ; que dans le premier instant ils nommeront Médor et Angélique ; que dès cet instant Roland s'éclaircira sur son malheur en frémissant, et qu'il n'aura pas plus que nous la patience d'attendre que les entrées et les contre-danses soient finies pour apprendre un sort qui nous intéresse uniquement. J'avoue qu'il n'est pas contre la vraisemblance qu'une jeunesse pleine de tendresse et de joie s'arrête dans un lieu délicieux pour danser et chanter ; mais c'est seulement suspendre l'action du poème au moment le plus intéressant : car ce ne sont ni les amours d'Angélique et de Médor, ni leur éloge, qui font le sujet de la scène. Eh que nous font tous les froids couplets qu'on chante à cette occasion ? c'est le malheur de Roland et la manière naturelle et naïve dont il en est instruit, qui font le charme et l'intérêt de cette situation vraiment admirable.
Je me suis étendu exprès sur le ballet le plus heureusement placé qu'il y ait sur le théâtre lyrique en France, et l'on voit à quoi le goût et le bon sens réduisent ce ballet. Que feront-ils donc de ceux que le poète amène à tout propos ; et si leur voix est jamais écoutée sur ce théâtre, sera-t-il permis à un héros de l'opéra de prouver à sa maîtresse l'excès de ses feux par une troupe de gens qui danseront autour d'elle ?
Mais l'idée d'associer dans le même spectacle deux manières d'imiter la nature, ne serait-elle pas essentiellement opposée au bon sens et au vrai goût ? Ne serait-ce pas là une barbarie digne de ces temps gothiques où le devant d'un tableau était exécuté en relief, où l'on barbouillait une belle statue pour lui faire des yeux noirs ou des cheveux châtains ? Serait-il permis de confondre deux hypothèses différentes dans le même poème, et de le faire exécuter moitié par des gens qui disent qu'ils ne savent parler qu'en chantant, moitié par d'autres qui prétendent n'avoir d'autre langage que celui du geste et des mouvements ?
Pour exécuter ce spectacle avec succès, ne faudrait-il pas du-moins avoir des acteurs également habiles dans les deux arts, aussi bons danseurs qu'excellents chanteurs ? Comment serait-il possible de supporter que les uns ne dansassent jamais, et que les autres ne chantassent jamais ? Serait-il bien agréable pour un Dieu de ne savoir pas danser le plus méchant couplet d'une chaconne, et d'être obligé de céder sa place à M. Vestris, qui n'est qualifié dans le programme que du titre de suivant, mais qui écrase son Dieu en un instant par la grâce et la noblesse de ses attitudes, tandis que celui-ci est relégué avec son rang suprême sur une banquette dans un coin du théâtre ?
Une exécution ou puérîle ou impossible, voilà un des moindres inconvénients de cette confusion de deux talents, de deux manières d'imiter, qu'on a osé regarder comme un avantage, et qui a certainement empêché les progrès de la danse en France.
A en juger par l'emploi continuel des ballets, on serait autorisé à croire que l'art de la danse est porté au plus haut degré de perfection sur le théâtre de l'opera français ; mais lorsqu'on considère que le ballet n'est employé à l'opéra français qu'à danser et non à imiter par la danse, on n'est plus surpris de la médiocrité où l'art de la danse est resté en France, et l'on conçoit qu'un français plein de talents et de vues (M. Noverre), a pu être dans le cas d'aller créer le ballet loin de sa patrie.
Il est vrai qu'en lisant les programmes des différents opéra, on y trouve une variété merveilleuse de fêtes et de divertissements ; mais cette variété fait place dans l'exécution à la plus triste uniformité. Toutes les fêtes se réduisent à danser pour danser ; tous les ballets sont composés de deux files de danseurs et de danseuses qui se rangent de chaque côté du théâtre, et qui se mêlant ensuite, forment des figures et des grouppes sans aucune idée. Les meilleurs danseurs cependant sont réservés pour danser tantôt seuls, tantôt deux ; dans les grandes occasions ils forment des pas de trois, de quatre, et même de cinq ou de six, après quoi le corps du ballet qui s'est arrêté pour laisser la place à ses maîtres, reprend ses danses jusqu'à la fin du ballet. Pour tous ces différents divertissements, le musicien fournit des chaconnes, des loures, des sarabandes, des menuets, des passe-piés, des gavottes, des rigaudons, des contredanses. S'il y a quelquefois dans un ballet une idée, un instant d'action, c'est un pas de deux ou de trois qui l'exécute, après quoi le corps du ballet reprend incontinent sa danse insipide. La seule différence réelle qu'il y a d'une fête à une autre, se réduit à celle que le tailleur de l'opéra y met, en habillant le ballet tantôt en blanc, tantôt en verd, tantôt en jaune, tantôt en rouge, suivant les principes et l'étiquette du magasin.
Le ballet n'est donc proprement dans l'opéra français qu'une académie de danse, où sous les yeux du public les sujets médiocres s'exercent à figurer, à se rompre, à se reformer, et les grands danseurs à nous montrer des études plus difficiles dans différentes attitudes nobles, gracieuses et savantes. Le poète donne à ces exercices académiques cinq ou six noms différents dans le cours de son poème ; il fait donner à ses danseurs tantôt des bas blancs, tantôt des bas rouges, tantôt des perruques blondes, tantôt des perruques noires ; mais l'homme de goût n'aperçoit d'ailleurs aucune diversité dans ces ballets, et ne peut que regretter que tant d'habiles danseurs ne soient employés qu'à faire sur un théâtre des pas et des tours de salle.
C'est en effet avoir méconnu trop longtemps l'usage de l'art qui agit sur nos sens avec le plus d'empire, et qui produit les impressions les plus profondes et les plus terribles. Que dirions-nous d'une académie de peintres et de statuaires qui dans une exposition publique de leurs ouvrages ne nous montreraient que des études, des têtes, des bras, des jambes, des attitudes, sans idée, sans application, sans imitation précise ? Toutes ces choses ont sans doute du prix aux yeux d'un connaisseur éclairé ; mais un salon d'exposition est autre chose qu'un atelier.
Il en est de la danse comme du chant : la joie doit avoir créé les premières danses comme elle a inspiré les premiers chants ; mais un menuet, une contredanse, et toute la danse récréative d'un bal, sont précisément aussi déplacés sur le théâtre que la chanson et le couplet. Ce n'est que lorsque l'homme de génie s'est aperçu qu'on pouvait faire de la danse un art d'imitation propre à exprimer sans autre langue que celle du geste et des mouvements tous les sentiments et toutes les passions, ce n'est qu'alors que la danse est devenue digne de se montrer sur la scène ; il est vrai que ce spectacle est celui de tous qui a fait le moins de progrès parmi les modernes ; et si nous en avons Ve quelques essais en Italie, en Angleterre, en Allemagne, il faut convenir qu'il est encore loin de ces effets prodigieux des pantomimes dont l'histoire ancienne nous a conservé la mémoire.
Le spectacle en danse a besoin d'un poète, d'un musicien, et d'un maître de ballets. Son hypothèse est d'imiter la nature par le geste et par la pantomime, sans autre discours, sans autre accent que celui que la musique instrumentale fournira à l'interprétation de ses mouvements. Le poème dansé, ou ballet, doit être suivi, noué, dénoué, comme le poème lyrique. Il exige encore plus que lui la rapidité de l'action et une grande variété de situations. Comme le discours ne peut être exprimé dans ce drame que par le geste, rien n'y serait plus déplacé que des scènes de raisonnement et de conversation, et le dialogue en général n'y peut être employé, soit dans la tragédie, soit dans la comédie, qu'autant qu'il sert indispensablement de passage et de préparation aux grands tableaux et aux situations intéressantes.
Toute la poétique du poème lyrique s'applique naturellement et d'elle-même au poème ballet. Comme rien n'est moins naturel qu'un opéra où l'on chante d'un bout à l'autre, rien aussi ne serait plus faux qu'un ballet où l'on danserait toujours. Le créateur du poème ballet a dû connaître et distinguer dans la nature le moment tranquille et le moment passionné, celui de la scène et celui de l'air. Il a dû chercher deux manières distinctes pour exprimer deux moments si différents, et partager son poème entre la marche et la danse, comme le musicien partage le sien entre le récitatif et l'air.
Suivant ces principes, les personnages du poème ballet ne danseront qu'au moment de la passion, parce que ce moment est réellement dans la nature celui des mouvements violents et rapides. Le reste de l'action ne sera exécuté que par des gestes simples, par une marche cadencée, plus marquée, plus poétique, que la démarche ordinaire dont il n'y aurait pas moyen de passer naturellement et avec vérité au moment de la danse.
Ce moment tiendra dans le poème ballet la place que l'air occupe dans le poème lyrique ; mais l'on jugera aisément que ce moment ne peut être employé à danser des menuets, des gavottes ou des couplets de chaconne. Tous ces airs de danse ne signifient rien, n'imitent rien, n'expriment rien. L'air du moment de la danse dont le poète aura indiqué le sujet et la situation, sera de la part du musicien le développement de la passion et de tous ses mouvements. Le maître des ballets et le danseur intelligent, s'ils entendent cette langue, comme la profession de leur art l'exige, trouveront dans l'air du musicien tous leurs gestes notés avec la succession et les nuances de tous les mouvements.
Lorsque le poète aura créé un tel poème, et que le spectacle en danse aura acquis le degré de perfection dont il est susceptible, un grand compositeur ne dédaignera plus de mettre le poème ballet en musique, parce que ce ne sera plus un recueil de jolis menuets et d'autres petits airs de danse, plus dignes de la guinguette que du théâtre, et qu'on abandonne en Italie et en Allemagne avec raison au premier petit violon de l'orchestre. Cette suite de grandes et belles situations, puisée dans le sujet d'une action unique, et terminée par une catastrophe convenable, ouvrira au contraire au compositeur une vaste et brillante carrière, où il pourra déployer ses talents, et concourir à l'effet du spectacle le plus noble et le plus intéressant qu'on puisse offrir à une nation passionnée pour les beaux arts.
Le maître des ballets et le danseur sentiront de leur côté que l'exécution de ce poème demande autre chose que des pirouettes et des gargouillades ; que des attitudes fortes ou gracieuses, des à-plombs et tout le détail des exercices académiques et des tours de salle, n'ont de prix sur le théâtre qu'autant qu'ils sont placés à-propos, avec goût et avec intelligence, qu'ils servent à l'expression d'une situation touchante, d'une action intéressante et pathétique, et qu'on aperçoit dans le danseur, indépendamment de cette science, une étude profonde de la nature et de la vérité de ses mouvements.
Ce qui vient d'être dit ne contient que les premiers éléments d'une poétique de la danse, mais qui mériteraient pour les progrès d'un art bien peu perfectionné, d'être développés avec plus de soin et dans un plus grand détail. Les lettres pleines de chaleur et de vues que M. Noverre a publiées sur la danse, il y a quelques années, paraissent lui imposer le devoir d'écrire cette poétique, et de rendre à son art l'empire qui lui est dû et qu'il a exercé chez les anciens par la magie et l'enthousiasme de son langage.
De l'exécution du poème lyrique. La réunion du chant et de la danse dans le même poème ne serait point impossible, et serait peut-être une chose désirable ; mais cette association serait bien différente de celle qu'on a imaginée dans l'opéra français, et que le bon goût semble proscrire.
Le chant est un art si difficile, il demande tant d'application et d'étude, qu'il ne faut pas espérer qu'un grand chanteur puisse aussi être grand acteur. Ce cas serait du-moins trop rare pour n'être pas regardé comme une exception. L'exécution du chant et l'expression qu'il exige occupent déjà trop un chanteur pour lui permettre de donner le même soin à l'action. Très-souvent les mouvements que la situation demande, sont si violents, qu'ils ne permettraient guère de chanter avec grâce, ni même avec la force nécessaire ; et je crois impossible qu'au dernier période de la passion, le même acteur puisse chanter avec la chaleur et l'enthousiasme qu'il exige, et s'abandonner en même temps au délire et au plus grand désordre de la passion, sans que la précision de son chant en souffre.
D'un autre côté, en réfléchissant sur le génie de l'air ou aria des Italiens, on voit évidemment qu'il est dans son principe autant destiné à l'expression du geste qu'à celle du chant, et un pantomime intelligent trouvera dans la partie instrumentale de l'air tous ses gestes, toute la succession de ses mouvements notés avec la plus grande finesse. La musique a encore sur ce point merveilleusement suivi la nature. Car la passion n'élève pas seulement la voix, ne varie pas seulement les inflexions ; elle met la même variété et la même chaleur aussi dans le geste et dans les mouvements : ainsi le moment de la passion doit être en effet la réunion de ces deux expressions. Comment les rendrons-nous donc sur nos théâtres, sans que l'une souffre par l'autre ?
Les plus grandes découvertes sont toujours l'ouvrage du hasard. A Rome, Andronicus, fameux acteur, c'est-à-dire chanteur et pantomime à-la-fais, est enroué un jour à force de bis ; revocatus obtudit vocem. Le public ne veut pas se passer d'un acteur chéri : Andronicus continue donc les jours suivants de danser la pantomime, agit canticum ; mais comme son enrouement ne lui permet pas de chanter, il place un enfant devant le fluteur ou l'orchestre, et cet enfant chante pour lui : puerum ante tibicinem statuit ad canendum.
Cet expédient plait au peuple. Andronicus dispensé par un accident de chanter, s'abandonne avec plus de chaleur au geste et à la pantomime ; et depuis ce moment l'opéra, canticum, est exécuté par deux sortes d'acteurs qui représentent un même sujet en même temps, sur les mêmes airs, sur les mêmes mesures, sur la même scène, les uns par le chant, les autres par la danse ou pantomime. L'historien, ou le pantomime ne chante plus que de la main, histrionibus fabularum actus relinquitur ; et le chanteur ne joue plus que de la voix. La voix d'accord avec la flute explique en chantant le sujet, tandis que la danse d'accord avec la mesure du chant, l'exécute en gesticulant. Ad manum cantatur.... Diverbia voci relicta. Voyez Tite-Live.
Ce que le hasard établit jadis sur le théâtre de Rome, une imitation réfléchie devrait nous le faire adopter dans l'exécution de notre poème lyrique. Par ce moyen nos castrats qui sont ordinairement des chanteurs si excellents, et des acteurs si médiocres, ne seraient plus que des instruments parlans placés dans l'orchestre et le plus près de la scène qu'il serait possible. Ils exécuteraient la partie du chant avec une supériorité dont rien ne pourrait les distraire, tandis qu'un habîle pantomime exécuterait la partie de l'action avec la même chaleur et la même expression.
Plus on pénétrera l'esprit du poème lyrique, plus on sera engoué de cette idée. L'opéra ainsi exécuté ne serait plus restreint à ne charmer qu'un petit nombre d'hommes excessivement sensibles et qui entendent le langage de la musique. Le plus ignorant d'entre le peuple serait aussi avancé que le plus grand connaisseur, parce que le pantomime aurait soin de lui traduire la musique mot pour mot, et de rendre intelligible à ses yeux ce qu'il n'a pu entendre de ses oreilles.
Cette manière d'exécuter le poème lyrique rendrait aussi au poète et au compositeur l'empire que le chanteur et l'entrepreneur ont usurpé sur eux. Tout ce qui ne tient pas au fond du sujet ne serait plus supportable sur ce théâtre. Tout le style figuré et épique disparoitrait des ouvrages dramatiques : car quel geste le pantomime trouverait-il pour l'expression de telles paroles et de tels airs ? et comment nous ferait-il sentir, sans devenir ridicule, qu'il ressemble à un coursier indompté et fier, ou qu'il se compare à un vaisseau battu par la tempête ? Les situations les plus pathétiques ne seraient plus énervées par des épisodes froids et subalternes. Le poète, peu embarrassé de la durée du spectacle et du nombre des acteurs, conduirait son sujet par une intrigue simple, forte et rapide à la catastrophe que l'histoire ou la nature des choses aurait indiquée. Je ne sais combien d'actes, combien de décorations, combien d'acteurs il faudrait pour l'opéra d'Andromaque ou de Didon ainsi construit et exécuté ; mais je sais que ces sujets dépouillés de tout ce qui les défigure et les énerve, feraient les impressions les plus profondes et les plus terribles. Le musicien n'aurait rien changé à son faire ; le poète aurait rapproché le sien de la simplicité et de la force du théâtre d'Athènes, et la représentation théâtrale aurait acquis une vérité et un charme dont il serait téméraire de marquer les effets et les bornes.
Supposé que la durée d'un drame ainsi serré ne remplisse pas le temps consacré au spectacle, rien n'empêcherait d'imiter encore l'usage d'Athènes en représentant plus d'une pièce. Le poème lyrique chanté et dansé serait suivi du poème-ballet : celui-ci seul serait peut-être propre à représenter quelques instants d'un merveilleux visible.
Mais le sort de l'homme veut que sa petitesse paraisse toujours à côté de ses plus sublimes efforts de génie ; et nous mettons dans les affaires les plus sérieuses tant de négligence et d'inconséquence, qu'il ne faut pas nous croire capables de l'obstination et de la persévérance nécessaires à la perfection d'un simple art d'amusement. Et le sort des empires, et le sort des théâtres sont l'ouvrage du hasard : tout dépend de ce concours de circonstances qu'un heureux ou un mauvais hasard rassemble. Qu'il paraisse quelque part en Europe un grand prince ; et après avoir acquis par ses travaux le droit de consacrer un glorieux loisir à la culture des Beaux-Arts, qu'il porte ses vues sur le plus beau de tous, et l'art dramatique deviendra sous son règne le plus grand monument érigé à la félicité publique et à la gloire du génie de l'homme.
Les Italiens ont un poème lyrique qu'ils appellent oratorio ; ce sont des drames dont le sujet est tiré de nos livres sacrés. On les a quelquefois joués sur des théâtres élevés dans les églises ; mais ces exemples sont rares, et communément on ne fait aucun usage de ces pièces. Il est étonnant que la puissance spirituelle, qui favorise si fort en Italie les pompes religieuses, n'ait pas secondé la Poésie et la Musique dans le dessein de se consacrer à la Religion. De tels spectacles auraient pu devenir très-augustes et très-intéressants dans la célébration des solennités de l'Eglise.
Il ne serait pas singulier qu'un homme de goût fit plus de cas des oratorio de Metastasio, que de ses opéra les plus célèbres. On s'aperçoit bien que le poète n'y a pas été assujetti à une foule de lois arbitraires et absurdes, qui n'ont tendu qu'à le gêner et qu'à défigurer le poème lyrique.
Le compositeur pourrait se permettre dans l'oratorio un style plus élevé, plus figuré que celui de l'opéra. La religion qui rend ce drame sacré, semble aussi autoriser le musicien d'éloigner ses personnages un peu plus de la nature par des accens moins familiers à l'homme, et par une plus forte poésie. Cet article est de M. GRIMM.
POEME PHILOSOPHIQUE, (Poésie didactique) espèce de poème didactique dans lequel on emprunte le langage de la Poésie, pour traiter par principes des sujets de morale, de physique ou de métaphysique. On y raisonne, on y cite des autorités, des exemples, on tire des conséquences. Tel est l'ouvrage de Lucrèce parmi les anciens, celui de Pope parmi les modernes.
Le poème philosophique doit tendre sur toutes choses à la lumière, parce que le but des sciences est d'éclairer. Ainsi la méthode doit y être plus sensible que dans les autres poèmes didactiques et dans les poèmes de pure fiction. Ceux-là échauffent le cœur, ceux-ci éclairent l'esprit ou dirigent ses facultés. Il est donc moins permis d'y jeter des digressions qui empêchent de suivre le fil du raisonnement. Par la même raison, on s'attachera moins à y mettre des figures vives et poétiques, à moins qu'elles ne concourent à la clarté en donnant du corps aux pensées ; car autrement, il y aurait de la petitesse à sacrifier la netteté et la précision à l'éclat d'un beau mot ; aussi Lucrèce suit-il constamment son objet. On ne le voit point au milieu d'un raisonnement, s'égarer dans des descriptions inutiles à son but. Il en a quelques-unes dont la matière pourrait se passer ; mais il les place tellement, soit devant, soit après ses arguments, qu'elles servent, ou à préparer l'esprit à ce qu'il Ve dire, ou à le délasser, après lui avoir fait faire des efforts. Princip. de littérat. (D.J.)
POEME EN PROSE, (Belles Lettres) genre d'ouvrage où l'on retrouve la fiction et le style de la poésie, et qui par-là sont de vrais poèmes, à la mesure et à la rime près ; c'est une invention fort heureuse. Nous avons obligation à la poésie en prose de quelques ouvrages remplis d'aventures vraisemblables, et merveilleuses à la fais, comme de préceptes sages et praticables en même temps, qui n'auraient peut-être jamais Ve le jour, s'il eut fallu que les auteurs eussent assujetti leur génie à la rime et à la mesure. L'estimable auteur de Télémaque ne nous aurait jamais donné cet ouvrage enchanteur, s'il avait dû l'écrire en vers ; il est de beaux poèmes sans vers, comme de beaux tableaux sans le plus riche coloris. (D.J.)
POEME SECULAIRE, (Belles Lettres) carmen seculare, nom que donnaient les Romains à une espèce d'hymne qu'on chantait ou qu'on récitait aux jeux que l'on célébrait à la fin de chaque siècle de la fondation de Rome, qu'on appelait pour cela jeux séculaires. Voyez JEUX SECULAIRES.
On trouve un poème de cette espèce dans les ouvrages d'Horace, c'est une ode en vers saphiques qu'on trouve ordinairement à la fin de ses épodes, et qu'il composa par l'ordre d'Auguste l'an 737 de Rome, selon le père Jouvency. Il parait par cette pièce que le poème séculaire était ordinairement chanté par deux chœurs, l'un de jeunes garçons, et l'autre de jeunes filles. C'est peut-être par la même raison, que quelques commentateurs de ce poète ont regardé comme un poème séculaire la vingt-unième ode de son premier livre, parce qu'elle commence par ces vers :
Dianam tenerae dicite virgines,
Intonsum pueri dicite Cynthium.
Mais la dernière strophe prouve que ce n'était qu'un de ces cantiques qu'on adressait à ces divinités dans les calamités publiques, ou pour les prier de détourner des fléaux funestes, lorsque le peuple faisait des vœux dans les temples de toutes les divinités adorées à Rome, ce qu'on appelait supplicare ad omnia pulvinaria deorum.