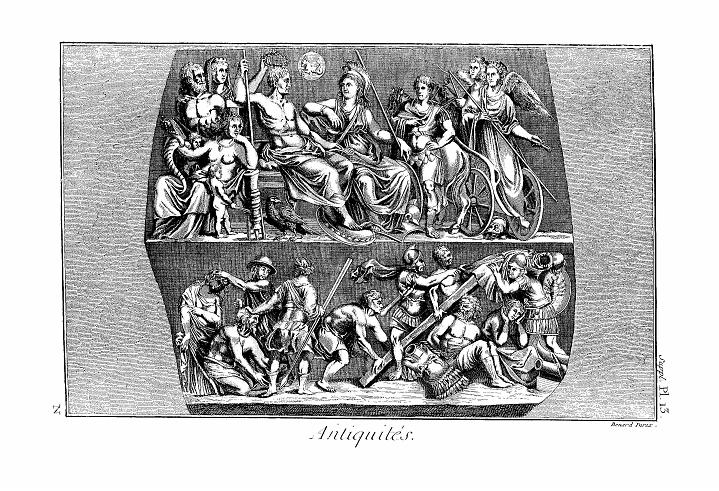S. m. (Histoire ancienne et moderne) sectateur de la religion judaïque.
Cette religion, dit l'auteur des lettres persanes, est un vieux tronc qui a produit deux branches, le Christianisme et le Mahométisme, qui ont couvert toute la terre : ou plutôt, ajoute-t-il, c'est une mère de deux filles qui l'ont accablée de mille plaies. Mais quelques mauvais traitements qu'elle en ait reçus, elle ne laisse pas de se glorifier de leur avoir donné la naissance. Elle se sert de l'une et de l'autre pour embrasser le monde, tandis que sa vieillesse vénérable embrasse tous les temps.
Josephe, Basnage et Prideaux ont épuisé l'histoire du peuple qui se tient si constamment dévoué à cette vieille religion, et qui marque si clairement le berceau, l'âge et les progrès de la nôtre.
Pour ne point ennuyer le lecteur de détails qu'il trouve dans tant de livres, concernant le peuple dont il s'agit ici, nous nous bornerons à quelques remarques moins communes sur son nombre, sa dispersion par tout l'univers, et son attachement inviolable à la loi mosaïque au milieu de l'opprobre et des véxations.
Quand l'on pense aux horreurs que les Juifs ont éprouvé depuis J. C. au carnage qui s'en fit sous quelques empereurs romains, et à ceux qui ont été répétés tant de fois dans tous les états chrétiens, on conçoit avec étonnement que ce peuple subsiste encore ; cependant non seulement il subsiste, mais, selon les apparences, il n'est pas moins nombreux aujourd'hui qu'il l'était autrefois dans le pays de Canaan. On n'en doutera point, si après avoir calculé le nombre des Juifs qui sont répandus dans l'occident, on y joint les prodigieux essaims de ceux qui pullulent en Orient, à la Chine, entre la plupart des nations de l'Europe et l'Afrique, dans les Indes orientales et occidentales, et même dans les parties intérieures de l'Amérique.
Leur ferme attachement à la loi de Moïse n'est pas moins remarquable, surtout si l'on considère leurs fréquentes apostasies, lorsqu'ils vivaient sous le gouvernement de leurs rais, de leurs juges, et à l'aspect de leurs temples. Le Judaïsme est maintenant, de toutes les religions du monde, celle qui est le plus rarement abjurée ; et c'est en partie le fruit des persécutions qu'elle a souffertes. Ses sectateurs, martyrs perpétuels de leur croyance, se sont regardés de plus en plus comme la source de toute sainteté, et ne nous ont envisagés que comme des Juifs rebelles qui ont changé la loi de Dieu, en suppliciant ceux qui la tenaient de sa propre main.
Leur nombre doit être naturellement attribué à leur exemption de porter les armes, à leur ardeur pour le mariage, à leur coutume de le contracter de bonne heure dans leurs familles, à leur loi de divorce, à leur genre de vie sobre et réglée, à leurs abstinences, à leur travail, et à leur exercice.
Leur dispersion ne se comprend pas moins aisément. Si, pendant que Jérusalem subsistait avec son temple, les Juifs ont été quelquefois chassés de leur patrie par les vicissitudes des Empires, ils l'ont encore été plus souvent par un zèle aveugle de tous les pays où ils se sont habitués depuis les progrès du Christianisme et du Mahométisme. Réduits à courir de terres en terres, de mers en mers, pour gagner leur vie, par-tout déclarés incapables de posséder aucun bien-fonds, et d'avoir aucun emploi, ils se sont vus obligés de se disperser de lieux en lieux, et de ne pouvoir s'établir fixement dans aucune contrée, faute d'appui, de puissance pour s'y maintenir, et de lumières dans l'art militaire.
Cette dispersion n'aurait pas manqué de ruiner le culte religieux de toute autre nation ; mais celui des Juifs s'est soutenu par la nature et la force de ses lais. Elles leur prescrivent de vivre ensemble autant qu'il est possible, dans un même corps, ou du moins dans une même enceinte, de ne point s'allier aux étrangers, de se marier entr'eux, de ne manger de la chair que des bêtes dont ils ont répandu le sang, ou préparées à leur manière. Ces ordonnances, et autres semblables, les lient plus étroitement, les fortifient dans leur croyance, les séparent des autres hommes, et ne leur laissent, pour subsister, de ressources que le commerce, profession longtemps méprisée par la plupart des peuples de l'Europe.
De-là vient qu'on la leur abandonna dans les siécles barbares ; et comme ils s'y enrichirent nécessairement, on les traita d'infames usuriers. Les rois ne pouvant fouiller dans la bourse de leurs sujets, mirent à la torture les Juifs, qu'ils ne regardaient pas comme des citoyens. Ce qui se passe en Angleterre à leur égard, peut donner une idée de ce qu'on exécuta contr'eux dans les autres pays. Le roi Jean ayant besoin d'argent, fit emprisonner les riches Juifs de son royaume pour en extorquer de leurs mains ; il y en eut peu qui échappèrent aux poursuites de sa chambre de justice. Un d'eux, à qui on arracha sept dents l'une après l'autre pour avoir son bien, donna mille marcs d'argent à la huitième. Henri III. tira d'Aaron, juif d'Iorck, quatorze mille marcs d'argent, et dix mille pour la reine. Il vendit les autres Juifs de son pays à Richard son frère pour un certain nombre d'années, ut quos rex excoriaverat, comes evisceraret, dit Matthieu Paris.
On n'oublia pas d'employer en France les mêmes traitements contre les Juifs ; on les mettait en prison, on les pillait, on les vendait, on les accusait de magie, de sacrifier des enfants, d'empoisonner les fontaines ; on les chassait du royaume, on les y laissait rentrer pour de l'argent ; et dans le temps même qu'on les tolérait, on les distinguait des autres habitants par des marques infamantes.
Il y a plus, la coutume s'introduisit dans ce royaume, de confisquer tous les biens des Juifs qui embrassaient le Christianisme. Cette coutume si bizarre, nous la savons par la loi qui l'abroge ; c'est l'édit du roi donné à Basville le 4 Avril 1392. La vraie raison de cette confiscation, que l'auteur de l'esprit des lois a si bien développée, était une espèce de droit d'amortissement pour le prince, ou pour les seigneurs, des taxes qu'ils levaient sur les Juifs, comme serfs main-mortables, auxquels ils succédaient. Or ils étaient privés de ce bénéfice, lorsque ceux-ci embrassaient le Christianisme.
En un mot, on ne peut dire combien, en tout lieu, on s'est joué de cette nation d'un siècle à l'autre. On a confisqué leurs biens, lorsqu'ils recevaient le Christianisme ; et bien-tôt après on les a fait bruler, lorsqu'ils ne voulurent pas le recevoir.
Enfin, proscrits sans-cesse de chaque pays, ils trouvèrent ingénieusement le moyen de sauver leurs fortunes, et de rendre pour jamais leurs retraites assurées. Bannis de France sous Philippe le Long en 1318, ils se réfugièrent en Lombardie, y donnèrent aux négociants des lettres sur ceux à qui ils avaient confié leurs effets en partant, et ces lettres furent acquittées. L'invention admirable des lettres de change sortit du sein du désespoir ; et pour lors seulement le commerce put éluder la violence, et se maintenir par tout le monde.
Depuis ce temps-là, les princes ont ouvert les yeux sur leurs propres intérêts, et ont traité les Juifs avec plus de modération. On a senti, dans quelques endroits du nord et du midi, qu'on ne pouvait se passer de leur secours. Mais, sans parler du Grand-Duc de Toscane, la Hollande et l'Angleterre animées de plus nobles principes, leur ont accordé toutes les douceurs possibles, sous la protection invariable de leur gouvernement. Ainsi répandus de nos jours avec plus de sûreté qu'ils n'en avaient encore eu dans tous les pays de l'Europe où règne le commerce, ils sont devenus des instruments par le moyen desquels les nations les plus éloignées peuvent converser et correspondre ensemble. Il en est d'eux, comme des chevilles et des cloux qu'on emploie dans un grand édifice, et qui sont nécessaires pour en joindre toutes les parties. On s'est fort mal trouvé en Espagne de les avoir chassés, ainsi qu'en France d'avoir persécuté des sujets dont la croyance différait en quelques points de celle du prince. L'amour de la religion chrétienne consiste dans sa pratique ; et cette pratique ne respire que douceur, qu'humanité, que charité. (D.J.)
* JUIFS, Philosophie des, (Histoire, Philosophie) Nous ne connaissons point de nation plus ancienne que la juive. Outre son antiquité, elle a sur les autres une seconde prérogative qui n'est pas moins importante ; c'est de n'avoir point passé par le polithéisme, et la suite des superstitions naturelles et générales pour arriver à l'unité de Dieu. La révélation et la prophétie ont été les deux premières sources de la connaissance de ses sages. Dieu se plut à s'entrenir avec Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse et ses successeurs. La longue vie qui fut accordée à la plupart d'entr'eux, ajouta beaucoup à leur expérience. Le loisir de l'état de pâtres qu'ils avaient embrassé, était très-favorable à la méditation et à l'observation de la nature. Chefs de familles nombreuses, ils étaient très-versés dans tout ce qui tient à l'économie rustique et domestique, et au gouvernement paternel. A l'extinction du patriarchat, on voit paraitre parmi eux un Moïse, un David, un Salomon, un Daniel, hommes d'une intelligence peu commune, et à qui l'on ne refusera pas le titre de grands législateurs. Qu'ont su les philosophes de la Grèce, les Hiérophantes de l'Egypte, et les Gymnosophistes de l'Inde qui les élève au-dessus des prophêtes ?
Noé construit l'arche, sépare les animaux purs des animaux impurs, se pourvait des substances propres à la nourriture d'une infinité d'espèces différentes, plante la vigne, en exprime le vin, et prédit à ses enfants leur destinée.
Sans ajouter foi aux rêveries que les payens et les Juifs ont débitées sur le compte de Sem et de Cham, ce que l'histoire nous en apprend suffit pour nous les rendre respectables ; mais quels hommes nous offre-t-elle qui soient comparables en autorité, en dignité, en jugement, en piété, en innocence, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph se fit admirer par sa sagesse chez le peuple le plus instruit de la terre, et le gouverna pendant quarante ans.
Mais nous voilà parvenus au temps de Moïse ; quel historien ! quel législateur ! quel philosophe ! quel poète ! quel homme !
La sagesse de Salomon a passé en proverbe. Il écrivit une multitude incroyable de paraboles ; il connut depuis le cedre qui croit sur le Liban, jusqu'à l'hyssope ; il connut et les oiseaux, et les poissons, et les quadrupedes, et les reptiles ; et l'on accourait de toutes les contrées de la terre pour le voir, l'entendre et l'admirer.
Abraham, Moïse, Salomon, Job, Daniel, et tous les sages qui se sont montrés chez la nation Juive avant la captivité de Babylone, nous fourniraient une ample matière, si leur histoire n'appartenait plutôt à la révélation qu'à la philosophie.
Passons maintenant à l'histoire des Juifs, au sortir de la captivité de Babylone, à ces temps où ils ont quitté le nom d'Israélites et d'Hébreux, pour prendre celui de Juifs.
De la philosophie des Juifs depuis le retour de la captivité de Babylone, jusqu'à la ruine de Jérusalem. Personne n'ignore que les Juifs n'ont jamais passé pour un peuple savant. Il est certain qu'ils n'avaient aucune teinture des sciences exactes, et qu'ils se trompaient grossièrement sur tous les articles qui en dépendent. Pour ce qui regarde la Physique, et le détail immense qui lui appartient, il n'est pas moins constant qu'ils n'en avaient aucune connaissance, non plus que des diverses parties de l'Histoire naturelle. Il faut donc donner ici au mot philosophie une signification plus étendue que celle qu'il a ordinairement. En effet il manquerait quelque chose à l'histoire de cette science, si elle était privée du détail des opinions et de la doctrine de ce peuple, détail qui jette un grand jour sur la philosophie des peuples avec lesquels ils ont été liés.
Pour traiter cette matière avec toute la clarté possible, il faut distinguer exactement les lieux où les Juifs ont fixé leur demeure, et les temps où se sont faites ces transmigrations : ces deux choses ont entrainé un grand changement dans leurs opinions. Il y a surtout deux époques remarquables ; la première est le schisme des Samaritains qui commença longtemps avant Esdras, et qui éclata avec fureur après sa mort ; la seconde remonte jusqu'au temps où Alexandre transporta en Egypte une nombreuse colonie de Juifs qui y jouirent d'une grande considération. Nous ne parlerons ici de ces deux époques qu'autant qu'il sera nécessaire pour expliquer les nouveaux dogmes qu'elles introduisirent chez les Hébreux.
Histoire des Samaritains. L'Ecriture-sainte nous apprend (ij. Reg. 15.) qu'environ deux cent ans avant qu'Esdras vit le jour, Salmanazar roi des Assyriens, ayant emmené en captivité les dix tribus d'Israèl, avait fait passer dans le pays de Samarie de nouveaux habitants, tirés partie des campagnes voisines de Babylone, partie d'Avach, d'Emath, de Sepharvaïm et de Cutha ; ce qui leur fit donner le nom de Cuthéens si odieux aux Juifs. Ces différents peuples emportèrent avec eux leurs anciennes divinités, et établirent chacun leur superstition particulière dans les villes de Samarie qui leur échurent en partage. Ici l'on adorait Sochotbenoth ; c'était le dieu des habitants de la campagne de Babylone ; là on rendait les honneurs divins à Nergel ; c'était celui des Cuthéens. La colonie d'Emach honorait Asima ; les Hevéens, Nebahaz et Tharthac. Pour les dieux des habitants de Sepharvaïm, nommés Advamelech et Anamelech, ils ressemblaient assez au dieu Moloch, adoré par les anciens Chananéens ; ils en avaient du moins la cruauté, et ils exigeaient aussi les enfants pour victimes. On voyait aussi les pères insensés les jeter au milieu des flammes en l'honneur de leur idole. Le vrai Dieu était le seul qu'on ne connut point dans un pays consacré par tant de marques éclatantes de son pouvoir. Il déchaina les lions du pays contre les idolâtres qui le profanaient. Ce fléau si violent et si subit portait tant de marques d'un chatiment du ciel, que l'infidélité même fut obligée d'en convenir. On en fit avertir le roi d'Assyrie : on lui représenta que les nations qu'il avait transférées en Israèl, n'avaient aucune connaissance du dieu de Samarie, et de la manière dont il voulait être honoré. Que ce Dieu irrité les persécutait sans ménagement ; qu'il rassemblait les lions de toutes les forêts, qu'il les envoyait dans les campagnes et jusques dans les villes ; et que s'ils n'apprenaient à apaiser ce Dieu vangeur qui les poursuivait, ils seraient obligés de déserter, ou qu'ils périraient tous. Salmanazar touché de ces remontrances, fit chercher parmi les captifs un des anciens prêtres de Samarie, et il le renvoya en Israèl parmi les nouveaux habitants, pour leur apprendre à honorer le dieu du pays. Les leçons furent écoutées par les idolâtres, mais ils ne renoncèrent pas pour cela à leurs dieux ; au contraire chaque colonie se mit à forger sa divinité. Toutes les villes eurent leurs idoles ; les temples et les hauts lieux bâtis par les Israélites recouvrèrent leur ancienne et sacrilege célébrité. On y plaça des prêtres tirés de la plus vîle populace, qui furent chargés des cérémonies et du soin des sacrifices. Au milieu de ce bizarre appareil de superstition et d'idolatrie, on donna aussi sa place au véritable Dieu. On connut par les instructions du lévite d'Israèl, que ce Dieu souverain méritait un culte supérieur à celui qu'on rendait aux autres divinités ; mais soit la faute du maître, soit celle des disciples, on n'alla pas jusqu'à comprendre que le Dieu du ciel et de la terre ne pouvait souffrir ce monstrueux assemblage ; et que pour l'adorer véritablement, il fallait l'adorer seul. Ces impiétés rendirent les Samaritains extrémement odieux aux Juifs ; mais la haine des derniers augmenta, lorsqu'au retour de la captivité, ils s'aperçurent qu'ils n'avaient point de plus cruels ennemis que ces faux frères. Jaloux de voir rebâtir le temple qui leur reprochait leur ancienne séparation, ils mirent tout en œuvre pour l'empêcher. Ils se cachèrent à l'ombre de la religion, et assurant les Juifs qu'ils invoquaient le même Dieu qu'eux, ils leur offrirent leurs services pour l'accomplissement d'un ouvrage qu'ils voulaient ruiner. Les Juifs ajoutent à l'Histoire sainte, qu'Esdras et Jérémie assemblèrent trois cent prêtres, qui les excommunièrent de la grande excommunication : ils maudirent celui qui mangerait du pain avec eux, comme s'il avait mangé de la chair de pourceau. Cependant les Samaritains ne cessaient de cabaler à la cour de Darius pour empêcher les Juifs de rebâtir le temple ; et les gouverneurs de Syrie et de Phénicie ne cessaient de les seconder dans ce dessein. Le senat et le peuple de Jérusalem les voyant si animés contr'eux, députèrent vers Darius, Zorobabel et quatre autres des plus distingués, pour se plaindre des Samaritains. Le roi ayant entendu ces députés, leur fit donner des lettres par lesquelles il ordonnait aux principaux officiers de Samarie, de seconder les Juifs dans leur pieux dessein, et de prendre pour cet effet sur son trésor provenant des tributs de Samarie, tout ce dont les sacrificateurs de Jérusalem auraient besoin pour leurs sacrifices. (Josephe, Antiq. jud. lib. XI. cap. iv.)
La division se forma encore d'une manière plus éclatante sous l'empire d'Alexandre le Grand. L'auteur de la chronique des Samaritains (voyez Basnage, Hist. des Juifs, liv. III. chap. iij.) rapporte que ce prince passa par Samarie, où il fut reçu par le grand prêtre Ezéchias qui lui promit la victoire sur les Perses : Alexandre lui fit des présents, et les Samaritains profitèrent de ce commencement de faveur pour obtenir de grands privilèges. Ce fait est contredit par Josephe qui l'attribue aux Juifs, de sorte qu'il est fort difficîle de décider lequel des deux partis a raison ; et il n'est pas surprenant que les savants soient partagés sur ce sujet. Ce qu'il y a de certain c'est que les Samaritains jouirent de la faveur du roi, et qu'ils reformèrent leur doctrine pour se délivrer du reproche d'hérésie que leur faisaient les Juifs. Cependant la haine de ces derniers, loin de diminuer se tourna en rage : Hircan assiégea Samarie, et la rasa de fond en comble aussi-bien que son temple. Elle sortit de ses ruines par les soins d'Aulus Gabinius, gouverneur de la province, Herode l'embellit par des ouvrages publics ; et elle fut nommée Sébaste, en l'honneur d'Auguste.
Doctrine des Samaritains. Il y a beaucoup d'apparence que les auteurs qui ont écrit sur la religion des Samaritains, ont épousé un peu trop la haine violente que les Juifs avaient pour ce peuple : ce que les anciens rapportent du culte qu'ils rendaient à la divinité, prouve évidemment que leur doctrine a été peinte sous des couleurs trop noires : surtout on ne peut guère justifier saint Epiphane qui s'est trompé souvent sur leur chapitre. Il reproche (lib. XI. cap. 8.) aux Samaritains d'adorer les téraphins que Rachel avait emportés à Laban, et que Jacob enterra. Il soutient aussi qu'ils regardaient vers le Garizim en priant, comme Daniel à Babylone regardait vers le temple de Jérusalem. Mais soit que saint Epiphane ait emprunté certe histoire des Thalmudistes ou de quelques autres auteurs Juifs, elle est d'autant plus fausse dans son ouvrage, qu'il s'imaginait que le Garizim était éloigné de Samarie, et qu'on était obligé de tourner ses regards vers cette montagne, parce que la distance était trop grande pour y aller faire ses dévotions. On soutient encore que les Samaritains avaient l'image d'un pigeon, qu'ils adoraient comme un symbole des dieux, et qu'ils avaient emprunté ce culte des Assyriens, qui mettaient dans leurs étendarts une colombe en mémoire de Sémiramis, qui avait été nourrie par cet oiseau et changée en colombe, et à qui ils rendaient des honneurs divins. Les Cuthéens qui étaient de ce pays, purent retenir le culte de leur pays, et en conserver la mémoire pendant quelque temps ; car on ne déracine pas si facilement l'amour des objets sensibles dans la religion, et le peuple se les laisse rarement arracher.
Mais les Juifs sont outrés sur cette matière, comme sur tout ce qui regarde les Samaritains. Ils soutiennent qu'ils avaient élevé une statue avec la figure d'une colombe qu'ils adoraient ; mais ils n'en donnent point d'autres preuves que leur persuasion. J'en suis très-persuadé, dit un rabbin, et cette persuasion ne suffit pas sans raisons. D'ailleurs il faut remarquer, 1°. qu'aucun des anciens écrivains, ni profanes, ni sacrés, ni payens, ni ecclésiastiques, n'ont parlé de ce culte que les Samaritains rendaient à un oiseau ; ce silence général est une preuve de la calomnie des Juifs. 2°. Il faut remarquer encore que les Juifs n'ont osé l'insérer dans le Thalmud ; cette fable n'est point dans le texte, mais dans la glose. Il faut donc reconnaître que c'est un auteur beaucoup plus moderne qui a imaginé ce conte ; car le Thalmud ne fut composé que plusieurs siècles après la ruine de Jérusalem et de Samarie. 3°. On cite le rabbin Meir, et on lui attribue cette découverte de l'idolatrie des Samaritains ; mais le culte public rendu sur le Garizim par un peuple entier, n'est pas une de ces choses qu'on puisse cacher longtemps, ni découvrir par subtilité ou par hasard. D'ailleurs le rabbin Meir est un nom qu'on produit : il n'est resté de lui, ni témoignage, ni écrit, sur lequel on puisse appuyer cette conjecture.
S. Epiphane les accuse encore de nier la résurrection des corps : et c'est pour leur prouver cette vérité importante, qu'il leur allegue l'exemple de Sara, laquelle conçut dans un âge avancé, et celui de la verge d'Aaron qui reverdit ; mais il y a une si grande distance d'une verge qui fleurit, et d'une vieille qui a des enfants, à la réunion de nos cendres dispersées, et au rétablissement du corps humain pourri depuis plusieurs siècles, qu'on ne conçoit pas comment il pouvait lier ces idées, et en tirer une conséquence. Quoi qu'il en sait, l'accusation est fausse, car les Samaritains croyaient la resurrection. En effet on trouve dans leur chronique deux choses qui le prouvent évidemment ; car ils parlent d'un jour de récompense et de peine, ce qui, dans le style des Arabes, marque le jour de la resurrection générale, et du déluge de feu. D'ailleurs ils ont inséré dans leur chronique l'éloge de Moïse, que Josué composa après la mort de ce législateur ; et entre les louanges qu'il lui donne, il s'écrie qu'il est le seul qui ait ressuscité les morts. On ne sait comment l'auteur pouvait attribuer à Moïse la résurrection miraculeuse de quelques morts, puisque l'Ecriture ne le dit pas, et que les Juifs même sont en peine de prouver qu'il était le plus grand des prophêtes, parce qu'il n'a pas arrêté le soleil comme Josué, ni ressuscité les morts comme Elisée. Mais ce qui acheve de constater que les Samaritains croyaient la résurrection, c'est que Ménandre qui avait été samaritain, fondait toute sa philosophie sur ce dogme. On sait d'ailleurs, et saint Epiphane ne l'a point nié, que les Dosithéens qui formaient une secte de samaritains, en faisaient hautement profession. Il est vraisemblable que ce qui a donné occasion à cette erreur, c'est que les Saducéens qui niaient véritablement la résurrection, furent appelés par les Pharisiens Cuthim, c'est-à-dire hérétiques, ce qui les fit confondre avec les Samaritains.
Enfin Léontius (de sectis, cap. 8.) leur reproche de ne point reconnaître l'existence des anges. Il semblerait qu'il a confondu les Samaritains avec les Saducéens ; et on pourrait l'en convaincre par l'autorité de saint Epiphane, qui distinguait les Samaritains et les Saducéens par ce caractère, que les derniers ne croyaient ni les anges, ni les esprits ; mais on sait que ce saint a souvent confondu les sentiments des anciennes sectes. Le savant Reland (Diss. misc. part. II. p. 25.) pensait que les Samaritains entendaient par un ange, une vertu, un instrument dont la divinité se sert pour agir, ou quelqu'organe sensible qu'il emploie pour l'exécution de ses ordres : ou bien ils croyaient que les anges sont des vertus naturellement unies à la divinité, et qu'il fait sortir quand il lui plait : cela parait par le Pentateuque samaritain, dans lequel on substitue souvent Dieu aux anges, et les anges à Dieu.
On ne doit point oublier Simon le magicien dans l'histoire des Samaritains, puisqu'il était Samaritain lui-même, et qu'il dogmatisa chez eux pendant quelque temps : voici ce que nous avons trouvé de plus vraisemblable à son sujet.
Simon était natif de Gitthon dans la province de Samarie : il y a apparence qu'il suivit la coutume des asiatiques qui voyageaient souvent en Egypte pour y apprendre la philosophie. Ce fut là sans-doute qu'il s'instruisit dans la magie qu'on enseignait dans les écoles. Depuis étant revenu dans sa patrie, il se donna pour un grand personnage, abusa longtemps le peuple de ses prestiges, et tâcha de leur faire croire qu'il était le libérateur du genre humain. S Luc act. VIIIe IXe rapporte que les Samaritains se laissèrent effectivement enchanter par ses artifices : et qu'ils le nommèrent la grande vertu de Dieu ; mais on suppose sans fondement qu'ils regardaient Simon le magicien comme le messie. Saint Epiphane assure (éphiph. haeres. pag. 54.) que cet imposteur prêchait aux Samaritains qu'il était le père, et aux Juifs qu'il était le fils. Il en fait par-là un extravagant qui n'aurait trompé personne par la contradiction qui ne pouvait être ignorée dans une si petite distance de lieu. En effet Simon adoré des Samaritains, ne pouvait être le docteur des Juifs : enfin prêcher aux Juifs qu'il était le fils, c'était les soulever contre lui, comme ils s'étaient soulevés contre J. C. lorsqu'il avait pris le titre de fils de Dieu. Il n'est pas même vraisemblable qu'il se regardât comme le messie, 1°. parce que l'historien sacré ne l'accuse que de magie, et c'était par-là qu'il avait séduit les Samaritains : 2°, parce que les Samaritains l'appelaient seulement la vertu de Dieu, la grande. Simon abusa dans la suite de ce titre qui lui avait été donné, et il y attacha des idées qu'on n'avait pas eues au commencement ; mais il ne prenait pas lui-même ce nom, c'étaient les Samaritains étonnés de ses prodiges, qui l'appelaient la vertu de Dieu. Cela convenait aux miracles apparents qu'il avait faits, mais on ne pouvait pas en conclure qu'il se regardât comme le messie. D'ailleurs il ne se mettait pas à la tête des armées, et ne soulevait pas les peuples ; il ne pouvait donc pas convaincre les Juifs mieux que J. C. qui avait fait des miracles plus réels et plus grands sous leurs yeux. Enfin ce serait le dernier de tous les prodiges, que Simon se fût converti, s'il s'était fait le messie ; son imposture aurait paru trop grossière pour en soutenir la honte ; Saint Luc ne lui impute rien de semblable : il fit ce qui était assez naturel : convaincu de la fausseté de son art, dont les plus habiles magiciens se défient toujours, et reconnaissant la vérité des miracles de Saint Philippes, il donna les mains à cette vérité, et se fit chrétien dans l'espérance de se rendre plus redoutable, et d'être admiré par des prodiges réels et plus éclatants que ceux qu'il avait faits. Ce fut là tellement le but de sa conversion, qu'il offrit aussitôt de l'argent pour acheter le don des miracles.
Simon le magicien alla aussi à Rome, et y séduisait comme ailleurs par divers prestiges. L'empereur Neron était si passionné pour la magie, qu'il ne l'était pas plus pour la musique. Il prétendait par cet art, commander aux dieux mêmes ; il n'épargna pour l'apprendre ni la dépense ni l'application, et toutefois il ne trouva jamais de vérité dans les promesses des magiciens ; en sorte que son exemple est une preuve illustre de la fausseté de cet art. D'ailleurs personne n'osait lui rien contester ; ni dire que ce qu'il ordonnait fût impossible. Jusques-là qu'il commanda de voler à un homme qui le promit, et fut longtemps nourri dans le palais sous cette espérance. Il fit même représenter dans le théâtre un Icare volant ; mais au premier effort Icare tomba près de sa loge, et l'ensanglanta lui-même. Simon, dit-on, promit aussi de voler, et de monter au ciel. Il s'éleva en effet, mais Saint Pierre et Saint Paul se mirent à genoux, et prièrent ensemble. Simon tomba et demeura étendu, les jambes brisées ; on l'emporta en un autre lieu, où ne pouvant souffrir les douleurs et la honte, il se précipita d'un comble très-élevé.
Plusieurs savants regardent cette histoire comme une fable, parce que selon eux, les auteurs qu'on cite pour la prouver, ne méritent point assez de créance, et qu'on ne trouve aucun vestige de cette fin tragique dans les auteurs antérieurs au troisième siècle, qui n'auraient pas manqué d'en parler si une aventure si étonnante était réellement arrivée.
Dosithée était Juif de naissance ; mais il se jeta dans le parti des Samaritains, parce qu'il ne put être le premier dans les deutéroses, (apud Nicetam, lib. I. cap. xxxv.). Ce terme de Nicetas est obscur ; il faut même le corriger ; et remettre dans le texte celui de Deuterotes, Eusebe (praep. lib. XI. cap. IIIe lib. XII. cap. j.) a parlé de ces deuterotes des Juifs qui se servaient d'énigmes pour expliquer la loi. C'était alors l'étude des beaux esprits, et le moyen de parvenir aux charges et aux honneurs. Peu de gens s'y appliquaient, parce qu'on la trouvait difficile. Dosithée s'était voulu distinguer en expliquant allégoriquement la loi, et il prétendait le premier rang entre ces interpretes.
On prétend (épiph. pag. 30.) que Dosithée fonda une secte chez les Samaritains, et que cette secte observa 1°. la circoncision et le sabbat, comme les Juifs : 2°. ils croyaient la résurrection des morts ; mais cet article est contesté, car ceux qui font Dosithée le père des Saducéens, l'accusent d'avoir combattu une vérité si consolante. 3°. Il était grand jeuneur ; et afin de rendre son jeune plus mortifiant, il condamnait l'usage de tout ce qui est animé. Enfin s'étant enfermé dans une caverne, il y mourut par une privation entière d'aliments, et ses disciples trouvèrent quelque temps après son cadavre rongé des vers et plein de mouches. 4°. Les Dosithéens faisaient grand cas de la virginité que la plupart gardaient ; et les autres, dit Saint Epiphane, s'abstenaient de leurs femmes après la mort. On ne sait ce que cela veut dire, si ce n'est qu'ils ne défendissent les secondes nôces qui ont paru illicites et honteuses à beaucoup de Chrétiens ; mais un critique a trouvé par le changement d'une lettre, un sens plus net et plus facîle à la loi des Dosithéens, qui s'abstenaient de leurs femmes lorsqu'elles étaient grosses, ou lorsqu'elles avaient enfanté. Nicetas fortifie cette conjecture, car il dit que les Dosithéens se séparaient de leurs femmes lorsqu'elles avaient eu un enfant ; cependant la première opinion parait plus raisonnable, parce que les Dosithéens rejetaient les femmes comme inutiles, lorsqu'ils avaient satisfait à la première vue du mariage, qui est la génération des enfants. 5°. Cette secte entêtée de ses austérités rigoureuses, regardait le reste du genre humain avec mépris ; elle ne voulait ni approcher ni toucher personne. On compte entre les observations dont ils se chargeaient, celle de demeurer vingt-quatre heures dans la même posture où ils étaient lorsque le sabbat commençait.
A-peu-près dans le même temps vivait Menandre le principal disciple de Simon le magicien : il était Samaritain comme lui, d'un bourg nommé Cappareatia ; il était aussi magicien ; en sorte qu'il séduisit plusieurs personnes à Antioche par les prestiges. Il disait, comme Simon ; que la vertu inconnue l'avait envoyé pour le salut des hommes, et que personne ne pouvait être sauvé s'il n'était baptisé en son nom ; mais que son baptême était la vraie résurrection, en sorte que ses disciples seraient immortels, même en ce monde : toutefois il y avait peu de gens qui reçussent son baptême.
Colonie des Juifs en Egypte. La haine ancienne que les Juifs avaient eue contre les Egyptiens, s'était amortie par la nécessité, et on a Ve souvent ces deux peuples unis se prêter leurs forces pour résister au roi d'Assyrie qui voulait les opprimer. Aristée conte même qu'avant que cette nécessité les eut réunis, un grand nombre de Juifs avait dejà passé en Egypte, pour aider à Psammétichus à dompter les Ethyopiens qui lui faisaient la guerre ; mais cette première transmigration est fort suspecte. 1°. Parce qu'on ne voit pas quelle relation les Juifs pouvaient avoir alors avec les Egyptiens, pour y envoyer des troupes auxiliaires. 2°. Ce furent quelques soldats d'Ionie et de Carie, qui, conformément à l'oracle, parurent sur les bords de l'Egypte, comme des hommes d'airain, parce qu'ils avaient des cuirasses, et qui prêtèrent leur secours à Psammétichus pour vaincre les autres rois d'Egypte, et ce furent là, dit Herodote (lib. II. pag. 152.) les premiers qui commencèrent à introduire une langue étrangère en Egypte ; car les pères leur envoyaient leurs enfants pour apprendre à parler grec. Diodore (lib. I. pag. 48.) joint quelques soldats arabes aux Grecs ; mais Aristée est le seul qui parle des Juifs.
Après la première ruine de Jérusalem et le meurtre de Gedalia qu'on avait laissé en Judée pour la gouverner, Jochanan alla chercher en Egypte un asîle contre la cruauté d'Ismael ; il enleva jusqu'au prophète Jérémie qui reclamait contre cette violence, et qui avait prédit les malheurs qui suivraient les réfugiés en Egypte. Nabuchodonosor profitant de la division qui s'était formée entre Apries et Amasis, lequel s'était mis à la tête des rebelles, au lieu de les combattre, entra en Egypte, et la conquit par la défaite d'Apries. Il suivit la coutume de ces temps-là, d'enlever les habitants des pays conquis, afin d'empêcher qu'ils ne remuassent. Les Juifs réfugiés en Egypte, eurent le même sort que les habitants naturels. Nabuchodonosor leur fit changer une seconde fois de domicîle ; cependant il en demeura quelques-uns dans ce pays-là, dont les familles se multiplièrent considérablement.
Alexandre le Grand voulant remplir Alexandrie, y fit une seconde peuplade de Juifs auxquels il accorda les mêmes privilèges qu'aux Macédoniens. Ptolomée Lagus, l'un de ses généraux, s'étant emparé de l'Egypte après sa mort, augmenta cette colonie par le droit de la guerre ; car voulant joindre la Syrie et la Judée à son nouveau royaume, il entra dans la Judée, s'empara de Jérusalem pendant le repos du sabbat, et enleva de tout le pays cent mille Juifs qu'il transporta en Egypte. Depuis ce temps-là, ce prince remarquant dans les Juifs beaucoup de fidélité et de bravoure, leur témoigna sa confiance en leur donnant la garde de ses places ; il y en avait d'autres établis à Alexandrie qui y faisaient fortune, et qui se louant de la douceur du gouvernement, purent y attirer leurs frères dejà ébranlés par la douceur et les promesses que Ptolomée leur avait faites dans son second voyage.
Philadelphe fit plus que son père ; car il rendit la liberté à ceux que son père avait faits esclaves. Plusieurs reprirent la route de la Judée qu'ils aimaient comme leur patrie ; mais il y en eut beaucoup qui demeurèrent dans un lieu où ils avaient eu le temps de prendre racine ; et Scaliger a raison de dire que ce furent ces gens-là qui composèrent en partie les synagogues nombreuses des Juifs Hellenistes : enfin ce qui prouve que les Juifs jouissaient alors d'une grande liberté, c'est qu'ils composèrent cette fameuse version des septante et peut-être la première version grecque qui se soit faite des livres de Moïse.
On dispute fort sur la manière dont cette version fut faite, et les Juifs ni les Chrétiens ne peuvent s'accorder sur cet événement. Nous n'entreprendrons point ici de les concilier ; nous nous contenterons de dire que l'autorité des pères qui ont soutenu le récit d'Aristée, ne doit plus ébranler personne, après les preuves démonstratives qu'on a produites contre lui.
Voilà l'origine des Juifs en Egypte ; il ne faut point douter que ce peuple n'ait commencé dans ce temps-là à connaître la doctrine des Egyptiens, et qu'il n'ait pris d'eux la méthode d'expliquer l'écriture par des allégories. Eusebe (cap. X.) soutint que du temps d'Aristobule qui vivait en Egypte sous le règne de Ptolomée Philometor, il y eut dans ce pays-là deux factions entre les Juifs, dont l'une se tenait attachée scrupuleusement au sens littéral de la loi, et l'autre perçant au-travers de l'écorce, pénétroit dans une philosophie plus sublime.
Philon qui vivait en Egypte au temps de J. C. donna tête baissée dans les allégories et dans le sens mystique ; il trouvait tout ce qu'il voulait dans l'écriture par cette méthode.
C'était encore en Egypte que les Esseniens parurent avec plus de réputation et d'éclat ; et ces sectaires enseignaient que les mots étaient autant d'images des choses cachées ; ils changeaient les volumes sacrés et les préceptes de la sagesse en allégories. Enfin la conformité étonnante qui se trouve entre la cabale des Egyptiens et celle des Juifs, ne nous permet pas de douter que les Juifs n'aient puisé cette science en Egypte, à moins qu'on ne veuille soutenir que les Egyptiens l'ont apprise des Juifs. Ce dernier sentiment a été très-bien refuté par de savants auteurs. Nous nous contenterons de dire ici que les Egyptiens jaloux de leur antiquité, de leur savoir, et de la beauté de leur esprit, regardaient avec mépris les autres nations, et les Juifs comme des esclaves qui avaient plié longtemps sous leur joug avant que de le secouer. On prend souvent les dieux de ses maîtres ; mais on ne les mandie presque jamais chez ses esclaves. On remarque comme une chose singulière à cette nation, que Sérapis fut porté d'un pays étranger en Egypte ; c'est la seule divinité qu'ils aient adoptée des étrangers ; et même le fait est contesté, parce que le culte de Sérapis parait beaucoup plus ancien en Egypte que le temps de Ptolomée Lagus, sous lequel cette translation se fit de Sinope à Alexandrie. Le culte d'Isis avait passé jusqu'à Rome, mais les dieux des Romains ne passaient point en Egypte, quoiqu'ils en fussent les conquérants et les maîtres. D'ailleurs les Chrétiens ont demeuré plus longtemps en Egypte que les Juifs ; ils avaient là des évêques et des maîtres très-savants. Non-seulement la religion y florissait, mais elle fut souvent appuyée par l'autorité souveraine. Cependant les Egyptiens, témoins de nos rits et de nos cérémonies, demeurèrent religieusement attachés à celles qu'ils avaient reçues de leurs ancêtres. Ils ne grossissaient point leur religion de nos observances, et ne les faisaient point entrer dans leur culte. Comment peut-on s'imaginer qu'Abraham, Joseph et Moïse aient eu l'art d'obliger les Egyptiens à abolir d'anciennes superstitions, pour recevoir la religion de leur main, pendant que l'église chrétienne qui avait tant de lignes de communication avec les Egyptiens idolâtres, et qui était dans un si grand voisinage, n'a pu rien lui prêter par le ministère d'un prodigieux nombre d'évêques et de savants, et pendant la durée d'un grand nombre de siècles ? Socrate rapporte l'attachement que les Egyptiens de son temps avaient pour leurs temples, leurs cérémonies, et leurs mystères ; on ne voit dans leur religion aucune trace de christianisme. Comment donc y pourrait-on remarquer des caractères évidents de judaïsme ?
Origine des différentes sectes chez les Juifs. Lorsque le don de prophétie eut cessé chez les Juifs, l'inquiétude générale de la nation n'étant plus réprimée par l'autorité de quelques hommes inspirés, ils ne purent se contenter du style simple et clair de l'écriture ; ils y ajoutèrent des allégories qui dans la suite produisirent de nouveaux dogmes, et par conséquent des sectes différentes. Comme c'est du sein de ces sectes que sont sortis les différents ordres d'écrivains, et les opinions dont nous devons donner l'idée, il est important d'en pénétrer le fond, et de voir s'il est possible quel a été leur sort depuis leur origine. Nous avertissons seulement que nous ne parlerons ici que des sectes principales.
La secte des Saducéens. Lightfoot (Hor. heb. ad Mat. III. 7. opp. tom. II.) a donné aux Saducéens une fausse origine, en soutenant que leur opinion commençait à se répandre du temps d'Esdras. Il assure qu'il y eut alors des impies qui commencèrent à nier la résurrection des morts et l'immortalité des ames. Il ajoute que Malachie les introduit disant : c'est envain que nous servons Dieu ; et Esdras qui voulut donner un préservatif à l'église contre cette erreur, ordonna qu'on finirait toutes les prières par ces mots, de siècle en siècle, afin qu'on sut qu'il y avait un siècle ou une autre vie après celle-ci. C'est ainsi que Lightfoot avait rapporté l'origine de cette secte ; mais il tomba depuis dans une autre extrémité ; il résolut de ne faire naître les Saducéens qu'après que la version des septante eut été faite par l'ordre de Ptolomée Philadelphe, et pour cet effet, au lieu de remonter jusqu'à Esdras, il a laissé couler deux ou trois générations depuis Zadoc ; il a abandonné les Rabbins et son propre sentiment, parce que les Saducéens rejetant les prophetes, et ne recevant que les Penthateuques, ils n'ont pu paraitre qu'après les septante interpretes qui ne traduisirent en grec que les cinq livres de Moïse, et qui défendirent de rien ajouter à leur version : mais sans examiner si les 70 interpretes ne traduisirent pas toute la bible, cette version n'était point à l'usage des Juifs, où se forma la secte des Saducéens. On y lisait la bible en hébreu, et les Saducéens recevaient les prophetes, aussi bien que les autres livres, ce qui renverse pleinement cette conjecture.
On trouve dans les docteurs hébreux une origine plus vraisemblable des Saducéens dans la personne d'Antigone surnommé Sochaeus, parce qu'il était né à Socho. Cet homme vivait environ deux cent quarante ans avant J. C. et criait à ses disciples : Ne soyez point comme des esclaves qui obéissent à leur maître par la vue de la récompense, obéissez sans espérer aucun fruit de vos travaux ; que la crainte du Seigneur soit sur vous. Cette maxime d'un théologien, qui vivait sous l'ancienne économie, surprend ; car la loi promettait non seulement des récompenses, mais elle parlait souvent d'une félicité temporelle qui devait toujours suivre la vertu. Il était difficîle de devenir contemplatif dans une religion si charnelle, cependant Antigonus le devint. On eut de la peine à voler après lui, et à le suivre dans une si grande élévation. Zadoc, l'un de ses disciples, qui ne put, ni abandonner tout à fait son maître, ni goûter sa théologie mystique, donna un autre sens à sa maxime, et conclut de-là qu'il n'y avait ni peines ni récompenses après la mort. Il devint le père des Saducéens, qui tirèrent de lui le nom de leur secte et le dogme.
Les Saducéens commencèrent à paraitre pendant qu'Onias était le souverain sacrificateur à Jérusalem ; que Ptolomée Evergete régnait en Egypte, et Séleucus Callinicus en Syrie. Ceux qui placent cet événement sous Alexandre le Grand, et qui assurent avec S. Epiphane, que ce fut dans le temple du Garizim, où Zadoc et Baythos s'étaient retirés, que cette secte prit naissance, ont fait une double faute : car Antigonus n'était point sacrificateur sous Alexandre, et on n'a imaginé la retraite de Zadoc à Samarie que pour rendre ses disciples plus odieux. Non seulement Josephe, qui haïssait les Saducéens, ne reproche jamais ce crime au chef de leur parti ; mais on les voit dans l'Evangîle adorant et servant dans le temple de Jérusalem ; on choisissait même parmi eux le grand-prêtre. Ce qui prouve que non seulement ils étaient tolérés chez les Juifs, mais qu'ils y avaient même assez d'autorité. Hircan, le souverain sacrificateur, se déclara pour eux contre les Pharisiens. Ces derniers soupçonnèrent la mère de ce prince d'avoir commis quelque impureté avec les payens. D'ailleurs ils voulaient l'obliger à opter entre le sceptre et la tiare ; mais le prince voulant être le maître de l'église et de l'état, n'eut aucune déférence pour leurs reproches. Il s'irrita contre eux, il en fit mourir quelques-uns ; les autres se retirèrent dans les déserts. Hircan se jeta en même temps du côté des Saducéens : il ordonna qu'on reçut les coutumes de Zadoc sous peine de la vie. Les Juifs assurent qu'il fit publier dans ses états un édit par lequel tous ceux qui ne recevraient pas les rits de Zadoc et de Baythos, ou qui suivraient la coutume des sages, perdraient la tête. Ces sages étaient les Pharisiens, à qui on a donné ce titre dans la suite, parce que leur parti prévalut. Cela arriva surtout après la ruine de Jérusalem et de son temple. Les Pharisiens, qui n'avaient pas sujet d'aimer les Saducéens, s'étant emparés de toute l'autorité, les firent passer pour des hérétiques, et même pour des Epicuriens. Ce qui a donné sans-doute occasion à saint Epiphane et à Tertullien de les confondre avec les Dosithéens. La haine que les Juifs avaient conçue contr'eux, passa dans le cœur même des Chrétiens : l'empereur Justinien les bannit de tous les lieux de sa domination, et ordonna qu'on envoyât au dernier supplice des gens qui défendaient certains dogmes d'impiété et d'athéisme, car ils niaient la résurrection et le dernier jugement. Ainsi cette secte subsistait encore alors, mais elle continuait d'être malheureuse.
L'édit de Justinien donna une nouvelle atteinte à cette secte, déjà fort affoiblie : car tous les Chrétiens s'accoutumant à regarder les Saducéens comme des impies dignes du dernier supplice, ils étaient obligés de fuir et de quitter l'Empire romain, qui était d'une vaste étendue. Ils trouvaient de nouveaux ennemis dans les autres lieux où les Pharisiens étaient établis : ainsi cette secte était errante et fugitive, lorsqu' Ananus lui rendit quelque éclat au milieu du huitième siècle. Mais cet événement est contesté par les Caraïtes, qui se plaignent qu'on leur ravit par jalousie un de leurs principaux défenseurs, afin d'avoir ensuite le plaisir de les confondre avec les Saducéens.
Doctrine des Saducéens. Les Saducéens, uniquement attachés à l'Ecriture sainte, rejetaient la loi orale, et toutes les traditions, dont on commença sous les Macchabées à faire une partie essentielle de la religion. Parmi le grand nombre des témoignages que nous pourrions apporter ici, nous nous contenterons d'un seul tiré de Josephe, qui prouvera bien clairement que c'était le sentiment des Saducéens : Les Pharisiens, dit-il, qui ont reçu ces constitutions par tradition de leurs ancêtres, les ont enseignées au peuple ; mais les Saducéens les rejettent, parce qu'elles ne sont pas comprises entre les lois données par Moïse, qu'ils soutiennent être les seules que l'on est obligé de suivre, etc. Antiq. jud. lib. XIII. cap. XVIIIe
S. Jérôme et la plupart des pères ont cru qu'ils retranchaient du canon les prophetes et tous les écris divins, excepté le Pentateuque de Moïse. Les critiques modernes (Simon. hist. critiq. du vieux Testament, liv. I. chap. xvj.) ont suivi les pères ; et ils ont remarqué que J. C. voulant prouver la resurrection aux Saducéens, leur cita uniquement Moïse, parce qu'un texte tiré des prophetes, dont ils rejetaient l'autorité, n'aurait pas fait une preuve contr'eux. J. Drusius a été le premier qui a osé douter d'un sentiment appuyé sur des autorités si respectables ; et Scaliger (Elench.t rihaeres. cap. xvj.) l'a absolument rejeté, fondé sur des raisons qui paraissent fort solides. 1°. Il est certain que les Saducéens n'avaient commencé de paraitre qu'après que le canon de l'Ecriture fut fermé, et que le don de prophétie étant éteint, il n'y avait plus de nouveaux livres à recevoir. Il est difficîle de croire qu'ils se soient soulevés contre le canon ordinaire, puisqu'il était reçu à Jérusalem. 2°. Les Saducéens enseignaient et priaient dans le temple. Cependant on y lisait les prophetes, comme cela parait par l'exemple de J. C. qui expliqua quelques passages d'Isaïe. 3°. Josephe, qui devoir connaître parfaitement cette secte, rapporte qu'ils recevaient ce qui est écrit. Il oppose ce qui est écrit à la doctrine orale des Pharisiens ; et il insinue que la controverse ne roulait que sur les traditions : ce qui fait conclure que les Saducéens recevaient toute l'Ecriture, et les autres prophetes, aussi-bien que Moïse. 4°. Cela parait encore plus évidemment par les disputes que les Pharisiens ou les docteurs ordinaires des Juifs ont soutenues contre ces sectaires. R. Gamaliel leur prouve la résurrection des morts par des passages tirés de Moïse, des Prophètes et des Agiographes ; et les Saducéens, au lieu de rejeter l'autorité des livres qu'on citait contr'eux, tâchèrent d'éluder ces passages par de vaines subtilités. 5°. Enfin les Saducéens reprochaient aux Pharisiens qu'ils croyaient que les livres saints souillaient. Quels étaient ces livres saints qui souillaient, au jugement des Pharisiens ? c'était l'Ecclésiastesiaste, le Cantique des Cantiques, et les Proverbess. Les Saducéens regardaient donc tous les livres comme des écrits divins, et avaient même plus de respect pour eux que les Pharisiens.
2°. La seconde et la principale erreur des Saducéens roulait sur l'existence de anges, et sur la spiritualité de l'âme. En effet, les Evangélistes leur reprochent qu'ils soutenaient qu'il n'y avait ni résurrection, ni esprit, ni ange. Le P. Simon donne une raison de ce sentiment. Il assure que, de l'aveu des Thalmudistes, le nom d'anges n'avait été en usage chez les Juifs que depuis le retour de la captivité ; et les Saducéens conclurent de-là que l'invention des anges était nouvelle ; que tout ce que l'Ecriture disait d'eux avait été ajouté par ceux de la grande synagogue, et qu'on devait regarder ce qu'ils en rapportaient comme autant d'allégories. Mais c'est disculper les Saducéens que l'Evangîle condamne sur cet article : car si l'existence des anges n'était fondée que sur une tradition assez nouvelle, ce n'était pas un grand crime que de les combattre, ou de tourner en allégories ce que les Thalmudistes en disaient. D'ailleurs, tout le monde sait que le dogme des anges était très-ancien chez les Juifs.
Théophilacte leur reproche d'avoir combattu la divinité du S. Esprit : il doute même s'ils ont connu Dieu, parce qu'ils étaient épais, grossiers, attachés à la matière ; et Arnobe, s'imaginant qu'on ne pouvoir nier l'existence des esprits, sans faire Dieu corporel, leur a attribué ce sentiment, et le savant Petau a donné dans le même piège. Si les Saducéens eussent admis de telles erreurs, il est vraisemblable que les Evangélistes en auraient parlé. Les Saducéens, qui niaient l'existence des esprits, parce qu'ils n'avaient d'idée claire et distincte que des objets sensibles et matériels, mettaient Dieu au-dessus de leur conception, et regardaient cet être infini comme une essence incompréhensible, parce qu'elle était parfaitement dégagée de la matière. Enfin, les Saducéens combattaient l'existence des esprits, sans attaquer la personne du S. Esprit, qui leur était aussi inconnue qu'aux disciples de Jean-Baptiste. Mais comment les Saducéens pouvaient-ils nier l'existence des anges, eux qui admettaient le Pentateuque, où il en est assez souvent parlé ? Sans examiner ici les sentiments peu vraisemblables du P. Hardouin et de Grotius, nous nous contenterons d'imiter la modestie de Scaliger, qui s'étant fait la même question, avouait ingenument qu'il en ignorait la raison.
3°. Une troisième erreur des Saducéens était que l'âme ne survit point au corps, mais qu'elle meurt avec lui. Joseph la leur attribue expressément.
4°. La quatrième erreur des Saducéens roulait sur la résurrection des corps, qu'ils combattaient comme impossible. Ils voulaient que l'homme entier périt par la mort ; et de-là naissait cette conséquence nécessaire et dangereuse, qu'il n'y avait ni récompense ni peine dans l'autre vie ; ils bornaient la justice vangeresse de Dieu à la vie présente.
5°. Il semble aussi que les Saducéens niaient la Providence, et c'est pourquoi on les met au rang des Epicuriens. Josephe dit qu'ils rejetaient le destin ; qu'ils ôtaient à Dieu toute inspection sur le mal, et toute influence sur le bien, parce qu'il avait placé le bien et le mal devant l'homme, en lui laissant une entière liberté de faire l'un et de fuir l'autre. Grotius, qui n'a pu concevoir que les Saducéens eussent ce sentiment, a cru qu'on devait corriger Josephe, et lire que Dieu n'a aucune part dans les actions des hommes, soit qu'ils fassent le mal, ou qu'ils ne le fassent pas. En un mot, il a dit que les Saducéens, entêtés d'une fausse idée de liberté, se donnaient un pouvoir entier de fuir le mal et de faire le bien. Il a raison dans le fond, mais il n'est pas nécessaire de changer le texte de Josephe pour attribuer ce sentiment aux Saducéens ; car le terme dont il s'est servi, rejette seulement une providence qui influe sur les actions des hommes. Les Saducéens ôtaient à Dieu une direction agissante sur la volonté, et ne lui laissaient que le droit de récompenser ou de punir ceux qui faisaient volontairement le bien ou le mal. On voit par-là que les Saducéens étaient à peu-près Pélagiens.
Enfin, les Saducéens prétendaient que la pluralité des femmes est condamnée dans ces paroles du Lévitique : Vous ne prendrez point une femme avec sa sœur, pour l'affliger en son vivant. Chap. XVIIIe Les Thalmudistes, défenseurs zélés de la polygamie, se croyaient autorisés à soutenir leur sentiment par les exemples de David et de Salomon, et concluaient que les Saducéens étaient hérétiques sur le mariage.
Mœurs des Saducéens. Quelques Chrétiens se sont imaginés que comme les Saducéens niaient les peines et les récompenses de l'autre vie et l'immortalité des âmes, leur doctrine les conduisait à un affreux libertinage. Mais il ne faut pas tirer des conséquences de cette nature, car elles sont souvent fausses. Il y a deux barrières à la corruption humaine, les châtiments de la vie présente et les peines de l'enfer. Les Saducéens avaient abattu la dernière barrière, mais ils laissaient subsister l'autre. Ils ne croyaient ni peine ni récompense pour l'avenir ; mais ils admettaient une Providence qui punissait le vice, et qui récompensait la vertu pendant cette vie. Le désir d'être heureux sur la terre, suffisait pour les retenir dans le devoir. Il y a bien des gens qui se mettraient peu en peine de l'éternité, s'ils pouvaient être heureux dans cette vie. C'est-là le but de leurs travaux et de leurs soins. Josephe assure que les Saducéens étaient fort sévères pour la punition des crimes, et cela devait être ainsi : en effet, les hommes ne pouvant être retenus par la crainte des châtiments éternels que ces sectaires rejetaient, il fallait les épouvanter par la sévérité des peines temporelles. Le même Josephe les représente comme des gens farouches, dont les mœurs étaient barbares, et avec lesquels les étrangers ne pouvaient avoir de commerce. Ils étaient souvent divisés les uns contre les autres. N'est-ce point trop adoucir ce trait hideux, que de l'expliquer de la liberté qu'ils se donnaient de disputer sur les matières de religion ? car Josephe qui rapporte ces deux choses, blâme l'une et loue l'autre, ou du moins il ne dit jamais que ce fut la différence des sentiments et la chaleur de la dispute qui causa ces divisions ordinaires dans la secte. Quoi qu'il en sait, Josephe qui était Pharisien, peut être soupçonné d'avoir trop écouté les sentiments de haine que sa secte avait pour les Saducéens.
Des Caraïtes. Origine des Caraïtes. Le nom de Caraïte signifie un homme qui lit, un scriptuaire, c'est-à-dire un homme qui s'attache scrupuleusement au texte de la loi, et qui rejette toutes les traditions orales.
Si on en croit les Caraïtes qu'on trouve aujourd'hui en Pologne et dans la Lithuanie, ils descendent des dix tributs que Salmanazar avait transportées, et qui ont passé de-là dans la Tartarie : mais on rejettera bien-tôt cette opinion, pour peu qu'on fasse attention au sort de ces dix tribus, et on sait qu'elles n'ont jamais passé dans ce pays-là.
Il est encore mal-à-propos de faire descendre les Caraïtes d'Esdras ; et il suffit de connaître les fondements de cette secte, pour en être convaincu. En effet, ces sectaires ne se sont élevés contre les autres docteurs, qu'à cause des traditions qu'on égalait à l'écriture, et de cette loi orale qu'on disait que Moïse avait donnée. Mais on n'a commencé à vanter les traditions chez les Juifs, que longtemps après Esdras, qui se contenta de leur donner la loi pour règle de leur conduite. On ne se soulève contre une erreur, qu'après sa naissance ; et on ne combat un dogme que lorsqu'il est enseigné publiquement. Les Caraïtes n'ont donc pu faire de secte particulière que quand ils ont Ve le cours et le nombre des traditions se grossir assez, pour faire craindre que la religion n'en souffrit.
Les rabbins donnent une autre origine aux Caraïtes : ils les font paraitre dès le temps d'Alexandre le Grand ; car, quand ce prince entra à Jérusalem, Jaddus, le souverain sacrificateur, était déjà le chef des Rabbinistes ou Traditionaires, et Ananus et Cascanatus, soutenaient avec éclat le parti des Caraïtes. Dieu se déclara en faveur des premiers ; car Jaddus fit un miracle en présence d'Alexandre ; mais Ananus et Cascanatus montrèrent leur impuissance. L'erreur est sensible ; car Ananus, chef des Caraïtes, qu'on fait contemporain d'Alexandre le Grand, n'a vécu que dans le VIIIe siècle de l'Eglise chrétienne.
Enfin, on les regarde comme une branche des Saducéens, et on leur impute d'avoir suivi toute la doctrine de Zadoc et de ses disciples. On ajoute qu'ils ont varié dans la suite, parce que s'apercevant que ce système les rendait odieux, ils en rejettèrent une partie, et se contentèrent de combattre les traditions et la loi orale qu'on a ajoutée à l'Ecriture. Cependant les Caraïtes n'ont jamais nié l'immortalité des âmes ; au contraire le caraïte que le père Simon a cité, croyait que l'âme vient du ciel, qu'elle subsiste comme les anges, et que le siècle à venir a été fait pour elle. Non-seulement les Caraïtes ont repoussé cette accusation, mais en recriminant ils soutiennent, que leurs ennemis doivent être plutôt soupçonnés de sadducéïsme qu'eux, puisqu'ils croient que les âmes seront anéanties, après quelques années de souffrances et de tourments dans les enfers. Enfin, ils ne comptent ni Zadoc ni Batithos au rang de leurs ancêtres et des fondateurs de leur secte. Les défenseurs de Caïn, de Judas, de Simon le Magicien, n'ont point rougi de prendre les noms de leurs chefs ; les Saducéens ont adopté celui de Zadoc : mais les Caraïtes le rejettent et le maudissent, parce qu'ils en condamnent les opinions pernicieuses.
Eusebe (Praep. evang. lib. VIII. cap. x.) nous fournit une conjecture qui nous aidera à découvrir la véritable origine de cette secte ; car en faisant un extrait d'Aristobule, qui parut avec éclat à la cour de Ptolomée Philometor, il remarque qu'il y avait en ce temps-là deux partis différents chez les Juifs, dont l'un prenait toutes les lois de Moïse à la lettre, et l'autre leur donnait un sens allégorique. Nous trouvons-là la véritable origine des Caraïtes, qui commencèrent à paraitre sous ce prince ; parce que ce fut alors que les interpretations allégoriques et les traditions furent reçues avec plus d'avidité et de respect. La religion judaïque commença de s'alterer par le commerce qu'on eut avec des étrangers. Ce commerce fut beaucoup plus fréquent depuis les conquêtes d'Alexandre, qu'il n'était auparavant ; et ce fut particulièrement avec les Egyptiens qu'on se lia, surtout pendant que les rois d'Egypte furent maîtres de la Judée, qu'ils y firent des voyages et des expéditions, et qu'ils en transportèrent les habitants. On n'emprunta pas des Egyptiens leurs idoles, mais leur méthode de traiter la Théologie et la Religion. Les docteurs juifs transportés ou nés dans ce pays-là, se jetèrent dans les interprétations allégoriques ; et c'est ce qui donna occasion aux deux partis dont parle Eusebe, de se former et de diviser la nation.
Doctrine des Caraïtes. 1°. Le fondement de la doctrine des Caraïtes consiste à dire qu'il faut s'attacher scrupuleusement à l'Ecriture sainte, et n'avoir d'autre règle que la loi et les conséquences qu'on en peut tirer. Ils rejettent donc toute tradition orale et ils confirment leur sentiment par les citations des autres docteurs qui les ont précédés, lesquels ont enseigné que tout est écrit dans la loi ; qu'il n'y a point de loi orale donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Ils demandent la raison qui aurait obligé Dieu à écrire une partie de ses lais, et à cacher l'autre, ou à la confier à la memoire des hommes. Il faut pourtant remarquer qu'ils recevaient les interprétations que les Docteurs avaient données de la loi ; et par-là ils admettaient une espèce de tradition, mais qui était bien différente de celle des rabbins. Ceux ci ajoutaient à l'Ecriture les constitutions et les nouveaux dogmes de leurs prédécesseurs ; les Caraïtes au contraire n'ajoutaient rien à la loi, mais ils se croyaient permis d'en interprêter les endroits obscurs, et de recevoir les éclaircissements que les anciens docteurs en avaient donnés.
2°. C'est se jouer du terme de tradition, que de croire avec M. Simon qu'ils s'en servent, parce qu'ils ont adopté les points des Massorethes. Il est bien vrai que les Caraïtes reçoivent ces points ; mais il ne s'ensuit pas de-là qu'ils admettent la tradition, car cela n'a aucune influence sur les dogmes de la Religion. Les Caraïtes font donc deux choses : 1°. ils rejettent les dogmes importants qu'on a ajoutés à la loi qui est suffisante pour le salut ; 2°. ils ne veulent pas qu'on égale les traditions indifférentes à la loi.
3°. Parmi les interprétations de l'Ecriture, ils ne reçoivent que celles qui sont littérales, et par conséquent ils rejettent les interprétations cabalistiques, mystiques, et allégoriques, comme n'ayant aucun fondement dans la loi.
4°. Les Caraïtes ont une idée fort simple et fort pure de la Divinité ; car ils lui donnent des attributs essentiels et inséparables ; et ces attributs ne sont autre chose que Dieu même. Ils le considèrent en suite comme une cause opérante qui produit des effets différents : ils expliquent la création suivant le texte de Moïse ; selon eux Adam ne serait point mort, s'il n'avait mangé de l'arbre de science. La providence de Dieu s'étend aussi-loin que sa connaissance, qui est infinie, et qui découvre généralement toutes choses. Bien que Dieu influe dans les actions des hommes, et qu'il leur prête son secours, cependant il depend d'eux de se déterminer au bien et au mal, de craindre Dieu ou de violer ses commandements. Il y a, selon les docteurs qui suivent en cela les Rabbinistes, une grâce commune, qui se répand sur tous les hommes, et que chacun reçoit selon sa disposition ; et cette disposition vient de la nature du tempérament ou des étoiles. Ils distinguent quatre dispositions différentes dans l'âme : l'une de mort et de vie ; l'autre de santé, et de maladie. Elle est morte, lorsqu'elle croupit dans le péché ; elle est vivante, lorsqu'elle s'attache au bien ; elle est malade, quand elle ne comprend pas les vérités célestes ; mais elle est saine, lorsqu'elle connait l'enchainure des événements et la nature des objets qui tombent sous sa connaissance. Enfin, ils croient que les âmes, en sortant du monde, seront récompensées ou punies ; les bonnes âmes iront dans le siècle à venir et dans l'Eden. C'est ainsi qu'ils appellent le paradis, où l'âme est nourrie par la vue et la connaissance des objets spirituels. Un de leurs docteurs avoue que quelques-uns s'imaginaient que l'âme des méchants passait par la voie de la métempsicose dans le corps des bêtes ; mais il refute cette opinion, étant persuadé que ceux qui sont chassés du domicîle de Dieu, vont dans un lieu qu'il appelle la gehenne, où ils souffrent à cause de leurs péchés, et vivent dans la douleur et la honte, où il y a un ver qui ne meurt point, et un feu qui brulera toujours.
5°. Il faut observer rigoureusement les jeunes.
6°. Il n'est point permis d'épouser la sœur de sa femme, même après la mort de celle-ci.
7°. Il faut observer exactement dans les mariages les degrés de parenté et d'affinité.
8°. C'est une idolâtrie que d'adorer les anges, le ciel, et les astres ; et il n'en faut point tolérer les représentations.
Enfin, leur morale est fort pure ; ils font surtout profession d'une grande tempérance ; ils craignent de manger trop, ou de se rendre trop délicats sur les mets qu'on leur présente ; ils ont un respect excessif pour leurs maîtres ; les Docteurs de leur côté sont charitables, et enseignent gratuitement ; ils prétendent se distinguer par-là de ceux qui se font dieux d'argent, en tirant de grandes sommes de leurs leçons.
De la secte des Pharisiens. Origine des Pharisiens. On ne connait point l'origine des Pharisiens, ni le temps auquel ils ont commencé de paraitre. Josephe qui devait bien connaître une secte dont il était membre et partisan zelé, semble en fixer l'origine sous Jonatham, l'un des Macchabées, environ cent trente ans avant Jesus-Christ.
On a cru jusqu'à présent qu'ils avaient pris le nom de séparés, ou de Pharisiens, parce qu'ils se séparaient du reste des hommes, au-dessus desquels ils s'élevaient par leurs austérités. Cependant il y a une nouvelle conjecture sur ce nom : les Pharisiens étaient opposés aux Saducéens qui niaient les récompenses de l'autre vie ; car ils soutenaient qu'il y avait un paras, ou une remunération après la mort. Cette récompense faisant le point de la controverse avec les Saducéens, et s'appelant Paras, les Pharisiens purent tirer de-là leur nom, plutôt que de la séparation qui leur était commune avec les Saducéens.
Doctrine des Pharisiens. 1°. Le zèle pour les traditions fait le premier crime des Pharisiens. Ils soutenaient qu'outre la loi donnée sur le Sinaï, et gravée dans les écrits de Moïse, Dieu avait confié verbalement à ce législateur un grand nombre de rits et de dogmes, qu'il avait fait passer à la postérité sans les écrire. Ils nomment les personnes par la bouche desquels ces traditions s'étaient conservées : ils leur donnaient la même autorité qu'à la Loi, et ils avaient raison, puisqu'ils supposaient que leur origine était également divine. J. C. censura ces traditions qui affoiblissaient le texte, au lieu de l'éclaircir, et qui ne tendaient qu'à flatter les passions au lieu de les corriger. Mais sa censure, bien loin de ramener les Pharisiens, les effaroucha, et ils en furent choqués comme d'un attentat commis par une personne qui n'avait aucune mission.
2°. Non-seulement on peut accomplir la Loi écrite, et la Loi orale, mais encore les hommes ont assez de forces pour accomplir les œuvres de surérogation, comme les jeunes, les abstinences, et autres dévotions très-mortifiantes, auxquelles ils donnaient un grand prix.
3°. Josephe dit que les Pharisiens admettaient non-seulement un Dieu créateur du ciel et de la terre, mais encore une providence ou un destin. La difficulté consiste à savoir ce qu'il entend par destin : il ne faut pas entendre par-là les étoiles, puisque les Juifs n'avaient aucune dévotion pour elles. Le destin chez les Payens, était l'enchainement des causes secondes, liées par la vérité éternelle. C'est ainsi qu'en parle Ciceron : mais chez les Pharisiens, le destin signifiait la providence et les decrets qu'elle a formés sur les événements humains. Josephe explique si nettement leur opinion, qu'il est difficîle de concevoir comment on a pu l'obscurcir. " Ils croient, dit il, (antiq. jud. lib. XVIII. cap. ij.) que tout se fait par le destin ; cependant ils n'ôtent pas à la volonté la liberté de se déterminer, parce que, selon eux, Dieu use de ce tempérament ; que quoique toutes choses arrivent par son decret, ou par son conseil, l'homme conserve pourtant le pouvoir de choisir entre le vice et la vertu ". Il n'y a rien de plus clair que le témoignage de cet historien, qui était engagé dans la secte des Pharisiens, et qui devait en connaître les sentiments. Comment s'imaginer après cela, que les Pharisiens se crussent soumis aveuglément aux influences des astres, et à l'enchainement des causes secondes ?
4°. En suivant cette signification naturelle, il est aisé de développer le véritable sentiment des Pharisiens, lesquels soutenaient trois choses différentes. 1°. Ils croiaient que les événements ordinaires et naturels arrivaient nécessairement, parce que la providence les avait prévus et déterminés ; c'est-là ce qu'ils appelaient le destin. 2°. Ils laissaient à l'homme sa liberté pour le bien et pour le mal. Josephe l'assure positivement, en disant qu'il dépendait de l'homme de faire le bien et le mal. La Providence reglait donc tous les événements humains ; mais elle n'imposait aucune nécessité pour les vices ni pour les vertus. Afin de mieux soutenir l'empire qu'ils se donnaient sur les mouvements du cœur, et sur les actions qu'il produisait, ils alléguaient ces paroles du Deutéronome, où Dieu déclare, qu'il a mis la mort et la vie devant son peuple, et les exhorte à choisir la vie. Cela s'accorde parfaitement avec l'orgueil des Pharisiens, qui se vantaient d'accomplir la Loi, et demandaient la récompense dû. à leurs bonnes œuvres, comme s'ils l'avaient méritée. 3°. Enfin, quoiqu'ils laissassent la liberté de choisir entre le bien et le mal, ils admettaient quelques secours de la part de Dieu ; car ils étaient aidés par le destin. Ce dernier principe lève toute la difficulté : car si le destin avait été chez eux une cause aveugle, un enchainement des causes secondes, ou l'influence des astres, il serait ridicule de dire que le destin les aidait.
5°. Les bonnes et les mauvaises actions sont récompensées ou punies non-seulement dans cette vie, mais encore dans l'autre ; d'où il s'ensuit que les Pharisiens croyaient la résurrection.
6°. On accuse les Pharisiens d'enseigner la transmigration des âmes, qu'ils avaient empruntée des Orientaux, chez lesquels ce sentiment était commun : mais cette accusation est contestée, parce que J. C. ne leur reproche jamais cette erreur, et qu'elle parait détruire la résurrection des morts : puisque si une âme a animé plusieurs corps sur la terre, on aura de la peine à choisir celui qu'elle doit préférer aux autres.
Je ne sais si cela suffit pour justifier cette secte : J. C. n'a pas eu dessein de combattre toutes les erreurs du Pharisaïsme ; et si S. Paul n'en avait parlé, nous ne connaitrions pas aujourd'hui leurs sentiments sur la justification. Il ne faut donc pas conclure du silence de l'Evangile, qu'ils n'ont point cru la transmigration des ames.
Il ne faut point non plus justifier les Pharisiens, parce qu'ils auraient renversé la résurrection par la métempsicose ; car les Juifs modernes admettent également la révolution des âmes, et la résurrection des corps, et les Pharisiens ont pu faire la même chose.
L'autorité de Josephe, qui parle nettement sur cette matière, doit prévaloir. Il assure (Antiq. jud. lib. XVIII. cap. ij.) que les Pharisiens croyaient que les âmes des méchants étaient renfermées dans des prisons, et souffraient-là des supplices éternels, pendant que celles des bons trouvaient un retour facîle à la vie, et rentraient dans un autre corps. On ne peut expliquer ce retour des âmes à la vie par la résurrection : car, selon les Pharisiens, l'âme étant immortelle, elle ne mourra point, et ne ressuscitera jamais. On ne peut pas dire aussi qu'elle rentrera dans un autre corps au dernier jour : car outre que l'âme reprendra par la résurrection le même corps qu'elle a animé pendant la vie, et qu'il y aura seulement quelque changement dans ses qualités ; les Pharisiens représentaient par-là la différente condition des bons et des mécans, immédiatement après la mort ; et c'est attribuer une pensée trop subtîle à Josephe, que d'étendre sa vue jusqu'à la résurrection. Un historien qui rapporte les opinions d'une secte, parle plus naturellement, et s'explique avec plus de netteté.
Mœurs des Pharisiens. Il est temps de parler des austérités des Pharisiens ; car ce fut par là qu'ils séduisirent le peuple, et qu'ils s'attirèrent une autorité qui les rendait redoutables aux rais. Ils faisaient de longues veilles, et se refusaient jusqu'au sommeil nécessaire. Les uns se couchaient sur une planche très-étroite, afin qu'ils ne pussent se garantir d'une chute dangereuse, lorsqu'ils s'endormiraient profondément ; et les autres encore plus austères semaient sur cette planche des cailloux et des épines, qui troublassent leur repos en les déchirant. Ils faisaient à Dieu de longues oraisons, qu'ils répétaient sans remuer les yeux, les bras, ni les mains. Ils achevaient de mortifier leur chair par des jeunes qu'ils observaient deux fois la semaine ; ils y ajoutaient les flagellations ; et c'était peut-être une des raisons qui les faisait appeler des Tires sang, parce qu'ils se déchiraient impitoyablement la peau, et se fouettaient jusqu'à ce que le sang coulât abondamment. Mais il y en avait d'autres à qui ce titre avait été donné, parce que marchant dans les rues les yeux baissés ou fermés, ils se frappaient la tête contre les murailles. Ils chargeaient leurs habits de phylactères, qui contenaient certaines sentences de la loi. Les épines étaient attachées aux pans de leur robe, afin de faire couler le sang de leurs pieds lorsqu'ils marchaient ; ils se séparaient des hommes, parce qu'ils étaient beaucoup plus saints qu'eux, et qu'ils craignaient d'être souillés par leur attouchement. Ils se lavaient plus souvent que les autres, afin de montrer par là qu'ils avaient un soin extrême de se purifier. Cependant à la faveur de ce zèle apparent, ils se rendaient vénérables au peuple. On leur donnait le titre de sages par excellence ; et leurs disciples s'entrecriaient, le sage explique aujourd'hui. On enfle les titres à proportion qu'on les mérite moins ; on tâche d'imposer aux peuples par de grands noms, lorsque les grandes vertus manquent. La jeunesse avait pour eux une si profonde vénération, qu'elle n'osait ni parler ni répondre, lors même qu'on lui faisait des censures ; en effet ils tenaient leurs disciples dans une espèce d'esclavage, et ils réglaient avec un pouvoir absolu tout ce qui regardait la religion.
On distingue dans le Thalmud sept ordres de Pharisiens. L'un mesurait l'obéissance à l'aune du profit et de la gloire ; l'autre ne levait point les pieds en marchant, et on l'appelait à cause de cela le pharisien tronqué ; le troisième frappait sa tête contre les murailles, afin d'en tirer le sang ; un quatrième cachait sa tête dans un capuchon, et regardait de cet enfoncement comme du fond d'un mortier ; le cinquième demandait fiérement, que faut-il que je fasse ? je le ferai. Qu'y a-t-il à faire que je n'aye fait ? le sixième obéissait par amour pour la vertu et pour la récompense ; et le dernier n'exécutait les ordres de Dieu que par la crainte de la peine.
Origine des Esséniens. Les Esséniens qui devraient être si célèbres par leurs austérités et par la sainteté exemplaire dont ils faisaient profession, ne le sont presque point. Serarius soutenait qu'ils étaient connus chez les Juifs depuis la sortie de l'Egypte, parce qu'il a supposé que c'étaient les Cinéens descendus de Jethro, lesquels suivirent Moïse, et de ces gens-là sortirent les Réchabites. Mais il est évident qu'il se trompait, car les Esséniens et les Réchabites étaient deux ordres différents de dévots, et les premiers ne paraissent point dans toute l'histoire de l'ancien-Testament comme les Réchabites. Gale savant anglais, leur donne la même antiquité ; mais de plus il en fait les pères et les prédécesseurs de Pythagore et de ses disciples. On n'en trouve aucune trace dans l'histoire des Macchabées sous lesquels ils doivent être nés ; l'Evangîle n'en parle jamais, parce qu'ils ne sortirent point de leur retraite pour aller disputer avec J. C. D'ailleurs ils ne voulaient point se confondre avec les Pharisiens, ni avec le reste des Juifs, parce qu'ils se croyaient plus saints qu'eux ; enfin ils étaient peu nombreux dans la Judée, et c'était principalement en Egypte qu'ils avaient leur retraite, et où Philon les avait vus.
Drusius fait descendre les Esséniens de ceux qu'Hircan persécuta, qui se retirèrent dans les déserts, et qui s'accoutumèrent par nécessité à un genre de vie très-dur, dans lequel ils perséverèrent volontairement ; mais il faut avouer qu'on ne connait pas l'origine de ces sectaires. Ils paraissent dans l'histoire de Josephe, sous Antigonus ; car ce fut alors qu'on vit ce prophête essénien, nommé Judas, lequel avait prédit qu'Antigonus serait tué un tel jour dans une tour.
Histoire des Esséniens. Voici comme Josephe (belle Jud. lib. II. cap. xij.) nous dépeint ces sectaires. " Ils sont Juifs de nation, dit-il, ils vivent dans une union très-étroite, et regardent les voluptés comme des vices que l'on doit fuir, et la continence et la victoire de ses passions, comme des vertus que l'on ne saurait trop estimer. Ils rejettent le mariage, non qu'ils croient qu'il faille détruire la race des hommes, mais pour éviter l'intempérance des femmes, qu'ils sont persuadés ne garder pas la foi à leurs maris. Mais ils ne laissent pas néanmoins de recevoir les jeunes enfants qu'on leur donne pour les instruire, et de les élever dans la vertu avec autant de soin et de charité que s'ils en étaient les pères, et ils les habillent et les nourrissent tous d'une même sorte.
Ils méprisent les richesses ; toutes choses sont communes entr'eux avec une égalité si admirable, que lorsque quelqu'un embrasse leur secte, il se dépouille de la propriété de ce qu'il possede, pour éviter par ce moyen la vanité des richesses, épargner aux autres la honte de la pauvreté, et par un si heureux mélange, vivre tous ensemble comme frères.
Ils ne peuvent souffrir de s'oindre le corps avec de l'huîle ; mais si cela arrive à quelqu'un contre son gré, ils essuyent cette huîle comme si c'étaient des taches et des souillures ; et se croient assez propres et assez parés, pourvu que leurs habits soient toujours bien blancs.
Ils choisissent pour économes des gens de bien qui reçoivent tout leur revenu, et le distribuent selon le besoin que chacun en a. Ils n'ont point de ville certaine dans laquelle ils demeurent, mais ils sont répandus en diverses villes, où ils reçoivent ceux qui désirent entrer dans leur société ; et quoiqu'ils ne les aient jamais vus auparavant, ils partagent avec eux ce qu'ils ont, comme s'ils les connaissaient depuis longtemps. Lorsqu'ils font quelque voyage, ils ne portent autre chose que des armes pour se défendre des voleurs. Ils ont dans chaque ville quelqu'un d'eux pour recevoir et loger ceux de leur secte qui y viennent, et leur donner des habits, et les autres choses dont ils peuvent avoir besoin. Ils ne changent point d'habits que quand les leurs sont déchirés ou usés. Ils ne vendent et n'achetent rien entr'eux, mais ils se communiquent les uns aux autres sans aucun échange, tout ce qu'ils ont. Ils sont très-religieux envers Dieu, ne parlent que des choses saintes avant que le soleil soit levé, et font alors des prières qu'ils ont reçues par tradition, pour demander à Dieu qu'il lui plaise de le faire luire sur la terre. Ils vont après travailler chacun à son ouvrage, selon qu'il leur est ordonné. A onze heures ils se rassemblent, et couverts d'un linge, se lavent le corps dans l'eau froide ; ils se retirent ensuite dans leurs cellules, dont l'entrée n'est permise à nuls de ceux qui ne sont pas de leur secte, et étant purifiés de la sorte, ils vont au réfectoire comme en un saint temple, où lorsqu'ils sont assis en grand silence, on met devant chacun d'eux du pain et une portion dans un petit plat. Un sacrificateur benit les viandes, et on n'oserait y toucher jusqu'à ce qu'il ait achevé sa prière : il en fait encore une autre après le repas. Ils quittent alors leurs habits qu'ils regardent comme sacrés, et retournent à leurs ouvrages.
On n'entend jamais du bruit dans leurs maisons ; chacun n'y parle qu'à son tour, et leur silence donne du respect aux étrangers. Il ne leur est permis de rien faire que par l'avis de leurs supérieurs, si ce n'est d'assister les pauvres.... Car quant à leurs parents, ils n'oseraient leur rien donner si on ne le leur permet. Ils prennent un extrême soin de reprimer leur colere ; ils aiment la paix, et gardent si inviolablement ce qu'ils promettent, que l'on peut ajouter plus de foi à leurs simples paroles, qu'aux serments des autres. Ils considèrent même les serments comme des parjures, parce qu'ils ne peuvent se persuader qu'un homme ne soit pas un menteur, lorsqu'il a besoin pour être cru de prendre Dieu à témoin.... Ils ne reçoivent pas sur le champ dans leur société ceux qui veulent embrasser leur manière de vivre, mais ils le font demeurer durant un an au-dehors, où ils ont chacun avec une portion, une pioche et un habit blanc. Ils leur donnent ensuite une nourriture plus conforme à la leur, et leur permettent de se laver comme eux dans de l'eau froide, afin de se purifier ; mais ils ne les font pas manger au refectoire, jusqu'à ce qu'ils aient encore durant deux ans éprouvé leurs mœurs, comme ils avaient auparavant éprouvé leur continence. Alors on les reçoit parce qu'on les en juge dignes, mais avant que de s'asseoir à table avec les autres, ils protestent solennellement d'honorer et de servir Dieu de tout leur cœur, d'observer la justice envers les hommes ; de ne faire jamais volontairement de mal à personne ; d'assister de tout leur pouvoir les gens de bien ; de garder la foi à tout le monde, et particulièrement aux souverains.
Ceux de cette secte sont très-justes et très-exacts dans leurs jugements : leur nombre n'est pas moindre que de cent lorsqu'ils les prononcent, et ce qu'ils ont une fois arrêté demeure immuable.
Ils observent plus religieusement le sabath que nuls autres de tous les Juifs. Aux autres jours, ils font dans un lieu à l'écart, un trou dans la terre d'un pied de profondeur, où après s'être déchargés, en se couvrant de leurs habits, comme s'ils avaient peur de souiller les rayons du soleil, ils remplissent cette fosse de la terre qu'ils en ont tirée.
Ils vivent si longtemps, que plusieurs vont jusqu'à cent ans ; ce que j'attribue à la simplicité de leur vie.
Ils méprisent les maux de la terre, triomphent des tourments par leur constance, et préfèrent la mort à la vie lorsque le sujet en est honorable. La guerre que nous avons eue contre les Romains a fait voir en mille manières que leur courage est invincible ; ils ont souffert le fer et le feu plutôt que de vouloir dire la moindre parole contre leur législateur, ni manger des viandes qui leur sont défendues, sans qu'au milieu de tant de tourments ils aient jeté une seule larme, ni dit la moindre parole, pour tâcher d'adoucir la cruauté de leurs bourreaux. Au contraire ils se moquaient d'eux, et rendaient l'esprit avec joye, parce qu'ils espéraient de passer de cette vie à une meilleure ; et qu'ils croyaient fermement que, comme nos corps sont mortels et corruptibles ; nos âmes sont immortelles et incorruptibles ; qu'elles sont d'une substance aèrienne très-subtile, et qu'étant enfermées dans nos corps comme dans une prison, où une certaine inclination les attire et les arrête, elles ne sont pas plutôt affranchies de ces liens charnels qui les retiennent comme dans une longue servitude, qu'elles s'élèvent dans l'air et s'envolent avec joye. En quoi ils conviennent avec les Grecs, qui croient que ces âmes heureuses ont leur séjour au-delà de l'Océan, dans une région où il n'y a ni pluie, ni neige, ni une chaleur excessive, mais qu'un doux zéphir rend toujours très-agréable : et qu'au contraire les âmes des méchants n'ont pour demeure que des lieux glacés et agités par de continuelles tempêtes, où elles gémissent éternellement dans des peines infinies. Car, c'est ainsi qu'il me parait que les Grecs veulent que leurs héros, à qui ils donnent le nom de demi-dieux, habitent des îles qu'ils appellent fortunées, et que les âmes des impies soient à jamais tourmentées dans les enfers, ainsi qu'ils disent que le sont celles de Sisyphe, de Tantale, d'Ixion et de Tytie.
Ces mêmes Esséniens croient que les âmes sont créées immortelles pour se porter à la vertu et se détourner du vice ; que les bons sont rendus meilleurs en cette vie par l'espérance d'être heureux après leur mort, et que les méchants qui s'imaginent pouvoir cacher en ce monde leurs mauvaises actions, en sont punis en l'autre par des tourments éternels. Tels sont leurs sentiments sur l'excellence de l'âme. Il y en a parmi eux qui se vantent de connaître les choses à venir tant par l'étude qu'ils font des livres saints et des anciennes prophéties, que par le soin qu'ils prennent de se sanctifier ; et il arrive rarement qu'ils se trompent dans leurs prédictions.
Il y a une autre sorte d'Esséniens qui conviennent avec les premiers dans l'usage des mêmes viandes, des mêmes mœurs et des mêmes lais, et n'en sont différents qu'en ce qui regarde le mariage. Car ceux-ci croient que c'est vouloir abolir la race des hommes que d'y renoncer, puisque si chacun embrassait ce sentiment, on la verrait bientôt éteinte. Ils s'y conduisent néanmoins avec tant de modération, qu'avant que de se marier ils observent durant trois ans si la personne qu'ils veulent épouser parait assez saine pour bien porter des enfants, et lorsqu'après être mariés elle devient grosse, ils ne couchent plus avec elle durant sa grossesse, pour témoigner que ce n'est pas la volupté, mais le désir de donner des hommes à la république, qui les engage dans le mariage ".
Josephe dit dans un autre endroit qu'ils abandonnaient tout à Dieu. Ces paroles font assez entendre le sentiment des Esséniens sur le concours de Dieu. Cet historien dit encore ailleurs que tout dépendait du destin, et qu'il ne nous arrivait rien que ce qu'il ordonnait. On voit par-là que les Esséniens s'opposaient aux Saducéens, et qu'ils faisaient dépendre toutes choses des decrets de la providence ; mais en même temps il est évident qu'ils donnaient à la providence des decrets qui rendaient les événements nécessaires, et ne laissaient à l'homme aucun reste de liberté. Josephe les opposant aux Pharisiens qui donnaient une partie des actions au destin, et l'autre à la volonté de l'homme, fait connaître qu'ils étendaient à toutes les actions l'influence du destin et la nécessité qu'il impose. Cependant, au rapport de Philon, les Esséniens ne faisaient point Dieu auteur du péché, ce qui est assez difficîle à concevoir ; car il est évident que si l'homme n'est pas libre, la religion périt, les actions cessent d'être bonnes et mauvaises, il n'y a plus de peine ni de récompense ; et on a raison de soutenir qu'il n'y a plus d'équité dans le jugement de Dieu.
Philon parle des Esséniens à-peu-près comme Josephe. Ils conviennent tous les deux sur leurs austérités, leurs mortifications ? et sur le soin qu'ils prenaient de cacher aux étrangers leur doctrine. Mais Philon assure qu'ils préféraient la campagne à la ville, parce qu'elle est plus propre à la méditation ; et qu'ils évitaient autant qu'il était possible le commerce des hommes corrompus, parce qu'ils croyaient que l'impureté des mœurs se communique aussi aisément qu'une mauvaise influence de l'air. Ce sentiment nous parait plus vraisemblable que celui de Josephe qui les fait demeurer dans les villes ; en effet on ne lit nulle part qu'il y ait eu dans aucune ville de la Palestine des communautés d'Esséniens, au contraire tous les auteurs qui ont parlé de ces sectaires, nous les représentent comme fuyant les grandes villes, et s'appliquant à l'agriculture. D'ailleurs s'ils eussent habité les villes, il est probable qu'on les connaitrait un peu mieux qu'on ne le fait, et l'Evangîle ne garderait pas sur eux un si profond silence ; mais leur éloignement des villes où J. C. prêchait, les a sans-doute soustraits aux censures qu'il aurait faites de leur erreur.
Des Thérapeutes. Philon (Philo de vitae contemp.) a distingué deux ordres d'Esséniens ; les uns s'attachaient à la pratique, et les autres qu'on nomme Thérapeutes, à la contemplation. Ces derniers étaient aussi de la secte des Esséniens ; Philon leur en donne le nom : il ne les distingue de la première branche de cette secte, que par quelque degré de perfection.
Philon nous les représente comme des gens qui faisaient de la contemplation de Dieu leur unique occupation, et leur principale félicité. C'était pour cela qu'ils se tenaient enfermés seul à seul dans leur cellule, sans parler, sans oser sortir, ni même regarder par les fenêtres. Ils demandaient à Dieu que leur âme fût toujours remplie d'une lumière céleste, et qu'élevés au-dessus de tout ce qu'il y a de sensible, ils pussent chercher et connaître la vérité plus parfaitement dans leur solitude, s'élevant au-dessus du soleil, de la nature, et de toutes les créatures. Ils perçaient directement à Dieu, le soleil de justice. Les idées de la divinité, des beautés, et des tresors du ciel, dont ils s'étaient nourris pendant le jour les suivaient jusques dans la nuit, jusques dans leurs songes, et pendant le sommeil même. Ils débitaient des préceptes excellents ; ils laissaient à leurs parents tous leurs biens, pour lesquels ils avaient un profond mépris, depuis qu'ils s'étaient enrichis de la philosophie céleste : ils sentaient une émotion violente, et une fureur divine, qui les entrainait dans l'étude de cette divine philosophie, et ils y trouvaient un souverain plaisir ; c'est pourquoi ils ne quittaient jamais leur étude, jusqu'à ce qu'ils fussent parvenus à ce degré de perfection qui les rendait heureux. On voit-là, si je ne me trompe, la contemplation des mystiques, leurs transports, leur union avec la divinité qui les rend souverainement heureux et parfaits sur la terre.
Cette secte que Philon a peinte dans un traité qu'il a fait exprès, afin d'en faire honneur à sa religion, contre les Grecs qui vantaient la morale et la pureté de leurs philosophes, a paru si sainte, que les Chrétiens leur ont envié la gloire de leurs austérités. Les plus modérés ne pouvant ôter absolument à la synagogue l'honneur de les avoir formés et nourris dans son sein, ont au moins soutenu qu'ils avaient embrassé le christianisme, dès le moment que S. Marc le prêcha en Egypte, et que changeant de religion sans changer de vie, ils devinrent les pères et les premiers instituteurs de la vie monastique.
Ce dernier sentiment a été soutenu avec chaleur par Eusebe, par saint Jérôme, et surtout par le père Montfaucon, homme distingué par son savoir, non-seulement dans un ordre savant, mais dans la république des lettres. Ce savant religieux a été réfuté par M. Bouhier premier président du parlement de Dijon, dont on peut consulter l'ouvrage ; nous nous bornerons ici à quelques remarques.
1°. On ne connait les Thérapeutes que par Philon. Il faut donc s'en tenir à son témoignage ; mais peut-on croire qu'un ennemi de la religion chrétienne, et qui a persévéré jusqu'à la mort dans la profession du judaïsme, quoique l'Evangîle fût connu, ait pris la peine de peindre d'une manière si édifiante les ennemis de sa religion et de ses cérémonies ? Le judaïsme et le christianisme sont deux religions ennemies ; l'une travaille à s'établir sur les ruines de l'autre : il est impossible qu'on fasse un éloge magnifique d'une religion qui travaille à l'anéantissement de celle qu'on croit et qu'on professe.
2°. Philon de qui on tire les preuves en faveur du christianisme des Thérapeutes, était né l'an 723 de Rome. Il dit qu'il était fort jeune lorsqu'il composa ses ouvrages ; et que dans la suite ses études furent interrompues par les grands emplois qu'on lui confia. En suivant ce calcul, il faut nécessairement que Philon ait écrit avant J. C. et à plus forte raison avant que le Christianisme eut pénétré jusqu'à Alexandrie. Si on donne à Philon trente-cinq ou quarante ans lorsqu'il composait ses livres, il n'était plus jeune. Cependant J. C. n'avait alors que huit ou dix ans ; il n'avait point encore enseigné ; l'Evangîle n'était point encore connu : les Thérapeutes ne pouvaient par conséquent être chrétiens : d'où il est aisé de conclure que c'est une secte de Juifs réformés, dont Philon nous a laissé le portrait.
3°. Philon remarque que les Thérapeutes étaient une branche des Esséniens ; comment donc a-t-on pu en faire des chrétiens, et laisser les autres dans le judaïsme ?
Philon remarque encore que c'étaient des disciples de Moïse ; et c'est-là un caractère de judaïsme qui ne peut être contesté, surtout par des chrétiens. L'occupation de ces gens-là consistait à feuilleter les sacrés volumes, à étudier la philosophie qu'ils avaient reçue de leurs ancêtres, à y chercher des allégories, s'imaginant que les secrets de la nature étaient cachés sous les termes les plus clairs ; et pour s'aider dans cette recherche, ils avaient les commentaires des anciens ; car les premiers auteurs de cette secte avaient laissé divers volumes d'allégories, et leurs disciples suivaient cette méthode. Peut-on connaître là des chrétiens ? qui étaient ces ancêtres qui avaient laissé tant d'écrits, lorsqu'il y avait à peine un seul évangîle publié ? Peut-on dire que les écrivains sacrés nous aient laissé des volumes pleins d'allégories ? quelle religion serait la nôtre, si on ne trouvait que cela dans les livres divins ? Peut-on dire que l'occupation des premiers saints du Christianisme fut de chercher les secrets de la nature cachés sous les termes les plus clairs de la parole de Dieu ? Cela convenait à des mystiques et à des dévots contemplatifs, qui se mêlaient de médecine : cela convenait à des Juifs, dont les docteurs aimaient les allégories jusqu'à la fureur : mais ni les ancêtres, ni la philosophie, ni les volumes pleins d'allégories, ne conviennent point aux auteurs de la religion chrétienne, ni aux chrétiens.
4°. Les Thérapeutes s'enfermaient toute la semaine sans sortir de leurs cellules, et même sans oser regarder par les fenêtres, et ne sortaient de-là que le jour du sabbat, portant leurs mains sous le manteau : l'une entre la poitrine et la barbe, et l'autre sur le côté. Reconnait-on les Chrétiens à cette posture ? et le jour de leur assemblée qui était le samedi, ne marque-t-il pas que c'était là des Juifs, rigoureux observateurs du jour du repos que Moïse avait indiqué ? Accoutumés comme la cigale à vivre de rosée, ils jeunaient toute la semaine, mais ils mangeaient et se reposaient le jour du sabbat. Dans leurs fêtes ils avaient une table sur laquelle on mettait du pain, pour imiter la table des pains de proposition que Moïse avait placée dans le temple. On chantait des hymnes nouveaux, et qui étaient l'ouvrage du plus ancien de l'assemblée ; mais lorsqu'il n'en composait pas, on prenait ceux de quelque ancien poète. On ne peut pas dire qu'il y eut alors d'anciens poètes chez les Chrétiens ; et ce terme ne convient guère au prophète David. On dansait aussi dans cette fête ; les hommes et les femmes le faisaient en mémoire de la mer Rouge, parce qu'ils s'imaginaient que Moïse avait donné cet exemple aux hommes, et que sa sœur s'était mise à la tête des femmes pour les faire danser et chanter. Cette fête durait jusqu'au lever du soleil ; et dès le moment que l'aurore paraissait, chacun se tournait du côté de l'orient, se souhaitait le bon jour, et se retirait dans sa cellule pour méditer et contempler Dieu : on voit là la même superstition pour le soleil qu'on a déjà remarquée dans les Esséniens du premier ordre.
5°. Enfin, on n'adopte les Thérapeutes qu'à cause de leurs austérités, et du rapport qu'ils ont avec la vie monastique.
Mais ne voit-on pas de semblables exemples de tempérance et de chasteté chez les payens, et particulièrement dans la secte de Pythagore, à laquelle Joseph la comparait de son temps ? La communauté des biens avait ébloui Eusebe, et l'avait obligé de comparer les Esséniens aux fidèles dont il est parlé dans l'histoire des Actes, qui mettaient tout en commun. Cependant les disciples de Pythagore faisaient la même chose ; car c'était une de leurs maximes, qu'il n'était pas permis d'avoir rien en propre. Chacun apportait à la communauté ce qu'il possédait : on en assistait les pauvres, lors même qu'ils étaient absens ou éloignés ; et ils poussaient si loin la charité, que l'un d'eux condamné au supplice par Denys le tyran, trouva un pleige qui prit sa place dans la prison, c'est le souverain degré de l'amour que de mourir les uns pour les autres. L'abstinence des viandes était sévérement observée par les disciples de Pythagore, aussi-bien que par les Thérapeutes. On ne mangeait que des herbes crues ou bouillies. Il y avait une certaine portion de pain réglée, qui ne pouvait ni charger ni remplir l'estomac : on le frottait quelquefois d'un peu de miel. Le vin était défendu, et on n'avait point d'autre breuvage que l'eau pure. Pythagore voulait qu'on négligeât les plaisirs et les voluptés de cette vie, et ne les trouvait pas dignes d'arrêter l'homme sur la terre. Il rejetait les onctions d'huîle comme les Thérapeutes : ses disciples portaient des habits blancs ; ceux de lin paraissaient trop superbes, ils n'en avaient que de laine. Ils n'osaient ni railler, ni rire, et ils ne devaient point jurer par le nom de Dieu, parce que chacun devait faire connaître sa bonne foi, et n'avait pas besoin de ratifier sa parole par un serment. Ils avaient un profond respect pour les vieillards, devant lesquels ils gardaient longtemps le silence. Ils n'osaient faire de l'eau en présence du soleil, superstition que les Thérapeutes avaient encore empruntée d'eux. Enfin ils étaient fort entêtés de la spéculation et du repos qui l'accompagne ; c'est pourquoi ils en faisaient un de leurs préceptes les plus importants,
O juvenes ! tacitâ colite haec pia sacra quiete ;
disait Pythagore à ses disciples, à la tête d'un de ses ouvrages. En comparant les sectes des Thérapeutes et des Pythagoriciens, on les trouve si semblables dans tous les Chefs qui ont ébloui les Chrétiens, qu'il semble que l'une soit sortie de l'autre. Cependant si on trouve de semblables austérités chez les payens, on ne doit plus être étonné de les voir chez les Juifs éclairés par la loi de Moïse ; et on ne doit pas leur ravir cette gloire pour la transporter au Christianisme.
Histoire de la philosophie juive depuis la ruine de Jérusalem. La ruine de Jérusalem causa chez les Juifs des révolutions qui furent fatales aux Sciences. Ceux qui avaient échappé à l'epée des Romains, aux flammes qui réduisirent en cendres Jérusalem et son temple, ou qui après la désolation de cette grande ville, ne furent pas vendus au marché comme des esclaves et des bêtes de charge, tâchèrent de chercher une retraite et un asile. Ils en trouvèrent un en Orient et à Babylone, où il y avait encore un grand nombre de ceux qu'on y avait transportés dans les anciennes guerres : il était naturel d'aller implorer là la charité de leurs frères, qui s'y étaient fait des établissements considérables. Les autres se réfugièrent en Egypte, où il y avait aussi depuis longtemps beaucoup de Juifs puissants et assez riches pour recevoir ces malheureux ; mais ils portèrent là leur esprit de sédition et de révolte, ce qui y causa un nouveau massacre. Les rabbins assurent que les familles considérables furent transportées dès ce temps-là en Espagne, qu'ils appelaient sépharad ; et que c'est dans ce lieu où sont encore les restes des tribus de Benjamin et de Juda les descendants de la maison de David : c'est pourquoi les juifs de ce pays-là ont toujours regardé avec mépris ceux des autres nations, comme si le sang royal et la distinction des tribus s'étaient mieux conservées chez eux, que par-tout ailleurs. Mais il y eut un quatrième ordre de juifs qui pourraient à plus juste titre se faire honneur de leur origine. Ce furent ceux qui demeurèrent dans leur patrie, ou dans les masures de Jérusalem, ou dans les lieux voisins, dans lesquels ils se distinguèrent en rassemblant un petit corps de la nation, et par les charges qu'ils y exercèrent. Les rabbins assurent même que Tite fit transporter le sanhédrim à Japhné ou Jamnia, et qu'on érigea deux académies, l'une à Tibérias, et l'autre à Lydde. Enfin ils soutiennent qu'il y eut aussi dès ce temps-là un patriarche qui après avoir travaillé à rétablir la religion et son église dispersée, étendit son autorité sur toutes les synagogues de l'Occident.
On prétend que les académies furent érigées l'an 220 ou l'an 230 ; la plus ancienne était celle de Nahardea, ville située sur les bords de l'Euphrate. Un rabbin nommé Samuel prit la conduite de cette école : ce Samuel est un homme fameux dans sa nation. Elle le distingue par les titres de vigilant, d'arioch, de sapor boi, et de lunatique, parce qu'on prétend qu'il gouvernait le peuple aussi absolument que les rois font leurs sujets, et que le chemin du ciel lui était aussi connu que celui de son académie. Il mourut l'an 270 de J. C. et la ville de Nahardea ayant été prise l'an 278, l'académie fut ruinée.
On dit encore qu'on érigea d'abord l'académie à Sora, qui avait emprunté son nom de la Syrie ; car les Juifs le donnent à toutes les terres qui s'étendent depuis Damas et l'Euphrate, jusqu'à Babylone, et Sora était située sur l'Euphrate.
Pumdebita était une ville située dans la Mésopotamie, agréable par la beauté de ses édifices. Elle était fort décriée par les mœurs de ses habitants, qui étaient presque tous autant de voleurs : personne ne voulait avoir commerce avec eux ; et les Juifs ont encore ce proverbe : qu'il faut changer de domicîle lorsqu'on a un pumdébitain pour voisin. Rabbin Chasda ne laissa pas de la choisir l'an 290 pour y enseigner. Comme il avait été collègue de Huna qui régentait à Sora, il y a lieu de soupçonner que quelque jalousie ou quelque chagrin personnel l'engagea à faire cette erection. Il ne put pourtant donner à sa nouvelle académie le lustre et la réputation qu'avait déjà celle de Sora, laquelle tint toujours le dessus sur celle de Pumdebita.
On érigea deux autres académies l'an 373, l'une à Naresch proche de Sora, et l'autre à Machusia ; enfin il s'en éleva une cinquième à la fin du dixième siècle, dans un lieu nommé Peruts Sciabbur, où l'on dit qu'il y avait neuf mille Juifs.
Les chefs des académies ont donné beaucoup de lustre à la nation juive par leurs écrits, et ils avaient un grand pouvoir sur le peuple ; car comme le gouvernement des Juifs dépend d'une infinité de cas de conscience, et que Moïse a donné des lois politiques qui sont aussi sacrées que les cérémonielles, ces docteurs qu'on consultait souvent étaient aussi les maîtres des peuples. Quelques-uns craient même que depuis la ruine du temple, les conseils étant ruinés ou confondus avec les académies, le pouvoir appartenait entièrement aux chefs de ces académies.
Parmi tous ces docteurs juifs, il n'y en a eu aucun qui se soit rendu plus illustre, soit par l'intégrité de ses mœurs, soit par l'étendue de ses connaissances, que Juda le Saint. Après la ruine de Jérusalem, les chefs des écoles ou des académies qui s'étaient élévées dans la Judée, ayant pris quelque autorité sur le peuple par les leçons et les conseils qu'ils lui donnaient, furent appelés princes de la captivité. Le premier de ces princes fut Gamaliel, qui eut pour successeur Simeon III. son fils, après lequel parut Juda le Saint dont nous parlons ici. Celui-ci vint au monde le même jour qu'Attibas mourut ; et on s'imagine que cet événement avait été prédit par Salomon, qui a dit qu'un soleil se lève et qu'un soleil se couche. Attibas mourut sous Adrien, qui lui fit porter la peine de son imposture. Ghédalia place la mort violente de ce fourbe l'an 37, après la ruine du temple, qui serait la cent quarante-troisième année de l'ére chrétienne ; mais alors il serait évidemment faux que cet événement fut arrivé sous l'empire d'Adrien qui était déjà mort ; et si Juda le Saint naissait alors, il faut nécessairement fixer sa naissance à l'an 135 de J. C. On peut remarquer, en passant, qu'il ne faut pas s'arrêter aux calculs des Juifs, peu jaloux d'une exacte chronologie.
Le lieu de sa naissance était Tsippuri. Ce terme signifie un petit oiseau, et la ville était située sur une des montagnes de la Galilée. Les Juifs, jaloux de la gloire de Juda, lui donnent le titre de saint, ou même de saint des saints, à cause de la pureté de sa vie. Cependant je n'ose dire en quoi consistait cette pureté ; elle paraitrait badine et ridicule. Il devint le chef de la nation, et eut une si grande autorité, que quelques-uns de ses disciples ayant osé le quitter pour aller faire une intercalation à Lydde, ils eurent tous un mauvais regard ; c'est-à-dire, qu'ils moururent tous d'un châtiment exemplaire : mais ce miracle est fabuleux.
Juda devint plus recommandable par la répétition de la loi qu'il publia. Ce livre est un code du droit civil et canonique des Juifs, qu'on appelle Misnah. Il crut qu'il était souverainement nécessaire d'y travailler, parce que la nation dispersée en tant de lieux, avait oublié les rites, et se serait éloignée de la religion et de la jurisprudence de ses ancêtres, si on les confiait uniquement à leur mémoire. Au lieu qu'on expliquait auparavant la tradition selon la volonté des professeurs, ou par rapport à la capacité des étudiants, ou bien enfin selon les circonstances qui le demandaient, Juda fit une espèce de système et de cours qu'on suivit depuis exactement dans les académies. Il divisa ce rituel en six parties. La première roule sur la distinction des semences dans un champ, les arbres, les fruits, les décimes, etc. La seconde règle, l'observance des fêtes. Dans la troisième qui traite des femmes, on décide toutes les causes matrimoniales. La quatrième qui regarde les pertes, roule sur les procès qui naissent dans le commerce, et les procédures qu'on y doit tenir : on y ajoute un traité d'idolatrie, parce que c'est un des articles importants sur lesquels roulent les jugements. La cinquième partie regarde les oblations, et on examine dans la dernière tout ce qui est nécessaire à la purification.
Il est difficîle de fixer le temps auquel Juda le Saint commença et finit cet ouvrage, qui lui a donné une si grande réputation. Il faut seulement remarquer, 1°. qu'on ne doit pas le confondre avec le thalmud, dont nous parlerons bien-tôt, et qui ne fut achevé que longtemps après. 2°. On a mal placé cet ouvrage dans les tables chronologiques des synagogues, lorsqu'on compte aujourd'hui 1614 ans depuis sa publication ; car cette année tomberait sur l'année 140 de J. C. où Juda le Saint ne pouvait avoir que quatre ans. 3°. Au contraire, on le retarde trop, lorsqu'on assure qu'il fut publié cent cinquante ans après la ruine de Jérusalem ; car cette année tomberait sur l'an 220 ou 218 de J. C. et Juda était mort auparavant. 4°. En suivant le calcul qui est le plus ordinaire, Juda doit être né l'an 135 de J. C. Il peut avoir travaillé à ce recueil depuis qu'il fut prince de la captivité, et après avoir jugé souvent les différends qui naissaient dans sa nation. Ainsi on peut dire qu'il le fit environ l'an 180, lorsqu'il avait quarante-quatre ans, à la fleur de son âge, et qu'une assez longue expérience lui avait appris à décider les questions de la loi.
Juda s'acquit une si grande autorité par cet ouvrage, qu'il se mit au-dessus des lois ; car au lieu que pendant que Jérusalem subsistait, les chefs du Sanhédrim étaient soumis à ce conseil, et sujets à la peine, Juda, si l'on en croit les historiens de sa nation, s'éleva au-dessus des anciennes lais, et Siméon, fils de Lachis, ayant osé soutenir que le prince devait être fouetté lorsqu'il pêchait, Juda envoya ses officiers pour l'arrêter, et l'aurait puni sévèrement, s'il ne lui était échappé par une prompte fuite. Juda conserva son orgueil jusqu'à la mort ; car il voulut qu'on portât son corps avec pompe, et qu'on pleurât dans toutes les grandes villes où l'enterrement passerait, défendant de le faire dans les petites. Toutes les villes coururent à cet enterrement ; le jour fut prolongé, et la nuit retardée jusqu'à ce que chacun fût de retour dans sa maison, et eut le temps d'allumer une chandelle pour le sabbat. La fille de la voix se fit entendre, et prononça que tous ceux qui avaient suivi la pompe funèbre seraient sauvés, à l'exception d'un seul qui tomba dans le désespoir, et se précipita.
Origine du Thalmud et de la Gémare. Quoique le recueil des traditions, composé par Juda le Saint, sous le titre de Misnah, parut un ouvrage parfait, on ne laissait pas d'y remarquer encore deux défauts considérables : l'un, que ce recueil était confus, parce que l'auteur y avait rapporté le sentiment de différents docteurs, sans les nommer, et sans décider lequel de ces sentiments méritait d'être préféré ; l'autre défaut rendait ce corps de Droit canon presque inutile, parce qu'il était trop court, et ne résolvait qu'une petite partie des cas douteux, et des questions qui commençaient à s'agiter chez les Juifs.
Afin de remédier à ces défauts, Jochanan aidé de Rab et de Samuel, deux disciples de Juda le Saint, firent un commentaire sur l'ouvrage de leur maître, et c'est ce qu'on appelle le thalmud (thalmud signifie doctrine) de Jérusalem. Sait qu'il eut été composé en Judée pour les Juifs qui étaient restés en ce pays-là ; soit qu'il fût écrit dans la langue qu'on y parlait, les Juifs ne s'accordent pas sur le temps auquel cette partie de la gémare, qui signifie perfection, fut composée. Les uns craient que ce fut deux cent ans après la ruine de Jérusalem. Enfin, il y a quelques docteurs qui ne comptent que cent cinquante ans, et qui soutiennent que Rab et Samuel, quittant la Judée, allèrent à Babylone l'an 219 de l'ére chrétienne. Cependant ce sont-là les chefs du second ordre des théologiens qui sont appelés Gémaristes, parce qu'ils ont composé la gémare. Leur ouvrage ne peut être placé qu'après le règne de Dioclétien, puisqu'il y est parlé de ce prince. Le P. Morin soutient même qu'il y a des termes barbares, comme celui de borgheni, pour marquer un bourg, dont nous sommes redevables aux Vandales ou aux Goths ; d'où il conclut que cet ouvrage ne peut avoir paru que dans le cinquième siècle.
Il y avait encore un défaut dans la gémare ou le thalmud de Jérusalem ; car on n'y rapportait que les sentiments d'un petit nombre de docteurs. D'ailleurs il était écrit dans une langue très-barbare, qui était celle qu'on parlait en Judée, et qui s'était corrompue par le mélange des nations étrangères. C'est pourquoi les Amoréens, c'est-à-dire les commentateurs, commencèrent une nouvelle explication des traditions. R. Ase se chargea de ce travail. Il tenait son école à Sora, proche de Babylone ; et ce fut-là qu'il produisit son commentaire sur la misnah de Juda. Il ne l'acheva pas ; mais ses enfants et ses disciples y mirent la dernière main. C'est-là ce qu'on appelle la gémare ou le thalmud de Babylone, qu'on préfére à celui de Jérusalem. C'est un grand et vaste corps qui renferme les traditions, le droit canon des Juifs, et toutes les questions qui regardent la loi. La misnah est le texte ; la gémare en est le commentaire, et ces deux parties font le thalmud de Babylone.
La foule des docteurs juifs et chrétiens convient que le thalmud fut achevé l'an 500 ou 505 de l'ére chrétienne : mais le P. Morin, s'écartant de la route ordinaire, soutient qu'on aurait tort de croire tout ce que les Juifs disent sur l'antiquité de leurs livres, dont ils ne connaissent pas eux-mêmes l'origine. Il assure que la misnah ne put être composée que l'an 500, et le thalmud de Babylone l'an 700 ou environ. Nous ne prenons aucun intérêt à l'antiquité de ces livres remplis de traditions. Il faut même avouer qu'on ne peut fixer qu'avec beaucoup de peine et d'incertitude le temps auquel le thalmud peut avoir été formé, parce que c'est une compilation composée de décisions d'un grand nombre de docteurs qui ont étudié les cas de conscience, et à laquelle on a pu ajouter de temps en temps de nouvelles décisions. On ne peut se confier sur cette matière, ni au témoignage des auteurs juifs, ni au silence des chrétiens : les premiers ont intérêt à vanter l'antiquité de leurs livres, et ils ne sont pas exacts en matière de Chronologie : les seconds ont examiné rarement ce qui se passait chez les Juifs, parce qu'ils ne faisaient qu'une petite figure dans l'Empire. D'ailleurs leur conversion était rare et difficîle ; et pour y travailler, il fallait apprendre une langue qui leur paraissait barbare. On ne peut voir sans étonnement que dans ce grand nombre de prêtres et d'évêques qui ont composé le clergé pendant la durée de tant de siècles, il y en ait eu si peu qui aient su l'hébreu, et qui aient pu lire ou l'ancien Testament, ou les commentaires des Juifs dans l'original. On passait le temps à chicaner sur des faits ou des questions subtiles, pendant qu'on négligeait une étude utîle ou nécessaire. Les témoins manquent de toutes parts ; et comment s'assurer de la tradition, lorsqu'on est privé de ce secours ?
Jugements sur le Thalmud. On a porté quatre jugements différents sur le thalmud ; c'est-à-dire, sur ce corps de droit canon et de tradition. Les Juifs l'égalent à la loi de Dieu. Quelques Chrétiens l'estiment avec excès. Les troisiemes le condamnent au feu, et les derniers gardent un juste milieu entre tous ces sentiments. Il faut en donner une idée générale.
Les Juifs sont convaincus que les Thalmudistes n'ont jamais été inspirés, et ils n'attribuent l'inspiration qu'aux Prophètes. Cependant ils ne laissent pas de préférer le thalmud à l'Ecriture sainte ; car ils comparent l'Ecriture à l'eau, et la tradition à du vin excellent : la loi est le sel ; la misnah du poivre, et les thalmuds sont des aromates précieux. Ils soutiennent hardiment que celui qui péche contre Moïse peut être absous ; mais qu'on mérite la mort, lorsqu'on contredit les docteurs ; et qu'on commet un péché plus criant, en violant les préceptes des sages que ceux de la loi. C'est pourquoi ils infligent une peine sale et puante à ceux qui ne les observent pas : damnantur in stercore bullienti. Ils décident les questions et les cas de conscience par le thalmud comme par une loi souveraine.
Comme il pourrait paraitre étrange qu'on puise préférer les traditions à une loi que Dieu a dictée, et qui a été écrite par ses ordres, il ne sera pas inutîle de prouver ce que nous venons d'avancer par l'autorité des rabbins.
R. Isaac nous assure qu'il ne faut pas s'imaginer que la loi écrite soit le fondement de la religion ; au contraire, c'est la loi orale. C'est à cause de cette dernière loi que Dieu a traité alliance avec le peuple d'Israel. En effet, il savait que son peuple serait transporté chez les nations étrangères, et que les Payens transcriraient ses livres sacrés. C'est pourquoi il n'a pas voulu que la loi orale fût écrite, de peur qu'elle ne fût connue des idolatres ; et c'est ici un des préceptes généraux des rabbins : Apprents, mon fils, à avoir plus d'attention aux paroles des Scribes qu'aux paroles de la loi.
Les rabbins nous fournissent une autre preuve de l'attachement qu'ils ont pour les traditions, et de leur vénération pour les sages, en soutenant dans leur corps de Droit, que ceux qui s'attachent à la lecture de la Bible ont quelque degré de vertu ; mais il est médiocre, et il ne peut être mis en ligne de compte. Etudier la seconde loi ou la tradition, c'est une vertu qui mérite sa récompense, parce qu'il n'y a rien de plus parfait que l'étude de la gémare. C'est pourquoi Eléazar, étant au lit de la mort, répondit à ses écoliers, qui lui demandaient le chemin de la vie et du siècle à venir : Détournez vos enfants de l'étude de la Bible, et les mettez aux pieds des sages. Cette maxime est confirmée dans un livre qu'on appelle l'autel d'or ; car on y assure qu'il n'y a point d'étude au-dessus de celle du très-saint thalmud, et le R. Jacob donne ce précepte dans le thalmud de Jérusalem : Apprents, mon fils, que les paroles des Scribes sont plus aimables que celles de Prophètes.
Enfin, tout cela est prouvé par une historiette du roi Pirgandicus. Ce prince n'est pas connu, mais cela n'est point nécessaire pour découvrir le sentiment des rabbins. C'était un infidèle, qui pria onze docteurs fameux à souper. Il les reçut magnifiquement, et leur proposa de manger de la chair de pourceau, d'avoir commerce avec des femmes payennes, ou de boire du vin consacré aux idoles. Il fallait opter entre ces trois partis. On délibéra et on résolut de prendre le dernier, parce que les deux premiers articles avaient été défendus par la loi, et que c'étaient uniquement les rabbins qui défendaient de boire le vin consacré aux faux dieux. Le roi se conforma au choix des docteurs. On leur donna du vin impur, dont ils burent largement. On fit ensuite tourner la table, qui était sur un pivot. Les docteurs échauffés par le vin, ne prirent point garde à ce qu'ils mangeaient ; c'était de la chair de pourceaux. En sortant de table, on les mit au lit, où ils trouvèrent des femmes. La concupiscence échauffée par le vin, joua son jeu. Le remords ne se fit sentir que le lendemain matin, qu'on apprit aux docteurs qu'ils avaient violé la loi par degrés. Ils en furent punis : car ils moururent tous la même année de mort subite ; et ce malheur leur arriva, parce qu'ils avaient méprisé les préceptes des sages, et qu'ils avaient cru pouvoir le faire plus impunément que ceux de la loi écrite : et en effet on lit dans la misnah, que ceux qui péchent contre les paroles des sages sont plus coupables que ceux qui violent les paroles de la loi.
Les Juifs demeurent d'accord que cette loi ne suffit pas ; c'est pourquoi on y ajoute souvent de nouveaux commentaires dans lesquels on entre dans un détail plus précis, et on fait souvent de nouvelles décisions. Il est même impossible qu'on fasse autrement, parce que les définitions thalmudiques, qui sont courtes, ne pourvaient pas à tout, et sont très-souvent obscures ; mais lorsque le thalmud est clair, on le suit exactement.
Cependant on y trouve une infinité de choses qui pourraient diminuer la profonde vénération qu'on a depuis tant de siècles pour cet ouvrage, si on le lisait avec attention et sans préjugé. Le malheur des Juifs est d'aborder ce livre avec une obéissance aveugle pour tout ce qu'il contient. On forme son goût sur cet ouvrage, et on s'accoutume à ne trouver rien de beau que ce qui est conforme au thalmud ; mais si on l'examinait comme une compilation de différents auteurs qui ont pu se tromper, qui ont eu quelquefois un très-mauvais goût dans le choix des matières qu'ils ont traitées, et qui ont pu être ignorants, on y remarquerait cent choses qui avilissent la religion, au lieu d'en relever l'éclat.
On y conte que Dieu, afin de tuer le temps avant la création de l'univers, où il était seul, s'occupait à bâtir divers mondes qu'il détruisait aussi-tôt, jusqu'à ce que, par différents essais, il eut appris à en faire un aussi parfait que le nôtre. Ils rapportent la finesse d'un rabbin, qui trompa Dieu et le diable ; car il pria le démon de le porter jusqu'à la porte des cieux, afin qu'après avoir Ve de-là le bonheur des saints, il mourut plus tranquillement. Le diable fit ce que le rabbin demandait, lequel voyant la porte du ciel ouverte, se jeta dedans avec violence, en jurant son grand Dieu qu'il n'en sortirait jamais ; et Dieu, qui ne voulait pas laisser commettre un parjure, fut obligé de le laisser-là, pendant que le démon trompé s'en allait fort honteux. Non seulement on y fait Adam hermaphrodite ; mais on soutient qu'ayant voulu assouvir sa passion avec tous les animaux de la terre, il ne trouva qu'Eve qui put le contenter. Ils introduisent deux femmes qui vont disputer dans les synagogues sur l'usage qu'un mari peut faire d'elles ; et les rabbins décident nettement qu'un mari peut faire sans crime tout ce qu'il veut, parce qu'un homme qui achète un poisson, peut manger le devant ou le derrière, selon son bon plaisir. On y trouve des contradictions sensibles, et au lieu de se donner la peine de les lever, ils font intervenir une voix miraculeuse du ciel, qui crie que l'une et l'autre, quoique directement opposées, vient du ciel. La manière dont ils veulent qu'on traite les Chrétiens est dure : car ils permettent qu'on vole leur bien, qu'on les regarde comme des bêtes brutes, qu'on les pousse dans le précipice si on les voit sur le bord, qu'on les tue impunément, et qu'on fasse tous les matins de terribles imprécations contre eux. Quoique la haine et le désir de la vengeance aient dicté ces leçons, il ne laisse pas d'être étonnant qu'on seme dans un sommaire de la religion, des lois et des préceptes si évidemment opposés à la charité.
Les docteurs qui ont travaillé à ces recueils de traditions, profitant de l'ignorance de leur nation, ont écrit tout ce qui leur venait dans l'esprit, sans se mettre en peine d'accorder leurs conjectures avec l'histoire étrangère qu'ils ignoraient parfaitement.
L'historiette de César se plaignant à Gamaliel de ce que Dieu est un voleur, est badine. Mais devait-elle avoir sa place dans ce recueil ? César demande à Gamaliel pourquoi Dieu a dérobé une côte à Adam. La fille répond, au lieu de son père, que les voleurs étaient venus la nuit passée chez elle, et qu'ils avaient laissé un vase d'or dans sa maison, au lieu de celui de terre qu'ils avaient emporté, et qu'elle ne s'en plaignait pas. L'application du conte était aisée. Dieu avait donné une servante à Adam, au lieu d'une côte : le changement est bon : César l'approuva ; mais il ne laissa pas de censurer Dieu de l'avoir fait en secret et pendant qu'Adam dormait. La fille toujours habile, se fit apporter un morceau de viande cuite sous la cendre, et ensuite elle le présente à l'Empereur, lequel refuse d'en manger : cela me fait mal au cœur, dit César ; hé bien, répliqua la jeune fille, Eve aurait fait mal au cœur au premier homme, si Dieu la lui avait donnée grossièrement et sans art, après l'avoir formée sous ses yeux. Que de bagatelles !
Cependant il y a des Chrétiens qui, à l'imitation des Juifs, regardent le Thalmud comme une mine abondante, d'où l'on peut tirer des trésors infinis. Ils s'imaginent qu'il n'y a que le travail qui dégoute les hommes de chercher ces trésors, et de s'en enrichir : ils se plaignent (Sixtus Senensis. Galatin. Morin.) amèrement du mépris qu'on a pour les rabbins. Ils se tournent de tous les côtés, non-seulement pour les justifier, mais pour faire valoir ce qu'ils ont dit. On admire leurs sentences ; on trouve dans leurs rites mille choses qui ont du rapport avec la religion chrétienne, et qui en développent les mystères. Il semble que J. C. et ses apôtres n'aient pu avoir de l'esprit qu'en copiant les Rabbins qui sont venus après eux. Du moins c'est à l'imitation des Juifs que ce divin redempteur a fait un si grand usage du style métaphorique : c'est d'eux aussi qu'il a emprunté les paraboles du Lazare, des vierges folles, et celle des ouvriers envoyés à la vigne, car on les trouve encore aujourd'hui dans le Thalmud.
On peut raisonner ainsi par deux motifs différents, L'amour-propre fait souvent parler les docteurs. On aime à se faire valoir par quelqu'endroit ; et lorsqu'on s'est jeté dans une étude, sans peser l'usage qu'on en peut faire, on en relève l'utilité par intérêt ; on estime beaucoup un peu d'or chargé de beaucoup de crasse, parce qu'on a employé beaucoup de temps à le déterrer. On crie à la négligence ; et on accuse de paresse ceux qui ne veulent pas se donner la même peine, et suivre la route qu'on a prise. D'ailleurs on peut s'entêter des livres qu'on lit : combien de gens ont été fous de la théologie scolastique, qui n'apprenait que des mots barbares, au lieu des vérités solides qu'on doit chercher. On s'imagine que ce qu'on étudie avec tant de travail et de peine, ne peut être mauvais ; ainsi, soit par intérêt ou par préjugé, on loue avec excès ce qui n'est pas fort digne de louange.
N'est-il pas ridicule de vouloir que J. C. ait emprunté ses paraboles et ses leçons des Thalmudistes, qui n'ont vécu que trois ou quatre cent ans après lui ? Pourquoi veut-on que les Thalmudistes n'aient pas été ses copistes ? La plupart des paraboles qu'on trouve dans le Thalmud, sont différentes de celles de l'évangile, et on y a presque toujours un autre but. Celle des ouvriers qui vont tard à la vigne, n'est-elle pas revêtue de circonstances ridicules, et appliquée au R. Bon qui avait plus travaillé sur la loi en vingt-huit ans, qu'un autre n'avait fait en cent ? On a recueilli quantité d'expressions et de pensées des Grecs, qui ont rapport avec celles de l'évangile. Dira-t-on pour cela que J. C. ait copié les écrits des Grecs ? On dit que ces paraboles étaient dejà inventées, et avaient cours chez les Juifs avant que J. C. enseignât : mais d'où le sait-on ? Il faut deviner, afin d'avoir le plaisir de faire des Pharisiens autant de docteurs originaux, et de J. C. un copiste qui empruntait ce que les autres avaient de plus fin et de plus délicat. J. C. suivait ses idées, et débitait ses propres pensées ; mais il faut avouer qu'il y en a de communes à toutes les nations, et que plusieurs hommes disent la même chose, sans s'être jamais connus, ni avoir lu les ouvrages des autres. Tout ce qu'on peut dire de plus avantageux pour les Thalmudistes, c'est d'avoir fait des comparaisons semblables à celles de J. C. mais l'application que le fils de Dieu en faisait, et les leçons qu'il en a tirées, sont toujours belles et sanctifiantes, au lieu que l'application des autres est presque toujours puérîle et badine.
L'étude de la Philosophie cabalistique fut en usage chez les Juifs, peu de temps après la ruine de Jérusalem. Parmi les docteurs qui s'appliquèrent à cette prétendue science, R. Atriba, et R. Simeon Ben Jochaï furent ceux qui se distinguèrent le plus. Le premier est auteur du livre Jezivah, ou de la création ; le second, du Sohar, ou du livre de la splendeur. Nous allons donner l'abrégé de la vie de ces deux hommes si célèbres dans leur nation.
Atriba fleurit peu après que Tite eut ruiné la ville de Jérusalem. Il n'était juif que du côté de sa mère, et l'on prétend que son père descendait de Lisera, général d'armée de Jabin, roi de Tyr. Atriba vécut à la campagne jusqu'à l'âge de quarante ans, et n'y eut pas un emploi fort honorable, puisqu'il y gardait les troupeaux de Calba Schuva, riche bourgeois de Jérusalem. Enfin il entreprit d'étudier, à l'instigation de la fille de son maître, laquelle lui promit de l'épouser, s'il faisait de grands progrès dans les sciences. Il s'appliqua si fortement à l'étude pendant les vingt-quatre ans qu'il passa aux académies, qu'après cela il se vit environné d'une foule de disciples, comme un des plus grands maîtres qui eussent été en Israèl. Il avait, dit-on, jusqu'à vingtquatre mille écoliers. Il se déclara pour l'imposteur Barcho-chebas, et soutint que c'était de lui qu'il fallait entendre ces paroles de Balaam, une étoîle sortira de Jacob, et qu'on avait en sa personne le véritable messie. Les troupes que l'empereur Hadrien envoya contre les Juifs, qui sous la conduite de ce faux messie, avaient commis des massacres épouvantables, exterminèrent cette faction. Atriba fut pris et puni du dernier supplice avec beaucoup de cruauté. On lui déchira la chair avec des peignes de fer, mais de telle sorte qu'on faisait durer la peine, et qu'on ne le fit mourir qu'à petit feu. Il vécut six vingt ans, et fut enterré avec sa femme dans une caverne, sur une montagne qui n'est pas loin de Tibériade. Ses 24 mille disciples furent enterrés au-dessous de lui sur la même montagne. Je rapporte ces choses, sans prétendre qu'on les croye toutes. On l'accuse d'avoir altéré le texte de la bible, afin de pouvoir répondre à une objection des Chrétiens. En effet jamais ces derniers ne disputèrent contre les Juifs plus fortement que dans ce temps-là, et jamais aussi ils ne les combattirent plus efficacement. Car ils ne faisaient que leur montrer d'un côté les évangiles, et de l'autre les ruines de Jérusalem, qui étaient devant leurs yeux, pour les convaincre que J. C. qui avait si clairement prédit sa désolation, était le prophète que Moïse avait promis. Ils les pressaient vivement par leurs propres traditions, qui portaient que le Christ se manifesterait après le cours d'environ six mille ans, en leur montrant que ce nombre d'années était accompli.
Les Juifs donnent de grands éloges à Atriba ; ils l'appelaient Sethumtaah, c'est-à-dire, l'autentique. Il faudrait un volume tout entier, dit l'un deux (Zautus) si l'on voulait parler dignement de lui. Son nom, dit un autre (Kionig) a parcouru tout l'univers, et nous avons reçu de sa bouche toute la loi orale.
Nous avons déjà dit que Simeon Jochaïdes est l'auteur du fameux livre de Zohar, auquel on a fait depuis un grand nombre d'additions. Il est important de savoir ce qu'on dit de cet auteur et de son livre, puisque c'est-là où sont renfermés les mystères de la cabale, et qu'on lui donne la gloire de les avoir transmis à la postérité.
On croit que Siméon vivait quelques années avant la ruine de Jérusalem. Tite le condamna à la mort, mais son fils et lui se dérobèrent à la persécution, en se cachant dans une caverne, où ils eurent le loisir de composer le livre dont nous parlons. Cependant comme il ignorait encore diverses choses, le prophète Elie descendait de temps en temps du ciel dans la caverne pour l'instruire, et Dieu l'aidait miraculeusement, en ordonnant aux mots de se ranger les uns auprès des autres, dans l'ordre qu'ils devaient avoir pour former de grands mystères.
Ces apparitions d'Elie et le secours miraculeux de Dieu embarrassent quelques auteurs chrétiens ; ils estiment trop la cabale, pour avouer que celui qui en a révélé les mystères, soit un imposteur qui se vante mal-à-propos d'une inspiration divine. Soutenir que le démon qui animait au commencement de l'église chrétienne Apollonius de Thyane, afin d'ébranler la foi des miracles apostoliques, répandit aussi chez les Juifs le bruit de ces apparitions fréquentes d'Elie, afin d'empêcher qu'on ne crut celle qui s'était faite pour J. C. lorsqu'il fut transfiguré sur le Thabor ; c'est se faire illusion, car Dieu n'exauce point la prière des démons lorsqu'ils travaillent à perdre l'Eglise, et ne fait point dépendre d'eux l'apparition des prophetes. On pourrait tourner ces apparitions en allégories ; mais on aime mieux dire que Siméon Jochaïdes dictait ces mystères avec le secours du ciel : c'est le témoignage que lui rend un chrétien (Knorrius) qui a publié son ouvrage.
La première partie de cet ouvrage a pour titre Zeniutha, ou mystère, parce qu'en effet on y révéle une infinité de choses. On prétend les tirer de l'Ecriture-sainte, et en effet on ne propose presque rien sans citer quelqu'endroit des écrivains sacrés, que l'auteur explique à sa manière. Il serait difficîle d'en donner un extrait suivi ; mais on y découvre particulièrement le microprosopon, c'est-à-dire le petit visage ; le macroprosopon, c'est-à-dire le long visage ; sa femme, les neuf et les treize conformations de sa barbe.
On entre dans un plus grand détail dans le livre suivant, qu'on appelle le grand sinode. Siméon avait beaucoup de peine à révéler ces mystères à ses disciples ; mais comme ils lui représentèrent que le secret de l'éternel est pour ceux qui le craignent, et qu'ils l'assurèrent tous qu'ils craignaient Dieu, il entra plus hardiment dans l'explication des grandes vérités. Il explique la rosée du cerveau du vieillard ou du grand visage. Il examine ensuite son crâne, ses cheveux, car il porte sur sa tête mille millions de milliers, et sept mille cinq cent boucles de cheveux blancs comme la laine. A chaque boucle il y a quatre cent dix cheveux, selon le nombre du mot Kadosch. Des cheveux on passe au front, aux yeux, au nez, et toutes ces parties du grand visage renferment des choses admirables ; mais surtout sa barbe est une barbe qui mérite des éloges infinis : " cette barbe est au-dessus de toute louange ; jamais ni prophète ni saint n'approcha d'elle ; elle est blanche comme la neige ; elle descend jusqu'au nombril ; c'est l'ornement des ornements, et la vérité des vérités ; malheur à celui qui la touche : il y a treize parties dans cette barbe, qui renferment toutes de grands mystères ; mais il n'y a que les initiés qui les comprennent ".
Enfin le petit synode est le dernier adieu que Siméon fit à ses disciples. Il fut chagrin de voir sa maison remplie de monde, parce que le miracle d'un feu surnaturel qui en écartait la foule des disciples pendant la tenue du grand synode, avait cessé ; mais quelques-uns s'étant retirés, il ordonna à R. Abba d'écrire ses dernières paroles : il expliqua encore une fois le vieillard : " sa tête est cachée dans un lieu supérieur, où on ne la voit pas ; mais elle répand son front qui est beau, agréable ; c'est le bon plaisir des plaisirs ". On parle avec la même obscurité de toutes les parties du petit visage, sans oublier celle qui adoucit la femme.
Si on demande à quoi tendent tous les mystères, il faut avouer qu'il est très-difficîle de les découvrir, parce que toutes les expressions allégoriques étant susceptibles de plusieurs sens, et faisant naître des idées très différentes, on ne peut se fixer qu'après beaucoup de peine et de travail ; et qui veut prendre cette peine, s'il n'espère en tirer de grands usages ?
Remarquons plutôt que cette méthode de peindre les opérations de la divinité sous des figures humaines, était fort en usage chez les Egyptiens ; car ils peignaient un homme avec un visage de feu, et des cornes, une crosse à la main droite, sept cercles à la gauche, et des ailes attachées à ses épaules. Ils représentaient par là Jupiter ou le Soleil, et les effets qu'il produit dans le monde. Le feu du visage signifiait la chaleur qui vivifie toutes choses ; les cornes, les rayons de lumière. Sa barbe était mystérieuse, aussi bien que celle du long visage des cabalistes ; car elle indiquait les éléments. Sa crosse était le symbole du pouvoir qu'il avait sur tous les corps sublunaires. Ses cuisses était la terre chargée d'arbres et de moissons ; les eaux sortaient de son nombril ; ses genoux indiquaient les montagnes, et les parties raboteuses de la terre ; les ailes, les vents et la promptitude avec laquelle ils marchent : enfin les cercles étaient le symbole des planètes.
Siméon finit sa vie en débitant toutes ces visions. Lorsqu'il parlait à ses disciples, une lumière éclatante se répandit dans toute la maison, tellement qu'on n'osait jeter les yeux sur lui. Un feu était au-dehors, qui empêchait les voisins d'entrer ; mais le feu et la lumière ayant disparu, on s'aperçut que la lampe d'Israèl était éteinte. Les disciples de Zippori vinrent en foule pour honorer ses funérailles, et lui rendre les derniers devoirs ; mais on les renvoya, parce que Eleazar son fils et R. Abba qui avait été le secrétaire du petit synode, voulaient agir seuls. En l'enterrant on entendit une voix qui criait : Venez aux nôces de Siméon ; il entrera en paix et reposera dans sa chambre. Une flamme marchait devant le cercueil, et semblait l'embraser ; et lorsqu'on le mit dans le tombeau, on entendit crier : C'est ici celui qui a fait trembler la terre, et qui a ébranlé les royaumes. C'est ainsi que les Juifs font de l'auteur du Zohar un homme miraculeux jusqu'après sa mort, parce qu'ils le regardent comme le premier de tous les cabalistes.
Des grands hommes qui ont fleuri chez les Juifs dans le douzième siècle. Le douzième siècle fut très-fécond en docteurs habiles. On ne se souciera peut-être pas d'en voir le catalogue, parce que ceux qui passent pour des oracles dans les synagogues, paraissent souvent de très-petits génies à ceux qui lisent leurs ouvrages sans préjugé. Les Chrétiens demandent trop aux rabbins, et les rabbins donnent trop peu aux Chrétiens. Ceux-ci ne lisent presque jamais les livres composés par un juif, sans un préjugé avantageux pour lui. Ils s'imaginent qu'ils doivent y trouver une connaissance exacte des anciennes cérémonies, des événements obscurs ; en un mot qu'on doit y lire la solution de toutes les difficultés de l'Ecriture. Pourquoi cela ? Parce qu'un homme est juif, s'ensuit-il qu'il connaisse mieux l'histoire de sa nation que les Chrétiens, puisqu'il n'a point d'autres secours que la bible et l'histoire de Joseph, que le juif ne lit presque jamais ? S'imagine-t-on qu'il y a dans cette nation certains livres que nous ne connaissons pas, et que ces Messieurs ont lus ? C'est vouloir se tromper, car ils ne citent aucun monument qui soit plus ancien que le christianisme. Vouloir que la tradition se soit conservée plus fidèlement chez eux, c'est se repaitre d'une chimère ; car comment cette tradition aurait-elle pu passer de lieu en lieu, et de bouche en bouche pendant un si grand nombre de siècles et de dispersions fréquentes ? Il suffit de lire un rabbin pour connaître l'attachement violent qu'il a pour sa nation, et comment il déguise les faits, afin de les accommoder à ses préjugés. D'un autre côté les Rabbins nous donnent beaucoup moins qu'ils ne peuvent. Ils ont deux grands avantages sur nous ; car possédant la langue sainte dès leur naissance, ils pourraient fournir des lumières pour l'explication des termes obscurs de l'Ecriture ; et comme ils sont obligés de pratiquer certaines cérémonies de la loi, ils pourraient par-là nous donner l'intelligence des anciennes. Ils le font quelquefois ; mais souvent au lieu de chercher le sens littéral des Ecritures, ils courent après des sens mystiques qui font perdre de vue le but de l'écrivain, et l'intention du saint-Esprit. D'ailleurs ils descendent dans un détail excessif des cérémonies sous lesquelles ils ont enseveli l'esprit de la loi.
Si on veut faire un choix de ces docteurs, ceux du douzième siècle doivent être préférés à tous les autres : car non-seulement ils étaient habiles, mais ils ont fourni de grands secours pour l'intelligence de l'ancien Testament. Nous ne parlerons ici que d'Aben-Ezra, et de Maïmonides, comme les plus fameux.
Aben-Ezra est appelé le sage par excellence ; il naquit l'an 1099, et il mourut en 1174, âgé de 75 ans. Il l'insinue lui-même, lorsque prévoyant sa mort, il disait que comme Abraham sortit de Charan âgé de 75 ans, il sortirait aussi dans le même temps de Charon ou du feu de la colere du siècle. Il voyagea, parce qu'il crut que cela était nécessaire pour faire de grands progrès dans les sciences. Il mourut à Rhodes, et sit porter de-là ses os dans la Terre-sainte.
Ce fut un des plus grands hommes de sa nation et de son siècle. Comme il était bon astronome, il fit de si heureuses découvertes dans cette science, que les plus habiles mathématiciens ne se sont pas fait un scrupule de les adopter. Il excella dans la médecine, mais ce fut principalement par ses explications de l'écriture, qu'il se fit connaître. Au lieu de suivre la méthode ordinaire de ceux qui l'avaient précédé, il s'attacha à la grammaire et au sens littéral des écrits sacrés, qu'il développe avec tant de pénétration et de jugement, que les Chrétiens même le préfèrent à la plupart de leurs interpretes. Il a montré le chemin aux critiques qui soutiennent aujourd'hui que le peuple d'Israèl ne passa point au travers de la mer Rouge, mais qu'il y fit un cercle pendant que l'eau était basse afin que Pharaon les suivit, et fût submergé ; mais ce n'est pas là une de ses meilleures conjectures. Il n'osa rejeter absolument la cabale, quoiqu'il en connut le faible, parce qu'il eut peur de se faire des affaires avec les auteurs de son temps qui y étaient fort attachés, et même avec le peuple qui regardait le livre de Zohar rempli de ces sortes d'explications, comme un ouvrage excellent : il déclara seulement que cette méthode d'interprêter l'Ecriture n'était pas sure, et que si on respectait la cabale des anciens, on ne devait pas ajouter de nouvelles explications à celles qu'ils avaient produites, ni abandonner l'écriture au caprice de l'esprit humain.
Maimonides (il s'appelait Moïse, et était fils de Maïmon, mais il est plus connu par le nom de son père : on l'appelle Maïmonides ; quelques uns le font naître l'an 1133). Il parut dans le même siècle. Scaliger soutenait que c'était-là le premier des docteurs qui eut cessé de badiner chez les Juifs, comme Diodore chez les Grecs. En effet il avait trouvé beaucoup de vide dans l'étude de la gémare ; il regrettait le temps qu'il y avait perdu, et s'appliquant à des études plus solides, il avait beaucoup médité sur l'Ecriture. Il savait le grec ; il avait lu les philosophes, et particulièrement Aristote, qu'il cite souvent. Il causa de si violentes émotions dans les synagogues, que celles de France et d'Espagne s'excommunièrent à cause de lui. Il était né à Cordoue l'an 1131. Il se vantait d'être descendu de la maison de David, comme font la plupart des Juifs d'Espagne. Maïmon son père et juge de sa nation en Espagne, comptait entre ses ancêtres une longue suite de personnes qui avaient possédé successivement cette charge. On dit qu'il fut averti en songe de rompre la résolution qu'il avait prise de garder le célibat, et de se marier à une fille de boucher qui était sa voisine. Maïmon feignit peut-être un songe pour cacher une amourette qui lui faisait honte, et fit intervenir le miracle pour colorer sa faiblesse. La mère mourut en mettant Moïse au monde, et Maïmon se remaria. Je ne sais si la seconde femme qui eut plusieurs enfants, haïssait le petit Moïse, ou s'il avait dans sa jeunesse un esprit morne et pesant, comme on le dit. Mais son père lui reprochait sa naissance, le battit plusieurs fais, et enfin le chassa de sa maison. On dit que ne trouvant point d'autre gîte que le couvert d'une synagogue, il y passa la nuit, et à son reveil il se trouva un homme d'esprit tout différent de ce qu'il était auparavant. Il se mit sous la discipline de Joseph le Lévite, fils de Mégas, sous lequel il fit en peu de temps de grands progrès. L'envie de revoir le lieu de sa naissance le prit ; mais en retournant à Cordoue, au lieu d'entrer dans la maison de son père, il enseigna publiquement dans la synagogue avec un grand étonnement des assistants : son père qui le reconnut alla l'embrasser, et le reçut chez lui. Quelques historiens s'inscrivent en faux contre cet événement, parce que Joseph fils de Mégas, n'était âgé que de dix ans plus que Moïse. Cette raison est puérîle ; car un maître de trente ans peut instruire un disciple qui n'en a que vingt. Mais il est plus vraisemblable que Maimon instruisit lui-même son fils, et ensuite l'envoya étudier sous Averroès, qui était alors dans une haute réputation, chez les Arabes. Ce disciple eut un attachement et une fidélité exemplaires pour son maître. Averroès était déchu de sa faveur par une nouvelle révolution arrivée chez les Maures en Espagne. Abdi Amoumen, capitaine d'une troupe de bandits, qui se disait descendu en ligne droite d'Houssain fils d'Aly, avait détroné les Marabouts en Afrique, et ensuite il était entré l'an 1144 en Espagne, et se rendit en peu de temps maître de ce royaume : il fit chercher Averroès qui avait eu beaucoup de crédit à la cour des Marabouts, et qui lui était suspect. Ce docteur se réfugia chez les Juifs, et confia le secret de sa retraite à Maïmonides, qui aima mieux souffrir tout, que de découvrir le lieu où son maître était caché. Abulpharage dit même que Maïmonides changea de religion, et qu'il se fit Musulman, jusqu'à ce que ayant donné ordre à ses affaires, il passa en Egypte pour vivre en liberté. Ses amis ont nié la chose, mais Averroès qui voulait que son âme fût avec celle des Philosophes, parce que le Mahométisme était la religion des pourceaux, le Judaïsme celle des enfants, et le Christianisme impossible à observer, n'avait pas inspiré un grand attachement à son disciple pour la loi. D'ailleurs un Espagnol qui alla persécuter ce docteur en Egypte jusqu'à la fin de sa vie, lui reprocha cette faiblesse avec tant de hauteur, que l'affaire fut portée devant le sultan, lequel jugea que tout ce qu'on fait involontairement et par violence en matière de religion, doit être compté pour rien ; d'où il concluait que Maïmonides n'avait jamais été musulman. Cependant c'était le condamner et décider contre lui, en même temps qu'il semblait l'absoudre ; car il déclarait que l'abjuration était véritable, mais exempte de crime ; puisque la volonté n'y avait pas eu de part. Enfin on a lieu de soupçonner Maïmonides d'avoir abandonné sa religion par sa morale relâchée sur cet article ; car non seulement il permet aux Noachides de retomber dans l'idolatrie si la nécessité le demande, parce qu'ils n'ont reçu aucun ordre de sanctifier le nom de Dieu ; mais il soutient qu'on ne pêche point en sacrifiant avec les idolâtres, et en renonçant à la religion, pourvu qu'on ne le fasse point en présence de dix personnes ; car alors il faut mourir plutôt que de renoncer à la loi ; mais Maïmonides croyait que ce péché cesse lorsqu'on le commet en secret. (Maimon. fundam. leg. cap. v.) La maxime est singulière, car ce n'est plus la religion qu'il faut aimer et défendre au péril de sa vie : c'est la présence de dix Israèlites qu'il faut craindre, et qui seule fait le crime. On a lieu de soupçonner que l'interêt avait dicté à Maïmonides une maxime si bizarre, et qu'ayant abjuré le Judaïsme en secret, il croyait calmer sa conscience, et se défendre à la faveur de cette distinction. Quoi qu'il en sait, Maïmonides demeura en Egypte le reste de ses jours, ce qui l'a fait appeler Moïse l'Egyptien. Il y fut longtemps sans emploi, tellement qu'il fut réduit au métier de Jouailler. Cependant il ne laissait pas d'étudier, et il acheva alors son commentaire sur la misnah, qu'il avait commencé en Espagne dès l'âge de vingt-trois ans. Alphadel, fils de Saladin, étant revenu en Egypte, après en avoir été chassé par son frère, connut le mérite de Maïmonides, et le choisit pour son médecin : il lui donna pension. Maïmonides assure que cet emploi l'occupait absolument, car il était obligé d'aller tous les jours à la cour, et d'y demeurer longtemps s'il y avait quelque malade. En revenant chez lui il trouvait quantité de personnes qui venaient le consulter. Cependant il ne laissa pas de travailler pour son bienfaiteur ; car il traduisit Avicenne, et on voit encore à Bologne, cet ouvrage qui fut fait par ordre d'Alphadel, l'an 1194.
Les Egyptiens furent jaloux de voir Maïmonides si puissant à la cour : pour l'en arracher, les médecins lui demandèrent un essai de son art. Pour cet effet, ils lui présentèrent un verre de poison, qu'il avala sans en craindre l'effet, parce qu'il avait le contre-poison ; mais ayant oblige dix médecins à avaler son poison, ils moururent tous, parce qu'ils n'avaient pas d'antidote spécifique. On dit aussi que d'autres médecins mirent un verre de poison auprès du lit du sultan, pour lui persuader que Maïmonides en voulait à sa vie, et qu'on l'obligea de se couper les veines. Mais il avait appris qu'il y avait dans le corps humain une veine que les Médecins ne connaissaient pas, et qui n'étant pas encore coupée, l'effusion entière du sang ne pouvait se faire ; il se sauva par cette veine inconnue. Cette circonstance ne s'accorde point avec l'histoire de sa vie.
En effet, non-seulement il protégea sa nation à la cour des nouveaux sultants qui s'établissaient sur la ruine des Aliades, mais il fonda une académie à Alexandrie, où un grand nombre de disciples vinrent du fonds de l'Egypte, de la Syrie, et de la Judée, pour étudier sous lui. Il en aurait eu beaucoup davantage, si une nouvelle persécution arrivée en orient, n'avait empêché les étrangers de s'y rendre. Elle fut si violente, qu'une partie des Juifs fut obligée de se faire mahométants pour se garantir de la misere : et Maïmonides qui ne pouvait leur inspirer de la fermeté, se trouva réduit comme un grand nombre d'autres, à faire le faux prophète, et à promettre à ses religionnaires une délivrance qui n'arriva pas. Il mourut au commencement du XIIIe siècle, et ordonna qu'on l'enterrât à Tibérias, où ses ancêtres avaient leur sépulture.
Ce docteur composa un grand nombre d'ouvrages ; il commenta la misnah ; il fit une main forte, et le docteur des questions douteuses. On prétend qu'il écrivit en Médecine, aussi-bien qu'en Théologie et en grec comme en arabe ; mais que ces livres sont très-rares ou perdus. On l'accuse d'avoir méprisé la cabale jusqu'à sa vieillesse ; mais on dit que trouvant alors à Jérusalem un homme très-habîle dans cette science, il s'était appliqué fortement à cette étude. Rabbi Chaiim assure avoir Ve une lettre de Maïmonides, qui témoignait son chagrin de n'avoir pas percé plutôt dans les mystères de la Loi : mais on croit que les Cabalistes ont supposé cette lettre, afin de n'avoir pas été méprisés par un homme qu'on appelle la lumière de l'orient et de l'occident.
Ses ouvrages furent reçus avec beaucoup d'applaudissement ; cependant il faut avouer qu'il avait souvent des idées fort abstraites, et qu'ayant étudié la Métaphysique, il en faisait un trop grand usage. Il soutenait que toutes les facultés étaient des anges ; il s'imaginait qu'il expliquait par-là beaucoup plus nettement les opérations de la Divinité, et les expressions de l'Ecriture. N'est-il pas étrange, disait-il, qu'on admette ce que disent quelques docteurs, qu'un ange entre dans le sein de la femme pour y former un embryon ; quoique ces mêmes docteurs assurent qu'un ange est un feu consumant, au lieu de reconnaître plutôt que la faculté générante est un ange ? C'est pour cette raison que Dieu parle souvent dans l'Ecriture, et qu'il dit, faisons l'homme à notre image, parce que quelques rabbins avaient conclu de ce passage, que Dieu avait un corps, quoiqu'infiniment plus parfait que les nôtres ; il soutint que l'image signifie la forme essentielle qui constitue une chose dans son être. Tout cela est fort subtil, ne lève point la difficulté, et ne découvre point le véritable sens des paroles de Dieu. Il croyait que les astres sont animés, et que les sphères célestes vivent. Il disait que Dieu ne s'était repenti que d'une chose, d'avoir confondu les bons avec les méchants dans la ruine du premier temple. Il était persuadé que les promesses de la Loi, qui subsistera toujours, ne regardent qu'une félicité temporelle, et qu'elles seront accomplies sous le règne du Messie. Il soutient que le royaume de Juda fut rendu à la postérité de Jéchonias, dans la personne de Salatiel, quoique S. Luc assure positivement que Salatiel n'était pas fils de Jéchonias, mais de Néri.
De la Philosophie exotérique des Juifs. Les Juifs avaient deux espèces de philosophie : l'une exotérique, dont les dogmes étaient enseignés publiquement, soit dans les livres, soit dans les écoles, l'autre esotérique, dont les principes n'étaient révélés qu'à un petit nombre de personnes choisies, et étaient soigneusement cachés à la multitude. Cette dernière science s'appelle cabale. Voyez l'article CABALE.
Avant de parler des principaux dogmes de la philosophie exotérique, il ne sera pas inutîle d'avertir le lecteur, qu'on ne doit pas s'attendre à trouver chez les Juifs de la justesse dans les idées, de l'exactitude dans le raisonnement, de la précision dans le style ; en un mot, tout ce qui doit caractériser une saine philosophie. On n'y trouve au contraire qu'un mélange confus des principes de la raison et de la révélation, une obscurité affectée, et souvent impénétrable, des principes qui conduisent au fanatisme, un respect aveugle pour l'autorité des Docteurs, et pour l'antiquité ; en un mot, tous les défauts qui annoncent une nation ignorante et superstitieuse : voici les principaux dogmes de cette espèce de philosophie.
Idée que les Juifs ont de la Divinité. I. L'unité d'un Dieu fait un des dogmes fondamentaux de la synagogue moderne, aussi-bien que des anciens Juifs : ils s'éloignent également du païen, qui croit la pluralité des dieux, et des Chrétiens qui admettent trois personnes divines dans une seule essence.
Les rabbins avouent que Dieu serait fini s'il avait un corps : ainsi, quoiqu'ils parlent souvent de Dieu, comme d'un homme, ils ne laissent pas de le regarder comme un être purement spirituel. Ils donnent à cette essence infinie toutes les perfections qu'on peut imaginer, et en écartent tous les défauts qui sont attachés à la nature humaine, ou à la créature ; surtout ils lui donnent une puissance absolue et sans bornes, par laquelle il gouverne l'univers.
II. Le juif qui convertit le roi de Cozar, expliquait à ce prince les attributs de la Divinité d'une manière orthodoxe. Il dit que, quoiqu'on appelle Dieu miséricordieux, cependant il ne sent jamais le frémissement de la nature, ni l'émotion du cœur, puisque c'est une faiblesse dans l'homme : mais on entend par-là que l'Etre souverain fait du bien à quelqu'un. On le compare à un juge qui condamne et qui absout ceux qu'on lui présente, sans que son esprit ni son cœur soient altérés par les différentes sentences qu'il prononce ; quoique de-là dépendent la vie ou la mort des coupables. Il assure qu'on doit appeler Dieu lumière : (Corri. part. II.) mais il ne faut pas s'imaginer que ce soit une lumière réelle, ou semblable à celle qui nous éclaire ; car on ferait Dieu corporel, s'il était véritablement lumière : mais on lui donne ce nom, parce qu'on craint qu'on ne le conçoive comme ténébreux. Comme cette idée serait trop basse, il faut l'écarter, et concevoir Dieu sous celle d'une lumière éclatante et inaccessible. Quoiqu'il n'y ait que les créatures qui soient susceptibles de vie et de mort, on ne laisse pas de dire que Dieu vit, et qu'il est la vie ; mais on entend par-là qu'il existe éternellement, et on ne veut pas le réduire à la condition des êtres mortels. Toutes ces explications sont pures, et conformes aux idées que l'Ecriture nous donne de Dieu.
III. Il est vrai qu'on trouve souvent dans les écrits des Docteurs certaines expressions fortes, et quelques actions attribuées à la Divinité, qui scandalisent ceux qui n'en pénètrent pas le sens ; et delà vient que ces gens-là chargent les rabbins de blasphêmes et d'impiétés, dont ils ne sont pas coupables. En effet, on peut ramener ces expressions à un bon sens, quoiqu'elles paraissent profanes aux uns, et risibles aux autres. Ils veulent dire que Dieu n'a châtié qu'avec douleur son peuple, lorsqu'ils l'introduisent pleurant pendant les trois veilles de la nuit, et criant, malheur à moi qui ai détruit ma maison, et dispersé mon peuple parmi les nations de la terre. Quelque forte que soit l'expression, on ne laisse pas d'en trouver de semblables dans les Prophètes. Il faut pourtant avouer qu'ils outrent les choses, en ajoutant qu'ils ont entendu souvent cette voix lamentable de la Divinité, lorsqu'ils passent sur les ruines du temple ; car la fausseté du fait est évidente. Ils badinent dans une chose sérieuse, quand ils ajoutent que deux des larmes de la Divinité, qui pleure la ruine de sa maison, tombent dans la mer, et y causent de violents mouvements ; ou lorsqu' entêtés de leurs téphilims, ils en mettent autour de la tête de Dieu, pendant qu'ils prient que sa justice cede enfin à sa miséricorde. S'ils veulent vanter par-là la necessité des téphilims, il ne faut pas le faire aux dépens de la Divinité qu'on habille ridiculement aux yeux des peuples.
IV. Ils ont seulement dessein d'étaler les effets de la puissance infinie de Dieu, en disant que c'est un lion, dont le rugissement fait un bruit horrible ; et en contant que César ayant eu dessein de voir Dieu, R. Josué le pria de faire sentir les effets de sa présence. A cette prière, la Divinité se retira à quatre cent lieues de Rome ; il rugit et le bruit de ce rugissement fut si terrible que la muraille de la ville tomba, et toutes les femmes enceintes avortèrent. Dieu s'approchant plus près de cent lieues, et rugissant de la même manière, César effrayé du bruit, tomba de dessus son trône, et tous les Romains qui vivaient alors, perdirent leurs dents molaires.
V. Ils veulent marquer sa présence dans le paradis terrestre, lorsqu'ils le font promener dans ce lieu délicieux comme un homme. Ils insinuent que les âmes apportent leur ignorance de la terre, et ont peine à s'instruire des merveilles du paradis, lorsqu'ils représentent ce même Dieu comme un maître d'école qui enseigne les nouveaux venus dans le ciel. Ils veulent relever l'excellence de la synagogue en disant qu'elle est la mère, la femme, et la fille de Dieu. Enfin ils disent (Maïmon. more Nevochim ; cap. xxvij.) deux choses importantes à leur justification ; l'une qu'ils sont obligés de parler de Dieu comme ayant un corps, afin de faire comprendre au vulgaire que c'est un être réel ; car, le peuple ne conçoit d'existence réelle que dans les objets matériels et sensibles : l'autre, qu'ils ne donnent à Dieu que des actions nobles, et qui marquent quelque perfection, comme de se mouvoir et d'agir : c'est pourquoi on ne dit jamais que Dieu mange et qu'il bait.
VI. Cependant, il faut avouer que ces théologiens ne parlent pas avec assez d'exactitude ni de sincérité. Pourquoi obliger les hommes à se donner la torture pour pénétrer leurs pensées ? Explique-t-on mieux la nature ineffable d'un Dieu, en ajoutant de nouvelles ombres à celles que sa grandeur répand déjà sur nos esprits ? Il faut tâcher d'éclaircir ce qui est impénétrable, au lieu de former un nouveau voîle qui le cache plus profondément. C'est le penchant de tous les peuples, et presque de tous les hommes, que de se former l'idée d'un Dieu corporel. Si les rabbins n'ont pas pensé comme le peuple, ils ont pris plaisir à parler comme lui, et par-là ils affoiblissent le respect qu'on doit à la Divinité. Il faut toujours avoir des idées grandes et nobles de Dieu : il faut inspirer les mêmes idées au peuple, qui n'a que trop d'inclination à les avilir. Pourquoi donc répéter si souvent des choses qui tendent à faire regarder un Dieu comme un être matériel ? On ne peut même justifier parfaitement ces docteurs. Que veulent-ils dire, lorsqu'ils assurent que Dieu ne put révéler à Jacob la vente de son fils Joseph, parce que ses frères avaient obligé Dieu de jurer avec eux qu'on garderait le secret sous peine d'excommunication ? Qu'entend-on, lorsqu'on assure que Dieu, affligé d'avoir créé l'homme, s'en consola, parce qu'il n'était pas d'une matière céleste, puisqu'alors il aurait entrainé dans sa révolte tous les habitants du paradis ? Que veut-on dire, quand on rapporte que Dieu joue avec le léviathan, et qu'il a tué la femelle de ce monstre, parce qu'il n'était pas de la bienséance que Dieu jouât avec une femelle ? Les mystères qu'on tirera de-là à force de machines, seront grossiers ; ils aviliront toujours la Divinité ; et si ceux qui les étudient, se trouvent embarrassés à chercher le sens mystique, sans pouvoir le développer, que pensera le peuple à qui on débite ces imaginations ?
Sentiment des Juifs sur la Providence et sur la liberté. I. Les Juifs soutiennent que la providence gouverne toutes les créatures depuis la licorne, jusqu'aux œufs de poux. Les Chrétiens ont accusé Maïmonides d'avoir renversé ce dogme capital de la Religion ; mais ce docteur attribue ce sentiment à Epicure, et à quelques hérétiques en Israèl, et traite d'athées ceux qui nient que tout dépend de Dieu. Il croit que cette Providence spéciale, qui veille sur chaque action de l'homme, n'agit pas pour remuer une feuille, ni pour produire un vermisseau : car tout ce qui regarde les animaux et les créatures, se fait par accident, comme l'a dit Aristote.
II. Cependant, on explique différemment la chose : comme les Docteurs se sont souvent attachés à la lecture d'Aristote et des autres philosophes, ils ont examiné avec soin si Dieu savait tous les événements, et cette question les a fort embarrassés. Quelques-uns ont dit que Dieu ne pouvait connaître que lui-même, parce que la science se multipliant à proportion des objets qu'on connait, il faudrait admettre en Dieu plusieurs degrés, ou même plusieurs sciences. D'ailleurs, Dieu ne peut savoir que ce qui est immuable ; cependant la plupart des événements dépendent de la volonté de l'homme, qui est libre. Maïmonides, (Maïmon. more Nevochim. cap. xx.) avoue que comme nous ne pouvons connaître l'essence de Dieu, il est aussi impossible d'approfondir la nature de sa connaissance. " Il faut donc se contenter de dire, que Dieu sait tout et n'ignore rien ; que sa connaissance ne s'acquiert point par degrés, et qu'elle n'est chargée d'aucune imperfection. Enfin, si nous y trouvons quelquefois des contradictions et des difficultés, elles naissent de notre ignorance, et de la disproportion qui est entre Dieu et nous ". Ce raisonnement est judicieux et sage : d'ailleurs, il croyait qu'on devait tolérer les opinions différentes que les sages et les Philosophes avaient formées sur la science de Dieu et sur sa providence, puisqu'ils ne péchaient pas par ignorance, mais parce que la chose est incompréhensible.
III. Le sentiment commun des rabbins est que la volonté de l'homme est parfaitement libre. Cette liberté est tellement un des apanages de l'homme, qu'il cesserait, disent-ils, d'être homme, s'il perdait ce pouvoir. Il cesserait en même temps d'être raisonnable, s'il aimait le bien, et fuyait le mal sans connaissance, ou par un instinct de la nature, à-peu-près comme la pierre qui tombe d'en-haut, et la brebis qui fuit le loup. Que deviendraient les peines et les récompenses, les menaces et les promesses ; en un mot, tous les préceptes de la Loi, s'il ne dépendait pas de l'homme de les accomplir ou de les violer ? Enfin, les Juifs sont si jaloux de cette liberté d'indifférence, qu'ils s'imaginent qu'il est impossible de penser sur cette matière autrement qu'eux. Ils sont persuadés qu'on dissimule son sentiment toutes les fois qu'on ôte au franc-arbitre quelque partie de sa liberté, et qu'on est obligé d'y revenir tôt ou tard, parce que s'il y avait une prédestination, en vertu de laquelle tous les événements deviendraient nécessaires, l'homme cesserait de prévenir les maux, et de chercher ce qui peut contribuer à la défense, ou à la conservation de sa vie ; et si on dit avec quelques chrétiens, que Dieu qui a déterminé la fin, a déterminé en même temps les moyens par lesquels on l'obtient, on rétablit par-là le franc-arbitre après l'avoir ruiné, puisque le choix de ces moyens dépend de la volonté de celui qui les néglige ou qui les emploie.
IV. Mais, au-moins ne reconnaissaient-ils point la grâce ? Philon, qui vivait au temps de J. C. disait, que comme les ténèbres s'écartent lorsque le soleil remonte sur l'horizon, de même lorsque le soleil divin éclaire une âme, son ignorance se dissipe, et la connaissance y entre. Mais ce sont-là des termes généraux, qui décident d'autant moins la question, qu'il ne parait pas par l'Evangile, que la grâce régénérante fût connue en ces temps-là des docteurs Juifs ; puisque Nicodème n'en avait aucune idée, et que les autres ne savaient pas même qu'il y eut un Saint-Esprit, dont les opérations sont si nécessaires pour la conversion.
V. Les Juifs ont dit que la grâce prévient les mérites du juste. Voilà une grâce prévenante reconnue par les rabbins ; mais il ne faut pas s'imaginer que ce sait-là un sentiment généralement reçu. Menasse, (Menasse, de fragilit. humanâ) a réfuté ces docteurs qui s'éloignaient de la tradition, parce que, si la grâce prévenait la volonté, elle cesserait d'être libre, et il n'établit que deux sortes de secours de la part de Dieu ; l'un, par lequel il ménage les occasions favorables pour exécuter un bon dessein qu'on a formé ; et l'autre par lequel il aide l'homme, lorsqu'il a commencé de bien vivre.
VI. Il semble qu'en rejetant la grâce prévenante, on reconnait un secours de la Divinité qui suit la volonté de l'homme, et qui influe dans ses actions. Menasse dit qu'on a besoin du concours de la Providence pour toutes les actions honnêtes : il se sert de la comparaison d'un homme, qui voulant charger sur ses épaules un fardeau, appelle quelqu'un à son secours. La Divinité est ce bras étranger qui vient aider le juste, lorsqu'il a fait ses premiers efforts pour accomplir la Loi. On cite des docteurs encore plus anciens que Menasse, lesquels ont prouvé qu'il était impossible que la chose se fit autrement, sans détruire tout le mérite des œuvres. " Ils demandent si Dieu, qui préviendrait l'homme, donnerait une grâce commune à tous, ou particulière à quelques-uns. Si cette grâce efficace était commune, comment tous les hommes ne sont-ils pas justes et sauvés ? Et si elle est particulière, comment Dieu peut-il sans injustice sauver les uns, et laisser périr les autres ? Il est beaucoup plus vrai que Dieu imite les hommes qui prêtent leurs secours à ceux qu'ils voient avoir formé de bons desseins, et faire quelques efforts pour se rendre vertueux. Si l'homme était assez méchant, pour ne pouvoir faire le bien sans la grâce, Dieu serait l'auteur du péché, etc.
VII. On ne s'explique pas nettement sur la nature de ce secours qui soulage la volonté dans ses besoins ; mais je suis persuadé qu'on se borne aux influences de la Providence, et qu'on ne distingue point entre cette Providence qui dirige les événements humains et la grâce salutaire qui convertit les pécheurs. R. Eliezer confirme cette pensée ; car il introduit Dieu qui ouvre à l'homme le chemin de la vie et de la mort, et qui lui en donne le choix. Il place sept anges dans le chemin de la mort, dont quatre pleins de miséricorde, se tiennent dehors à chaque porte, pour empêcher les pêcheurs d'y entrer. Que fais-tu ? crie le premier ange au pécheur qui veut entrer ; il n'y a point ici de vie : vas-tu te jeter dans le feu ? repens-toi. S'il passe la première porte, le second Ange l'arrête, et lui crie, que Dieu le haïra et s'éloignera de lui. Le troisième lui apprend qu'il sera effacé du livre de vie : le quatrième le conjure d'attendre-là que Dieu vienne chercher les pénitens ; et s'il persévère dans le crime, il n'y a plus de retour. Les anges cruels se saisissent de lui : on ne donne donc point d'autres secours à l'homme, que l'avertissement des anges, qui sont les ministres de la Providence.
Sentiment des Juifs sur la création du monde. 1°. Le plus grand nombre des docteurs juifs craient que le monde a été créé par Dieu, comme le dit Moïse ; et on met au rang des hérétiques chassés du sein d'Israèl, ou excommuniés, ceux qui disent que la matière était co-éternelle à l'Etre souverain.
Cependant il s'éleva du temps de Maïmonides, au douzième siècle, une controverse sur l'antiquité du monde. Les uns entêtés de la philosophie d'Aristote, suivaient son sentiment sur l'éternité du monde ; c'est pourquoi Maïmonides fut obligé de le réfuter fortement ; les autres prétendaient que la matière était éternelle. Dieu était bien le principe et la cause de son existence : il en a même tiré les formes différentes, comme le potier les tire de l'argille, et le forgeron du fer qu'il manie : mais Dieu n'a jamais existé sans cette matière, comme la matière n'a jamais existé sans Dieu. Tout ce qu'il a fait dans la création, était de régler son mouvement, et de mettre toutes ses parties dans le bel ordre où nous les voyons. Enfin, il y a eu des gens, qui ne pouvant concevoir que Dieu, semblable aux ouvriers ordinaires, eut existé avant son ouvrage, ou qu'il fût demeuré dans le ciel sans agir, soutenaient qu'il avait créé le monde de tout temps, ou plutôt de toute éternité.
2°. Ceux qui dans les synagogues veulent soutenir l'éternité du monde, tâchent de se mettre à couvert de la censure par l'autorité de Maïmonides, parce qu'ils pretendent que ce grand docteur n'a point mis la création entre les articles fondamentaux de la foi. Mais il est aisé de justifier ce docteur ; car on lit ces paroles dans la confession de foi qu'il a dressée : Si le monde est créé, il y a un créateur ; car personne ne peut se créer soi-même : il y a donc un Dieu. Il ajoute, que Dieu seul est éternel, et que toutes choses ont eu un commencement. Enfin il déclare ailleurs que la création est un des fondements de la foi, sur lesquels on ne doit se laisser ébranler que par une démonstration qu'on ne trouvera jamais.
3°. Il est vrai que ce docteur raisonne quelquefois faiblement sur cette matière. S'il combat l'opinion d'Aristote qui soutenait aussi l'éternité du monde, la génération et la corruption dans le ciel, il trouva la méthode de Platon assez commode, parce qu'elle ne renverse pas les miracles, et qu'on peut l'accommoder avec l'Ecriture ; enfin elle lui paraissait appuyée sur de bonnes raisons, quoiqu'elles ne fussent pas démonstratives. Il ajoutait qu'il serait aussi facîle à ceux qui soutenaient l'éternité du monde, d'expliquer tous les endroits de l'Ecriture où il est parlé de la création, que de donner un bon sens à ceux où cette même Ecriture donne des bras et des mains à Dieu. Il semble aussi qu'il ne se soit déterminé que par intérêt du côté de la création préférablement à l'éternité du monde, parce que si le monde était éternel, et que les hommes se fussent créés indépendamment de Dieu, la glorieuse préférence que la nation juive a eue sur toutes les autres nations, deviendrait chimérique. Mais de quelque manière que Maïmonides ait raisonné, un lecteur équitable ne peut l'accuser d'avoir cru l'éternité du monde, puisqu'il a rejeté formellement, et qu'il a fait l'apologie de Salomon, que les hérétiques citaient comme un de leurs témoins.
4. Mais si les docteurs sont ordinairement orthodoxes sur l'article de la création, il faut avouer qu'ils s'écartent presque aussi-tôt de Moïse. On tolérait dans la synagogue les théologiens qui soutenaient qu'il y avait un monde avant celui que nous habitons, parce que Moïse a commencé l'histoire de la Genèse par un B, qui marque deux. Il était indifférent à ce législateur de commencer son livre par une autre lettre ; mais il a renversé sa construction, et commencé son ouvrage par un B, afin d'apprendre aux initiés que c'était ici le second monde, et que le premier avait fini dans le système millénaire, selon l'ordre que Dieu a établi dans les révolutions qui se feront. Voyez l'article CABALE.
5. C'est encore un sentiment assez commun chez les Juifs que le ciel et les astres sont animés. Cette croyance est même très-ancienne chez eux ; car Philon l'avait empruntée de Platon, dont il faisait sa principale étude. Il disait nettement que les astres é aient des créatures intelligentes qui n'avaient jamais fait de mal, et qui étaient incapables d'en faire. Il ajoutait qu'ils ont un mouvement circulaire, parce que c'est le plus parfait, et celui qui convient le mieux aux âmes et aux substances intelligentes.
Sentiments des Juifs sur les anges et sur les démons, sur l'âme et sur le premier homme. 1. Les hommes se plaisent à raisonner beaucoup sur ce qu'ils connaissent le moins. On connait peu la nature de l'âme ; on connait encore moins celle des anges : on ne peut savoir que par la révélation leur création et leur existence. Les écrivains sacrés que Dieu conduisait ont été timides et sobres sur cette matière. Que de raisons pour imposer silence à l'homme, et donner des bornes à sa témérité ! Cependant il y a peu de sujets sur lesquels on ait autant raisonné que sur les anges ; le peuple curieux consulte ses docteurs : ces derniers ne veulent pas laisser soupçonner qu'ils ignorent ce qui se passe dans le ciel, ni se borner aux lumières que Moïse a laissées. Ce serait se dégrader du doctorat que d'ignorer quelque chose, et se remettre au rang du simple peuple qui peut lire Moïse, et qui n'interroge les théologiens que sur ce que l'Ecriture ne dit pas. Avouer son ignorance dans une matière obscure, ce serait un acte de modestie, qui n'est pas permis à ceux qui se mêlent d'enseigner. On ne pense pas qu'on s'égare volontairement, puisqu'on veut donner aux anges des attributs et des perfections sans les connaître, et sans consulter Dieu qui les a formés.
Comme Moïse ne s'explique point sur le temps auquel les anges furent créés, on supplée à son silence par des conjectures. Quelques-uns craient que Dieu forma les anges le second jour de la création. Il y a des docteurs qui assurent qu'ayant été appelés au conseil de Dieu sur la production de l'homme, ils se partagèrent en opinions différentes. L'une approuvait sa création, et l'autre la rejetait, parce qu'il prévoyait qu'Adam pécherait par complaisance pour sa femme ; mais Dieu fit taire ces anges ennemis de l'homme, et le créa avant qu'ils s'en fussent aperçus : ce qui rendit leurs murmures inutiles ; et il les avertit qu'ils pécheraient aussi en devenant amoureux des filles des hommes. Les autres soutiennent que les anges ne furent créés que le cinquième jour. Un troisième parti veut que Dieu les produise tous les jours, et qu'ils sortent d'un fleuve qu'on appelle Dinor ; enfin quelques-uns donnent aux anges le pouvoir de s'entre-créer les uns les autres, et c'est ainsi que l'ange Gabriel a été créé par Michel qui est au-dessus de lui.
2. Il ne faut pas faire une hérésie aux Juifs de ce qu'ils enseignent sur la nature des anges. Les docteurs éclairés reconnaissent que ce sont des substances purement spirituelles, entièrement dégagées de la matière ; et ils admettent une figure dans tous les passages de l'Ecriture qui les représentent sous des idées corporelles, parce que les anges revêtent souvent la figure du feu, d'un homme ou d'une femme.
Il y a pourtant quelques rabbins plus grossiers, lesquels ne pouvant digérer ce que l'Ecriture dit des anges, qui les représente sous la figure d'un bœuf, d'un chariot de feu ou avec des ailes, enseignent qu'il y a un second ordre d'anges, qu'on appelle les anges du ministère, lesquels ont des corps subtils comme le feu. Ils font plus, ils craient qu'il y a différence de sexe entre les anges, dont les uns donnent et les autres reçoivent.
Philon juif avait commencé à donner trop aux anges, en les regardant comme les colonnes sur lesquelles cet univers est appuyé. On l'a suivi, et on a cru non-seulement que chaque nation avait son ange particulier, qui s'intéressait fortement pour elle, mais qu'il y en avait qui présidaient sur chaque chose. Azariel préside sur l'eau ; Gazardia, sur l'Orient, afin d'avoir soin que le soleil se lève ; et Nékid, sur le pain et les aliments. Ils ont des anges qui président sur chaque planète, sur chaque mois de l'année et sur les heures du jour. Les Juifs craient aussi que chaque homme a deux anges, l'un bon, qui le garde, l'autre mauvais qui examine ses actions. Si le jour du sabbat, au retour de la synagogue, les deux anges trouvent le lit fait, la table dressée, les chandelles allumées, le bon ange s'en réjouit, et dit, Dieu veuille qu'au prochain sabbat les choses soient en aussi bon ordre ! et le mauvais ange est obligé de répondre amen. S'il y a du désordre dans la maison, le mauvais ange à son tour souhaite que la même chose arrive au prochain sabbat, et le bon ange répond amen.
La théologie des Juifs ne s'arrête pas là. Maïmonides qui avait fort étudié Aristote, soutenait que ce philosophe n'avait rien dit qui fût contraire à la loi, excepté qu'il croyait que les intelligences étaient éternelles, et que Dieu ne les avait point produites. En suivant les principes des anciens philosophes, il disait qu'il y a une sphère supérieure à toutes les autres qui leur communique le mouvement. Il remarque que plusieurs docteurs de sa nation croyaient avec Pythagore, que les cieux et les étoiles formaient en se mouvant un son harmonieux, qu'on ne pouvait entendre à cause de l'éloignement ; mais qu'on ne pouvait pas en douter, puisque nos corps ne peuvent se mouvoir sans faire du bruit, quoiqu'ils soient beaucoup plus petits que les orbes célestes. Il parait rejeter cette opinion ; je ne sais même s'il n'a pas tort de l'attribuer aux docteurs : en effet les rabbins disent qu'il y a trois choses dont le son passe d'un bout du monde à l'autre ; la voix du peuple romain, celle de la sphère du soleil, et de l'âme qui quitte le monde.
Quoiqu'il en sait, Maïmonides dit non-seulement que toutes ces sphères sont mues et gouvernées par des anges ; mais il prétend que ce sont véritablement des anges. Il leur donne la connaissance et la volonté par laquelle ils exercent leurs opérations : il remarque que le titre d'ange et de messager signifie la même chose. On peut donc dire que les intelligences, les sphères, et les éléments qui exécutent la volonté de Dieu, sont des anges, et doivent porter ce nom.
4. On donne trois origines différentes aux démons. 1°. On soutient quelquefois que Dieu les a créés le même jour qu'il créa les enfers pour leur servir de domicile. Il les forma spirituels, parce qu'il n'eut pas le loisir de leur donner des corps. La fête du sabbat commençait au moment de leur création, et Dieu fut obligé d'interrompre son ouvrage, afin de ne pas violer le repos de la fête. Les autres disent qu'Adam ayant été longtemps sans connaître sa femme, l'ange Samaèl touché de sa beauté, s'unit avec elle, et elle conçut et enfanta les démons. Ils soutiennent aussi qu'Adam, dont ils font une espèce de scélérat, fut le père des esprits malins.
On compte ailleurs, car il y a là-dessus une grande diversité d'opinions, quatre mères des diables : dont l'une est Nahama, sœur de Tubalin, belle comme les anges, auxquels elle s'abandonna ; elle vit encore, et elle entre subtilement dans le lit des hommes endormis, et les oblige de se souiller avec elle ; l'autre est Lilith, dont l'histoire est fameuse chez les Juifs. Enfin il y a des docteurs qui croient que les anges créés dans un état d'innocence, en sont déchus par jalousie pour l'homme, et par leur révolte contre Dieu : ce qui s'accorde mieux avec le récit de Moïse.
5. Les Juifs craient que les démons ont été créés mâles et femelles, et que de leur conjonction il en a pu naître d'autres. Ils disent encore que les âmes des damnés se changent pour quelque temps en démons, pour aller tourmenter les hommes, visiter leur tombeau, voir les vers qui rongent leurs cadavres, ce qui les afflige, et ensuite s'en retournent aux enfers.
Ces démons ont trois avantages qui leur sont communs avec les anges. Ils ont des ailes comme eux ; ils volent comme eux d'un bout du monde à l'autre ; enfin ils savent l'avenir. Ils ont trois imperfections qui leur sont communes avec les hommes ; car ils sont obligés de manger et de boire ; ils engendrent et multiplient, et enfin ils meurent comme nous.
6. Dieu s'entretenant avec les anges vit naître une dispute entr'eux à cause de l'homme. La jalousie les avait saisis ; ils soutinrent à Dieu que l'homme n'était que vanité, et qu'il avait tort de lui donner un si grand empire. Dieu soutint l'excellence de son ouvrage par deux raisons ; l'une que l'homme le louerait sur la terre, comme les anges le louaient dans le ciel. Secondement il demanda à ces anges si fiers, s'ils savaient les noms de toutes les créatures ; ils avouèrent leur ignorance, qui fut d'autant plus honteuse, qu'Adam ayant paru aussi-tôt, il les récita sans y manquer. Schamaèl qui était le chef de cette assemblée céleste, perdit patience. Il descendit sur la terre, et ayant remarqué que le serpent était le plus subtil de tous les animaux, il s'en servit pour séduire Eve.
C'est ainsi que les Juifs rapportent la chute des anges ; et de leur récit, il parait qu'il y avait un chef des anges avant leur apostasie, et que le chef s'appelait Schamael. En cela ils ne s'éloignent pas beaucoup des chrétiens ; car une partie des saints pères ont regardé le diable avant sa chute comme le prince de tous les anges.
7. Moïse dit que les fils de Dieu voyant que les filles des hommes étaient belles, se souillèrent avec elles. Philon juif a substitué les anges aux fils de Dieu ; et il remarque que Moïse a donné le titre d'anges à ceux que les philosophes appellent génies. Enoch a rapporté non-seulement la chute des anges avec les femmes, mais il en developpe toutes les circonstances, il nomme les vingt anges qui firent complot de se marier ; ils prirent des femmes l'an 1170 du monde, et de ce mariage nâquirent les géants. Ces démons enseignèrent ensuite aux hommes les Arts et les Sciences. Azael apprit aux garçons à faire des armes, et aux filles à se farder ; Semireas leur apprit la colere et la violence ; Pharmarus fut le docteur de la magie : ces leçons reçues avec avidité des hommes et des femmes, causèrent un désordre affreux. Quatre anges persévérants se présentèrent devant le trône de Dieu, et lui remontrèrent le désordre que les géants causaient : Les esprits des âmes des hommes morts crient, et leurs soupirs montent jusqu'à la porte du ciel, sans pouvoir parvenir jusqu'à toi, à cause des injustices qui se font sur la terre. Tu vois cela, et tu ne nous apprents point ce qu'il faut faire.
La remontrance eut pourtant son effet. Dieu ordonna à Uriel " d'aller avertir le fils de Lamech qui était Noé, qu'il serait garanti de la mort éternellement. Il commanda à Raphaël de saisir Exaèl l'un des anges rebelles, de le jeter lié pieds et mains dans les ténèbres ; d'ouvrir le désert qui est dans un autre désert, et de le jeter là ; de mettre sur lui des pierres aiguës, et d'empêcher qu'il ne vit la lumière, jusqu'à ce qu'on le jette dans l'embrasement de feu au jour du jugement. L'ange Gabriel fut chargé de mettre aux mains les géants afin qu'ils s'entretuassent ; et Michaèl devait prendre Sémireas et tous les anges mariés, afin que quand ils auraient Ve périr les géants et tous leurs enfants, on les liât pendant soixante et dix générations, dans les cachots de la terre jusqu'au jour de l'accomplissement de toutes choses, et du jugement où ils devaient être jetés dans un abîme de feu et de tourments éternels ".
8. Un rabbin moderne (Menasse), qui avait fort étudié les anciens, assure que la préexistence des âmes est un sentiment généralement reçu chez les docteurs juifs. Ils soutiennent qu'elles furent toutes formées dès le premier jour de la création, et qu'elles se trouvèrent toutes dans le jardin d'Eden. Dieu leur parlait quand il dit, faisons l'homme ; il les unit aux corps à proportion qu'il s'en forme quelqu'un. Ils appuient cette pensée sur ce que Dieu dit dans Isaïe, j'ai fait les ames. Il ne se servirait pas d'un temps passé s'il en créait encore tous les jours un grand nombre : l'ouvrage doit être achevé depuis longtemps, puisque Dieu dit, j'ai fait.
9. Ces âmes jouissent d'un grand bonheur dans le ciel, en attendant qu'elles puissent être unies aux corps. Cependant elles peuvent mériter quelque chose par leur conduite ; et c'est-là une des raisons qui fait la grande différence des mariages, dont les uns sont heureux, et les autres mauvais, parce que Dieu envoie les âmes selon leurs mérites. Elles ont été créées doubles, afin qu'il y eut une âme pour le mari, et une autre pour la femme. Lorsque ces âmes qui ont été faites l'une pour l'autre, se trouvent unies sur la terre, leur condition est infailliblement heureuse, et le mariage tranquille. Mais Dieu, pour punir les âmes qui n'ont pas répondu à l'excellence de leur origine, sépare celles qui avaient été faites l'une pour l'autre, et alors il est impossible qu'il n'arrive de la division et du désordre. Origène n'avait pas adopté ce dernier article de la théologie judaïque, mais il suivait les deux premiers ; car il croyait que les âmes avaient préexisté, et que Dieu les unissait aux corps célestes ou terrestres, grossiers ou subtils, à proportion de ce qu'elles avaient fait dans le ciel, et personne n'ignore qu'Origène a eu beaucoup de disciples et d'approbateurs chez les Chrétiens.
10. Ces âmes sortirent pures de la main de Dieu. On récite encore aujourd'hui une prière qu'on attribue aux docteurs de la grande synagogue, dans laquelle on lit : O Dieu ! l'âme que tu m'as donnée est pure ; tu l'as créée, tu l'as formée, tu l'as inspirée ; tu la conserves au-dedans de moi, tu la reprendras, lorsqu'elle s'envolera, et tu me la rendras au temps que tu as marqué.
On trouve dans cette prière tout ce qui regarde l'âme ; car voici comment rabbin Menasse l'a commentée : l'âme que tu m'as donnée est pure, pour apprendre que c'est une substance spirituelle, subtile, qui a été formée d'une matière pure et nette. Tu l'as créée, c'est-à-dire au commencement du monde avec les autres ames. Tu l'as formée, parce que notre âme est un corps spirituel, composé d'une matière céleste et insensible ; et les cabalistes ajoutent qu'elle s'unit au corps pour recevoir la peine ou la récompense de ce qu'elle a fait. Tu l'as inspirée, c'est-à-dire tu l'as unie à mon corps sans l'intervention des corps célestes, qui influent ordinairement dans les âmes végétatives et sensitives. Tu la conserves, parce que Dieu est la garde des hommes. Tu la reprendras, ce qui prouve qu'elle est immortelle. Tu me la rendras, ce qui nous assure de la vérité de la résurrection.
11. Les Thalmudistes débitent une infinité de fables sur le chapitre d'Adam et de sa création. Ils comptent les douze heures du jour auquel il fut créé, et ils n'en laissent aucune qui soit vide. A la première heure, Dieu assembla la poudre dont il devait le composer, et il devint un embrion. A la seconde, il se tint sur ses pieds. A la quatrième, il donna les noms aux animaux. La septième fut employée au mariage d'Eve, que Dieu lui amena comme une paranymphe, après l'avoir frisée. A dix heures Adam pécha ; on le jugea aussi-tôt, et à douze heures il sentait déjà la peine et les sueurs du travail.
12. Dieu l'avait fait si grand qu'il remplissait le monde, ou du moins il touchait le ciel. Les anges étonnés en murmurèrent, et dirent à Dieu qu'il y avait deux êtres souverains, l'un au ciel et l'autre sur la terre. Dieu averti de la faute qu'il avait faite, appuya la main sur la tête d'Adam, et le réduisit à une nature de mille coudées ; mais en donnant au premier homme cette grandeur immense, ils ont voulu seulement dire qu'il connaissait tous les secrets de la nature, et que cette science diminua considérablement par le péché ; ce qui est orthodoxe. Ils ajoutent que Dieu l'avait fait d'abord double, comme les payens nous représentent Janus à deux fronts ; c'est pourquoi on n'eut besoin que de donner un coup de hache pour partager ces deux corps ; et cela est clairement expliqué par le prophète, qui assure que Dieu l'a formé par devant et par derrière : et comme Moïse dit aussi que Dieu le forma mâle et femelle ; on conclut que le premier homme était hermaphrodite.
13. Sans nous arrêter à toutes ces visions qu'on multiplierait à l'infini, les docteurs soutiennent, 1°. qu'Adam fut créé dans un état de perfection ; car s'il était venu au monde comme un enfant, il aurait eu besoin de nourrice et de précepteur. 2°. C'était une créature subtîle : la matière de son corps était si délicate et si fine, qu'il approchait de la nature des anges, et son entendement était aussi parfait que celui d'un homme le peut être. Il avait une connaissance de Dieu et de tous les objets spirituels, sans l'avoir jamais apprise, il lui suffisait d'y penser ; c'est pourquoi on l'appelait fils de Dieu. Il n'ignorait pas même le nom de Dieu ; car Adam ayant donné le nom à tous les animaux, Dieu lui demanda quel est mon nom ? et Adam répondit, Jéhovah. C'est toi qui es ; et c'est à cela que Dieu fait allusion dans le prophète Isaïe, lorsqu'il dit : je suis celui qui suis, c'est là mon nom ; c'est-à-dire, le nom qu'Adam m'a donné et que j'ai pris.
14. Ils ne conviennent pas que la femme fut aussi parfaite que l'homme, parce que Dieu ne l'avait formée que pour lui être une aide. Ils ne sont pas même persuadés que Dieu l'eut faite à son image. Un théologien chrétien (Lambert Danaeus, in Antiquittatibus, pag. 42.) a adopté ce sentiment en l'adoucissant ; car il enseigne que l'image de Dieu était beaucoup plus vive dans l'homme que dans la femme ; c'est pourquoi elle eut besoin que son mari lui servit de précepteur, et lui apprit l'ordre de Dieu, au lieu qu'Adam l'avait reçu immédiatement de sa bouche.
15. Les docteurs craient aussi que l'homme fait à l'image de Dieu était circoncis ; mais ils ne prennent pas garde que, pour relever l'excellence d'une cérémonie, ils font un Dieu corporel. Adam se plongea d'abord dans une débauche affreuse, en s'accouplant avec les bêtes, sans pouvoir assouvir sa convoitise, jusqu'à ce qu'il s'unit à Eve. D'autres disent au contraire qu'Eve était le fruit défendu auquel il ne pouvait toucher sans crime ; mais emporté par la tentation que causait la beauté extraordinaire de cette femme, il pécha. Ils ne veulent point que Caïn soit sorti d'Adam, parce qu'il était né du serpent qui avait tenté Eve. Il fut si affligé de la mort d'Abel, qu'il demeura cent trente ans sans connaître sa femme, et ce fut alors qu'il commença à faire des enfants à son image et ressemblance. On lui reproche son apostasie, qui alla jusqu'à faire revenir la peau du prépuce, afin d'effacer l'image de Dieu. Adam, après avoir rompu cette alliance, se repentit ; il maltraita son corps l'espace de sept semaines dans le fleuve Géhon, et le pauvre corps fut tellement sacrifié, qu'il devint percé comme un crible. On dit qu'il y a des mystères renfermés dans toutes ces histoires ; comme en effet il faut nécessairement qu'il y en ait quelques-uns ; mais il faudrait avoir beaucoup de temps et d'esprit pour les développer tous. Remarquons seulement que ceux qui donnent des règles sur l'usage des métaphores, et qui prétendent qu'on ne s'en sert jamais que lorsqu'on y a préparé ses lecteurs, et qu'on est assuré qu'ils lisent dans l'esprit ce qu'on pense, connaissent peu le génie des Orientaux, et que leurs règles se trouveraient ici beaucoup trop courtes.
16. On accuse les Juifs d'appuyer les systèmes des Préadamistes qu'on a développés dans ces derniers siècles avec beaucoup de subtilité ; mais il est certain qu'ils craient qu'Adam est le premier de tous les hommes. Sangarius donne Jambuscar pour précepteur à Adam ; mais il ne rapporte ni son sentiment, ni celui de sa nation. Il a suivi plutôt les imaginations des Indiens et de quelques barbares, qui contaient que trois hommes nommés Jambuscha, Zagtith et Boan ont vécu avant Adam, et que le premier avait été son précepteur. C'est envain qu'on se sert de l'autorité de Maïmonides un des plus sages docteurs des Juifs ; car il rapporte qu'Adam est le premier de tous les hommes qui soit né par une génération ordinaire ; il attribue cette pensée aux Zabiens, et bien loin de l'approuver, il la regarde comme une fausse idée qu'on doit rejeter ; et qu'on n'a imaginé cela que pour défendre l'éternité du monde que ces peuples qui habitaient la Perse soutenaient.
Les Juifs disent ordinairement qu'Adam était né jeune dans une stature d'homme fait, parce que toutes choses doivent avoir été créées dans un état de perfection ; et comme il sortait immédiatement des mains de Dieu, il était souverainement sage et prophète créé à l'image de Dieu. On ne finirait pas, si on rapportait tout ce que cette image de la divinité dans l'homme leur a fait dire. Il suffit de remarquer qu'au milieu des docteurs qui s'égarent, il y en a plusieurs, comme Maimonides et Kimki, qui, sans avoir aucun égard au corps du premier homme, la placent dans son âme et dans ses facultés intellectuelles. Le premier avoue qu'il y avait des docteurs qui croyaient que c'était nier l'existence de Dieu, que de soutenir qu'il n'avait point de corps, puisque l'homme est matériel, et que Dieu l'avait fait à son image. Mais il remarque que l'image est la vertu spécifique qui nous fait exister, et que par conséquent l'âme est cette image. Il outre même la chose ; car il veut que les Idolâtres, qui se prosternent devant les images, ne leur aient pas donné ce nom, à cause de quelque trait de ressemblance avec les originaux ; mais parce qu'ils attribuent à ces figures sensibles quelque vertu.
Cependant il y en a d'autres qui prétendent que cette image consistait dans la liberté dont l'homme jouissait. Les anges aiment le bien par nécessité ; l'homme seul pouvait aimer la vertu ou le vice. Comme Dieu, il peut agir et n'agir pas. Ils ne prennent pas garde que Dieu aime le bien encore plus nécessairement que les anges qui pouvaient pécher, comme il parait par l'exemple des démons ; et que si cette liberté d'indifférence pour le bien est un degré d'excellence, on élève le premier homme au-dessus de Dieu.
18. Les Antitrinitaires ont tort de s'appuyer sur le témoignage des Juifs, pour prouver qu'Adam était né mortel, et que le péché n'a fait à cet égard aucun changement à sa condition ; car ils disent nettement que si nos premiers pères eussent persévéré dans l'innocence, toutes leurs générations futures n'auraient pas senti les émotions de la concupiscence, et qu'ils eussent toujours vécu. R. Béchai, disputant contre les philosophes qui défendaient la mortalité du premier homme, soutient qu'il ne leur est point permis d'abandonner la théologie que leurs ancêtres ont puisée dans les écrits des prophetes, lesquels ont enseigné que l'homme eut vécu éternellement, s'il n'eut point péché. Manasse, qui vivait au milieu du siècle passé, dans un lieu où il ne pouvait ignorer la prétention des Sociniens, prouve trois choses qui leur sont directement opposées : 1. que l'immortalité du premier homme, persévérant dans l'innocence, est fondée sur l'Ecriture ; 2. que Hana, fils de Hanina, R. Jéhuda, et un grand nombre de rabbins, dont il cite les témoignages, ont été de ce sentiment ; 3. enfin, il montre que cette immortalité de l'homme s'accorde avec la raison, puisqu' Adam n'avait aucune cause intérieure qui put le faire mourir, et qu'il ne craignait rien du dehors, puisqu'il vivait dans un lieu très-agréable, et que le fruit de l'arbre de vie, dont il devait se nourrir, augmentait sa vigueur.
19. Nous dirons peu de chose sur la création de la femme : peut-être prendra-t-on ce que nous en dirons pour autant de plaisanteries ; mais il ne faut pas oublier une si noble partie du genre humain. On dit donc que Dieu ne voulut point la créer d'abord, parce qu'il prévit que l'homme se plaindrait bientôt de sa malice. Il attendit qu'Adam la lui demandât ; et il ne manqua pas de le faire, dès qu'il eut remarqué que tous les animaux paraissaient devant lui deux à deux. Dieu prit toutes les précautions nécessaires pour la rendre bonne ; mais ce fut inutilement. Il ne voulut point la tirer de la tête, de peur qu'elle n'eut l'esprit et l'âme coquette ; cependant on a eu beau faire, ce malheur n'a pas laissé d'arriver ; et le prophète Isaïe se plaignait, il y a déjà longtemps, que les filles d'Israèl allaient la tête levée et la gorge nue. Dieu ne voulut pas la tirer des yeux, de peur qu'elle ne jouât de la prunelle ; cependant Isaïe se plaint encore que les filles avaient l'oeil tourné à la galanterie. Il ne voulut point la tirer de la bouche, de peur qu'elle ne parlât trop ; mais on ne saurait arrêter sa langue, ni le flux de sa bouche. Il ne la prit point de l'oreille, de peur que ce ne fût une écouteuse ; cependant il est dit de Sara, qu'elle écoutait à la porte du tabernacle, afin de savoir le secret des anges. Dieu ne la forma point du cœur, de peur qu'elle ne fût jalouse ; cependant combien de jalousies et d'envies déchirent le cœur des filles et des femmes ! Il n'y a point de passion, après celle de l'amour, à laquelle elles succombent plus aisément. Une sœur, qui a plus de bonheur, et surtout plus de galans, est l'objet de la haine de sa sœur ; et le mérite ou la beauté sont des crimes qui ne se pardonnent jamais. Dieu ne voulut point former la femme ni des pieds ni de la main, de peur qu'elle ne fût coureuse, et que l'envie de dérober ne la prit ; cependant Dina courut et se perdit ; et avant elle, Rachel avait dérobé les dieux de son père. On a eu donc beau choisir une partie honnête et dure de l'homme, d'où il semble qu'il ne pouvait sortir aucun défaut, la femme n'a pas laissé de les avoir tous. C'est la description que les auteurs juifs nous en donnent. Il y a peut-être des gens qui la trouveront si juste, qu'ils ne voudront pas la mettre au rang de leurs visions, et qui s'imagineront qu'ils ont voulu renfermer une vérité connue sous des termes figurés.
Dogmes des Péripatéticiens, adoptés par les Juifs. 1. Dieu est le premier et le suprême moteur des cieux.
2. Toutes les choses créées se divisent en trois classes. Les unes sont composées de matière et de forme, et elles sont perpétuellement sujettes à la génération et à la corruption ; les autres sont aussi composées de matière et de forme, comme les premières ; mais leur forme est perpétuellement attachée à la matière ; et leur matière et leur forme ne sont point semblables à celles des autres êtres créés : tels sont les cieux et les étoiles. Il y en a enfin qui ont une forme sans matière, comme les anges.
3. Il y a neuf cieux, celui de la Lune, celui de Mercure, celui de Venus, celui du Soleil, celui de Mars, celui de Jupiter, celui de Saturne et des autres étoiles, sans compter le plus élevé de tous, qui les enveloppe, et qui fait tous les jours une révolution d'orient en occident.
4. Les cieux sont purs comme du crystal ; c'est pour cela que les étoiles du huitième ciel paraissent au-dessous du premier.
5. Chacun de ces huit cieux se divise en d'autres cieux particuliers, dont les uns tournent d'orient en occident, les autres d'occident en orient ; et il n'y a point de vide parmi eux.
6. Les cieux n'ont ni légéreté, ni pesanteur, ni couleur ; car la couleur bleue que nous leur attribuons, ne vient que d'une erreur de nos yeux, occasionnée par la hauteur de l'atmosphère.
7. La terre est au milieu de toutes les sphères qui environnent le monde. Il y a des étoiles attachées aux petits cieux : or ces petits cieux ne tournent point autour de la terre, mais ils sont attachés aux grands cieux, au centre desquels la terre se trouve.
8. La terre est presque quarante fois plus grande que la lune ; et le soleil est cent soixante et dix fois plus grand que la terre. Il n'y a point d'étoîle plus grande que le soleil, ni plus petite que Mercure.
9. Tous les cieux et toutes les étoiles ont une âme, et sont doués de connaissance et de sagesse. Ils vivent et ils connaissent celui qui d'une seule parole fit sortir l'univers du néant.
10. Au-dessous du ciel de la lune, Dieu créa une certaine matière différente de la matière des cieux ; et il mit dans cette matière des formes qui ne sont point semblables aux formes des cieux. Ces élements constituent le feu, l'air, l'eau et la terre.
11. Le feu est le plus proche de la lune : au-dessous de lui suivent l'air, l'eau et la terre ; et chacun de ces éléments enveloppe de toutes parts celui qui est au-dessous.
12. Ces quatre éléments n'ont ni âme ni connaissance ; ce sont comme des corps morts qui cependant conservent leur rang.
13. Le mouvement du feu et de l'air est de monter du centre de la terre vers le ciel ; celui de l'eau et de la terre est d'aller vers le centre.
14. La nature du feu qui est le plus léger de tous les éléments, est chaude et seche ; l'air est chaud et humide ; l'eau froide et humide ; la terre, qui est le plus pesant de tous les éléments, est froide et seche.
15. Comme tous les corps sont composés de ces quatre éléments, il n'y en a point qui ne renferme en même temps le froid et le chaud, le sec et l'humide ; mais il y en a dans lesquels une de ces qualités domine sur les autres.
Principes de morale des Juifs. 1. Ne soyez point comme des mercenaires qui ne servent leur maître qu'à condition d'en être payés ; mais servez votre maître sans aucune espérance d'en être récompensés, et que la crainte de Dieu soit toujours devant vos yeux.
2. Faites toujours attention à ces trois choses, et vous ne pécherez jamais. Il y a au-dessus de vous un oeil qui voit tout, une oreille qui entend tout, et toutes vos actions sont écrites dans le livre de vie.
3. Faites toujours attention à ces trois choses, et vous ne pécherez jamais. D'où venez-vous ? où allez-vous ? à qui rendrez-vous compte de votre vie ? Vous venez de la terre, vous retournerez à la terre, et vous rendrez compte de vos actions au roi des rais.
4. La sagesse ne Ve jamais sans la crainte de Dieu, ni la prudence sans la science.
5. Celui là est coupable, qui, lorsqu'il s'éveille la nuit, ou qu'il se promene seul, s'occupe de pensées frivoles.
6. Celui-là est sage qui apprend quelque chose de tous les hommes.
7. Il y a cinq choses qui caractérisent le sage. 1. Il ne parle point devant celui qui le surpasse en sagesse et en autorité. 2. Il ne répond point avec précipitation. 3. Il interroge à propos, et il répond à propos. 4. Il ne contrarie point son ami. 5. Il dit toujours la vérité.
8. Un homme timide n'apprend jamais bien, et un homme colere enseigne toujours mal.
9. Faites-vous une loi de parler peu et d'agir beaucoup, et soyez affable envers tout le monde.
10. Ne parlez pas longtemps avec une femme, pas même avec la vôtre, beaucoup moins avec celle d'un autre ; cela irrite les passions, et nous détourne de l'étude de la loi.
11. Défiez-vous des grands, et en général de ceux qui sont élevés en dignité ; ils ne se lient avec leurs inférieurs que pour leurs propres intérêts. Ils vous témoigneront de l'amitié, tant que vous leur serez utîle ; mais n'attendez d'eux ni secours ni compassion dans vos malheurs.
12. Avant de juger quelqu'un mettez-vous à sa place, et commencez toujours par le supposer innocent.
13. Que la gloire de votre ami vous soit aussi chère que la vôtre.
14. Celui qui augmente ses richesses, multiplie ses inquiétudes. Celui qui multiplie ses femmes, remplit sa maison de poisons. Celui qui augmente le nombre de ses servantes, augmente le nombre des femmes débauchées. Enfin, celui qui augmente le nombre de ses domestiques, augmente le nombre des voleurs.