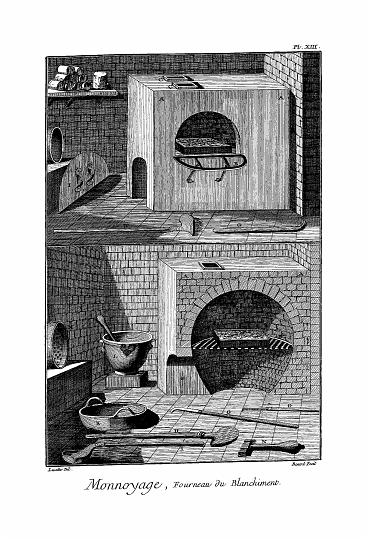S. f. (Science des Mœurs) c'est la science qui nous prescrit une sage conduite et les moyens d'y conformer nos actions.
S'il sied bien à ces créatures raisonnables d'appliquer leurs facultés aux choses auxquelles elles sont destinées, la Morale est la propre science des hommes ; parce que c'est une connaissance généralement proportionnée à leur capacité naturelle, et d'où dépend leur plus grand intérêt. Elle porte donc avec elle les preuves de son prix ; et si quelqu'un a besoin qu'on raisonne beaucoup pour l'en convaincre, c'est un esprit trop gâté pour être ramené par le raisonnement.
J'avoue qu'on ne peut pas traiter la Morale par des arguments démonstratifs, et j'en sais deux ou trois raisons principales. 1°. le défaut de signes. Nous n'avons pas de marques sensibles, qui réprésentent aux yeux les idées morales ; nous n'avons que des mots pour les exprimer : or quoique ces mots restent les mêmes quand ils sont écrits, cependant les idées qu'ils signifient, peuvent varier dans le même homme ; il est fort rare qu'elles ne soient pas différentes, en différentes personnes. 2°. les idées morales sont communément plus composées que celles des figures employées dans les mathématiques. Il arrive de-là que les noms des idées morales, ont une signification plus incertaine ; et de plus, que l'esprit ne peut retenir aisément des combinaisons précises, pour examiner les rapports et les disconvenances des choses. 3°. l'intérêt humain, cette passion si trompeuse, s'oppose à la démonstration des vérités morales ; car il est vraisemblable que si les hommes voulaient s'appliquer à la recherche de ces vérités, selon la même méthode et avec la même indifférence qu'ils cherchent les vérités mathématiques, ils les trouveraient avec la même facilité.
La science des mœurs peut être acquise jusqu'à un certain degré d'évidence, par tous ceux qui veulent faire usage de leur raison, dans quelque état qu'ils se trouvent. L'expérience la plus commune de la vie, et un peu de réflexion sur soi-même et sur les objets qui nous environnent de toutes parts, suffisent pour fournir aux personnes les plus simples, les idées générales de certains devoirs, sans lesquels la société ne saurait se maintenir. En effet, les gens les moins éclairés, montrent par leurs discours et par leur conduite, qu'ils ont des idées assez droites en matière de morale, quoiqu'ils ne puissent pas toujours les bien développer, ni exprimer nettement tout ce qu'ils sentent ; mais ceux qui ont plus de pénétration, doivent être capables d'acquérir d'une manière distincte, toutes les lumières dont ils ont besoin pour se conduire.
Il n'est pas question dans la Morale de connaître l'essence réelle des substances, il ne faut que comparer avec soin certaines relations que l'on conçoit entre les actions humaines et une certaine règle. La vérité et la certitude des discours de morale, est considérée indépendamment de la vie des hommes, et de l'existence que les vertus dont ils traitent, ont actuellement dans le monde. Les Offices de Cicéron ne sont pas moins conformes à la vérité, quoiqu'il n'y ait presque personne qui en pratique exactement les maximes, et qui règle sa vie sur le modèle d'un homme de bien, tel que Cicéron nous l'a dépeint dans cet ouvrage. S'il est vrai dans la spéculation, que le meurtre mérite la mort, il le sera pareillement à l'égard de toute action réelle conforme à cette idée de meurtre.
Les difficultés qui embarrassent quelquefois en matière de morale, ne viennent pas tant de l'obscurité qu'on trouve dans les préceptes, que de certaines circonstances particulières, qui en rendent l'application difficîle ; mais ces circonstances particulières ne prouvent pas plus l'incertitude du précepte, que la peine qu'on a d'appliquer une démonstration de mathématique, n'en diminue l'infaillibilité. D'ailleurs, ces difficultés ne regardent pas les principes généraux, ni les maximes qui en découlent immédiatement ou médiatement, mais seulement quelques conséquences éloignées. Pour peu qu'on fasse usage de son bon sens, on ne doutera pas le moins du monde de la certitude des règles suivantes : qu'il faut obéir aux lois de la Divinité, autant qu'elles nous sont connues : qu'il n'est pas permis de faire du mal à autrui : que si l'on a causé du dommage, on doit le réparer : qu'il est juste d'obéir aux lois d'un souverain légitime, tant qu'il ne prescrit rien de contraire aux maximes invariables du Droit naturel, ou à quelque loi divine clairement révélée, etc. Ces vérités et plusieurs autres semblables, sont d'une telle évidence, qu'on ne saurait y rien opposer de plausible.
Si la science des mœurs s'est trouvée de tout temps extrêmement négligée, il n'est pas difficîle d'en découvrir les causes. Il est certain que les divers besoins de la vie, vrais ou imaginaires, les faux intérêts, les impressions de l'exemple et des coutumes, le torrent de la mode et des opinions reçues, les préjugés de l'enfance, les passions surtout, détournent ordinairement les esprits d'une étude sérieuse de la Morale. La philosophie, dit agréablement l'auteur moderne des Dialogues des morts, ne regarde que les hommes, et nullement le reste de l'univers. L'Astronome pense aux astres, le physicien à la nature, et les Philosophes à eux ; mais parce que cette philosophie les incommoderait, si elle se mêlait de leurs affaires, et si elle prétendait régler leurs passions, ils l'envaient dans le ciel arranger les planètes et en mesurer les mouvements ; ou bien ils la promenent sur la terre, pour lui faire examiner tout ce qu'ils y voient : enfin ils l'occupent toujours le plus loin d'eux qu'il leur est possible.
Il est pourtant certain, malgré cette plaisanterie de M. de Fontenelle, que dans tous les temps, ce sont les laïques philosophes qui ont fait le meilleur accueil à la Morale ; et c'est une vérité qu'on peut établir par tous les écrits des Sages de la Grèce et de Rome. Socrate, le plus honnête homme de l'antiquité fit une étude particulière de la Morale, et la traita avec autant de grandeur, que d'exactitude ; tout ce qu'il dit de la Providence en particulier, est digne des lumières de l'Evangile. La Morale est aussi partout répandue dans les ouvrages de Platon. Aristote en fit un système méthodique, d'après les mêmes principes et la même économie de son maître. La morale d'Epicure n'est pas moins belle, que droite dans ses fondements. Je conviens que sa doctrine sur le bonheur pouvait être mal interpretée, et qu'il en résulta de fâcheux effets, qui décrièrent sa secte : mais au fond cette doctrine était assez raisonnable ; et l'on ne saurait nier, que prenant le mot de bonheur dans le sens que lui donnait Epicure, la félicité de l'homme ne consiste dans le sentiment du plaisir, ou en général dans le contentement de l'esprit.
Cependant Zénon contemporain d'Epicure, se frayait une route encore plus glorieuse, en fondant la secte des Stoïciens. En effet il n'y a point eu de Philosophes qui aient parlé plus fortement de la fatale nécessité des choses, ni plus magnifiquement de la liberté de l'homme, que l'ont fait les Stoïciens. Rien n'est plus beau que leur morale, considérée en elle-même ; et à quelques-unes de leurs maximes près, rien n'est plus conforme aux lumières de la droite raison. Leur grand principe, c'est qu'il faut vivre conformément à la constitution de la nature humaine, et que le souverain bien de l'homme consiste dans la vertu ; c'est-à-dire dans les lumières de la droite raison, qui nous font considérer ce qui convient véritablement à notre état. Ils regardaient le monde comme un royaume dont Dieu est le principe, et comme un tout, à l'utilité duquel chaque personne qui en fait partie, doit concourir et rapporter toutes ses actions, sans préférer jamais son avantage particulier à l'intérêt commun. Ils croyaient qu'ils étaient nés, non chacun pour soi, mais pour la société humaine ; c'était là le caractère distinctif de leur secte, et l'idée qu'ils donnaient de la nature du juste et de l'honnête. Il n'y a point de Philosophes qui aient si bien reconnu, et si fort recommandé les devoirs indispensables où sont tous les hommes les uns envers les autres, précisément en-tant qu'hommes. Selon eux, on est né pour procurer du bien à tous les humains ; exercer la bénéficence envers tous ; se contenter d'avoir fait une bonne action, et l'oublier même en quelque manière, au-lieu de s'en proposer quelque récompense ; passer d'une bonne action à une bonne action ; se croire suffisamment payé, en ce que l'on a eu occasion de rendre service aux autres, et ne chercher par conséquent hors de soi, ni le profit ni la louange. A l'égard de nous-mêmes, il faut, disent les Stoïciens, n'avoir rien tant à cœur que la vertu ; ne se laisser jamais détourner de son devoir, ni par le désir de la vie, ni par la crainte des tourments, ni par celle de la mort ; moins encore de quelque dommage, ou de quelque perte que ce sait. Je ne dois pas entrer ici dans de plus grands détails ; mais un savant anglais, Thomas Gataker, dans la préface de son vaste et instructif Commentaire sur Marc Antonin, nous a donné un abrégé des plus beaux preceptes de la morale des Stoïciens, tiré du livre même de cet empereur, et de ceux d'Epictete et de Séneque, trois philosophes de cette secte estimable, et qui sont les seuls avec Plutarque, dont il nous reste quelques écrits.
Depuis Epicure et Zénon, on ne vit plus de beaux génies tenter de nouvelles routes dans la science de la Morale : chacun suivit la secte qu'il trouva la plus à son gout. Les Romains, qui reçurent des Grecs les arts et les sciences, s'en tinrent aux systèmes de leurs maîtres. Du temps d'Auguste, un philosophe d'Alexandrie nommé Potamon, introduisit une manière de philosopher que l'on appela éclectique, parce qu'elle consistait à choisir de tous les dogmes des Philosophes, ceux qui paraissaient les plus raisonnables. Cicéron suit à-peu-près cette méthode dans son livre des Offices, où il est tantôt stoïcien, tantôt péripatéticien. Cet excellent livre que tout le monde connait, est sans contredit le meilleur traité de Morale, le plus régulier, le plus méthodique et le plus exact que nous ayons. Il n'y a guère de moins bonnes choses dans celui des Lais, tout imparfait qu'il est ; mais c'est grand dommage qu'on ait perdu son Traité de la république, dont le peu de fragments qui nous restent donnent la plus haute idée.
Pour ce qui regarde la Morale de Séneque et de Plutarque, je serais assez du sentiment de Montagne, dans le jugement qu'il en porte. Ces deux auteurs, dit-il, se rencontrent dans la plupart des opinions utiles et vraies ; comme aussi leur fortune les fit naître à-peu-près dans le même siècle ; tous deux venus de pays étranger ; tous deux riches et puissants. Leur instruction est de la crême philosophique : Plutarque est plus uniforme et constant : Séneque plus ondoyant et divers : celui-ci se roidit et se tend pour armer la vertu contre la faiblesse, la crainte et les vicieux appétits : l'autre semble n'estimer pas tant leur effort, et dédaigner d'en hâter son pas, et de se mettre sur sa garde : il parait dans Séneque qu'il prête un peu à la tyrannie des empereurs de son temps : Plutarque est libre par-tout : Séneque est plein de pointes et de saillies : Plutarque de choses : celui-là vous échauffe plus et vous émeut : celui-ci vous contente davantage et vous paye mieux, il nous guide ; l'autre nous pousse : tantôt dans Plutarque, les discours sont étendus ; et tantôt il ne les touche que simplement, montrant seulement du doigt par où nous irons s'il nous plait, et se contentant de ne donner qu'une atteinte dans le plus vif d'un repos. Il les faut arracher de-là, et les mettre en place marchande.
J'ajoute que les sujets des morales de Plutarque, sont en général traités superficiellement ; et que les ouvrages de Séneque, le meilleur même, celui des Bienfaits, n'a point d'ordre. Epictete est plus simple et plus pur ; mais il manque de vues et d'élévation. Marc Antonin montre un esprit plus vaste et plus grand que son empire. Il ne s'est pas contenté d'expliquer solidement les preceptes de ses maîtres, il les a souvent corrigés, et leur a donné une nouvelle force, par la manière ingénieuse et naturelle dont il les a proposés, ou par les nouvelles découvertes qu'il y a jointes.
Les Platoniciens qui se rendirent célèbres dans le IIIe et iv. siécle, un Plotin, un Amélius, un Porphyre, un Jamblique, un Proclus, etc. s'attachèrent beaucoup plus à expliquer les spéculations, ou plutôt les réveries du fondateur de leur secte, qu'à cultiver sa morale. Un très-petit nombre de docteurs de l'Eglise chrétienne ne furent guère plus heureux, en s'entêtant d'idées chimériques, d'allégories, de disputes frivoles, et en s'abandonnant aux fougues de leur imagination échauffée. Il serait superflu de parcourir les siécles suivants, où l'ignorance et la corruption ne laissèrent presque plus qu'une étincelle de bon sens et de morale.
Cependant Aristote abandonné, reparut dans le VIe siécle. Boèce en traduisant quelques ouvrages du philosophe de Stagyre, jeta les fondements de cette autorité despotique, que la philosophie péripatéticienne vint à acquérir dans la suite des temps. Les Arabes s'en entêtèrent dans le XIe siécle, et l'introduisirent en Espagne, où elle subsiste toujours : de-là naquit la philosophie scolastique, qui se répandit dans toute l'Europe ; et dont la barbarie porta encore plus de préjudice à la religion et à la Morale, qu'aux sciences spéculatives.
La morale des scolastiques est un ouvrage de pièces rapportées, un corps confus, sans règle et sans principe, un mélange des pensées d'Aristote, du droit civil, du droit canon, des maximes de l'Ecriture-sainte et des Peres. Le bon et le mauvais se trouvent mêlés ensemble ; mais de manière qu'il y a beaucoup plus de mauvais que de bon. Les casuistes des derniers siécles n'ont fait qu'enchérir en vaines subtilités, et qui pis est en erreurs monstrueuses. Passons tous ces malheureux temps, et venons enfin à celui où la science des mœurs est, pour ainsi dire, ressuscitée.
Le fameux chancelier Bacon, qui finit sa carrière au commencement du XVIIe siécle, est un de ces grands génies à qui la postérité sera éternellement redevable des belles vues qu'il a fournies pour le rétablissement des sciences. Ce fut la lecture des ouvrages de ce grand homme, qui inspira à Hugues Grotius la pensée d'oser le premier former un système de morale, et de droit naturel. Personne n'était plus propre que Grotius à tenter cette entreprise. Un amour sincère de la vérité, une netteté d'esprit admirable, un discernement exquis, une profonde méditation, une érudition universelle, une lecture prodigieuse, une application continuelle à l'étude, au milieu d'un grand nombre de traverses, et des fonctions pénibles de plusieurs emplois considérables, sont les qualités qu'on ne saurait sans ignorance et sans injustice refuser à ce grand homme. Si la philosophie de son siècle était encore pleine de tenèbres, il a presque suppléé à ce défaut par la force de son bon sens et de son jugement. Son ouvrage, aujourd'hui si connu, parut à Paris pour la première fois en 1625.
Quoique Selden ait prodigué la plus vaste érudition dans son système des lois des Hébreux sur la morale et le droit naturel, il s'en faut bien qu'il ait effacé, ni même égalé Grotius. Outre le désordre et l'obscurité qui règnent dans la manière d'écrire de ce savant anglais, ses principes ne sont point tirés des lumières de la raison, mais des sept préceptes donnés à Noé, qui ne sont fondés que sur une tradition douteuse, ou sur les décisions des rabbins.
Peu de temps avant la mort de Grotius, parut sur la scène le fameux Thomas Hobbes. Si ce beau génie eut philosophé sans prévention, il aurait rendu des services considérables à la recherche de la vérité ; mais il pose pour principe des sociétés, la conservation de soi-même et l'utilité particulière : mais il établit sur cette supposition, que l'état de nature est un état de guerre de chacun contre tous ; mais il donne aux rois une autorité sans bornes, prétendant que la volonté des souverains fait et la religion, et tout ce qui est juste ou injuste.
Il était réservé à Samuel Puffendorf de profiter heureusement des lumières de tous ceux qui l'avaient précédé, et d'y joindre ses propres découvertes. Il dévéloppe distinctement les maximes fondamentales de la Morale, que Grotius n'avait fait qu'indiquer, et il en déduit par des conséquences suivies, les principaux devoirs de l'homme et du citoyen en quelque état qu'il se trouve. Il n'emprunte guère les pensées des auteurs, sans les développer, sans les étendre, et sans en tirer un plus grand parti. Mais c'est à M. Barbeyrac que le lecteur doit les principaux avantages qu'il peut aujourd'hui tirer de la lecture du droit de la guerre et de la paix, et du droit de la nature et des gens. Il leur faut joindre l'étude de Shafftbury, de Hutcheson, de Cumberland, de Wollaston, de la Placette et de l'Esprit des lais, qui respire la pure morale de l'homme dans quelque état qu'il se trouve.
Il nous manque peut-être un ouvrage philosophique sur la conformité de la morale de l'Evangîle avec les lumières de la droite raison ; car l'une et l'autre marchent d'un pas égal, et ne peuvent être séparées. La révélation suppose dans les hommes des connaissances qu'ils ont déjà, ou qu'ils peuvent acquérir en faisant usage de leurs lumières naturelles. L'existence d'une divinité infinie en puissance, en sagesse et en bonté, étant un principe évident par lui-même, les écrivains sacrés ne s'attachent point à l'établir : c'est par la même raison qu'ils n'ont point fait un système methodique de la morale, et qu'ils se sont contentés de préceptes généraux, dont ils nous laissent tirer les conséquences pour les appliquer à l'état de chacun, et aux divers cas particuliers.
Enfin ce serait mal connaître la religion, que de relever le mérite de la foi aux dépens de la Morale ; car quoique la foi soit nécessaire à tous les Chrétiens, on peut avancer avec vérité, que la Morale l'emporte sur la foi à divers égards. 1°. Parce qu'on peut être en état de faire du bien, et de se rendre plus utîle au monde par la Morale sans la foi, que par la foi sans la Morale. 2°. Parce que la Morale donne une plus grande perfection à la nature humaine, en ce qu'elle tranquillise l'esprit, qu'elle calme les passions, et qu'elle avance le bonheur de chacun en particulier. 3°. Parce que la règle pour la Morale est encore plus certaine que celle de la foi, puisque les nations civilisées du monde s'accordent sur les points essentiels de la Morale, autant qu'elles diffèrent sur ceux de la foi. 4°. Parce que l'incrédulité n'est pas d'une nature si maligne que le vice ; ou, pour envisager la même chose sous une autre vue, parce qu'on convient en général qu'un incrédule vertueux peut être sauvé, surtout dans le cas d'une ignorance invincible, et qu'il n'y a point de salut pour un croyant vicieux. 5°. Parce que la foi semble tirer sa principale, si ce n'est pas même toute sa vertu, de l'influence qu'elle a sur la morale. (D.J.)