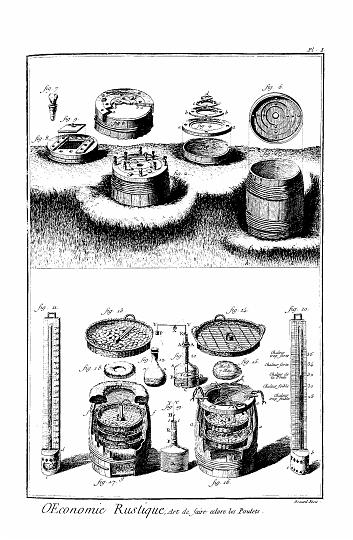S. m. (Théologie et Morale) nom que l'on donne aux dix commandements de Dieu gravés sur deux tables de pierre, et donnés à Moyse sur le mont Sinaï.
Ce mot est composé du grec , dix, et de , discours ou parole, comme si l'on disait les dix paroles ; c'est pourquoi les Juifs les appellent de temps immémorial les dix paroles.
Le nombre des dix préceptes est certain ; mais les commentateurs ne conviennent pas de leur distinction : car quelques-uns comptent dix préceptes qui regardent Dieu, en distinguant la défense de faire des figures taillées, du précepte qui ordonne de n'avoir point de dieux étrangers. Les autres n'en comptent que trois qui regardent le Seigneur, et sept qui concernent le prochain, en séparant ce précepte, Vous ne désirerez point la maison de votre prochain, d'avec celui-ci, ni sa femme, etc. Ces préceptes ont été conservés dans la loi évangelique, à l'exception de l'observation du sabbat, qui est changée en celle du dimanche, et ils obligent les Chrétiens comme les Juifs. Voyez DIMANCHE.
Les Samaritains, dans le texte et dans les versions qu'ils ont du Pentateuque, ajoutent après le dix-septième verset du vingtième chapitre de l'Exode, et après le XXIe. verset du Ve. chapitre du Deuteronome, un XIe. commandement ; savoir, de bâtir un autel sur le mont Garizim. C'est une interpolation qu'ils ont faite dans le texte, pour s'autoriser à avoir un temple et un autel sur cette montagne, afin de justifier leur schisme, et de décréditer, s'il leur était possible, le temple de Jérusalem, et la manière dont on y adorait Dieu. Cette interpolation parait même être de beaucoup antérieure à Jesus-Christ, à qui la femme samaritaine dit dans saint Jean, c. IVe Ve 20. patres nostri in monte hoc adoraverunt. Le mot patres marque une tradition ancienne, immémoriale ; et en effet cette opinion pouvait être née avec le schisme de Jéroboam.
Les Talmudistes, et après eux Postel dans son traité de Phenicum litteris, disent que le Décalogue ou les dix commandements étaient entiérement gravés sur les tables que Dieu donna à Moyse ; mais que cependant le milieu du mem final et du samech demeuraient miraculeusement suspendus, sans être attachés à rien. Voyez la dissertation sur les médailles samaritaines, imprimée à Paris en 1715. Les mêmes auteurs ajoutent que le Décalogue était écrit en lettres de lumière, c'est-à-dire en caractères brillans et éclatants.
Tous les préceptes du Décalogue se peuvent déduire de la justice et de la bienveillance universelle que la loi naturelle ordonne, et c'est un beau système que nous allons développer.
La première table du Décalogue prescrit nos devoirs envers Dieu ; l'autre envers les hommes, et toutes deux se réduisent à l'amour de Dieu et des hommes. Or il est clair que l'une et l'autre est renfermée dans le précepte de la bienveillance universelle, qui résulte nécessairement de la considération de la nature, en tant qu'elle a Dieu pour objet, comme le chef du système intellectuel, et les hommes comme soumis à son empire.
La première table du Décalogue se rapporte particulièrement à cette partie de la loi de la justice universelle, qui nous enseigne qu'il est nécessaire pour le bien commun, et par conséquent pour le bonheur de chacun de nous en particulier, de rendre à Dieu ce qui lui appartient, c'est-à-dire de reconnaître que Dieu est le souverain maître de tout et de toutes choses. Pour ce qui est du droit ou de la nécessité de lui attribuer un tel empire, on le déduit de ce que Dieu, infiniment bon, peut et veut obtenir cette fin de la manière la plus parfaite, étant doué d'une bonté et d'une sagesse infinie, par laquelle il découvre pleinement toutes les parties de cette grande fin, et tous les moyens les plus propres pour y parvenir ; ayant une volonté qui toujours embrasse la meilleure fin, et choisit les moyens les plus convenables, parce qu'elle est essentiellement d'accord avec sa sagesse et sa bonté ; étant enfin revêtu d'une puissance qui ne manque jamais d'exécuter ce à quoi sa volonté souverainement sage s'est déterminée.
Dès que l'on a découvert les perfections de l'Etre souverain, et la nécessité de l'empire de cet Etre souverain par rapport au bien commun, qui est le plus grand de tous, on est suffisamment averti de ne rendre à aucun autre que ce sait, un culte égal à celui que l'on rend à Dieu ; ce qui est défendu dans le premier précepte du Décalogue : de ne se représenter jamais Dieu comme semblable aux hommes, moins encore à d'autres animaux, ou comme ayant une forme corporelle dans laquelle il soit renfermé ; ce qui est défendu dans le second précepte : de ne s'attirer point le courroux et la vengeance de Dieu par quelque parjure ; ce qui fait la matière du troisième précepte : de destiner au culte divin une portion convenable de notre temps ; ce que le quatrième et dernier précepte de la première table insinue par l'exemple du sabbat, dont il recommande l'observation.
La seconde table peut être de même déduite de cette partie de la justice universelle, par laquelle la loi naturelle ordonne, comme une chose nécessaire pour le bien commun, d'établir et de maintenir inviolablement entre les hommes des domaines distincts, certains droits de propriété sur les choses, sur les personnes et sur les actions de celles-ci, c'est-à-dire qu'il s'en fasse une distribution sagement accommodée à la plus excellente fin, et que l'on garde celle que l'on trouve ainsi établie ; de sorte que chacun ait en propre du moins ce qui lui est nécessaire pour se conserver et pour être utîle aux autres ; deux effets qui l'un et l'autre contribuent au bonheur public.
Si nous cherchons plus distinctement ce qu'il faut de toute nécessité regarder comme appartenant en propre à chacun, pour le bien de tous, nous trouverons que tout se réduit aux chefs suivants.
1°. Le droit que chacun a de conserver sa vie et ses membres en leur entier, pourvu qu'il ne commette rien de contraire à quelqu'utilité publique, qui soit plus considérable que la vie d'un seul homme. C'est à un tel droit que le sixième précepte du Décalogue défend de donner aucune atteinte ; et par-là il permet non-seulement, mais encore il ordonne un amour de soi-même restreint dans certaines bornes. De plus, chacun a droit d'exiger la bonne foi et la fidélité dans les conventions qui n'ont rien de contraire au bien public. Entre ces conventions, une des plus utiles au genre humain, c'est celle du mariage, d'où dépend toute l'espérance de laisser des successeurs de famille, et d'avoir des aides dans la vieillesse ; c'est pourquoi le septième précepte ordonne à chacun de respecter inviolablement la fidélité des engagements de ce contrat ; c'est le moyen d'être plus assuré que le mari de la mère est le vrai père ; et en même temps ce précepte fraye le chemin à cette tendresse toute particulière que chacun a pour ses enfants.
2°. Chacun a besoin absolument de quelque portion des choses extérieures et du service des autres hommes, pour conserver sa vie et pour entretenir sa famille ; comme aussi pour être en état de se rendre utîle aux autres. Ainsi le bien public demande que dans le premier partage qu'on doit faire, on assigne à chacun de tels biens, et que chacun conserve la propriété de ceux qui lui sont échus ; en sorte que personne ne le trouble dans la jouissance de son droit : c'est ce que prescrit le huitième précepte.
3°. Il est bon encore pour l'utilité publique, que chacun, à l'égard de tous les droits dont nous venons de parler, comme lui étant acquis, soit à l'abri non-seulement des attentats réels, mais encore des atteintes que les autres pourraient y donner par des paroles nuisibles ou par des paroles illégitimes. Tout cela est défendu dans le neuvième et dixième précepte du Décalogue. Au reste, de l'obéissance rendue à tous ces préceptes négatifs, il résulte ce que l'on appelle innocence.
Il ne suffit pourtant pas de s'abstenir de faire du mal à qui que ce soit ; le bien commun demande encore manifestement que l'on soit disposé par des sentiments d'affection à rendre service aux autres, et qu'on le fasse dans l'occasion, par des paroles et par des actions, en tout ce que les préceptes du Décalogue indiqués ci-dessus, insinuent être nécessaire pour la fin que l'on doit se proposer. De plus, la bienveillance universelle acquiert de nouvelles forces par les secours de la reconnaissance, ou même par la seule vue de ceux qu'elle en peut tirer. Cette vertu est prescrite dans le cinquième précepte du Décalogue, dont j'ai renvoyé exprès à parler dans cet endroit ; et quoique dans ce cinquième précepte il ne soit fait mention expresse que de la reconnaissance envers nos parents, qui sont nos premiers bienfaiteurs après Dieu, le père commun de tous, c'est un exemple d'où nous pouvons apprendre, à cause de la parité de raison, qu'il faut montrer les effets de ce sentiment à tous ceux qui nous ont fait du bien, de quelque manière que ce sait.
On ne peut étendre plus loin l'idée de l'humanité, car on travaille suffisamment au bien public, en éloignant d'un côté les obstacles qui s'y opposent, et prenant d'autre côté des sentiments de bienveillance qui se répandent sur toutes les parties du système des êtres raisonnables, et procurent à chacun, autant qu'il dépend de nous, ce qui lui est nécessaire.
Enfin, comme les hommes ont en partage une raison qui leur enseigne l'existence d'un être souverain, auteur de tous les biens dont ils jouissent, cet être souverain veut par conséquent qu'ils lui rendent l'honneur qu'ils lui doivent, non parce qu'il en a besoin pour lui-même, mais parce qu'il ne peut point se contredire, ni autoriser rien de contraire à ce qui suit nécessairement de la relation qu'il y a entre le Créateur et les créatures : toutes les lois qu'il leur a prescrites tendent à les rendre heureuses ; or pourraient-elles observer ces lais, si elles n'en vénéraient pas l'auteur ? notre propre avantage ne demande-t-il pas encore que nous observions avant toutes choses ce premier devoir, puisqu'il est le fondement des autres, et que sans l'observation de ceux-là, on ne saurait pratiquer ceux-ci comme il faut ? Ces idées sont donc très-conformes à l'ordre des deux grands préceptes du Décalogue, qui font le sommaire de toute la loi, d'aimer Dieu par-dessus toutes choses, et notre prochain comme nous-mêmes ; c'est-à-dire de reconnaître le Créateur comme notre souverain seigneur tout-puissant, tout bon, tout sage, tout parfait, et de procurer à nos semblables leur bonheur, autant que cela dépend de nous.
Voilà un commentaire également judicieux et philosophique du Décalogue ; je l'ai extrait du beau traité des lois naturelles du docteur Cumberland, et je n'ai rien Ve de si bon dans aucun ouvrage de Morale ou de Théologie sur cette matière. Je n'ajouterai qu'une seule remarque.
Quoiqu'il soit vrai que les préceptes du Décalogue se rapportent par eux-mêmes au droit naturel, ainsi que le démontre l'illustre évêque de Péterborough, il me parait néanmoins qu'en tant qu'on considère ces préceptes comme gravés sur deux tables et donnés aux Israèlites par Moyse, on peut les appeler les lois civiles de ce peuple, ou plutôt les principaux chefs de son droit civil, auxquels le législateur ajoute ensuite divers commandements particuliers, accompagnés d'une détermination précise des peines dont il menaçait les contrevenans. En effet, le Décalogue ne parle point de tous les crimes, pas même de tous ceux qui étaient punissables devant le tribunal civil ; il ne parle que des plus énormes de chaque espèce. Il n'y est point fait mention, par exemple, des coups que l'on porte sans aller au-delà d'une blessure, mais seulement de l'homicide, ni de tout profit illicite qui tourne au détriment d'autrui ; mais seulement du larcin ; ni de toute perfidie, mais du seul faux témoignage. Le Décalogue ne contient donc que les principaux chefs, ou les fondements du gouvernement politique des Juifs ; mais néanmoins ces fondements (mettant à part ce qui regardait en particulier la nation judaïque) renferment des lois qui sont naturellement imposées à tous les hommes, et à l'observation desquelles ils sont tenus dans l'indépendance de l'état de la nature, comme dans toute société civile. Art. de M(D.J.)