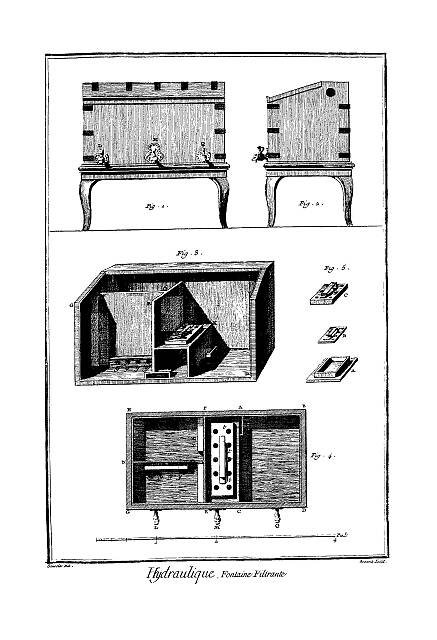S. f. (Métaphysique) En voyant tous les jours changer les choses, et en considérant qu'elles ont eu un commencement, nous acquérons l'idée de ce qu'on nomme cause et effet. La cause est tout ce par l'efficace de quoi une chose est ; et effet, tout ce qui est par l'efficace d'une cause. Toute cause, par cela même qu'elle produit un effet, peut être appelée efficiente : mais comme il y a différentes manières de produire un effet, on distingue diverses sortes de causes. Il y a des causes physiques, des causes morales, et des causes instrumentales. J'appelle causes physiques, toutes celles qui produisent immédiatement par elles-mêmes leur effet. Je nomme causes morales, celles qui ne le produisent que dépendamment d'une cause physique, de laquelle il émane immédiatement. Les causes instrumentales ont cela de commun avec les causes morales, qu'elles ne produisent pas par elles-mêmes leur effet, mais seulement par l'intervention d'une cause physique ; et c'est pourquoi on donne aux unes et aux autres le nom de causes occasionnelles : mais ce qui met entr'elles beaucoup de différence, c'est que si les premières ne sont que causes morales dans les effets qu'elles produisent occasionnellement, du moins elles sont causes physiques de l'effet par lequel elles deviennent causes occasionnelles d'un autre effet ; au lieu que les causes purement instrumentales n'étant douées d'aucune force ni d'aucune activité, demeurent toujours renfermées dans la sphère de causes purement occasionnelles : telle est, par exemple, la matière, qui d'elle-même est brute, insensible et inactive. Il n'en est pas de même des esprits, dont la nature est d'être actifs, et par consequent d'être causes physiques : si mon âme n'est que cause occasionnelle des divers mouvements qu'elle fait naître dans l'âme de ceux avec qui je m'entretiens, du moins elle est cause physique de ses déterminations particulières.
C'est ici le lieu d'examiner de quelle manière l'âme agit sur le corps : est-elle cause physique, ou n'est-elle que cause occasionnelle des divers mouvements qu'elle lui imprime ? Ici les sentiments des philosophes sont partagés ; et l'on peut dire que dans cette question les derniers efforts de la philosophie pourraient bien s'épuiser inutilement pour la résoudre. Le système de L'HARMONIE PREETABLIE, dont M. Leibnitz est auteur, tranche tout d'un coup la difficulté : c'est dommage que ce système détruise la liberté, et qu'il rende douteuse l'existence du monde corporel. Voyez cet article, où nous avons démontré l'un et l'autre. Le système ancien de l'influence réelle de l'âme sur le corps, détruit par notre Descartes et par le P. Malebranche son fidèle disciple, se trouve remis en honneur par le puissant appui que lui prêtent aujourd'hui les philosophes anglais. Dieu, selon ce système, a renfermé l'efficace qu'il communique à l'âme en la créant, dans les bornes du corps organisé auquel il l'unit ; son pouvoir est limité à cette petite portion de matière, et même elle n'en jouit qu'avec certaines restrictions qui sont les lois de l'union. Ce système moins subtil, moins raffiné que celui des causes occasionnelles, plait d'autant plus à la plupart des esprits, qu'il s'accorde assez bien avec le sentiment naturel, qui admet dans l'âme une efficace réelle pour mouvoir la matière : mais ce système qu'on nous donne ici sous le nom radouci de sentiment naturel, ne serait-il point plutôt l'effet du préjugé ? En effet, ce pouvoir d'un esprit fini sur la matière, cette influence qu'on lui suppose sur une substance si dissemblable à la sienne, et qui naturellement est indépendante de lui, est quelque chose de bien obscur. Les esprits étant des substances actives, et ayant incontestablement le pouvoir de se mouvoir ou de se modifier eux-mêmes, il est sans-doute plus raisonnable de leur attribuer une pareille influence sur la matière, que d'attribuer à la matière, être passif et incapable d'agir sur lui-même, un vrai pouvoir d'agir sur l'esprit, et de la modifier. Mais cela même que je viens d'observer est un fâcheux inconvénient pour ce système ; il ne peut dès-lors être vrai qu'à moitié. S'il explique en quelque sorte comment le corps obéit aux volontés de l'âme par ses mouvements, il n'explique point comment l'âme obéit fidélement à son tour aux impressions du corps : il rend raison de l'action ; il n'en rend aucune de la sensation. Sur ce dernier point on est réduit à recourir aux causes occasionnelles, et à l'opération immédiate de Dieu sur l'âme. Qu'en coute-t-il d'y avoir aussi recours pour expliquer l'efficace des désirs de l'âme ? le système entier n'en sera que plus simple et mieux assorti.
Ce système, dit-on, n'est nullement philosophique, parce qu'il remonte droit à la première cause ; et que sans apporter de raisons naturelles des phénomènes qui nous embarrassent, il donne d'abord la volonté de Dieu pour tout dénouement. Autant nous en apprendra, dit-on, l'homme le plus ignorant, s'il est consulté ; car qui ne sait que la volonté divine est la première cause de tout ? Mais c'est une cause universelle : or ce n'est pas de cette cause qu'il s'agit. On demande d'un philosophe qu'il assigne la cause particulière de chaque effet. Jamais objection ne fut plus méprisable. Voulez-vous, disait le P. Malebranche, qu'un philosophe trouve des causes qui ne sont point ? Le vrai usage de la Philosophie, c'est de nous conduire à Dieu, et de nous montrer par les effets mêmes de la nature, la nécessité d'une première cause. Quand les effets sont subordonnés les uns aux autres, et soumis à certaines lais, la tâche du philosophe est de découvrir ces lais, et de remonter par degrés au premier principe, en suivant la chaîne des causes secondes. Il n'y a point de progrès de causes à l'infini ; et c'est ce qui prouve l'existence d'un Dieu, la plus importante et la première des vérités. La différence du paysan au philosophe, qui tous deux sont également convaincus que la volonté de Dieu fait tout, c'est que le philosophe voit pourquoi elle fait tout, ce que le paysan ne voit pas ; c'est qu'il sait discerner les effets dont cette volonté est cause immédiate, d'avec les effets qu'elle produit par l'intervention des causes secondes, et des lois générales auxquelles ces causes secondes sont soumises.
On fait une seconde objection plus considérable que la première : c'est, dit-on, réduire l'action de la divinité à un pur jeu tout à fait indigne d'elle, que d'établir des causes occasionnelles. Ces causes seront en même temps l'effet et la règle de l'opération divine ; l'action qui les produit leur sera soumise. Tant que cette objection roulera sur les lois qui règlent la communication des mouvements entre les différentes parties de la matière, on ne peut nier qu'elle ne soit plausible. En effet, si les corps n'ont aucune activité par eux-mêmes, les lois du mouvement, dans le système du P. Malebranche, semblent n'être qu'un jeu : mais cet inconvénient ne subsiste plus dès qu'on applique le système à l'union du corps et de l'âme. Quoique l'âme n'ait aucune efficace réelle sur les corps, il suffit qu'elle ait le pouvoir de se modifier, qu'elle soit cause physique de ses propres volontés, pour rendre très-sage l'établissement d'une telle âme comme cause occasionnelle de certains mouvements du corps. Ici, comme l'utilité de l'âme est le but, la volonté de l'âme est la règle. Cette volonté étant une cause physique de ses propres actes, est par-là distincte de la volonté de Dieu même, et peut devenir une règle et un principe dont la sagesse divine fait dépendre les changements de la matière. Les volontés d'un esprit créé, dès-là qu'elles sont produites par cet esprit, sont une cause mitoyenne entre la volonté de Dieu et les mouvements des corps, qui rend raison de l'ordre de ces mouvements, et qui nous dispense de recourir, pour les expliquer, à la volonté immédiate de Dieu ; et c'est, ce semble, le seul moyen de distinguer les volontés générales d'avec les particulières. Les unes et les autres produisent bien immédiatement l'effet : mais dans celles-ci la volonté n'a de rapport qu'à cet effet singulier qu'elle veut produire ; au lieu que dans celle-là on peut dire que Dieu n'a voulu produire cet effet, que parce qu'il a voulu quelqu'autre chose dont cet effet est la conséquence. C'est bien une volonté efficace de Dieu qui me fait marcher : mais il ne veut me faire marcher qu'en conséquence de ce qu'il a voulu une fois pour toutes, que les mouvements de mon corps suivissent les désirs de mon âme. La volonté que j'ai de marcher, est une cause mitoyenne entre le mouvement de mon corps et la volonté de Dieu. Je marche en vertu d'une loi générale. Mon âme est vraie cause des mouvements de mon corps, parce qu'elle est cause de ses propres volontés, auxquelles il a plu au Créateur d'attacher ces mouvements. Ainsi les actions corporelles avec toutes leurs suites bonnes ou mauvaises, lui sont justement imputées ; elle en est vraie cause, selon l'usage le plus commun de ce terme. Cause, dans le langage ordinaire, signifie une raison par laquelle un effet est distingué d'un autre effet, et non cette efficace générale qui influe dans tous les effets. Pour rendre les hommes responsables de leurs actions, il importe fort peu qu'ils les produisent ou non par une efficacité naturelle, par un pouvoir physique que le Créateur ait donné à leur âme en la formant, de mouvoir le corps qui lui est uni : mais il importe beaucoup qu'ils soient causes morales ou libres ; il importe beaucoup que l'âme ait un tel empire sur ses propres actes, qu'elle puisse à son gré vouloir ou ne vouloir pas ces mouvements corporels qui suivent nécessairement sa volonté. Otez toute action aux corps, et faites mouvoir l'univers par l'efficace des volontés divines, toujours appliquées à remuer la matière, les lois du mouvement ne seront point un jeu, dès que vous conserverez aux esprits une véritable efficace, un pouvoir réel de se modifier eux-mêmes ; et dès que vous reconnoitrez qu'un certain arrangement de la matière à laquelle Dieu les unit, devient pour eux, par les diverses sensations qu'il y excite, une occasion de déployer leur activité.
Outre les causes physiques, morales, et instrumentales, on en distingue encore de plusieurs sortes ; savoir, la cause matérielle, la cause formelle, la cause exemplaire, la cause finale. La cause matérielle est le sujet sur lequel l'agent travaille, ou ce dont la chose est formée ; le marbre par exemple, est la cause matérielle d'une statue. La cause formelle, c'est ce qui détermine une chose à être ce qu'elle est, et qui la distingue de toute autre : la cause formelle s'unissant à la matérielle, produit le corps ou le composé. La cause exemplaire, c'est le modèle que se propose l'agent, et qui le dirige dans son action : ce modèle est ou intrinseque ou extrinseque à l'agent : dans le premier cas, il se confond avec les idées-archetypes, voyez IDEE ; dans le second cas, il se prend pour toutes les riches productions de la nature, et pour tous les ouvrages exquis de l'ART. Voyez ces deux articles. Pour ce qui regarde les causes finales, consultez l'article suivant. (X)
CAUSES FINALES, (Métaphysique) Le principe des causes finales consiste à chercher les causes des effets de la nature par la fin que son auteur a dû se proposer en produisant ces effets. On peut dire plus généralement, que le principe des causes finales consiste à trouver les lois des phénomènes par des principes métaphysiques.
Ce mot a été fort en usage dans la Philosophie ancienne, où l'on rendait raison de plusieurs phénomènes, tant bien que mal, par les principes métaphysiques aussi tant bons que mauvais. Par exemple on disait : l'eau monte dans les pompes, parce que la nature a horreur du vide ; voilà le principe métaphysique absurde par lequel on expliquait ce phénomène. Aussi le chancelier Bacon, ce génie sublime, ne parait pas faire grand cas de l'usage des causes finales dans la Physique. Causarum finalium, dit-il, investigatio sterilis est, et tanquam virgo Deo consecrata, nil parit. De augm. scient. lib. III. chap. Ve Quand ce grand génie parlait ainsi, il avait sans doute en vue le principe des causes finales, employé même d'une manière plus raisonnable que ne l'employaient les scolastiques. Car l'horreur du vide, par exemple, est un principe plus que stérile, puisqu'il est absurde. Bacon avait bien senti que nous voyons la nature trop en petit pour pouvoir nous mettre à la place de son auteur ; que nous ne voyons que quelques effets qui tiennent à d'autres, et dont nous n'apercevons pas la chaîne ; que la fin du Créateur doit presque toujours nous échapper, et que c'est s'exposer à bien des erreurs que de vouloir la démêler, et surtout expliquer par-là les phénomènes. Descartes a suivi la même route que Bacon, et sa philosophie a proscrit les causes finales, avec la scolastique. Cependant un grand philosophe moderne, M. Leibnitz, a essayé de ressusciter les causes finales, dans un écrit imprimé Act. erud. 1682, sous le titre de Unicum Opticæ, Catoptricæ, et Dioptricæ principium. Dans cet ouvrage M. Léibnitz se déclare hautement pour cette manière de philosopher, et il en donne un essai en déterminant les lois que suit la lumière.
La nature, dit-il, agit toujours par les voies les plus simples et les plus courtes ; c'est pour cela qu'un rayon de lumière dans un même milieu Ve toujours en ligne droite tant qu'il ne rencontre point d'obstacle : s'il rencontre une surface solide, il doit se réfléchir de manière que les angles d'incidence et de reflexion soient égaux ; parce que le rayon obligé de se réfléchir, Ve dans ce cas d'un point à un autre par le chemin le plus court qu'il est possible. Cela se trouve démontré par-tout. Voyez MIROIR et REFRACTION. Enfin si le globule lumineux rencontre une surface transparente, il doit se rompre de manière que les sinus d'incidence et de réfraction soient en raison directe des vitesses dans les deux milieux ; parce que dans ce cas il ira d'un point à un autre, dans le temps le plus court qu'il est possible.
M. de Fermat avant M. Leibnitz, s'était servi de ce même principe pour déterminer les lois de la réfraction ; et il ne faudrait peut-être que ce que nous venons de dire, pour démontrer combien l'usage des causes finales est dangereux.
En effet, il est vrai que dans la réflexion sur les miroirs plans et convexes, le chemin du rayon est le plus court qu'il est possible : mais il n'en est pas de même dans les miroirs concaves ; et il est aisé de démontrer que souvent ce chemin, au lieu d'être le plus court, est le plus long. J'avoue que le père Taquet, qui a adopté dans sa catoptrique ce principe du plus court chemin, pour expliquer la réflexion, n'est pas embarrassé de la difficulté des miroirs concaves. Lorsque la nature, dit-il, ne peut pas prendre ce chemin le plus court, elle prend le plus long ; parce que le chemin le plus long est unique et déterminé, comme le chemin le plus court. On peut bien appliquer ici ce mot de Cicéron : nihil tam absurdum excogitari potest, quod dictum non sit ab aliquo philosophorum.
Voilà donc le principe des causes finales en défaut sur la réflexion. C'est bien pis sur la réfraction ; car en premier lieu pourquoi dans le cas de la réflexion, la nature suit-elle tout-à-la-fais le plus court chemin et le plus court temps ; au lieu que dans la réfraction, elle ne prend que le plus court temps, et laisse le plus court chemin ? On dira qu'il a fallu choisir ; parce que dans le cas de la réfraction, le plus court temps et le plus court chemin ne peuvent s'accorder ensemble. A la bonne heure : mais pourquoi préférer le temps au chemin ? En second lieu, suivant MM. Fermat et Leibnitz, les sinus sont en raison directe des vitesses, au lieu qu'ils doivent être en raison inverse. Voyez REFRACTION et ACTION. Reconnaissons donc l'abus des causes finales par le phénomène même que leurs partisans se proposent d'expliquer à l'aide de ce principe.
Mais s'il est dangereux de se servir des causes finales à priori pour trouver les lois des phénomènes ; il peut être utile, et il est au moins curieux de faire voir comment le principe des causes finales s'accorde avec les lois des phénomènes, pourvu qu'on ait commencé par déterminer ces lois d'après des principes de mécanique clairs et incontestables. C'est ce que M. de Maupertuis s'est proposé de faire à l'égard de la réfraction en particulier, dans un mémoire imprimé parmi ceux de l'académie des Sciences, 1744. Nous en avons parlé au mot ACTION. Il fait à la fin et au commencement de ce mémoire, des réflexions très-judicieuses et très-philosophiques sur les causes finales. Il a depuis étendu ces réflexions, et porté plus loin leur usage dans les mémoires de l'académie de Berlin, 1746, et dans sa cosmologie. Il montre dans ces ouvrages l'abus qu'on a fait du principe des causes finales, pour donner des preuves de l'existence de Dieu par les effets les moins importants de la nature ; au lieu de chercher en grand des preuves de cette vérité si incontestable. Voyez l'article COSMOLOGIE. Ce qui appartient à la sagesse du Créateur, dit M. de Fontenelle, semble être encore plus au-dessus de notre faible portée, que ce qui appartient à sa puissance, Eloge de M. Leibnitz. Voyez aussi des réflexions très-sages de M. de Mairan sur le principe des causes finales, dans les mém. acad. 1723. (O)
CAUSE, en Mécanique et en Physique, se dit de tout ce qui produit du changement dans l'état d'un corps, c'est-à-dire, qui le met en mouvement ou qui l'arrête, ou qui altère le mouvement.
C'est une loi générale de la nature, que tout corps persiste dans son état de repos ou de mouvement, jusqu'à ce qu'il survienne quelque cause qui change cet état. Voyez PROJECTILE, IS DE LA NATURETURE.
Nous ne connaissons que deux sortes de causes capables de produire ou d'altérer le mouvement dans les corps ; les unes viennent de l'action mutuelle que les corps exercent les uns sur les autres, à raison de leur impénétrabilité : telles sont l'impulsion et les actions qui s'en dérivent, comme la traduction. Voyez ces deux mots. En effet, lorsqu'un corps en pousse un autre, cela vient de ce que l'un et l'autre corps sont impénétrables ; il en est de même lorsqu'un corps en tire un autre : car la traction, comme celle d'un cheval attaché à une voiture, n'est proprement qu'une impulsion. Le cheval pousse la courroie attachée à son poitrail ; et cette courroie étant attachée au char, le char doit suivre.
On peut donc regarder l'impénétrabilité des corps comme une des causes principales des effets que nous observons dans la nature ; mais il est d'autres effets dont nous ne voyons pas aussi clairement que l'impénétrabilité soit la cause ; parce que nous ne pouvons démontrer par quelle impulsion mécanique ces effets sont produits ; et que toutes les explications qu'on en a données par l'impulsion, sont contraires aux lois de la mécanique, ou démenties par les phénomènes. Tels sont la pesanteur des corps, la force qui retient les planètes dans leurs orbites, etc. Voyez PESANTEUR, GRAVITATION, ATTRACTION, etc.
C'est pourquoi, si on ne veut pas décider absolument que ces phénomènes aient une autre cause que l'impulsion, il faut au moins se garder de croire et de soutenir qu'ils aient l'impulsion pour cause : il est donc nécessaire de reconnaître une classe d'effets, et par conséquent de causes dans lesquelles l'impulsion ou n'agit point, ou ne se manifeste pas.
Les causes de la première espèce, savoir celles qui viennent de l'impulsion, ont des lois très-connues ; et c'est sur ces lois que sont fondées celles de la percussion, celles de la dynamique, etc. Voyez ces mots.
Il n'en est pas de même des causes de la seconde espèce. Nous ne les connaissons pas ; nous ne savons donc ce qu'elles sont que par leurs effets : leur effet seul nous est connu, et la loi de cet effet ne peut être donnée que par l'expérience, puisqu'elle ne saurait l'être à priori, la cause étant inconnue. Nous voyons l'effet, nous concluons qu'il a une cause : mais voilà jusqu'où il nous est permis d'aller. C'est ainsi qu'on a découvert par l'expérience la loi que suivent les corps pesans dans leur chute, sans connaître la cause de la pesanteur.
C'est un principe communément reçu en Mécanique, et très-usité, que les effets sont proportionnels à leurs causes. Ce principe pourtant n'est guère plus utîle et plus fécond que les axiomes. Voyez AXIOME. En effet je voudrais bien savoir de quel avantage il peut être.
1°. S'il s'agit des causes de la seconde espèce, qui ne sont connues que par leurs effets, il ne peut jamais servir de rien. Car si on ne connait pas l'effet, on ne connaitra rien du tout ; et si on connait l'effet, on n'a plus besoin du principe ; puisque deux effets différents étant donnés, on n'a qu'à les comparer immédiatement, sans s'embarrasser s'ils sont proportionnés ou non à leurs causes.
2°. S'il s'agit des causes de la première espèce, c'est-à-dire des causes qui viennent de l'impulsion, ces causes ne peuvent jamais être autre chose qu'un corps qui est en mouvement, et qui en pousse un autre. Or, non-seulement on a des lois de l'impulsion et de la percussion, indépendamment de ce principe : mais il serait même possible, si on s'en servait, de tomber dans l'erreur. Je l'ai fait voir, article 119 de mon traité de dynamique, je vais le répéter ici en peu de mots.
Sait un corps M qui choque avec la vitesse u un autre corps en repos m ; il est démontré, voyez PERCUSSION, que la vitesse commune aux deux corps après le choc sera Mu/(M + m.) Voilà ; si l'on veut, l'effet ; la cause est dans la masse M, animée de la vitesse u. Mais quelle fonction de M et de u prendra-t-on pour exprimer cette cause ? sera-ce M u, ou M u u, ou M 2 u, ou M u 3, etc. et ainsi à l'infini ? D'ailleurs, laquelle de ces fonctions qu'on prenne pour exprimer la cause, la vitesse produite dans le corps m variera à mesure que m variera, et ne sera point par conséquent proportionnelle à la cause, puisque M et u restant constants, la cause reste la même. On dira peut-être que je ne prents ici qu'une partie de l'effet, savoir la vitesse produite dans le corps m, et que l'effet total est (M M u)/(M + m) + (M m u)/(M + m), c'est-à-dire la somme des deux qualités de mouvement, laquelle est égale et proportionnelle à la cause M u. A la bonne-heure : mais l'effet total dont il s'agit, est composé de deux qualités de mouvement, qu'il faut que je connaisse séparément ; et comment les connaitrai-je avec ce principe, que l'effet est proportionnel à sa cause ? Il faudrait donc diviser la cause en deux parties pour chacun des deux effets partiels : comment se tirer de cet embarras ?
Il serait à souhaiter que les Mécaniciens reconnussent enfin bien distinctement que nous ne connaissons rien dans le mouvement que le mouvement même, c'est-à-dire l'espace parcouru et le temps employé à le parcourir, et que les causes métaphysiques nous sont inconnues ; que ce que nous appelons causes, même de la première espèce, n'est tel qu'improprement ; ce sont des effets desquels il résulte d'autres effets. Un corps en pousse un autre, c'est-à-dire ce corps est en mouvement, il en rencontre un autre, il doit nécessairement arriver du changement à cette occasion dans l'état des deux corps, à cause de leur impénétrabilité ; l'on détermine les lois de ce changement par des principes certains, et l'on regarde en conséquence le corps choquant comme la cause du mouvement du corps choqué. Mais cette façon de parler est impropre. La cause métaphysique, la vraie cause nous est inconnue. Voyez IMPULSION.
D'ailleurs quand on dit que les effets sont proportionnels à leurs causes ; ou on n'a point d'idée claire de ce que l'on dit, ou on veut dire que deux causes, par exemple, sont entr'elles comme leurs effets. Or, si ce sont deux causes métaphysiques dont on veut parler, comment peut-on avancer pareille assertion ? Les effets peuvent se comparer, parce qu'on peut trouver qu'un espace est double ou triple, etc. d'un autre parcouru dans le même temps : mais peut-on dire qu'une cause métaphysique, c'est-à-dire qui n'est pas elle-même un effet matériel, et pour ainsi dire palpable, soit double d'une autre cause métaphysique ? C'est comme si on disait qu'une sensation est double d'une autre ; que le blanc est double du rouge, etc. Je vois deux objets dont l'un est double de l'autre : peut-on dire que mes deux sensations sont proportionnelles à leurs objets ?
Un autre inconvénient du principe dont il s'agit, c'est le grand nombre de parallogismes dans lequel il peut entraîner, lorsqu'on sait mal démêler les causes qui se compliquent quelquefois plusieurs ensemble, pour produire un effet qui parait unique. Rien n'est si commun que cette mauvaise manière de raisonner. Concluons donc que le principe dont nous parlons est utile, et même dangereux. Il y a beaucoup d'apparence que si on ne s'était jamais avisé de dire que les effets sont proportionnels à leurs causes, on n'eut jamais disputé sur les forces vives. Voyez FORCE. Car tout le monde convient des effets. Que n'en restait-on là ? Mais on a voulu subtiliser, et on a tout brouillé au lieu d'éclaircir tout. (O)
CAUSE PROCATARCTIQUE, en Médecine, signifie la cause ou l'occasion originale primitive, ou préexistante d'un effet.
Ce mot vient du grec , qui est formé du verbe , je préexiste, je vais devant.
Telle est, par exemple, une maladie qui s'unit et coopère avec quelqu'autre maladie dont elle est suivie. Ainsi lorsque la colere ou la chaleur du climat dans lequel on vit, donne aux humeurs une disposition qui produit la fièvre, cette disposition est la cause immédiate de la fièvre ; et la colere ou la chaleur en est la cause procatarctique.
CAUSE CONTINENTE, en Médecine, se dit de celle dont la maladie dépend si immédiatement, qu'elle ne saurait cesser tant qu'elle subsiste. Voyez MALADIE.
Une cause continente de la suppression d'urine, est le calcul qui se trouve dans la vessie. Voyez CALCUL.
Fièvre continente ou continue, est celle dont la crise se fait sans intermission ou rémission. Voyez FIEVRE. (N)
CAUSE, en terme de Pratique, est la contestation qui fait l'objet d'un plaidoyer ; et quelquefois le plaidoyer même. On dit plutôt procès, quand il s'agit d'une affaire qui s'instruit par écritures.
On appelle causes d'appel, les moyens que l'appelant entend alléguer pour soutenir la légitimité de son appel. (H)
CAUSES MAJEURES, dans la discipline ecclésiastique, sont toutes les questions importantes qui concernent soit le dogme, soit la discipline, et particulièrement les actions intentées contre les évêques, dans des cas où il peut y avoir lieu à la déposition.
Suivant l'ancien droit, ces causes étaient jugées dans le concîle de la province, du jugement duquel le septième canon du concîle de Sardique, tenu en 347, permet d'appeler au pape, pour examiner de nouveau l'affaire : mais il en réserve toujours le jugement aux évêques de la province voisine.
Suivant le droit nouveau, c'est-à-dire l'introduction des Decrétales, comprises dans le recueil d'Isidore, c'est-à-dire depuis le IXe siècle, le concîle de la province peut bien instruire et examiner le procès : mais la décision doit être réservée au saint siège. Toutes les causes majeures depuis ce temps ont été censées appartenir au pape seul en première instance : et voici ce que les canonistes lui attribuent. Déclarer les articles de foi : convoquer le concîle général : approuver les conciles et les écrits des autres docteurs : diviser et unir les évêchés, ou en transférer le siège ; exempter les évêques et les abbés de la juridiction de leurs ordinaires : transférer les évêques : les déposer, les rétablir : juger souverainement, en sorte qu'il n'y ait point d'appel de ses jugements.
Voilà ce qu'on entend communément par causes majeures. La pragmatique-sanction a reconnu que les causes majeures, dont l'énumération expresse se trouve dans le droit, doivent être portées immédiatement au saint-siège, et qu'il y a des personnes dont la déposition appartient au pape : en sorte que s'ils sont trouvés mériter cette peine, ils doivent lui être renvoyés avec leur procès instruit.
Le concîle de Trente, sess. XXIV. c. Ve ordonne que les causes criminelles contre les évêques, si elles sont assez graves pour mériter déposition ou privation, ne seront examinées et terminées que par le pape ; que s'il est nécessaire de les commettre hors de la cour de Rome, ce sera aux évêques ou au métropolitain que le pape choisira par commission spéciale signée de sa main ; qu'il ne leur commettra que la seule connaissance du fait, et qu'ils seront obligés d'en renvoyer l'instruction au pape, à qui le jugement définitif est réservé. On laisse au concîle provincial les moindres causes.
Mais l'église gallicane a conservé l'ancien droit, suivant lequel les évêques ne doivent être jugés que par les évêques de la province assemblés en concile, en y appelant ceux des provinces voisines jusqu'au nombre de douze, sauf l'appel au pape suivant le concîle de Sardique. C'est ce que le clergé de France a arrêté, tant par sa protestation faite dans le temps contre le decret du concîle de Trente, que par celle qu'il fit en 1650, au sujet de ce qui s'était passé d'irrégulier et de contraire à ses droits dans l'instruction du procès de l'évêque de Léon ; en 1632 Fleuri, Instit. au Droit ecclés. tom. II. Part. III. ch. XVIIIe pag. 169. et suiv. (G)