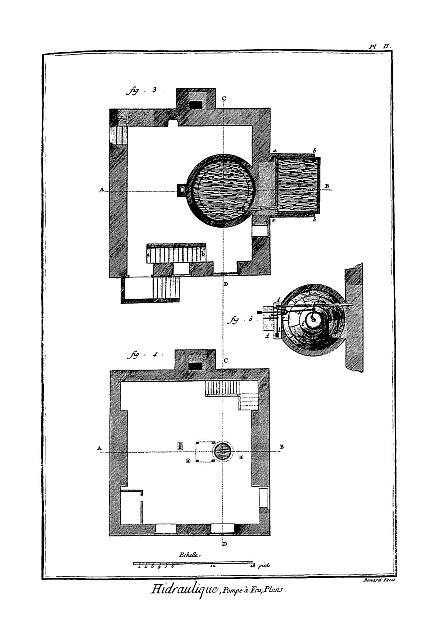S. m. (Métaphysique) succession de phénomènes dans l'univers, ou mode de durée marqué par certaines périodes et mesures, et principalement par le mouvement et par la révolution apparente du soleil. Voyez MODE et DUREE.
Voici les différentes opinions des philosophes sur le temps.
M. Locke observe que l'idée du temps en général s'acquiert en considérant quelque partie d'une durée infinie, divisée par des mesures périodiques ; et l'idée de quelque temps particulier ou de longueur de durée, comme est un jour, une heure, etc. s'acquiert d'abord en remarquant certains corps qui se meuvent suivant des périodes régulières, &, à ce qu'il semble, également distantes les unes des autres.
Comme nous pouvons nous représenter ou répéter tant que nous voulons ces longueurs ou mesures de temps, nous pouvons aussi nous imaginer une durée, dans laquelle rien ne se passe ou n'existe réellement, etc. c'est ainsi que nous nous formons l'idée de ce qu'on appelle lendemain, année prochaine, &c.
Quelques-uns des philosophes modernes définissent le temps ; la durée d'une chose dont l'existence n'est point sans commencement, ni sans fin ; ce qui distingue le temps de l'éternité. Voyez ÉTERNITE.
Aristote et les Péripatéticiens définissent le temps, numerus motus secundum prius et posterius ; ou une multitude de parties de mouvement qui passent et se succedent les unes des autres dans un flux continuel, et qui ont rapport ensemble entant que les unes sont antérieures et les autres postérieures.
Il s'ensuivrait de-là que le temps n'est autre chose que le mouvement lui-même, ou du-moins la durée du mouvement, considéré comme ayant plusieurs parties, dont les unes succedent continuellement aux autres ; mais, suivant ce principe, le temps ou la durée temporelle n'auraient pas lieu par rapport aux corps qui ne sont point en mouvement ; cependant personne ne peut nier que ces corps n'existent dans le temps, ou qu'ils n'aient une durée successive.
Pour éviter cet inconvénient, les Epicuriens et les Corpusculaires définissent le temps, une sorte de flux ou de succession différant du mouvement, et consistant dans une infinité de parties qui se succedent continuellement et immédiatement les unes aux autres ; mais d'autres philosophes rejettent cette notion, comme établissant un être éternel indépendant de Dieu : en effet, comment concevoir un temps avant l'existence de choses qui soient susceptibles de flux ou de succession ? et d'ailleurs il faudrait dire ce que c'est que ce flux, si c'est une substance ou un accident.
Plusieurs philosophes distinguent le temps comme on distingue le lieu, en temps absolu et en temps relatif. Voyez LIEU.
Le temps absolu est le temps considéré en lui-même, sans aucun rapport aux corps, ni à leurs mouvements ; ce temps s'écoule également, c'est-à-dire qu'il ne Ve jamais ni plus vite, ni plus lentement, mais que tous les degrés de son écoulement, si on peut parler ainsi, sont égaux ou invariables.
Le temps relatif ou apparent est la mesure de quelque durée, rendue sensible par le moyen du mouvement. Comme le flux égal et uniforme du temps n'affecte point nos sens, et que dans ce flux il n'y a rien qui puisse nous faire connaître immédiatement le temps même, il faut de nécessité avoir recours à quelque mouvement, par lequel nous puissions déterminer la quantité du temps, en comparant les parties du temps à celles de l'espace que le mobîle parcourt. C'est pourquoi, comme nous jugeons, que les temps sont égaux, quand ils s'écoulent pendant qu'un corps qui est en mouvement uniforme parcourt des espaces égaux, de même nous jugeons que les temps sont égaux quand ils s'écoulent pendant que le soleil, la lune et les autres luminaires célestes achevent leurs révolutions ordinaires, qui, à nos sens, paraissent uniformes. Voyez MOUVEMENT et UNIFORME.
Mais comme l'écoulement du temps ne peut être accéleré ni retardé, au-lieu que tous les corps se meuvent tantôt plus vite, et tantôt plus doucement, et que peut-être il n'y a point de mouvement parfaitement uniforme dans la nature, quelques auteurs croient qu'on ne peut conclure que le temps absolu est quelque chose de réellement et effectivement distingué du mouvement : car en supposant pour un moment, que les cieux et les astres eussent été sans mouvement depuis la création, s'ensuit-il de-là que le cours du temps aurait été arrêté ou interrompu ? et la durée de cet état de repos n'aurait-elle point été égale au temps qui s'est écoulé depuis la création ?
Comme le temps absolu est une quantité qui coule d'une manière uniforme et qui est très-simple de sa nature, les Mathématiciens le représentent à l'imagination par les plus simples grandeurs sensibles, et en particulier par des lignes droites et par des cercles, avec lesquels le temps absolu parait avoir beaucoup d'analogie pour ce qui regarde la succession, la similitude des parties, etc.
A la vérité, il n'est pas absolument nécessaire de mesurer le temps par le mouvement ; car le retour constant et périodique d'une chose qui arrive ou se manifeste par intervalles également éloignés les uns des autres, comme par exemple, l'épanouissement d'une plante, etc. peuvent faire la même chose. En effet, M. Locke fait mention d'un peuple de l'Amérique, lequel a coutume de compter les années par l'arrivée et par le départ des oiseaux. Chambers.
Voici ce que pense sur la notion du temps M. Formey dans l'article qu'il nous a communiqué sur ce sujet. Il en est, dit-il, à-peu-près de la notion du temps comme de celle de l'espace. On est partagé sur la réalité. Cependant il y a beaucoup moins de partisans du temps réel, que de l'espace réel, et l'on convient assez généralement que la durée n'est que l'ordre des choses successives en tant qu'elles se succedent, en faisant abstraction de toute autre qualité interne que de la simple succession. Ce qui fait naître la succession confuse et imaginaire du temps, comme de quelque chose qui existe indépendamment des êtres successifs, c'est la possibilité idéale.
On se figure le temps comme un être composé de parties continues et successives, qui coule uniformément, qui subsiste indépendamment des choses qui existent dans le temps qui a été dans un flux continuel de toute éternité et qui continuera de même. Mais cette notion du temps conduit aux mêmes difficultés que celle de l'espace absolu, c'est-à-dire que, selon cette notion, le temps serait un être nécessaire, immuable, éternel, subsistant par lui-même, et que par conséquent tous les attributs de Dieu lui conviendraient. C'est ce que nous avons déjà observé.
Par la possibilité idéale du temps, nous pouvons effectivement concevoir une succession antérieure à la succession réelle, pendant laquelle il se serait écoulé un temps assignable. C'est de cette idée qu'on se forme du temps qu'est venue la fameuse question que M. Clarke faisait à M. Leibnitz, pourquoi Dieu n'avait pas créé le monde six mille ans plus tôt ou plus tard ? M. Leibnitz n'eut pas de peine à renverser cette objection du docteur anglais, et son opinion sur la nature du temps par le principe de la raison suffisante ; il n'eut besoin pour y parvenir que de l'objection même de M. Clarke sur la création. Car si le temps est un être absolu qui consiste dans un flux uniforme, la question pourquoi Dieu n'a pas créé le monde six mille ans plus tôt ou plus tard devient réelle, et force à reconnaître qu'il est arrivé quelque chose sans raison suffisante. En effet, la même succession des êtres de l'univers étant conservée, Dieu pouvait faire commencer le monde plus tôt ou plus tard, sans causer le moindre dérangement. Or, puisque tous les instants sont égaux, quand on ne fait attention qu'à la simple succession, il n'y a rien en eux qui eut pu faire préférer l'un à l'autre, dès qu'aucune diversité ne serait parvenue dans le monde par ce choix ; ainsi un instant aurait été choisi par Dieu préférablement à un autre, pour donner l'existence à ce monde sans raison suffisante ; ce qu'on ne peut point admettre.
Le temps n'est donc qu'un être abstrait qui n'est rien hors des choses, et qui n'est point par conséquent susceptible des propriétés que l'imagination lui attribue : voici comment nous arrivons à sa notion. Lorsque nous faisons attention à la succession continue de plusieurs êtres, et que nous nous représentons l'existence du premier A distincte de celle du second B, et celle du second B distincte de celle du troisième C, et ainsi de suite, et que nous remarquons que deux n'existent jamais ensemble ; mais que A ayant cessé d'exister, B lui succede aussi-tôt, que B ayant cessé, C lui succede, etc. nous nous formons la notion de cet être que nous appelons temps ; et en tant que nous rapportons l'existence d'un être permanent à ces êtres successifs, nous disons qu'il a duré un certain temps.
On dit donc qu'un être dure, lorsqu'il co-existe à plusieurs autres êtres successifs dans une suite continue. Ainsi la durée d'un être devient explicable et commensurable par l'existence successive de plusieurs autres êtres ; car on prend l'existence d'un seul de ces êtres successifs pour un, celle de deux pour deux, et ainsi des autres ; et comme l'être qui dure leur co-existe à tous, son existence devient commensurable par l'existence de tous ces êtres successifs. On dit, par exemple, qu'un corps emploie du temps à parcourir un espace, parce qu'on distingue l'existence de ce corps dans un seul point, de son existence dans tout autre point ; et on remarque que ce corps ne saurait exister dans le second point, sans avoir cessé d'exister dans le premier, et que l'existence dans le second point suit immédiatement l'existence dans le premier. Et en tant qu'on assemble ces diverses existences et qu'on les considère comme faisant un, on dit que ce corps emploie du temps pour parcourir une ligne. Ainsi le temps n'est rien de réel dans les choses qui durent ; mais c'est un simple mode ou rapport extérieur, qui dépend uniquement de l'esprit, en tant qu'il compare la durée des êtres avec le mouvement du soleil, et des autres corps extérieurs, ou avec la succession de nos idées. Car lorsqu'on fait attention à l'enchainement des idées de notre âme, on se représente en même temps le nombre de toutes ces idées qui se succedent ; et de ces deux idées, savoir de l'ordre de leur succession et de leur nombre, on se forme une troisième idée, qui nous représente le temps comme une grandeur qui s'augmente continuellement.
L'esprit ne considère donc dans la notion abstraite du temps, que les êtres en général ; et abstraction faite de toutes les déterminations que ces êtres peuvent avoir, on ajoute seulement à cette idée générale, qu'on en a retenu celle de leur non-co-existence, c'est-à-dire, que le premier et le second ne peuvent point exister ensemble, mais que le second suit le premier immédiatement, et sans qu'on en puisse faire exister un autre entre deux, faisant encore ici abstraction des raisons internes, et des causes qui les font succéder l'un à l'autre. De cette manière l'on se forme un être idéal, que l'on fait consister dans un flux uniforme, et qui doit être semblable dans toutes ses parties.
Cet être abstrait doit nous paraitre indépendant des choses existantes, et subsistant par lui-même. Car puisque nous pouvons distinguer la manière successive d'exister des êtres, de leurs déterminations internes, et des causes qui font naître cette succession, nous devons regarder le temps à part comme un être constitué hors des choses, capable de subsister sans elles. Et comme nous pouvons aussi rendre à ces déterminations générales les déterminations particulières, qui en font des êtres d'une certaine espèce, il nous doit sembler que nous faisons exister quelque chose dans cet être successif qui n'existait point auparavant, et que nous pouvons de nouveau l'ôter sans détruire cet être. Le temps doit aussi nécessairement être considéré comme continu ; car si deux êtres successifs A et B ne sont pas censés continus dans leur succession, on en pourra placer un ou plusieurs entre deux, qui existeront après que A aura existé, et avant que B existe. Or par-là même on admet un temps entre l'existence successive d'A et de B. Ainsi on doit considérer le temps comme continu. Toutes ces notions peuvent avoir leur usage, quand il ne s'agit que de la grandeur de la durée et de composer les durées de plusieurs êtres ensemble. Comme dans la Géométrie on n'est occupé que de ces sortes de considérations, on peut fort bien mettre alors la notion imaginaire à la place de la notion réelle. Mais il faut bien se garder dans la Métaphysique et dans la Physique de faire la même substitution ; car alors on tomberait dans les difficultés de faire de la durée un être éternel, et de lui donner tous les attributs de Dieu.
Le temps n'est donc autre chose que l'ordre des êtres successifs, et on s'en forme une idée en tant qu'on ne considère que l'ordre de leur succession. Ainsi il n'y a point de temps sans des êtres véritables et successifs, rangés dans une suite continue ; et il y a du temps, aussi-tôt qu'il existe de tels êtres. Mais cette ressemblance dans la manière de se succéder des êtres, et cet ordre qui nait de leur succession, ne sont pas ces choses elles-mêmes.
Il en est du temps comme du nombre, qui n'est pas les choses nombrées, et du lieu, qui n'est pas les choses placées dans ce lieu : le nombre n'est qu'un agrégé des mêmes unités, et chaque chose devient une unité, quand on considère le tout simplement comme un être ; ainsi le nombre n'est qu'une relation d'un être considéré à l'égard de tous ; et quoiqu'il soit différent des choses nombrées, cependant il n'existe actuellement qu'en tant qu'il existe des choses qu'on peut réduire comme des unités sous la même classe. Ces choses posées, on pose un nombre, et quand on les ôte, il n'y en a plus. De même le temps, qui n'est que l'ordre des successions continues, ne saurait exister, à-moins qu'il n'existe des choses dans une suite continue ; aussi il y a du temps lorsque ces choses sont, et on l'ôte, quand on ôte ces choses ; et cependant il est, comme le nombre, différent de ces choses qui se suivent dans une suite continue. Cette comparaison du temps et du nombre peut servir à se former la véritable notion du temps, et à comprendre que le temps, de même que l'espace, n'est rien d'absolu hors des choses.
Quant à Dieu, on ne peut pas dire qu'il est dans le temps, car il n'y a point de succession en lui, puisqu'il ne peut lui arriver de changement. Dieu est toujours le même, et ne varie point dans sa nature. Comme il est hors du monde, c'est-à-dire, qu'il n'est point lié avec les êtres dont l'union constitue le monde, il ne co-existe point aux êtres successifs comme les créatures. Ainsi sa durée ne peut se mesurer par celle des êtres successifs ; car quoique Dieu continue d'exister pendant le temps, comme le temps n'est que l'ordre de la succession des êtres, et que cette succession est immuable par rapport à Dieu, auquel toutes les choses avec tous leurs changements sont présentes à la fais, Dieu n'existe point dans le temps. Dieu est à la fois tout ce qu'il peut être, au lieu que les créatures ne peuvent subir que successivement les états dont elles sont susceptibles.
Le temps actuel n'étant qu'un ordre successif dans une suite continue, on ne peut admettre de portion du temps, qu'en tant qu'il y a eu des choses réelles qui ont existé et cessé d'exister ; car l'existence successive fait le temps, et un être qui co-existe au moindre changement actuel dans la nature, a duré le petit temps actuel ; et les moindres changements, par exemple, les mouvements des plus petits animaux, désignent les plus petites parties actuelles du temps dont nous puissions nous apercevoir.
On représente ordinairement le temps par le mouvement uniforme d'un point qui décrit une ligne droite, et on le mesure aussi par le mouvement uniforme d'un objet. Le point est l'état successif, présent successivement à différents points, et engendrant par sa fluxion une succession continue, à laquelle nous attachons l'idée du temps. Le mouvement uniforme d'un objet mesure le temps ; car lorsque ce mouvement a lieu, le mobîle parcourt, par exemple, un pied dans le même temps, dans lequel il en a parcouru un premier pied : donc la durée des choses qui co-existent au mobîle pendant qu'il parcourt un pied, étant prise pour un, la durée de celles qui coexisteront à son mouvement pendant qu'il parcourra deux pieds sera deux, et ainsi de suite ; en sorte que par-là le temps devient commensurable, puisqu'on peut assigner la raison d'une durée à une autre durée qu'on avait prise pour l'unité ; ainsi dans les horloges l'aiguille se meut uniformément dans un cercle, et la douzième partie de la circonférence de ce cercle fait unité, et l'on mesure le temps avec cette unité, en disant deux heures, trois heures, etc. De même on prend une année pour un, parce que les révolutions du soleil dans l'écliptique sont égales, au-moins sensiblement, et on s'en sert pour mesurer d'autres durées par rapport à cette unité. On connait les efforts que les Astronomes ont faits pour trouver un mouvement uniforme qui les mit à portée d'en mesurer exactement le temps, et c'est ce que M. Huygens a trouvé par le moyen des pendules. Voyez PENDULE, etc.
Comme ce sont nos idées qui nous représentent les êtres successifs, la notion du temps nait de la succession de nos idées, et non du mouvement des corps extérieurs ; car nous aurions une notion du temps, quand même il n'existerait autre chose que notre âme, et en tant que les choses qui existent hors de nous sont conformes aux idées de notre âme qui les représentent, elles existent dans le temps.
Le mouvement est si loin de nous donner par lui-même l'idée de la durée, comme quelques philosophes l'ont prétendu, que nous n'acquérons même l'idée du mouvement, que par la réflexion que nous faisons sur les idées successives, que le corps qui se meut excite dans notre esprit par sa co-existence successive aux différents êtres qui l'environnent. Voilà pourquoi nous n'avons point l'idée du mouvement, en regardant la lune ou l'aiguille d'une montre, quoique l'une et l'autre soit en mouvement ; car ce mouvement est si lent, que le mobîle parait dans ce même point pendant que nous avons une longue succession d'idées. Le temps bien loin d'être la même chose que le mouvement, n'en dépend donc à aucun égard. Tant qu'il y aura des êtres dont l'existence se succédera, il y aura nécessairement un temps, soit que les êtres se meuvent ou qu'ils soient en repos.
Il n'y a point de mesure du temps exactement juste. Chacun a sa mesure propre du temps dans la promptitude ou la lenteur avec laquelle ses idées se succedent, et c'est de ces différentes vitesses en diverses personnes, ou dans la même en divers temps, que naissent ces façons de parler, j'ai trouvé le temps bien long ou bien court ; car le temps nous parait long, lorsque les idées se succedent lentement dans notre esprit, et au contraire. Les mesures du temps sont arbitraires, et peuvent varier chez les différents peuples ; la seule qui soit universelle, c'est l'instant. Lisez sur la mesure du temps les écrits de Messieurs Leibnitz et Clarke, dans le recueil de diverses pièces, publié par M. des Maizeaux ; le tome I. chap. VIe des institutions de physique de Madame du Châtelet ; et les paragraphes 569. 587. de l'ontologie de M. Wolf. Article de M. FORMEY.
Quelques auteurs distinguent le temps en astronomique et civil.
Le temps astronomique est celui qui se mesure purement et simplement par le mouvement des corps célestes.
Le temps civil n'est autre chose que le temps astronomique, accommodé aux usages de la société civile, et divisé en années, mois, jours, etc. Voyez JOUR, SEMAINE, MOIS, ANNEE, etc. Voyez aussi ALMANACH, CALENDRIER, etc.
Le temps fait l'objet de la chronologie. Voyez CHRONOLOGIE.
On distingue aussi dans l'Astronomie le temps vrai ou apparent, et le temps moyen ; on en peut voir l'explication à l'article ÉQUATION DU TEMS. Chambers.
TEMS, s. m. (Grammaire) les Grammairiens, si l'on veut juger de leurs idées par les dénominations qui les désignent, semblent n'avoir eu jusqu'à présent que des notions bien confuses des temps en général et de leurs différentes espèces. Pour ne pas suivre en aveugle le torrent de la multitude, et pour n'en adopter les décisions qu'en connaissance de cause, qu'il me soit permis de recourir ici au flambeau de la Métaphysique ; elle seule peut indiquer toutes les idées comprises dans la nature des temps, et les différences qui peuvent en constituer les espèces : quand elle aura prononcé sur les points de vue possibles, il ne s'agira plus que de les reconnaître dans les usages connus des langues, soit en les considérant d'une manière générale, soit en les examinant dans les différents modes du verbe.
ART. I. Notion générale des temps. Selon M. de Gamaches (dissert. I. de son Astronomie physique) que l'on peut en ce point regarder comme l'organe de toute l'école cartésienne, le temps est la succession même attachée à l'existence de la créature. Si cette notion du temps a quelque défaut d'exactitude, il faut pourtant avouer qu'elle tient de bien près à la vérité, puisque l'existence successive des êtres est la seule mesure du temps qui soit à notre portée, comme le temps devient à son tour la mesure de l'existence successive.
Cette mobilité successive de l'existence ou du temps, nous la fixons en quelque sorte, pour la rendre commensurable, en y établissant des points fixes caractérisés par quelques faits particuliers : de même que nous parvenons à soumettre à nos mesures et à nos calculs l'étendue intellectuelle, quelque impalpable qu'elle sait, en y établissant des points fixes caractérisés par quelque corps palpable et sensible.
On donne à ces points fixes de la succession de l'existence ou du temps, le nom d'époques (du grec , venu de , morari, arrêter), parce que ce sont des instants dont on arrête, en quelque manière, la rapide mobilité, pour en faire comme des lieux de repos, d'où l'on observe pour ainsi dire, ce qui co-existe, ce qui précède et ce qui suit. On appelle période, une portion du temps dont le commencement et la fin sont déterminés par des époques : de , circum, et , via ; parce qu'une portion de temps bornée de toutes parts, est comme un espace autour duquel on peut tourner.
Après ces notions préliminaires et fondamentales, il semble que l'on peut dire qu'en général les temps sont les formes du verbe, qui expriment les différents rapports d'existence aux diverses époques que l'on peut envisager dans la durée.
Je dis d'abord que ce sont les formes du verbe, afin de comprendre dans cette définition, non-seulement les simples inflexions consacrées à cet usage, mais encore toutes les locutions qui y sont destinées exclusivement, et qui auraient pu être remplacées par des terminaisons ; en sorte qu'elle peut convenir également à ce qu'on appelle des temps simples, des temps composés ou surcomposés, et même à quantité d'idiotismes qui ont une destination analogue, comme en français, je viens d'entrer, j'allais sortir, le monde doit finir, &c.
J'ajoute que ces formes expriment les différents rapports d'existence aux diverses époques que l'on peut envisager dans la durée : par-là après avoir indiqué le matériel des temps, j'en caractérise la signification, dans laquelle il y a deux choses à considérer, savoir les rapports d'existence à une époque, et l'époque qui est le terme de comparaison.
§. I. Première division générale des TEMS. L'existence peut avoir, en général, trois sortes de rapports à l'époque de comparaison : rapport de simultanéité, lorsque l'existence est coïncidente avec l'époque ; rapport d'antériorité, lorsque l'existence précède l'époque ; et rapport de postériorité, lorsque l'existence succede à l'époque. De-là trois espèces générales de temps, les présents, les prétérits et les futurs.
Les présents sont les formes du verbe, qui expriment la simultanéité d'existence à l'égard de l'époque de comparaison. On leur donne le nom de présents, parce qu'ils désignent une existence, qui, dans le temps même de l'époque, est réellement présente, puisqu'elle est simultanée avec l'époque.
Les prétérits sont les formes du verbe, qui expriment l'antériorité d'existence à l'égard de l'époque de comparaison. On leur donne le nom de prétérits, parce qu'ils désignent une existence, qui, dans le temps même de l'époque, est déjà passée (praeterita), puisqu'elle est antérieure à l'époque.
Les futurs sont les formes du verbe, qui expriment la postériorité d'existence à l'égard de l'époque de comparaison. On leur donne le nom de futurs, parce qu'ils désignent une existence, qui, dans le temps même de l'époque, est encore à venir (futura), puisqu'elle est postérieure à l'époque.
C'est véritablement du point de l'époque qu'il faut envisager les autres parties de la durée successive pour apprécier l'existence ; parce que l'époque est le point d'observation : ce qui co-existe est présent, ce qui précède est passé ou prétérit, ce qui suit est à venir ou futur. Rien donc de plus heureux que les dénominations ordinaires pour désigner les idées que l'on vient de développer ; rien de plus analogue que ces idées, pour expliquer d'une manière plausible les termes que l'on vient de définir.
L'idée de simultanéité caractérise très-bien les présents ; celle d'antériorité est le caractère exact des prétérits ; et l'idée de postériorité offre nettement la différence des futurs.
Il n'est pas possible que les temps des verbes expriment autre chose que des rapports d'existence à quelque époque de comparaison ; il est également impossible d'imaginer quelque espèce de rapport autre que ceux que l'on vient d'exposer : il ne peut donc en effet y avoir que trois espèces générales de temps, et chacune doit être différenciée par l'un de ces trois rapports généraux.
Je dis trois espèces générales de TEMS, parce que chaque espèce peut se soudiviser, et se soudivise réellement en plusieurs branches, dont les caractères distinctifs dépendent des divers points de vue accessoires qui peuvent se combiner avec les idées générales et fondamentales de ces trois espèces primitives.
§. 2. Seconde division générale des TEMS. La soudivision la plus générale des temps doit se prendre dans la manière d'envisager l'époque de comparaison, ou sous un point de vue général et indéterminé, ou sous un point de vue spécial et déterminé.
Sous le premier aspect, les temps des verbes expriment tel ou tel rapport d'existence à une époque quelconque et indéterminée : sous le second aspect, les temps des verbes expriment tel ou tel rapport d'existence à une époque précise et déterminée.
Les noms d'indéfinis et de définis employés ailleurs abusivement par le commun des Grammairiens, me paraissent assez propres à caractériser ces deux différences de temps. On peut donner le nom d'indéfinis à ceux de la première espèce, parce qu'ils ne tiennent effectivement à aucune époque précise et déterminée, et qu'ils n'expriment en quelque sorte que l'un des trois rapports généraux d'existence, avec abstraction de toute époque de comparaison. Ceux de la seconde espèce peuvent être nommés définis, parce qu'ils sont essentiellement relatifs à quelque époque précise et déterminée.
Chacune des trois espèces générales de temps est susceptible de cette distinction, parce qu'on peut également considérer et exprimer la simultanéité, l'antériorité et la postériorité, ou avec abstraction de toute époque, ou avec relation à une époque précise et déterminée ; on peut donc distinguer en indéfinis et définis, les présents, les prétérits et les futurs.
Un présent indéfini est une forme du verbe qui exprime la simultanéité d'existence à l'égard d'une époque quelconque ; un présent défini est une forme du verbe qui exprime la simultanéité d'existence à l'égard d'une époque précise et déterminée.
Un prétérit indéfini est une forme du verbe qui exprime l'antériorité d'existence à l'égard d'une époque quelconque ; un prétérit défini est une forme du verbe qui exprime l'antériorité d'existence à l'égard d'une époque précise et déterminée.
Un futur indéfini est une forme du verbe qui exprime la postériorité d'existence à l'égard d'une époque quelconque ; un futur défini est une forme du verbe qui exprime la postériorité d'existence à l'égard d'une époque précise et déterminée.
§. 3. Traisième division générale des TEMS. Il n'y a qu'une manière de faire abstraction de toute époque, et c'est pour cela qu'il ne peut y avoir qu'un présent, un prétérit et un futur indéfini. Mais il peut y avoir fondement à la soudivision de toutes les espèces de temps définis, dans les diverses positions de l'époque précise de comparaison, je veux dire, dans les diverses relations de cette époque à un point fixe de la durée.
Ce point fixe doit être le même pour celui qui parle et pour ceux à qui le discours est transmis, soit de vive voix soit par écrit, autrement une langue ancienne serait, si je puis le dire, intraduisible pour les modernes ; le langage d'un peuple serait incommunicable à un autre peuple, celui même d'un homme serait inintelligible pour un autre homme, quelque affinité qu'ils eussent d'ailleurs.
Mais dans cette suite infinie d'instants qui se succedent rapidement, et qui nous échappent sans-cesse, auquel doit-on s'arrêter, et par quelle raison de préférence se déterminera-t-on pour l'un plutôt que pour l'autre ? Il en est du choix de ce point fondamental, dans la grammaire, comme de celui d'un premier méridien, dans la géographie ; rien de plus naturel que de se déterminer pour le méridien du lieu même où le géographe opère ; rien de plus raisonnable que de se fixer à l'instant même de la production de la parole. C'est en effet celui qui, dans toutes les langues, sert de dernier terme à toutes les relations de temps que l'on a besoin d'exprimer, sous quelque forme que l'on veuille les rendre sensibles.
On peut donc dire que la position de l'époque de comparaison est la relation à l'instant même de l'acte de la parole. Or cette relation peut être aussi ou de simultanéité, ou d'antériorité, ou de postériorité, ce qui peut faire distinguer trois sortes d'époques déterminées : une époque actuelle qui coincide avec l'acte de la parole : une époque antérieure, qui précède l'acte de la parole : et une époque postérieure, qui suit l'acte de la parole.
De-là la distinction des trois espèces de temps définis en trois espèces subalternes, qui me semblent ne pouvoir être mieux caractérisées que par les dénominations d'actuel, d'antérieur et de postérieur tirées de la position même de l'époque déterminée qui les différencie.
Un présent défini est donc actuel, antérieur ou postérieur, selon qu'il exprime la simultanéité d'existence à l'égard d'une époque déterminément actuelle, antérieure ou postérieure.
Un prétérit défini est actuel, antérieur ou postérieur, selon qu'il exprime l'antériorité d'existence à l'égard d'une époque déterminément actuelle, antérieure ou postérieure.
Enfin un futur défini est pareillement actuel, antérieur ou postérieur, selon qu'il exprime la postériorité d'existence à l'égard d'une époque déterminément actuelle, antérieure ou postérieure.
ART. II. Conformité du système métaphysique des TEMS avec les usages des langues. On conviendra peut-être que le système que je présente ici, est raisonné, que les dénominations que j'y emploie, en caractérisent très-bien les parties, puisqu'elles désignent toutes les idées partielles qui y sont combinées, et l'ordre même des combinaisons. Mais on a Ve s'élever et périr tant de systèmes ingénieux et réguliers, que l'on est aujourd'hui bien fondé à se défier de tous ceux qui se présentent avec les mêmes apparences de régularité ; une belle hypothèse n'est souvent qu'une belle fiction ; et celle-ci se trouve si éloignée du langage ordinaire des Grammairiens, soit dans le nombre des temps qu'elle semble admettre, soit dans les noms qu'elle leur assigne, qu'on peut bien la soupçonner d'être purement idéale, et d'avoir assez peu d'analogie avec les usages des langues.
La raison, j'en conviens, autorise ce soupçon ; mais elle exige un examen avant que de passer condamnation. L'expérience est la pierre de touche des systèmes, et c'est aux faits à proscrire ou à justifier les hypothèses.
§. 1. Système des PRESENS justifié par l'usage des langues. Prenons donc la voie de l'analyse ; et pour ne point nous charger de trop de matière, ne nous occupons d'abord que de la première des trois espèces générales de temps, des présents.
I. Il en est un qui est unanimement reconnu pour présent par tous les Grammairiens ; sum, je suis, laudo, je loue, miror, j'admire, etc. Il a dans les langues qui l'admettent, tous les caractères d'un présent véritablement indéfini, dans le sens que j'ai donné à ce terme.
1°. On l'emploie comme présent actuel ; ainsi quand je dis, par exemple, à quelqu'un, je vous loue d'avoir fait cette action, mon action de louer est exprimée comme coexistante avec l'acte de la parole.
2°. On l'emploie comme présent antérieur. Que l'on dise dans un récit, je le rencontre en chemin, je lui demande où il va, je vois qu'il s'embarrasse ; " en tout cela, où il n'y a que des temps présents, je le rencontre est dit pour je le rencontrai ; je demande pour je demandai ; où il Ve pour où il allait ; je vois pour je vis ; et qu'il s'embarrasse pour qu'il s'embarrassait. " Regnier, gramm. franc. in -12, pag. 343, in -4°. pag. 360. En effet, dans cet exemple les verbes je rencontre, je demande, je vais, désignent mon action de rencontrer, de demander, de voir, comme coexistante dans le période antérieur indiqué par quelqu'autre circonstance du récit ; et les verbes il va, il s'embarrasse, énoncent l'action d'aller et de s'embarrasser comme coexistante avec l'époque indiquée par les verbes précédents je demande et je vais, puisque ce que je demandai, c'est où il allait dans l'instant même de ma demande, et ce que je vis, c'est qu'il s'embarrassait dans le moment même que je le voyais. Tous les verbes de cette phrase sont donc réellement employés comme des présents antérieurs, c'est-à-dire, comme exprimant la simultanéité d'existence à l'égard d'une époque antérieure au moment de la parole.
3°. Le même temps s'emploie encore comme présent postérieur. Je pars demain, je fais tantôt mes adieux ; c'est-à-dire, je partirai demain, et je ferai tantôt mes adieux : je pars et je fais énoncent mon action de partir et de faire, comme simultanée avec l'époque nettement désignée par les mots demain et tantôt, qui ne peut être qu'une époque postérieure au moment où je parle.
4°. Enfin l'on trouve ce temps employé avec abstraction de toute époque, ou si l'on veut, avec une égale relation à toutes les époques possibles ; c'est dans ce sens qu'il sert à l'expression des propositions d'éternelle vérité : Dieu est juste, les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits : c'est que ces vérités sont les mêmes dans tous les temps, qu'elles coexistent avec toutes les époques, et le verbe en conséquence, se met à un temps qui exprime la simultanéité d'existence avec abstraction de toute époque, afin de pouvoir être rapporté à toutes ses époques.
Il en est de même des vérités morales qui contiennent en quelque sorte l'histoire de ce qui est arrivé, et la prédiction de ce qui doit arriver. Ainsi dans cette maxime de M. de la Rochefoucault (pensée LV.) la haine pour les favoris n'est autre chose que l'amour de la faveur, le verbe est exprime une simultanéité relative à une époque quelconque, et actuelle, et antérieure, et postérieure.
Le temps auquel on donne communément le nom de présent, est donc un présent indéfini, un temps qui n'étant nullement astreint à aucune époque, peut demeurer dans cette généralité, ou être rapporté indifféremment à toute époque déterminée, pourvu qu'on lui conserve toujours sa signification essentielle et inamissible, je veux dire, la simultanéité d'existence.
Les différents usages que nous venons de remarquer dans le présent indéfini, peuvent nous conduire à reconnaître les présents définis ; et il ne doit point y en avoir d'autres que ceux pour lesquels le présent indéfini lui-même est employé, parce qu'exprimant essentiellement la simultanéité d'existence avec abstraction de toute époque, s'il sort de cette généralité, ce n'est point pour ne plus signifier la simultanéité, mais c'est pour l'exprimer avec rapport à une époque déterminée. Or
II. Nous avons Ve le présent indéfini employé pour le présent actuel, comme quand on dit, je vous loue d'avoir fait cette action ; mais dans ce cas-là même, il n'y a aucun autre temps que l'on puisse substituer à je loue ; et cette observation est commune à toutes les langues dont les verbes se conjuguent par temps.
La conséquence est facîle à tirer : c'est qu'aucune langue ne reconnait dans les verbes de présent actuel proprement dit, et que partout c'est le présent indéfini qui en fait la fonction. La raison en est simple : le présent indéfini ne se rapporte lui-même à aucune époque déterminée ; ce sont les circonstances du discours qui déterminent celle à laquelle on doit le rapporter en chaque occasion ; ici c'est à une époque antérieure ; là, à une époque postérieure ; ailleurs, à toutes les époques possibles. Si donc les circonstances du discours ne désignent aucune époque précise, le présent indéfini ne peut plus se rapporter alors qu'à l'instant qui sert essentiellement de dernier terme de comparaison à toutes les relations de temps, c'est-à-dire, à l'instant même de la parole : cet instant dans toutes les autres occurrences n'est que le terme éloigné de la relation ; dans celle-ci, il en est le terme prochain et immédiat, puisqu'il est le seul.
III. Nous avons Ve le présent indéfini employé comme présent antérieur, comme dans cette phrase, je le rencontre en chemin, je lui demande où il va, je vois qu'il s'embarrasse ; et dans ces cas, nous trouvons d'autres temps que l'on peut substituer au présent indéfini ; je rencontrai pour je rencontre, je demandai pour je demande, et je vis pour je vais, sont donc des présents antérieurs ; il allait pour il va, et il s'embarrassait pour il s'embarrasse, sont encore d'autres présents antérieurs. Ainsi nous voilà forcés à admettre deux sortes de présents antérieurs ; l'un dont on trouve des exemples dans presque toutes les langues, eram, j'étais, laudabam, je louais, mirabar, j'admirais ; l'autre, qui n'est connu que dans quelques langues modernes de l'Europe, l'italien, l'espagnol et le français, je fus, je louai, j'admirai.
1°. Voici sur la première espèce, comment s'explique le plus célèbre des grammairiens philosophes, en parlant des temps que j'appelle définis, et qu'il nomme composés dans le sens. " Le premier, dit-il, (gramm. gén. part. II. ch. xiv. édit. de 1660, ch. XVe édit. de 1756), est celui qui marque le passé avec rapport au présent, et on l'a nommé prétérit imparfait, parce qu'il ne marque pas la chose simplement et proprement comme faite, mais comme présente à l'égard d'une chose qui est déjà néanmoins passée. Ainsi quand je dis, cùm intravit, coenabam, je soupais, lorsqu'il est entré, l'action de souper est bien passée au regard du temps auquel je parle, mais je la marque comme présente au regard de la chose dont je parle, qui est l'entrée d'un tel ".
De l'aveu même de cet auteur, ce temps qu'il nomme prétérit, marque donc la chose comme présente à l'égard d'une autre qui est déjà passée. Or quoique cette chose en soi doive être réputée passée à l'égard du temps où l'on parle, Ve que ce n'est pas-là le point de vue indiqué par la forme du verbe dont il est question ; il fallait conclure que cette forme marque le présent avec rapport au passé, plutôt que de dire au contraire qu'elle marque le passé avec rapport au présent. Cette inconséquence est dû. à l'habitude de donner à ce temps, sans examen et sur la foi des Grammairiens, le nom abusif de prétérit ; on y trouve aisément une idée d'antériorité que l'on prend pour l'idée principale, et qui semble en effet fixer ce temps dans la classe des prétérits ; on y aperçoit ensuite confusément une idée de simultanéité que l'on croit sécondaire et modificative de la première : c'est une méprise, qui à parler exactement, renverse l'ordre des idées, et on le sent bien par l'embarras qui nait de ce désordre ; mais que faire ? Le préjugé prononce que le temps en question est prétérit ; la raison réclame, on la laisse dire, mais on lui donne, pour ainsi dire, acte de son opposition, en donnant à ce prétendu prétérit le nom d'imparfait : dénomination qui caractérise moins l'idée qu'il faut prendre de ce temps, que la manière dont on l'a envisagé.
2°. Le préjugé parait encore plus fort sur la seconde espèce de présent antérieur ; mais dépouillons-nous de toute préoccupation, et jugeons de la véritable destination de ce temps par les usages des langues qui l'admettent, plutôt que par les dénominations hazardées et peu réfléchies des Grammairiens. Leur unanimité même déjà prise en défaut sur le prétendu prétérit imparfait et sur bien d'autres points, a encore ici des caractères d'incertitude qui la rendent justement suspecte de méprise. En s'accordant pour placer au rang des prétérits je fus, je louai, j'admirai, les uns veulent que ce prétendu prétérit soit défini, et les autres qu'il soit indéfini ou aoriste, termes qui avec un sens très-clair ne paraissent pas appliqués ici d'une manière trop précise. Laissons-les disputer sur ce qui les divise, et profitons de ce dont ils conviennent sur l'emploi de ce temps ; ils sont à cet égard des témoins irrécusables de sa valeur usuelle. Or en le regardant comme un prétérit, tous les Grammairiens conviennent qu'il n'exprime que les choses passées dans un période de temps antérieur à celui dans lequel on parle.
Cet aveu combiné avec le principe fondamental de la notion des temps, suffit pour décider la question. Il faut considérer dans les temps 1°. une relation générale d'existence à un terme de comparaison, 2°. le terme même de comparaison. C'est en vertu de la relation générale d'existence qu'un temps est présent, prétérit ou futur, selon qu'il exprime la simultanéité, l'antériorité ou la postériorité d'existence ; c'est par la manière d'envisager le terme, ou sous un point de vue général et indéfini, ou sous un point de vue spécial et déterminé, que ce temps est indéfini ou défini ; et c'est par la position déterminée du terme, qu'un temps défini est actuel, antérieur ou postérieur, selon que le terme a lui-même l'un de ces rapports au moment de l'acte de la parole.
Or le temps, dont il s'agit, a pour terme de comparaison, non une époque instantanée, mais un période de temps : ce période, dit-on, doit être antérieur à celui dans lequel on parle ; par conséquent c'est un temps qui est de la classe des définis, et entre ceux-ci il est de l'ordre des temps antérieurs. Il reste donc à déterminer l'espèce générale de rapport que ce temps exprime relativement à ce période antérieur : mais il est évident qu'il exprime la simultanéité d'existence, puisqu'il désigne la chose comme passée dans ce période, et non avant ce période ; JE LUS hier votre lettre, c'est-à-dire que mon action de lire était simultanée avec le jour d'hier. Ce temps est donc en effet un présent antérieur.
On sent bien qu'il diffère assez du premier pour n'être pas confondu sous le même nom ; c'est par le terme de comparaison qu'ils diffèrent, et c'est de là qu'il convient de tirer la différence de leurs dénominations. Je disais donc que j'étais, je louais, j'admirais sont au présent antérieur simple, et que je fus, je louai, j'admirai sont au présent antérieur périodique.
Je ne doute pas que plusieurs ne regardent comme un paradoxe, de placer parmi les présents, ce temps que l'on a toujours regardé comme un prétérit. Cette opinion peut néanmoins compter sur le suffrage d'un grand peuple, et trouver un fondement dans une langue plus ancienne que la nôtre. La langue allemande, qui n'a point de présent antérieur périodique, se sert du présent antérieur simple pour exprimer la même idée : ich war (j'étais ou je fus) ; c'est ainsi qu'on le trouve dans la conjugaison du verbe auxiliaire seyn (être), de la grammaire allemande de M. Gottsched par M. Quand (édit. de Paris, 1754. ch. VIIe pag. 41.) ; et l'auteur prévoyant bien que cela peut surprendre, dit expressément dans une note, que l'imparfait exprime en même temps en allemand le prétérit et l'imparfait des français. Il est aisé de s'en apercevoir dans la manière de parler des Allemands qui ne sont pas encore assez maîtres de notre langue : presque par-tout où nous employons le présent antérieur périodique, ils se servent du présent antérieur simple, et disent, par exemple, je le trouvais hier en chemin, je lui demandais où il va, je voyais qu'il s'embarrasse, au lieu de dire, je le trouvai hier en chemin, je lui demandai où il allait, je vis qu'il s'embarrassait : c'est le germanisme qui perce à-travers les mots français, et qui dépose que nos verbes je trouvai, je demandai, je vis sont en effet de la même classe que, je trouvais, je demandais, je voyais. Les Allemands, nos voisins et nos contemporains, et peut-être nos pères ou nos frères, en fait de langage, ont mieux saisi l'idée caractéristique de notre présent antérieur périodique, l'idée de simultanéité, que ceux de nos méthodistes français qui se sont attachés servilement à la grammaire latine, plutôt que de consulter l'usage, à qui seul appartient la législation grammaticale. La langue anglaise est encore dans le même cas que l'allemande ; i had (j'avais et j'eus) ; i Was (j'étais et je fus). On peut voir la grammaire française - anglaise de Mauger, pag. 69, 70 ; et la grammaire anglaise-française de Festeau, pag. 42, 45. (in -8. Bruxelles, 1693.) Au reste je parle ici à ceux qui saisissent les preuves métaphysiques, qui les apprécient, et qui s'en contentent : ceux qui veulent des preuves de fait, et dont la métaphysique n'est peut-être que plus sure, trouveront plus loin ce qu'ils désirent ; des témoignages, des analogies, des raisons de syntaxe, tout viendra par la suite à l'appui du système que l'on développe ici.
IV. Continuons et achevons de lutter contre les préjugés, en proposant encore un paradoxe. Nous avons Ve le présent indéfini employé pour le présent postérieur, comme dans cette phrase, je pars demain ; dans ce cas nous trouvons un autre temps que l'on peut substituer au présent indéfini, et ce ne peut être que le présent postérieur lui-même : je partirai est donc un présent postérieur. Les gens accoutumés à voir les choses sous un autre aspect et sous un autre nom, vont dire ce que m'a déjà dit un homme d'esprit, versé dans la connaissance de plusieurs langues, que je vais faire des présents de tous les temps du verbe. Il faudrait pour cela que je confondisse toutes les idées distinctives des temps, et j'ose me flatter que mes réflexions auront une meilleure issue.
Un présent postérieur doit exprimer la simultanéité d'existence à l'égard d'une époque déterminément postérieure ; et c'est précisément l'usage naturel du temps dont il s'agit ici. Ecoutons encore l'auteur de la grammaire générale. " On aurait pu de même, dit-il (loc. cit.), ajouter un quatrième temps composé, savoir celui qui eut marqué l'avenir avec rapport au présent... néanmoins dans l'usage on l'a confondu... et en latin même on se sert pour cela de futur simple : cum caenabo, intrabis (vous entrerez quand je souperai) ; par où je marque mon souper comme futur en soi, mais comme présent à l'égard de votre entrée ".
On retrouve encore ici le même défaut que j'ai déjà relevé à l'occasion du présent antérieur simple : l'auteur dit que le temps dont il parle, eut marqué l'avenir avec rapport au présent ; et il prouve lui - même qu'il fallait dire qu'il eut marqué le présent avec rapport à l'avenir, puisque, de son aveu, coenabo, dans la phrase qu'il allegue, marque mon souper comme présent à l'égard de votre entrée, qui en soi est à venir. Coenabo (je souperai) est donc un présent postérieur.
Non, dit M. Lancelot ; le présent postérieur n'existe point ; c'est le futur simple qui en fait l'office dans l'occurrence. Si je prenais l'inverse de la thése, et que je dise que le futur n'existe point, mais que le présent postérieur en fait les fonctions ; je crois qu'il serait difficîle de décider d'une manière raisonnable entre les deux assertions : mais sans recourir à un faux-fuyant qui n'éclaircirait rien, qu'on me dise seulement pourquoi on ne tient aucun compte dans la conjugaison du verbe des temps très-réels coenaturus sum, coenaturus eram, coenaturus ero, qui sont évidemment des futurs ? Or s'il existe d'autres futurs que coenabo, pourquoi refuserait-on à coenabo la dénomination de présent postérieur, puisqu'il en fait réellement les fonctions.
Ceux qui auront lu l'article FUTUR, m'objecteront que je suis en contradiction avec moi-même, puisque j'y regarde comme futur le même temps que je nomme ici présent postérieur. J'avoue la contradiction de la doctrine que j'expose ici, avec l'article en question : mais il contient déjà le germe qui se développe aujourd'hui. Ce germe, contraint alors par la concurrence des idées de mon collègue, n'a ni pu ni dû se développer avec toute l'aisance que donne une liberté entière : et l'on ne doit regarder comme à moi, dans cet article, que ce qui peut faire partie de mon système ; je désavoue le reste, ou je le retracte.
§. 2. Système des PRETERITS justifié par les usages des langues. Comme nous avons reconnu quatre présents dans notre langue, quoiqu'on n'en trouve que trois dans la plupart des autres ; nous allons y reconnaître pareillement quatre prétérits, tandis que les autres langues n'en admettent au plus que trois.
I. Le premier, fui (j'ai été), laudavi (j'ai loué), miratus sum (j'ai admiré), etc. généralement reconnu pour prétérit, et décoré par tous les grammairiens du nom de prétérit-parfait, a tous les caractères exigibles d'un prétérit indéfini : et quoiqu'en effet on ne l'emploie pas à autant d'usages différents que le présent indéfini, il en a cependant assez pour prouver qu'il renferme fondamentalement l'abstraction de toute époque, ce qui est l'essence des temps indéfinis.
1°. On fait usage de ce prétérit pour désigner le prétérit actuel. J'AI LU l'excellent livre des Tropes, c'est-à-dire, mon action de lire ce livre est antérieure au moment même où je parle. Il y a plus ; aucune langue n'a établi dans ses verbes un prétérit actuel proprement dit ; c'est le prétérit indéfini qui en fait les fonctions, et c'est par la même raison qui fait que le présent indéfini tient lieu de présent actuel, raison, par conséquent, que je ne dois plus répéter.
2°. On emploie fréquemment le prétérit indéfini pour le prétérit postérieur. J'AI FINI dans un moment ; si vous AVEZ RELU cet ouvrage demain, vous m'en direz votre avis : dans le premier exemple, j'ai fini, énonce l'action de finir comme antérieure à l'époque désignée par ces mots, dans un moment, qui est nécessairement une époque postérieure ; c'est comme si l'on disait, J'AURAI FINI dans un moment, ou dans un moment je pourrai dire, J'AI FINI : dans le second exemple, vous avez relu, présente l'action de relire comme antérieure à l'époque postérieure indiquée par le mot demain, et c'est comme si l'on disait, lorsque VOUS AUREZ RELU demain cet ouvrage, vous m'en direz votre avis, ou lorsque demain vous pourrez dire que VOUS AVEZ RELU, &c.
3°. Le prétérit indéfini est quelquefois employé pour le prétérit antérieur. Que je dise dans un récit : sur les accusations vagues et contradictoires qu'on alléguait contre lui, je prends sa défense avec feu et avec succès : à peine AI-JE PARLE, qu'un bruit sourd s'élève de toutes parts, etc. Dans cet exemple, ai-je parlé énonce mon action de parler comme antérieure à l'époque désignée par ces mots, un bruit sourd s'élève : mais le présent indéfini s'élève est mis ici pour le présent antérieur périodique s'éleva ; et par conséquent l'époque est réellement antérieure à l'acte de la parole. Ai-je parlé est donc employé pour avais-je parlé, et il énonce en effet l'antériorité de mon action de parler à l'égard d'une époque antérieure elle-même au moment actuel de la parole.
4°. Le prétérit indéfini n'est jamais employé dans le sens totalement indéfini, comme le présent : c'est que les propositions d'éternelle vérité, essentiellement présentes à l'égard de toutes les époques, ne sont ni ne peuvent être antérieures ni postérieures à aucune : et les propositions d'une vérité contingente ont nécessairement des rapports différents aux diverses époques ; rapport de la simultanéité pour l'une, d'antériorité pour l'autre, de postériorité pour une troisième.
II. Le second de nos prétérits, est le prétérit antérieur simple, fueram (j'avais été), laudaveram (j'avais loué), miratus fueram (j'avais admiré). Les grammairiens ont donné à ce temps le nom de prétérit-plusque parfait, parce qu'ayant nommé parfait le prétérit indéfini, dont le caractère est d'exprimer l'antériorité d'existence, ils ont cru devoir ajouter quelque chose à cette qualification, pour désigner un temps qui exprime l'antériorité d'existence et l'antériorité d'époque.
Mais qu'il me soit permis de remarquer que la dénomination de plusque parfait a tous les vices les plus propres à la faire proscrire. 1°. Elle implique contradiction, parce qu'elle suppose le parfait susceptible de plus ou de moins, quoiqu'il n'y ait rien de mieux que ce qui est parfait. 2°. Elle emporte encore une autre supposition également fausse, savoir qu'il y a quelque perfection dans l'antériorité, quoiqu'elle n'en admette ni plus ni moins que la simultanéité et la postériorité. 3°. Ces considérations donnent lieu de croire que les noms des prétérits parfaits et plusque parfaits n'ont été introduits, que pour les distinguer du prétendu prétérit imparfait ; mais comme il a été remarqué plus haut que cette dénomination ne peut servir qu'à désigner l'imperfection des idées des premiers nomenclateurs, il faut porter le même jugement des noms de parfait et de plusque-parfait qui ont le même fondement.
Quoi qu'il en sait, ce second prétérit exprime en effet l'antériorité d'existence à l'égard d'une époque antérieure elle-même à l'acte de la parole ; ainsi quand je dit coenaveram cum intravit, (j'avais soupé lorsqu'il est entré) ; coenaveram, (j'avais soupé), exprime l'antériorité de mon souper à l'égard de l'époque désignée par intravit, (il est entré) ; et cette époque est elle même antérieure au temps où je le dis : coenaveram est donc véritablement un prétérit antérieur simple, ou relatif à une simple époque.
III. En français, en italien, et en espagnol, on trouve encore un prétérit antérieur périodique, qui est propre à ces langues, et qui diffère du précédent par le terme de comparaison, comme le présent antérieur périodique diffère du présent antérieur simple ; j'eus eté, j'eus loué, j'eus admiré, sont des prétérits antérieurs périodiques ; et pour s'en convaincre, il n'y a qu'à examiner toutes les idées partielles désignées par ces formes des verbes être, louer, admirer, &c.
Quand je dis, par exemple, j'eus soupé hier avant qu'il entrât : il est évident 1°. que j'indique l'antériorité de mon souper, à l'égard de l'entrée dont il est question ; 2°. que cette entrée est elle-même antérieure au temps où je parle, puisqu'elle est annoncée comme simultanée avec le jour d'hier ; 3°. enfin il est certain que l'on ne peut dire j'eus soupé, que pour marquer l'antériorité du souper à l'égard d'une époque prise dans un période antérieur à celui où l'on parle : il est donc constant que tout verbe, sous cette forme, est au prétérit antérieur périodique.
IV. Enfin nous avons un prétérit postérieur, qui exprime l'antériorité d'existence à l'égard d'une époque postérieure au temps où l'on parle ; comme fuero, (j'aurai été), laudavero, (j'aurai loué), miratus ero, (j'aurai admiré).
" Le troisième temps composé, dit encore l'auteur de la grammaire générale (loc. cit.) est celui qui marque l'avenir avec rapport au passé, savoir le futur parfait, comme coenavero (j'aurai soupé) ; par où je marque mon action de souper comme future en soi, et comme passée au - regard d'une autre chose à venir qui la doit suivre ; comme quand j'aurai soupé il entrera : cela veut dire que mon souper qui n'est pas encore venu, sera passé lorsque son entrée, qui n'est pas encore venue, sera présente ".
La prévention pour les noms reçus fait toujours illusion à cet auteur ; il est persuadé que le temps dont il parle est un futur, parce que tous les grammairiens s'accordent à lui donner ce nom : c'est pour cela qu'il dit que ce temps marque l'avenir avec rapport au passé : au-lieu qu'il suit de l'exemple même de la grammaire générale, qu'il marque le passé avec rapport à l'avenir. Quelle est en effet l'intention de celui qui dit, quand j'aurai soupé il entrera ? c'est évidemment de fixer le rapport du temps de son souper, au temps de l'entrée de celui dont il parle ; cette entrée est l'époque de comparaison, et le souper est annoncé comme antérieur à cette époque ; c'est l'unique destination de la forme que le verbe prend en cette occurrence, et par conséquent cette forme marque réellement l'antériorité à l'égard d'une époque postérieure au temps de la parole, ou, pour me servir des termes de M. Lancelot, mais d'une manière conséquente à l'observation, elle marque le passé avec rapport à l'avenir.
Une autre erreur de cet écrivain célèbre, est de croire que coenavero, (j'aurai soupé), marque mon action de souper comme future en soi, et comme passée au regard d'une autre chose à venir, qui la doit suivre. Coenavero, et tous les temps pareils des autres verbes, n'expriment absolument que le second de ces deux rapports, et loin d'exprimer le premier, il ne le suppose pas même. En voici la preuve dans un raisonnement d'un auteur qu'on n'accusera pas de mal écrire, ou de ne pas sentir la force des termes de notre langue ; c'est M. Pluche.
" Si le tombeau, dit-il (spectacle de la nature, disc. prél. du tom. VIII. pag. 8. et 9.), est pour lui (l'homme) la fin de tout ; le genre humain se divise en deux parties, dont l'une se livre impunément au crime, l'autre s'attache sans fruit à la vertu... les voluptueux et les fourbes... seront ainsi les seules têtes bien montées, et le Créateur, qui a mis tant d'ordre dans le monde corporel, n'AURA ETABLI ni règle ni justice dans la nature intelligente, même après lui avoir inspiré une très-haute idée de la règle et de la justice ".
Dès le commencement de ce discours, on trouve une époque postérieure, fixée par un fait hypothétique ; si le tombeau est pour l'homme la fin de tout, c'est-à-dire, en termes clairement relatifs à l'avenir, si le tombeau doit être pour l'homme la fin de tout : quand on ajoute ensuite que le Créateur n'AURA ETABLI ni règle ni justice, on veut simplement désigner l'antériorité de cet établissement à l'égard de l'époque hypothétique, et il est constant qu'il ne s'agit point ici de rien statuer sur les actes futurs du Créateur ; mais qu'il est question de conclure, d'après ses actes passés, contre les suppositions absurdes qui tendent à anéantir l'idée de la providence. Le verbe aura établi, n'exprime donc en soi aucune futurition, et l'on aurait même pu dire, le Créateur n'a établi ni règle ni justice ; ce qui exclut entièrement et incontestablement l'idée d'avenir ; mais on a préféré avec raison le prétérit postérieur, parce qu'il était essentiel de rendre sensible la liaison de cette conséquence, avec l'hypothèse de la destruction totale de l'homme, que l'on suppose future ; et que rien ne convient mieux pour cela, que le prétérit postérieur, qui exprime essentiellement relation à une époque postérieure.
§. 3. Système des FUTURS, justifié par les usages des langues. L'idée de simultanéité, celle d'antériorité, et celle de postériorité, se combinent également avec l'idée du terme de comparaison : de-là autant de formes usuelles pour l'expression des futurs, qu'il y en a de généralement reçues pour la distinction des présents et pour celle des prétérits. Nous devons donc trouver un futur indéfini, un futur antérieur, et un futur postérieur.
I. Le futur indéfini doit exprimer la postériorité d'existence avec abstraction de toute époque de comparaison ; et c'est précisément le caractère des temps latins et français, futurus sum, (je dois être) ; laudaturus sum, (je dois louer) ; miraturus sum, (je dois admirer) ; etc.
Par exemple dans cette phrase, tout homme DOIT MOURIR, qui est l'expression d'une vérité morale, confirmée par l'expérience de tous les temps, ces mots doit mourir, expriment la postériorité de la mort, avec abstraction de toute époque, et dès-là avec relation à toutes les époques ; et c'est comme si l'on disait, tous les hommes nos prédécesseurs DEVOIENT MOURIR, ceux d'aujourd'hui DOIVENT MOURIR, et ceux qui nous succéderont DEVRONT MOURIR : ces mots doit mourir, constituent donc ici un vrai futur indéfini.
Ce futur indéfini sert exclusivement à l'expression du futur actuel, de la même manière, et pour la même raison que le présent et le prétérit actuels n'ont point d'autres formes que celle du présent et du prétérit indéfini : ainsi quand je dis, par exemple, je redoute le jugement que le public DOIT PORTER de cet ouvrage ; ces mots, doit porter, marquent évidemment la postériorité de l'action de juger, à l'égard du temps même où je parle, et font par conséquent ici l'office d'un futur actuel : c'est comme si je disais simplement, je redoute le jugement à venir du public sur cet ouvrage.
On trouve quelquefois la même forme employée dans le sens d'un futur postérieur ; par exemple dans cette phrase : si je DOIS jamais SU BIR un nouvel examen, je m'y préparerai avec soin ; ces mots je dois subir, désignent clairement la postériorité de l'action de subir à l'égard d'une époque postérieure elle-même au temps où je parle, et indiquée par le mot jamais ; ces mots font donc ici l'office de futur postérieur, et c'est comme si je disais, s'il est jamais un temps où je DEVRAI SUBIR, etc.
II. Le futur antérieur doit exprimer la postériorité à l'égard d'une époque antérieure à l'acte de la parole ; c'est ce qu'il est aisé de reconnaître dans futurus eram, (je devais être) ; laudaturus eram, (je devais louer) ; miraturus eram, (je devais admirer) ; etc.
Ainsi quand on dit, je DEVOIS hier SOUPER avec vous, l'arrivée de mon frère m'en empêcha ; ces mots, je devais souper, expriment la postériorité de mon souper à l'égard du commencement du jour d'hier, qui est une époque antérieure au temps où je parle ; je devais souper est donc un futur antérieur.
III. Le futur postérieur doit marquer la postériorité à l'égard d'une époque postérieure elle-même à l'acte de la parole ; et il est facîle de remarquer cette combinaison d'idées dans futurus ero, (je devrai être) ; laudaturus ero, (je devrai louer) ; miraturus ero, (je devrai admirer) ; etc.
Ainsi quand je dis, lorsque je DEVRAI SUBIR un examen, je m'y préparerai avec soin ; il est évident que mon action de subir l'examen, est désignée ici comme postérieure à un temps à venir désigné par lorsque : je devrai subir est donc en effet un futur postérieur, puisqu'il exprime la postériorité à l'égard d'une époque postérieure elle même à l'acte de la parole.
Art. III. Conformité du système des TEMS avec les analogies des langues. Qu'il me soit permis de retourner en quelque sorte sur mes pas, pour confirmer, par des observations générales, l'économie du système des temps, dont je viens de faire l'exposition. Mes premières remarques tomberont sur l'analogie de la formation des temps, et dans une même langue, et dans des langues différentes ; des analogies adoptées avec une certaine unanimité, doivent avoir un fondement dans la raison même, parce que, comme dit Varron (de ling. lat. VIII. iij.), qui in loquendo consuetudinem, quâ oportet uti, sequitur, non sine ea ratione. Il semble même que ce savant romain n'ait mis aucune différence entre ce qui est analogique, et ce qui est fondé en raison, puis qu'un peu plus haut, il emploie indifféremment les mots ratio et analogia. Sed hi qui in loquendo, dit-il, (Ibid. 1.) partim sequi jubent nos consuetudinem, partim rationem, non tam discrepant ; quod consuetudo et analogia conjunctiores sunt inter se quam hi credunt.
Le grammairien philosophe, car il mérite ce titre, ne portait ce jugement de l'analogie, qu'après l'avoir examinée et approfondie : il y avait entrevu le fondement de la division des temps, tel que je l'ai proposée, et il s'en explique d'une manière si positive et si précise, que je suis extrêmement surpris que personne n'ait songé à faire usage d'une idée qui ne peut que répandre beaucoup de jour sur la génération des temps dans toutes les langues. Voici ses paroles, et elles sont remarquables (Ibid. 56.) Similiter errant qui dicunt ex utrâque parte verba omnia commutare syllabas oportère ; ut in his, pungo, pungam, pupugi ; tundo, tundam, tutudi : dissimilia enim conferunt, verba imperfecta cum perfectis. Quòd si imperfecta modo conferrent, omnia verbi principia incommutabilia viderentur ; ut in his pungebam, pungo, pungam : et contrà ex utrâque parte commutabilia, si perfecta ponèrent ; ut pupugeram, pupugi, pupugero.
On voit que Varron distingue ici bien nettement les trois temps que je comprends sous le nom général de présents, des trois que je désigne par la dénomination commune de prétérits ; qu'il annonce une analogie commune aux trois temps de chaque espèce, mais différente d'une espèce à l'autre ; enfin qu'il distingue ces deux espèces par des noms différents, donnant aux temps de la première le nom d'imparfaits, imperfecta ; et à ceux de la seconde le nom de parfaits, perfecta.
Ce n'est pas par le choix des dénominations que je voudrais juger de la philosophie de cet auteur : avec de l'érudition, de l'esprit, de la sagacité même, il n'avait pas assez de métaphysique pour débrouiller la complication des idées élémentaires, si je puis parler ainsi, qui constituent le sens total des formes usuelles du verbe ; ce n'était pas le ton de son siècle ; mais il était observateur attentif, intelligent, patient, scrupuleux même ; et c'est peut-être le meilleur fond sur lequel puisse porter la saine philosophie. Justifions celle de Varron par le développement du principe qu'il vient de nous présenter.
Remarquons d'abord que dans la plupart des langues, il y a des temps simples et des temps composés.
Les temps simples, sont ceux qui ne consistent qu'en un seul mot, et qui entés tous sur une même racine fondamentale, différent entr'eux par les inflexions et les terminaisons propres à chacun.
Je dis inflexions et terminaisons ; et j'entends par le premier de ces termes, les changements qui se font dans le corps même du mot avant la dernière syllabe ; et par le second, les changements de la dernière ou des dernières syllabes. Voyez INFLEXION. Pung-o et pung-am ne diffèrent que par les terminaisons, et il en est de même de pupuger-o et pupuger-am : au contraire, pungo et pupugero ne diffèrent que par des inflexions, de même que pungam et pupugeram, puisqu'ils ont des racines et des terminaisons communes : enfin, pungam et pupugero diffèrent et par les inflexions, et par les terminaisons.
Les TEMS composés, sont ceux qui résultent de plusieurs mots, dont l'un est un temps simple du verbe même, et le reste est emprunté de quelque verbe auxiliaire.
On entend par verbe auxiliaire, un verbe dont les temps servent à former ceux des autres verbes ; et l'on peut en distinguer deux espèces, le naturel et l'usuel.
Le verbe auxiliaire naturel, est celui qui exprime spécialement et essentiellement l'existence, et que l'on connait ordinairement sous le nom de verbe substantif ; sum en latin, je suis en français, io sono en italien, yo soy en espagnol, ich bin en allemand, en grec. Je dis que ce verbe est auxiliaire naturel, parce qu'exprimant essentiellement l'existence, il parait plus naturel d'en employer les temps, que ceux de tout autre verbe, pour marquer les différents rapports d'existence qui caractérisent les temps de tous les verbes.
Le verbe auxiliaire usuel, est celui qui a une signification originelle, toute autre que celle de l'existence, et dont l'usage le dépouille entièrement, quand il sert à la formation des temps d'un autre verbe, pour ne lui laisser que celle qui convient aux rapports d'existence qu'il est alors chargé de caractériser. Tels sont, par exemple, en français, les verbes avoir et devoir, quand on dit, j'ai loué, je devais sortir ; ces verbes perdent alors leur signification originelle ; avoir ne signifie plus possession, mais antériorité ; devoir ne marque plus obligation, mais postériorité. Je dis que ces verbes sont auxiliaires usuels, parce que leur signification primitive ne les ayant pas destinés à cette espèce de service, ils n'ont pu y être assujettis que par l'autorité de l'usage, quem penes arbitrium est et jus et norma loquendi. Hor. art. poèt. 72.
Les langues modernes de l'Europe font bien plus d'usage des verbes auxiliaires que les langues anciennes ; mais les unes et les autres sont également guidées par le même esprit d'analogie.
§. I. Analogies des TEMS dans quelques langues modernes de l'Europe. Commençons par reconnaître cet esprit d'analogie dans les trois langues modernes que nous avons déjà comparées, la française, l'italienne et l'espagnole.
1°. On trouve dans ces trois langues les mêmes temps simples, et dans l'une, comme dans l'autre, il n'y a de simples, que ceux que je regarde comme des présents.
2°. Tous les temps où nous avons reconnu pour caractère fondamental et commun, l'idée d'antériorité, et dont, en conséquence, j'ai formé la classe des prétérits, sont composés dans les trois langues ; dans toutes trois, c'est communément le verbe qui signifie originellement possession, quelquefois celui qui exprime fondamentalement l'existence, qui est employé comme auxiliaire des prétérits, et toujours avec le supin ou le participe passif du verbe conjugué.
3°. Les futurs ont encore leur analogie distinctive dans les trois langues, quoiqu'il y ait quelque différence de l'une à l'autre. Nous nous servons en français de l'auxiliaire devoir, avec le présent de l'infinitif du verbe que l'on conjugue. Les Espagnols emploient le verbe aver (avoir), suivi de la préposition de et de l'infinitif du verbe principal ; tour elliptique qui semble exiger que l'on sous-entende le nom et hado (la destination), ou quelqu'autre semblable. Les Italiens ont adopté le tour français et plusieurs autres : Castelvetro, dans ses notes sur le Bembe (édit. de Naples 1714, in -4°. p. 220.) cite, comme expressions synonymes, debbo amare, (je dois aimer), ho ad amare, (j'ai à aimer), ho da amare, (j'ai d'aimer), sono per amare, (je suis pour aimer) ; je crois cependant qu'il y a quelque différence, parce que les langues n'admettent ni mots, ni phrases synonymes, et apparemment le tour italien semblable au nôtre est le seul qui y corresponde exactement.
§. 2. Analogies des TEMS dans la langue latine. La langue latine, dont le génie parait d'ailleurs si différent de celui des trois langues modernes, nous conduit encore aux mêmes conclusions par ses analogies propres ; et l'on peut même dire, qu'elle ajoute quelque chose de plus en faveur de mon système des temps.
I. Chacune des trois espèces y est caractérisée par des analogies particulières, qui sont communes à chacun des temps compris dans la même espèce.
1°. Tous ceux dont l'idée caractéristique commune est la simultanéité, et que je comprends, pour cette raison, sous le nom de présents, sont simples en latin, tant à la voix active, qu'à la voix passive, et ils ont tous une racine immédiate commune.
2°. Tous les temps que je nomme prétérits, parce que l'idée fondamentale qui leur est commune, est celle d'antériorité, sont encore simples à la voix active ; mais le changement d'inflexions à la racine commune, leur donne une racine immédiate toute différente, et qui caractérise leur analogie propre : d'ailleurs, les temps correspondants de la voix passive sont tous composés de l'auxiliaire naturel et du prétérit du participe passif.
3°. Enfin, tous les temps que je nomme futurs, à cause de l'idée de postériorité qui les caractérise, sont composés en latin du verbe auxiliaire naturel et du futur du participe actif, pour la voix active ; ou du futur du participe passif, pour la voix passive.
II. Nous trouverons dans les verbes de la même langue une autre espèce d'analogie, qui semble entrer encore plus spécialement dans les vues de mon système, voici en quoi elle consiste.
Les présents et les prétérits actifs sont également simples, et ont par conséquent une racine commune, qui est comme le type de la signification propre à chaque verbe : cette racine passe ensuite par différentes métamorphoses, au moyen des additions que l'on y fait, pour ajouter à l'idée propre du verbe les idées accessoires communes à tous les verbes : ainsi laud est la racine commune de tous les temps simples du verbe laudare (louer) ; c'en est le fondement immuable, sur lequel on pose ensuite tous les divers caractères des idées accessoires communes à tous les verbes.
Ces additions se font de manière, que les différences de verbe à verbe caractérisent les différentes conjugaisons, mais que les analogies générales se retrouvent par-tout.
Ainsi o ajouté simplement à la racine commune, est le caractère du présent indéfini qui est le premier de tous : cette racine subissant ensuite l'inflexion qui convient à chaque conjugaison, prend un b pour désigner les présents définis, qui diffèrent entr'eux par des terminaisons qui dénotent, ou l'antériorité ou la postériorité.
Au reste il ne faut point être surpris de trouver ici regebo pour regam, ni expedibo pour expediam ; on en trouve des exemples dans les auteurs anciens, et il est vraisemblable que l'analogie avait d'abord introduit expedie-b-o, comme expedie-b-am. Voyez la méthode latine de P. R. remarque sur les verbes, ch. IIe art. 1 des TEMS.
La terminaison i ajoutée à la racine commune modifiée par l'inflexion qui convient en propre à chaque verbe, caractérise le premier des prétérits, le prétérit indéfini. Cette terminaison est remplacée par l'inflexion er dans les prétérits définis, qui sont distingués l'un de l'autre par des terminaisons qui dénotent ou l'antériorité ou la postériorité.
Il résulte de tout ce qui vient d'être remarqué,
1°. Qu'en retranchant la terminaison du présent indéfini, il reste la racine commune des présents définis ; et qu'en retranchant la terminaison du prétérit indéfini ; il reste pareillement une racine commune aux prétérits définis.
2°. Que les deux temps que je nomme présents définis ont une inflexion commune b, qui leur est exclusivement propre, et qui indique dans ces deux temps une idée commune, laquelle est évidemment la simultanéité relative à une époque déterminée.
3°. Qu'il en est de même de l'inflexion er, commune aux deux temps que j'appelle préterits définis ; qu'elle indique dans ces deux temps une idée commune, qui est l'antériorité relative à une époque déterminée.
4°. Que ces conclusions sont fondées sur ce que ces inflexions caractéristiques modifient, ou la racine qui nait du présent indéfini, ou celle qui vient du prétérit défini, après en avoir retranché simplement la terminaison.
5°. Que l'antériorité ou la postériorité de l'époque étant la dernière des idées élémentaires renfermées dans la signification des temps définis, elle y est indiquée par la terminaison même ; que l'antériorité, soit des présents, soit des prétérits, y est désignée par am, lauda-b-am, laudav-er-am ; et que la postériorité y est indiquée par o, lauda-b-o, laudav-er-o.
L'espèce de parallelisme que j'établis ici entre les présents et les prétérits, que je dis également indéfinis ou définis, antérieurs ou postérieurs, se confirme encore par un autre usage qui est une espèce d'anomalie : c'est que novi, memini, et autres pareils, servent également au présent et au prétérit indéfini ; noveram, memineram, pour le présent et le prétérit antérieur ; novero, meminero, pour le présent et le prétérit postérieur. Rien ne prouve mieux, ce me semble, l'analogie commune que j'ai indiquée entre ces temps, et la destination que j'y ai établie : il en résulte effectivement, que le présent est au prétérit, précisément comme ce qu'on appelle imparfait est au temps que l'on nomme plusqueparfait ; et comme celui que l'on nomme ordinairement futur, est à celui que les anciens appelaient futur du subjonctif, et que la Grammaire générale nomme futur parfait : or le plusque parfait et le futur parfait sont évidemment des espèces de prétérits ; donc l'imparfait et le prétendu futur sont en effet des espèces de présents, comme je l'ai avancé.
III. La langue latine est dans l'usage de n'employer dans les conjugaisons que l'auxiliaire naturel, ce qui donne aussi le développement naturel des idées élémentaires de chacun des temps composés. Examinons d'abord les futurs du verbe actif ;
On voit que le futur du participe est commun à ces trois temps ; ce qui annonce une idée commune aux trois. Mais laudaturus, a, um est adjectif, &, comme on le sait, il s'accorde en genre, en nombre, et en cas avec le sujet du verbe ; c'est qu'il en exprime le rapport à l'action qui constitue la signification propre du verbe.
On voit d'autre part les présents du verbe auxiliaire, servir à la distinction de ces trois temps. Le présent indéfini, sum, fait envisager la futurition exprimée par le principe, dans le sens indéfini et sans rapport à aucune époque déterminée ; ce qui, dans l'occurrence, la fait rapporter à une époque actuelle ; laudaturus nunc sum.
Le présent antérieur, eram, fait rapporter la futurition du principe à une époque déterminément antérieure, d'où cette futurition pouvait être envisagée comme actuelle : laudaturus eram, c'est-à-dire, poteram tunc dicère, laudaturus nunc sum.
C'est à proportion la même chose du présent postérieur, ero ; il rapporte la futurition du participe à une époque déterminément postérieure, d'où elle pourra être envisagée comme actuelle : laudaturus ero, c'est-à-dire ; potero tunc dicère, laudaturus nunc sum.
C'est pour les prétérits la même analyse et la même décomposition ; on le voit sensiblement dans ceux des verbes déponens :
Le prétérit du participe, commun aux trois temps, et assujetti à s'accorder en genre, en nombre, et en cas avec le sujet, exprime l'état par rapport à l'action qui fait la signification propre du verbe, état d'antériorité qui devient dès-lors le caractère commun des trois temps.
Les trois présents du verbe auxiliaire sont pareillement relatifs aux différents aspects de l'époque. Precatus sum doit quelquefois être pris dans le sens indéfini ; d'autres fois dans le sens actuel, precatus nunc sum. Precatus eram, c'est-à-dire, tunc poteram dicère, precatus nunc sum. Et precatus ero, c'est tunc potero dicère, precatus nunc sum.
Quoique les présents soient simples dans tous les verbes latins, cependant l'analyse précédente des futurs et des prétérits nous indique comment on peut décomposer et interprêter les présents.
Precor, c'est-à-dire, sum precans, ou nunc sum precans.
Precabar, c'est-à-dire, eram precans, ou tunc poteram dicère, nunc sum precans.
Precabor, c'est-à-dire, ero precans, ou tunc potero dicère, nunc sum precans.
On voit donc encore ici l'idée de simultanéité commune à ces trois temps, et désignée par le présent du participe ; cette idée est ensuite modifiée par les divers aspects de l'époque, lesquels sont désignés par les divers présents du verbe auxiliaire.
Toutes les espèces d'analogies, prises dans diverses langues, ramènent donc constamment les temps du verbe à la même classification qui a été indiquée par le développement métaphysique des idées comprises dans la signification de ces formes. Ceux qui connaissent, dans l'étude des langues, le prix de l'analogie, sentent toute la force que donne à mon système cette heureuse concordance de l'analogie avec la métaphysique, et avoueront aisément que c'était à juste titre que Varron confondait l'analogie et la raison.
Serait-ce en effet le hasard qui reproduirait si constamment et qui assortirait si heureusement des analogies si précises et si marquées, dans des langues d'ailleurs très-différentes ? Il est bien plus raisonnable et plus sur d'y reconnaître le sceau du génie supérieur qui préside à l'art de la parole, qui dirige l'esprit particulier de chaque langue, et qui, en abandonnant au gré des nations les couleurs dont elles peignent la pensée, s'est réservé le dessein du tableau, parce qu'il doit toujours être le même, comme la pensée qui en est l'original ; et je ne doute pas qu'on ne retrouva dans telle autre langue formée, où l'on en voudra faire l'épreuve, les mêmes analogies ou d'autres équivalentes également propres à confirmer mon système.
Art. IV. Conformité du système des TEMS avec les vues de la syntaxe. Voici des considérations d'une autre espèce, mais également concluantes.
I. Si l'on conserve aux temps leurs anciennes dénominations, et que l'on en juge par les idées que ces dénominations présentent naturellement, il faut en convenir, les censeurs de notre langue en jugent raisonnablement ; et en examinant les divers emplois des temps, M. l'abbé Regnier a bien fait d'écrire en titre que l'usage confond quelquefois les TEMS des verbes, (gram. fr. in -12. p. 342. et suiv. in -4°. p. 359.) et d'assurer en effet que le présent a quelquefois la signification du futur, d'autres fois celle du prétérit, et que le prétérit à son tour est quelquefois employé pour le futur.
Mais ces étonnantes permutations ne peuvent qu'apporter beaucoup de confusion dans le discours, et faire obstacle à l'institution même de la parole. Cette faculté n'a été donnée à l'homme que pour la manifestation de ses pensées ; et cette manifestation ne peut se faire que par une exposition claire, débarrassée de toute équivoque &, à plus forte raison, de toute contradiction. Cependant rien de plus contradictoire que d'employer le même mot pour exprimer des idées aussi incommutables et même aussi opposées que celles qui caractérisent les différentes espèces de temps.
Si au-contraire on distingue avec moi les trois espèces générales de temps en indéfinis et définis, et ceux-ci en antérieurs et postérieurs, toute contradiction disparait. Quand on dit, je demande pour je demandai, où il Ve pour où il allait, je pars pour je partirai, le présent indéfini est employé selon sa destination naturelle : ce temps fait essentiellement abstraction de tout terme de comparaison déterminé ; il peut donc se rapporter, suivant l'occurrence, tantôt à un terme et tantôt à un autre, et devenir en conséquence, actuel, antérieur ou postérieur, selon l'exigence des cas.
Il en est de même du prétérit indéfini ; ce n'est point le détourner de sa signification naturelle, que de dire, par exemple, j'ai bientôt fait pour j'aurai bientôt fait : ce temps est essentiellement indépendant de tout terme de comparaison ; de-là la possibilité de le rapporter à tous les termes possibles de comparaison, selon les besoins de la parole.
Ce choix des temps indéfinis au lieu des définis, n'est pourtant pas arbitraire : il n'a lieu que quand il convient de rendre en quelque sorte plus sensible le rapport général d'existence, que le terme de comparaison ; distinction délicate, que tout esprit n'est pas en état de discerner et de sentir.
C'est pour cela que l'usage du présent indéfini est si fréquent dans les récits, surtout quand on se propose de les rendre intéressants ; c'est en lier plus essentiellement les parties en un seul tout, par l'idée de co-existence rendue, pour ainsi dire, plus saillante par l'usage perpétuel du présent indéfini, qui n'indique que cette idée, et qui fait abstraction de celle du terme.
Cette manière simple de rendre raison des différents emplois d'un même temps, doit paraitre, à ceux qui veulent être éclairés et qui aiment des solutions raisonnables, plus satisfaisante et plus lumineuse que l'énallage, nom mystérieux sous lequel se cache pompeusement l'ignorance de l'analogie, et qui ne peut pas être plus utîle dans la Grammaire, que ne l'était dans la Physique les qualités occultes du péripatétisme. Pour détruire le prestige, il ne faut que traduire en français ce mot grec d'origine, et voir quel profit on en tire quand il est dépouillé de cet air scientifique qu'il tient de sa source. Est-on plus éclairé, quand on a dit que je pars, par exemple, est mis pour je partirai par un changement ? car voilà ce que signifie le mot énallage. Ajoutons ces réflexions à celles de M. du Marsais, et concluons avec ce grammairien raisonnable (voyez ENALLAGE, que " l'énallage est une prétendue figure de construction, que les grammairiens qui raisonnent ne connaissent point, mais que les grammatistes célebrent ".
II. Il suit évidemment des observations précédentes, que les notions que j'ai données des temps sont un moyen sur de conciliation entre les langues, qui, pour exprimer la même chose, emploient constamment des temps différents. Par exemple, nous disons en français, si JE le TROUVE, je le lui dirai ; les Italiens se le TROVERO, glie lo dirò. Selon les idées ordinaires, la langue italienne est en règle, et la langue française autorise une faute contre les principes de la Grammaire générale, en admettant un présent au lieu d'un futur. Mais si l'on consulte la saine philosophie, il n'y a dans notre tour ni figure, ni abus ; il est naturel et vrai : les Italiens se servent du présent postérieur, qui convient en effet au point de vue particulier que l'on veut rendre ; et nous, nous employons le présent indéfini, parce qu'indépendant par nature de toute époque, il peut s'adapter à toutes les époques, et conséquemment à une époque postérieure.
Mille autres idiotismes pareils s'interpréteraient aussi aisément et avec autant de vérité par les mêmes principes. Le succès en démontre donc la justesse, et met en évidence la témérité de ceux qui taxent hardiment les usages des langues de bizarrerie, de caprice, de confusion, d'inconséquence, de contradiction. Il est plus sage, je l'ai déjà dit ailleurs, et je le répète ici, il est plus sage de se défier de ses propres lumières, que de juger irrégulier ce dont on ne voit pas la régularité.
Art. V. De quelques divisions des TEMS, particulières à la langue française. Si je bornais ici mes réflexions sur la nature et le nombre des temps, bien des lecteurs s'en contenteraient peut-être, parce qu'en effet j'ai à-peu-près examiné ceux qui sont d'un usage plus universel. Mais notre langue en a adopté quelques-uns qui lui sont propres, et qui dès-lors méritent d'être également approfondis, moins encore parce qu'ils nous appartiennent, que parce que la réalité de ces temps dans une langue en prouve la possibilité dans toutes, et que la sphère d'un système philosophique doit comprendre tous les possibles.
§. I. Des TEMS prochains et éloignés. Sous le rapport de simultanéité, l'existence est coincidente avec l'époque ; mais sous les deux autres rapports, d'antériorité et de postériorité, l'existence est séparée de l'époque par une distance, que l'on peut envisager d'une manière vague et générale, ou d'une manière spéciale et précise ; ce qui peut faire distinguer les prétérits et les futurs en deux classes.
Dans l'une de ces classes, on considérerait la distance d'une manière vague et indéterminée, ou plutôt on y considérerait l'antériorité ou la postériorité sans aucun égard à la distance, et conséquemment avec abstraction de toute distance déterminée. Pour ne point multiplier les dénominations, on pourrait conserver aux temps de cette classe les noms simples de prétérits ou de futurs, parce qu'on n'y exprime effectivement que l'antériorité ou la postériorité ; tels sont les prétérits et les futurs que nous avons vus jusqu'ici.
Dans la seconde classe, on considérerait la distance d'une manière précise et déterminée. Mais il n'est pas possible de donner à cette détermination la précision numérique ; ce serait introduire dans les langues une multitude infinie de formes, plus embarrassantes pour la mémoire qu'utiles pour l'expression, qui a d'ailleurs mille autres ressources pour rendre la précision numérique même, quand il est nécessaire. La distance à l'époque ne peut donc être déterminée dans les temps du verbe, que par les caractères généraux d'éloignement ou de proximité relativement à l'époque : de-là la distinction des temps de cette seconde classe, en éloignés et en prochains.
Les prétérits ou les futurs éloignés, seraient des formes qui exprimeraient l'antériorité ou la postériorité d'existence, avec l'idée accessoire d'une grande distance à l'égard de l'époque de comparaison. Sous cet aspect, les prétérits et les futurs pourraient être, comme les autres, indéfinis, antérieurs et postérieurs. Telles seraient, par exemple, les formes du verbe lire qui signifieraient l'antériorité éloignée que nous rendons par ces phrases : Il y a longtemps que j'ai lu, il y avait longtemps que j'avais lu, il y aura longtemps que j'aurai lu ; ou la postériorité éloignée que nous exprimons par celles-ci ; je dois être longtemps sans lire, je devais être longtemps sans lire, je devrai être longtemps sans lire.
Je ne sache pas qu'aucune langue ait admis des formes exclusivement propres à exprimer cette espèce de temps ; mais, comme je l'ai déjà observé, la seule possibilité suffit pour en rendre l'examen nécessaire dans une analyse exacte.
Les prétérits ou les futurs prochains, seraient des formes qui exprimeraient l'antériorité ou la postériorité d'existence, avec l'idée accessoire d'une courte distance à l'égard de l'époque de comparaison. Sous ce nouvel aspect, les prétérits et les futurs peuvent encore être indéfinis, antérieurs et postérieurs. Telles seraient, par exemple, les formes du verbe lire, qui signifieraient l'antériorité prochaine que les Latins rendent par ces phrases : Vix legi, vix legeram, vix legero ; ou la postériorité prochaine que les Latins expriment par celles-ci : jamjam lecturus sum, jamjam lecturus eram, jamjam lecturus ero.
La langue française qui parait n'avoir tenu aucun compte des temps éloignés, n'a pas négligé de même les temps prochains : elle en reconnait trois dans l'ordre des prétérits, et deux dans l'ordre des futurs ; et chacune de ces deux espèces de temps prochains est distinguée des autres temps de la même classe par son analogie particulière.
Les prétérits prochains sont composés du verbe auxiliaire venir, et du présent de l'infinitif du verbe conjugué, à la suite de la préposition de. Le verbe auxiliaire ne signifie plus alors le transport d'un lieu en un autre, comme quand il est employé selon sa destination originelle ; ses temps ne servent plus qu'à marquer la proximité de l'antériorité, et le point-de-vue particulier sous lequel on envisage l'époque de comparaison.
Le présent indéfini du verbe venir sert à composer le prétérit indéfini prochain du verbe conjugué : je viens d'être, je viens de louer, je viens d'admirer, &c.
Le présent antérieur du verbe venir sert à composer le prétérit antérieur prochain du verbe conjugué : je venais d'être, je venais de louer, je venais d'admirer, &c.
Le présent postérieur du verbe venir sert à composer le prétérit postérieur prochain du verbe conjugué : je viendrai d'être, je viendrai de louer, je viendrai d'admirer, &c.
Depuis quelque temps on dit en italien, io vengo di lodare, io venivo di lodare, etc. cette expression est un gallicisme qui a été blâmé par M. l'abbé Fontanini ; mais l'autorité de l'usage l'a enfin consacrée dans la langue italienne ; et la voilà pourvue, comme la nôtre, des prétérits prochains.
Les futurs prochains sont composés du verbe auxiliaire aller, suivi simplement du présent de l'infinitif du verbe conjugué. Le verbe auxiliaire perd encore ici sa signification originelle, pour ne plus marquer que la proximité de la futurition ; et ses divers présents désignent les divers points-de-vue sous lesquels on envisage l'époque de comparaison.
Le présent indéfini du verbe aller sert à composer le futur indéfini prochain du verbe conjugué : je vais être, je vais louer, je vais admirer, &c.
Le présent antérieur du verbe aller sert à composer le futur antérieur prochain du verbe conjugué : j'allais être, j'allais louer, j'allais admirer, &c.
Quand je dis que notre langue n'a point admis de temps éloignés, ni de futurs postérieurs prochains, je ne veux pas dire qu'elle soit privée de tous les moyens d'exprimer ces différents points-de-vue ; il ne lui faut qu'un adverbe, un tour de phrase, pour subvenir à tout. Je veux dire qu'elle n'a autorisé pour cela, dans ses verbes, aucune forme simple, ni aucune forme composée résultante de l'association d'un verbe auxiliaire qui se dépouille de sa signification originelle, pour marquer uniquement l'antériorité ou la postériorité d'existence éloignée, ou la postériorité d'existence prochaine à l'égard d'une époque postérieure. Je fais cette remarque, afin d'éviter toute équivoque et d'être entendu ; et je vais y en ajouter une seconde pour la même raison.
Quoique j'aye avancé que les verbes auxiliaires usuels perdent sous cet aspect leur signification originelle ; le choix de l'usage qui les a autorisés à faire ces fonctions, est pourtant fondé sur la signification même de ces verbes. Le verbe venir, par exemple, suppose une existence antérieure dans le lieu d'où l'on vient ; et dans le moment qu'on en vient, il n'y a pas longtemps qu'on y était : voilà précisément la raison du choix de ce verbe, pour servir à l'expression des prétérits prochains. Pareillement le verbe aller indique la postériorité d'existence dans le lieu où l'on Ve ; dans le temps qu'on y va, on est dans l'intention d'y être bientôt : voilà encore la justification de la préférence donnée à ce verbe pour désigner les futurs prochains. On justifierait par des inductions à-peu-près pareilles, les usages des verbes auxiliaires avoir et devoir, pour désigner d'une manière générale l'antériorité et la postériorité d'existence. Mais il n'en demeure pas moins vrai que tous ces verbes, devenus auxiliaires, perdent réellement leur signification primitive et fondamentale, et qu'ils n'en retiennent que des idées accessoires et éloignées, qui en font plutôt l'apanage que le fonds.
§. 2. Des temps positifs et comparatifs. Pour ne rien omettre de tout ce qui peut appartenir à la langue française, il me reste encore à examiner quelques temps qui y sont quelquefois usités quoique rarement, parce qu'ils y sont rarement nécessaires. C'est ainsi qu'en parle M. l'abbé de Dangeau, l'un de nos premiers grammairiens qui les ait observés et nommés. Opusc. sur la langue franc. pag. 177. 178. Il les appelle temps surcomposés, et il en donne le tableau pour les verbes qu'il nomme actifs, neutres-actifs et neutres-passifs. Ibid. Tables E. N. Q. pages 128. 142. 148. Tels sont ces temps : j'ai eu chanté, j'avais eu marché, j'aurai été arrivé.
Je commencerai par observer que la dénomination de temps surcomposés est trop générale, pour exciter dans l'esprit aucune idée précise, et conséquemment pour figurer dans un système vraiment philosophique.
J'ajouterai en second lieu, que cette dénomination n'a aucune conformité avec les lois que le simple bon sens prescrit sur la formation des noms techniques. Ces noms, autant qu'il est possible, doivent indiquer la nature de l'objet : c'est la règle que j'ai tâché de suivre à l'égard des dénominations que les besoins de mon système m'ont paru exiger ; et c'est celle dont l'observation parait le plus sensiblement dans la nomenclature des sciences et des arts. Or il est évident que le nom de surcomposés n'indique absolument rien de la nature des temps auxquels on le donne, et qu'il ne tombe que sur la forme extérieure de ces temps, laquelle est absolument accidentelle. Il peut donc être utile, pour la génération des temps, de remarquer cette propriété dans ceux que l'usage y a soumis ; mais en faire comme le caractère distinctif, c'est une méprise, et peut-être une erreur de logique.
Je remarquerai en troisième lieu, que les relations d'existence qui caractérisent les temps dont il s'agit ici, sont bien différentes de celles des temps moins composés que nous avons vus jusqu'à présent : j'ai eu aimé, j'avais eu entendu, j'aurais eu dit, sont par-là très-différents des temps moins composés, j'ai aimé, j'avais entendu, j'aurais dit. Or nous avons des temps surcomposés qui répondent exactement à ces derniers quant aux relations d'existence ; ce sont ceux de la voix passive, j'ai été aimé, j'avais été entendu, j'aurais été dit. Ainsi la dénomination de surcomposés comprendrait des temps qui exprimeraient des relations d'existence tout à fait différentes, et deviendrait par-là très-équivoque ; ce qui est le plus grand vice d'une nomenclature, et surtout d'une nomenclature technique.
Une quatrième remarque encore plus considérable, c'est que les tables de conjugaison proposées par M. l'abbé de Dangeau, semblent insinuer que les verbes qu'il nomme pronominaux, n'admettent point de temps surcomposés ; et il le dit nettement dans l'explication qu'il donne ensuite de ses tables. " Les parties surcomposées des verbes se trouvent, dit-il, (Opusc. page 210.) dans les neutres-passifs, et on dit, quand il a été arrivé : elles ne se trouvent point dans les verbes pronominaux neutrisés ; on dit bien, après m'être promené, mais on ne peut pas dire, après que je m'ai été promené longtemps ". Je conviens qu'avec cette sorte de verbes on ne peut pas employer les temps composés du verbe auxiliaire être ; ni dire, je m'ai été souvenu, comme on dirait j'ai été arrivé : mais de ce que l'usage n'a point autorisé cette formation des temps surcomposés, il ne s'ensuit point du tout qu'il n'en ait autorisé aucune autre.
On dit, après que j'ai eu parlé, verbe qui prend l'auxiliaire avoir ; après que j'ai été arrivé, verbe qui prend l'auxiliaire être ; l'un et l'autre sans la répétition du pronom personnel : mais il est constant que d'après les mêmes points-de-vue que l'on marque dans ces deux exemples, on peut avoir besoin de les désigner aussi quand le verbe est pronominal ou réflechi ; et il n'est guère moins sur que l'analogie du langage n'aura pas privé cette sorte de verbe d'une forme qu'elle a établie dans tous les autres. De même que l'on dit, dès que j'ai eu chanté, je suis parti pour vous voir (c'est un exemple du savant académicien) ; dès que j'ai été sorti, vous êtes arrivé : pourquoi ne dirait-on pas dans le même sens, et avec autant de clarté, de précision, et peut-être de fondement, dès que je me suis eu informé, je vous ai écrit ? Au-lieu donc de dire, après que je m'ai été promené longtemps, expression justement condamnée par M. de Dangeau, on dira, après que je me suis eu promené longtemps, ou après m'être eu promené longtemps.
Il est vrai que je ne garantirais pas qu'on trouvât dans nos bons écrivains des exemples de cette formation : mais je ne désespererais pas non plus d'y en rencontrer quelques-uns, surtout dans les comiques, dans les épistolaires, et dans les auteurs de romans ; et je suis bien assuré que tous les jours, dans les conversations des puristes les plus rigoureux, on entend de pareilles expressions sans en être choqué, ce qui est la marque la plus certaine qu'elles sont dans l'analogie de notre langue. Si elles ne sont pas encore dans le langage écrit, elles méritent du moins de n'en être pas rejetées : tout les y réclame, les intérêts de cette précision philosophique, qui est un des caractères de notre langue ; et ceux mêmes de la langue, qu'on ne saurait trop enrichir dès qu'on peut le faire sans contredire les usages analogiques.
Mais, me dira-t-on, l'analogie même n'est pas trop observée ici : les verbes simples qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, prennent un temps composé de cet auxiliaire, pour former leurs temps surcomposés ; j'ai eu chanté, j'aurais eu chanté, etc. les verbes simples qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, prennent un temps composé de cet auxiliaire, pour former leurs temps surcomposés ; j'ai été arrivé, j'aurais été arrivé, etc. au contraire les temps surcomposés des verbes pronominaux prennent un temps simple du verbe être avec le supin du verbe avoir ; ce qui est ou parait du-moins être une véritable anomalie.
Je réponds qu'il faut prendre garde de regarder comme anomalie, ce qui n'est en effet qu'une différence nécessaire dans l'analogie. Le verbe aimer fait j'ai aimé, j'ai eu aimé : s'il devient pronominal, il fera je me suis aimé ou aimée, au premier de ces deux temps où il n'est plus question du supin, mais du participe : mais quant au second, il faudra donc pareillement substituer le participe au supin, et pour ce qui est de l'auxiliaire avoir, il doit, à cause du double pronom personnel, se conjuguer lui-même par le secours de l'auxiliaire être ; je me suis eu, comme je me suis aimé ; mais ce supin du verbe avoir ne change point, et demeure indéclinable, parce que son véritable complément est le participe aimé dont il est suivi, voyez PARTICIPE. Ainsi aimer fera très-analogiquement je me suis eu aimé ou aimée.
Mais quelle est enfin la nature de ces temps, que nous ne connaissons que sous le nom de prétérits surcomposés ? L'un des deux auxiliaires y caractérise, comme dans les autres, l'antériorité ; le second, si nos procédés sont analogiques, doit désigner encore un autre rapport d'antériorité, dont l'idée est accessoire à l'égard de la première qui est fondamentale. L'antériorité fondamentale est relative à l'époque que l'on envisage primitivement ; et l'antériorité accessoire est relative à un autre événement mis en comparaison avec celui qui est directement exprimé par le verbe, sous la relation commune à la même époque primitive. Quand je dis, par exemple, dès que j'ai eu chanté, je suis parti pour vous voir ; l'existence de mon chant et celle de mon départ sont également présentées comme antérieures au moment où je parle ; voilà la relation commune à une même époque primitive, et c'est la relation de l'antériorité fondamentale : mais l'existence de mon chant est encore comparée à celle de mon départ, et le tour particulier j'ai eu chanté sert à marquer que l'existence de mon chant est encore antérieure à celle de mon départ, et c'est l'antériorité accessoire.
C'est donc cette antériorité accessoire, qui distingue des prétérits ordinaires ceux dont il est ici question ; et la dénomination qui leur convient doit indiquer, s'il est possible, ce caractère qui les différencie des autres. Mais comme l'antériorité fondamentale de l'existence est déjà exprimée par le nom de prétérit, et celle de l'époque par l'épithète d'antérieur ; il est difficîle de marquer une troisième fois la même idée, sans courir les risques de tomber dans une sorte de battologie : pour l'éviter, je donnerais à ces temps le nom de prétérits comparatifs, afin d'indiquer que l'antériorité fondamentale, qui constitue la nature commune de tous les prétérits, est mise en comparaison avec une autre antériorité accessoire ; car les choses composées doivent être homogènes. Or il y a quatre prétérits comparatifs.
1. Le prétérit indéfini comparatif, comme j'ai eu chanté.
2. Le prétérit antérieur simple comparatif, comme j'avais eu chanté.
3. Le prétérit antérieur périodique comparatif, comme j'eus eu chanté.
4. Le prétérit postérieur comparatif, comme j'aurai eu chanté.
Il me semble que les prétérits qui ne sont point comparatifs, sont suffisamment distingués de ceux qui le sont, par la suppression de l'épithète même de comparatifs ; car c'est être en danger de se payer de paroles, que de multiplier les noms sans nécessité. Mais d'autre part, on court risque de n'adopter que des idées confuses, quand on n'en attache pas les caractères distinctifs à un assez grand nombre de dénominations : et cette remarque me déterminerait assez à appeler positifs tous les prétérits qui ne sont pas comparatifs, surtout dans les occurrences où l'on parlerait des uns relativement aux autres. Je vais me servir de cette distinction dans une dernière remarque sur l'usage des prétérits comparatifs.
Ils ne peuvent jamais entrer que dans une proposition qui est membre d'une période explicite ou implicite : explicite ; j'ai eu lu tout ce livre avant que vous en eussiez lu la moitié : implicite ; j'ai eu lu tout ce livre avant vous, c'est-à-dire, avant que vous l'eussiez lu. Or c'est une règle indubitable qu'on ne doit se servir d'un prétérit comparatif, que quand le verbe de l'autre membre de la comparaison est à un prétérit positif de même nom ; parce que les termes comparés, comme je l'ai dit cent fais, doivent être homogènes. Ainsi l'on dira ; quand j'ai eu chanté, je suis sorti ; si j'avais eu chanté, je serais sorti avec vous ; Quand nous aurons été sortis, ils auront renoué la partie, etc. Ce serait une faute d'en user autrement, et de dire, par exemple, si j'avais eu chanté, je sortirais, etc.
Art. VI. Des temps considérés dans les modes. Les verbes se divisent en plusieurs modes qui répondent aux différents aspects sous lesquels on peut envisager la signification formelle des verbes, voyez MODE. On retrouve dans chaque mode la distinction des temps, parce qu'elle tient à la nature indestructible du verbe, (voyez VERBE.) Mais cette distinction reçoit d'un mode à l'autre des différences si marquées, que cela mérite une attention particulière. Les observations que je vais faire à ce sujet, ne tomberont que sur nos verbes français, afin d'éviter les embarras qui naitraient d'une comparaison trop compliquée ; ceux qui m'auront entendu, et qui connaitront d'autres langues, sauront bien y appliquer mon système, et reconnaître les parties qui en auront été adoptées ou rejetées par les différents usages de ces idiomes.
Nous avons six modes en français : l'indicatif, l'impératif, le suppositif, le subjonctif, l'infinitif et le participe, (voyez ces mots) : c'est l'ordre que je vais suivre dans cet article.
§. 1. Des temps de l'indicatif. Il semble que l'indicatif soit le mode le plus naturel et le plus nécessaire : lui seul exprime directement et purement la proposition principale ; et c'est pour cela que Scaliger le qualifie solus modus aptus scientiis, solus pater veritatis (de caus. L. L. cap. cxvj.) Aussi est-ce le seul mode qui admette toutes les espèces de temps autorisées dans chaque langue. Ainsi il ne s'agit, pour faire connaître au lecteur le mode indicatif, que de mettre sous ses yeux le système figuré des temps que je viens d'analyser. Je mettrai en parallèle trois verbes ; l'un simple, empruntant l'auxiliaire avoir ; le second également simple, mais se servant de l'auxiliaire naturel être ; enfin le troisième pronominal, et pour cela même différent des deux autres dans la formation de ses prétérits comparatifs. Ces trois verbes seront chanter, arriver, se révolter.
SYSTÈME DES TEMS DE L'INDICATIF.
§. 2. Des temps de l'impératif. J'ai déjà prouvé que notre impératif a deux temps ; que le premier est un présent postérieur, et le second, un prétérit postérieur, (voyez IMPERATIF.) J'avoue ici, que malgré tous mes efforts contre les préjugés de la vieille routine, je n'ai pas dissipé toute l'illusion de la maxime d'Apollon. (lib. I. cap. xxx.), qu'on ne commande pas les choses présentes ni les passées. Je pensais que ce qui avait trompé ce grammairien, c'est que le rapport de postériorité était essentiel au mode impératif : je ne le croi plus maintenant, et voici ce qui me fait changer d'avis. L'impératif est un mode qui ajoute à la signification principale du verbe, l'idée accessoire de la volonté de celui qui parle : or cette volonté peut être un commandement absolu, un désir, une permission, un conseil, un simple acquiescement. Si la volonté de celui qui parle est un commandement, un désir, une permission, un conseil ; tout cela est nécessairement relatif à une époque postérieure, parce qu'il n'est pas possible de commander, de désirer, de permettre, de conseiller que relativement à l'avenir : mais si la volonté de celui qui parle est un simple acquiescement, il peut se rapporter indifféremment à toutes les époques, parce qu'on peut également acquiescer à ce qui est actuel, antérieur ou postérieur à l'égard du moment où l'on s'en explique.
Un domestique, par exemple, dit à son maître qu'il a gardé la maison, qu'il n'est pas sorti, qu'il ne s'est pas enivré ; mais son maître, piqué de ce que néanmoins il n'a pas fait ce qu'il lui avait ordonné, lui répond : AYE GARDE la maison, ne SOIS pas SORTI, ne TE SOIS pas ENYVRE, que m'importe, si tu n'as pas fait ce que je voulais. Il est évident 1°. que ces expressions aye gardé, ne sois pas sorti, ne te sois pas enivré, sont à l'impératif, puisqu'elles indiquent l'acquiescement du maître aux assertions du domestique : 2°. qu'elles sont au prétérit actuel, puisqu'elles énoncent l'existence des attributs qui y sont énoncés, comme antérieurs au moment même où l'on parle ; et le maître aurait pu dire, TU AS GARDE la maison, TU N'ES pas SORTI, TU ne T'ES pas ENYVRE, que m'importe, &c.
Le prétérit de notre impératif peut donc être rapporté à différentes époques, et par conséquent il est indéfini. C'est d'après cette correction que je vais présenter ici le système des temps de ce mode, un peu autrement que je n'ai fait à l'article qui en traite expressément. Ceux qui ne se rétractent jamais, ne donnent pas pour cela des décisions plus sures ; ils ont quelquefois moins de bonne foi.
SYSTÈME DES TEMS DE L'IMPERATIF.
Les verbes pronominaux n'ont pas le prétérit indéfini à l'impératif, si ce n'est avec ne pas, comme dans l'exemple ci-dessus, ne te sois pas enivré ; mais on ne dirait pas sans négation, te sois enivré ; il faudrait prendre un autre tour. On pourrait peut-être croire que ce serait un impératif, si on disait, te sais-tu enivré pour la dernière fois ! Mais l'inversion du pronom subjectif tu nous avertit ici d'une ellipse, et c'est celle de la conjonction que et du verbe optatif je désire, je désire que tu te sois enivré, ce qui marque le subjonctif : (voyez SUBJONCTIF) d'ailleurs le pronom subjonctif n'est jamais exprimé avec nos impératifs, et c'est même ce qui en constitue principalement la forme distinctive. (Voyez IMPERATIF.)
§. 3. DES TEMS du suppositif. Nous avons dans ce mode un temps simple, comme les présents de l'indicatif ; je chanterais, j'arriverais, je me révolterais : nous en avons un qui est composé d'un temps simple de l'auxiliaire avoir, ou de l'auxiliaire être, comme les prétérits positifs de l'indicatif ; j'aurais chanté, je serais arrivé en vie, je me serais révolté ou tée : un autre temps est surcomposé, comme les prétérits comparatifs de l'indicatif, j'aurais eu chanté, j'aurais été arrivé ou vée, je me serais eu révolté ou tée : un autre emprunte l'auxiliaire venir, comme les prétérits prochains de l'indicatif ; je viendrais de chanter, d'arriver, de me dérober : enfin, il en est un qui se sert de l'auxiliaire devoir, comme les futurs positifs de l'indicatif, je devrais chanter, arriver, me révolter. L'analogie, qui dans les cas réellement semblables, établit toujours les usages des langues sur les mêmes principes, nous porte à ranger ces temps du suppositif dans les mêmes classes que ceux de l'indicatif auxquels ils sont analogues dans leur formation. Voilà sur quoi est formé le
SYSTÈME DES TEMS DU SUPPOSITIF.
Achevons d'établir par des exemples détaillés, ce qui n'est encore qu'une conclusion générale de l'analogie ; et reconnaissons, par l'analyse de l'usage, la vraie nature de chacun de ces temps.
1°. Le présent du suppositif est indéfini ; il en a les caractères, puisqu'étant rapporté tantôt à une époque, et tantôt à une autre, il ne tient effectivement à aucune époque précise et déterminée.
Si Clément VII. eut traité Henri VIII. avec plus de modération, la religion catholique SEROIT encore aujourd'hui dominante en Angleterre. Il est évident par l'adverbe aujourd'hui, que serait est employé dans cette phrase comme présent actuel.
En peignant dans un récit le désespoir d'un homme lâche, on peut dire : Il s'arrache les cheveux, il se jette à terre, il se releve, il blasphème contre le ciel, il déteste la vie qu'il en a reçue, il MOURROIT s'il avait le courage de se donner la mort. Il est certain que tout ce que l'on peint ici est antérieur au moment où l'on parle ; il s'arrache, il se jete, il se releve, il blasphème, il déteste, sont dits pour il s'arrachait, il se jetait, il se relevait, il blasphémait, il détestait, qui sont des présents antérieurs, et qui dans l'instant dont on rappelle le souvenir, pouvaient être employés comme des présents actuels : mais il en est de même du verbe il mourrait ; on pouvait l'employer alors dans le sens actuel, et on l'emploie ici dans le sens antérieur comme les verbes précédents, dont il ne diffère que par l'idée accessoire d'hypothèse qui caractérise le mode suppositif.
Si ma voiture était prête, JE PARTIROIS demain : l'adverbe demain exprime si nettement une époque postérieure, qu'on ne peut pas douter que le verbe je partirais ne soit employé ici comme présent postérieur.
2°. Le prétérit positif est pareillement indéfini, puisqu'on peut pareillement le rapporter à diverses époques, selon la diversité des occurrences.
Les Romains AUROIENT CONSERVE l'empire de la terre, s'ils avaient conservé leurs anciennes vertus ; c'est-à-dire, que nous pourrions dire aujourd'hui, les Romains ONT CONSERVE, etc. Or, le verbe ont conservé étant rapporté à aujourd'hui, qui exprime une époque actuelle, est employé comme prétérit actuel : par conséquent il faut dire la même chose du verbe auraient conservé, qui a ici le même sens, si ce n'est qu'il ne l'énonce qu'avec l'idée accessoire d'hypothèse, au lieu que l'on dit ont conservé d'une manière absolue et indépendante de toute supposition.
J'AUROIS FINI cet ouvrage à la fin du mois prochain, si des affaires urgentes ne m'avaient détourné : le prétérit positif j'aurais fini est relatif ici à l'époque désignée par ces mots, la fin du mois prochain, qui est certainement une époque postérieure ; et c'est comme si l'on disait, je pourrais dire à la fin du mois prochain, J'AI FINI, etc. j'aurais fini est donc employé dans cette phrase comme prétérit postérieur.
3°. Ce qui est prouvé du prétérit positif, est également vrai du prétérit comparatif ; il peut dans differentes phrases se rapporter à différentes époques ; il est indéfini.
Quand J'AUROIS EU PRIS toutes mes mesures avant l'arrivée du ministre, je ne pouvais réussir sans votre crédit. Il y a ici deux événements présentés comme antérieurs au moment de la parole, la précaution d'avoir pris toutes les mesures, et l'arrivée du ministre ; c'est pourquoi j'aurais eu pris est employé ici comme prétérit actuel, parce qu'il énonce la chose comme antérieure au moment de la parole : il est comparatif, afin d'indiquer encore l'antériorité des mesures prises à l'égard de l'arrivée du ministre, laquelle est également antérieure à l'époque actuelle. C'est comme si l'on disait, quand à l'arrivée du ministre, (qui est au prétérit actuel, puisqu'elle est actuellement passée), j'aurais pu dire, (autre prétérit également actuel), J'AI PRIS toutes mes mesures, (prétérit rapporté immédiatement à l'époque de l'arrivée du ministre, et par comparaison à l'époque actuelle).
Si on lui avait donné le commandement, j'étais sur qu'il AUROIT EU REPRIS toutes nos villes avant que les ennemis pussent se montrer, c'est-à-dire, je pouvais dire avec certitude, il AURA REPRIS toutes nos villes, etc. Or il aura repris est vraiment le prétérit postérieur de l'indicatif ; il aurait eu repris est donc employé comme prétérit postérieur, puisqu'il renferme le même sens.
4°. Pour ce qui concerne le prétérit prochain, il est encore indéfini, et on peut l'employer avec rélation à différentes époques.
Quelqu'un veut tirer de ce que je viens de rentrer, une conséquence que je désavoue, et je lui dis : quand JE VIENDROIS DE RENTRER, cela ne prouve rien. Il est évident que ces mots je viendrais de rentrer, sont immédiatement rélatifs au moment où je parle, et que par conséquent c'est un prétérit prochain actuel ; c'est comme si je disais, j'avoue que JE VIENS DE RENTRER actuellement, mais cela ne prouve rien.
Voici le même temps rapporté à une autre époque, quand je dis : allez chez mon frère, et quand il VIENDROIT DE RENTRER, amenez-le ici. Le verbe amenez est certainement ici au présent postérieur, et il est clair que ces mots, il viendrait de rentrer, expriment un événement antérieur à l'époque énoncée par amenez, qui est postérieure ; par conséquent il viendrait de rentrer est ici un prétérit postérieur.
5°. Enfin, le futur positif est également indéfini, puisqu'il sert aussi avec relation à diverses époques, comme on Ve le voir dans ces exemples.
Quand je ne DEVROIS pas VIVRE longtemps, je veux cependant améliorer cette terre ; c'est-à-dire, quand je serais sur que je ne DOIS pas VIVRE : or je dois vivre est évidemment le futur positif indéfini de l'indicatif, employé ici avec relation à une époque actuelle ; et il ne prend la place de je devrais vivre, qu'autant que je devrais vivre, est également rapporté à une époque actuelle ; c'est donc ici un futur actuel.
Nous lui avons souvent entendu dire qu'il voulait aller à ce siège, quand même il y DEVROIT PERIR ; c'est-à-dire, quand même il serait sur qu'il y DEVROIT PERIR : or il devait périr est le futur positif antérieur de l'indicatif, et puisqu'il tient ici la place de il devrait périr, c'est que il devrait périr, est employé dans le même sens, et que c'est ici un futur antérieur.
Tous les temps du suppositif sont donc indéfinis ; on vient de le prouver en détail de chacun en particulier : en voici une preuve générale. Les temps en eux-mêmes sont susceptibles partout des mêmes divisions que nous avons vues à l'indicatif, à-moins que l'idée accessoire qui constitue la nature d'un mode, ne soit opposée à quelques-uns des points de vue de ces divisions, comme on l'a Ve pour les temps de l'impératif. Mais l'idée d'hypothèse et de supposition, qui distingue de tous les autres le mode suppositif, s'accorde très-bien avec toutes les manières d'envisager les temps ; rien n'y répugne. Cependant l'usage de notre langue n'a admis qu'une seule forme pour chacune des espèces qui sont soudivisées dans l'indicatif par les diverses manières d'envisager l'époque : il est donc nécessaire que cette forme unique, dans chaque espèce de suppositif, ne tienne à aucune époque déterminée, afin que dans l'occurrence elle puisse être rapportée à l'une ou à l'autre selon les besoins de l'élocution ; c'est-à-dire, que chacun des temps du suppositif doit être indéfini.
Cette propriété, dont j'ai cru indispensable d'établir la théorie, je n'ai pas cru devoir l'indiquer dans la nomenclature des temps du suppositif ; parce qu'elle est commune à tous les temps, et que les dénominations techniques ne doivent se charger que des épithetes nécessaires à la distinction des espèces comprises sous un même genre.
§. IV. Des temps du subjonctif. Nous avons au subjonctif les mêmes classes générales de temps qu'à l'indicatif ; des présents, des prétérits et des futurs. Les prétérits y sont pareillement soudivisés en positifs, comparatifs et prochains ; et les futurs, en positifs et prochains. Toutes ces espèces sont analogues, dans leur formation, aux espèces correspondantes de l'indicatif et des autres modes : les présents y sont simples ; les prétérits positifs sont composés d'un temps simple de l'un des deux auxiliaires avoir ou être ; les comparatifs sont surcomposés des mêmes auxiliaires, et les prochains empruntent le verbe venir : les futurs positifs prennent l'auxiliaire devoir ; et les prochains, l'auxiliaire aller.
SYSTÊME DES TEMS DU SUBJONCTIF.
Il n'y a que deux temps dans chaque classe ; et je nomme le premier indéfini, et le second défini anté rieur : c'est que le premier est destiné par l'usage à exprimer le rapport d'existence, qui lui convient, à l'égard d'une époque envisagée comme actuelle par comparaison, ou avec un présent actuel, ou avec un présent postérieur ; au lieu que le second n'exprime le rapport qui lui convient, qu'à l'égard d'une époque envisagée comme actuelle, par comparaison avec un présent antérieur. En voici la preuve dans une suite systématique d'exemples comparés, dont le second, énoncé par le mode et dans le sens indicatif, sert perpétuellement de réponse au premier, qui est énoncé dans le sens subjonctif.
Les présents du subjonctif, que vous entendiez, que vous entendissiez, dans les exemples précédents, expriment la simultanéité d'existence à l'égard d'une époque qui est actuelle, relativement au moment marqué par l'un des présents du verbe principal, je ne crois pas, je ne croirai pas, je ne croyais pas : et c'est à l'égard d'une époque semblablement déterminée à l'actualité, que les prétérits du subjonctif, dans chacune des trois classes, expriment l'antériorité d'existence, et que les futurs des deux classes expriment la postériorité d'existence. Je vais rendre sensible cette remarque qui est importante, en l'appliquant aux trois exemples des prétérits positifs.
1°. Je ne crois pas que vous ayez entendu, c'est-à-dire, je crois que vous n'avez pas entendu : or vous avez entendu exprime l'antériorité d'existence, à l'égard d'une époque qui est actuelle, relativement au moment déterminé par le présent actuel du verbe principal je crois, qui est le moment même de la parole.
2°. Je ne croirai pas que vous ayez entendu, c'est-à-dire, je pourrai dire, je crois que vous n'avez pas entendu : or vous avez entendu exprime ici l'antériorité d'existence, à l'égard d'une époque qui est actuelle, relativement au moment déterminé par je crois, qui, dans l'exemple, est envisagé comme postérieur ; je croirai, ou je pourrai dire, je crois.
3°. Je ne croyais pas que vous eussiez entendu, c'est-à-dire, je pouvais dire, je crois que vous n'avez pas entendu : or vous avez entendu exprime encore l'antériorité d'existence, à l'égard d'une époque qui est actuelle, relativement au moment déterminé par je crois, qui dans cet exemple, est envisagé comme antérieur ; je croyais, ou je pourrai dire, je crois.
Les développements que je viens de donner sur ces trois exemples, suffiront à tout homme intelligent, pour lui faire apercevoir comment on pourrait expliquer chacun des autres, et démontrer que chacun des temps du subjonctif y est rapporté à une époque actuelle, relativement au moment déterminé par le present du verbe principal. Mais à l'égard du premier temps de chaque classe, l'actualité de l'époque de comparaison peut être également relative, ou à un présent actuel, ou à un présent postérieur, comme on le voit dans ces mêmes exemples ; et c'est par cette considération seulement que je regarde ces temps comme indéfinis : je regarde au contraire les autres comme définis, parce que l'actualité de l'époque de comparaison y est nécessairement et exclusivement relative à un présent antérieur ; et c'est aussi pour cela que je les qualifie tous d'antérieurs.
Ainsi le moment déterminé par l'un des présents du verbe principal, est pour les temps du subjonctif, ce que le seul moment de la parole est pour les temps de l'indicatif ; c'est le terme immédiat des relations qui fixent l'époque de comparaison. A l'indicatif, les temps expriment des rapports d'existence à une époque dont la position est fixée relativement au moment de la parole : au subjonctif ils expriment des rapports d'existence à une époque dont la position est fixée relativement au moment déterminé par l'un des présents du verbe principal.
Or ce moment déterminé par l'un des présents du verbe principal, peut avoir lui-même diverses relations au moment de la parole, puisqu'il peut être, ou actuel, ou antérieur, ou postérieur. Le rapport d'existence au moment de la parole, qui est exprimé par un temps du subjonctif, est donc bien plus composé que celui qui est exprimé par un temps de l'indicatif : celui de l'indicatif est composé de deux rapports, rapport d'existence à l'époque, et rapport de l'époque au moment de la parole : celui du subjonctif est composé de trois ; rapport d'existence à une époque, rapport de cette époque au moment déterminé par l'un des présents du verbe principal, et rapport de ce moment principal à celui de la parole.
Quand j'ai déclaré et nommé indéfini le premier de chacune des six classes de temps qui constituent le subjonctif, et que j'ai donné au second la qualification et le nom de défini antérieur ; je ne considérais dans ces temps que les deux premiers rapports élémentaires, celui de l'existence à l'époque, et celui de l'époque au moment principal. J'ai dû en agir ainsi, pour parvenir à fixer les caractères différentiels, et les dénominations distinctives des deux temps de chaque classe : car si l'on considère tout à la fois les trois rapports élémentaires, l'indétermination devient générale, et tous les temps sont indéfinis.
Par exemple, celui que j'appelle présent défini antérieur peut, au fonds, exprimer la simultanéité d'existence, à l'égard d'une époque, ou actuelle, ou antérieure, ou postérieure. Je vais le montrer dans trois exemples, où le même mot français sera traduit exactement en latin par trois temps différents qui indiqueront sans équivoque l'actualité, l'antériorité, et la postériorité de l'époque envisagée dans le même temps français.
1°. Quand je parlai hier au chymiste, je ne croyais pas que vous entendissiez ; (audire te non existimabam.)
2°. Je ne crois pas que vous entendissiez hier ce que je vous dis, puisque vous n'avez pas suivi mon conseil ; (audivisse te non existimo.)
3°. Votre surdité était si grande, que je ne croyais pas que vous entendissiez jamais ; (ut te unquam auditurum esse non existimarem.)
Dans le premier cas, vous entendissiez est relatif à une époque actuelle, et il est rendu par le présent audire ; dans le second cas, l'époque est antérieure, et vous entendissiez est traduit par le prétérit audivisse ; dans le troisième enfin, il est rendu par le futur auditurum esse, parce que l'époque est postérieure : ce qui n'empêche pas que dans chacun des trois cas, vous entendissiez n'exprime réellement la simultanéité d'existence à l'égard de l'époque, et ne soit par conséquent un vrai présent.
Ce que je viens d'observer sur le présent antérieur, se vérifierait de même sur les trois prétérits et les deux futurs antérieurs ; mais il est inutîle d'établir par trop d'exemples, ce qui d'ailleurs est connu et avoué de tous les Grammairiens, quoiqu'en d'autres termes. " Le subjonctif, dit l'auteur de la Méthode latine de P. R. (Rem. sur les verbes, ch. II. §. iij.) marque toujours une signification indépendante et comme suivante de quelque chose : c'est pourquoi dans tous ses temps, il participe souvent de l'avenir ". Je ne sais pas si cet auteur voyait en effet, dans la dépendance de la signification du subjonctif, l'indétermination des temps de ce mode ; mais il la voyait du-moins comme un fait, puisqu'il en recherche ici la cause : et cela suffit aux vues que j'ai en le citant. Vossius, (Anal. III. xv.) est de même avis sur les temps du subjonctif latin ; ainsi que l'abbé Régnier, (Grammaire fr. in-12. pag. 344. in-4°. pag. 361.) sur les temps du subjonctif français.
Mais indépendamment de toutes les autorités, chacun peut aisément vérifier qu'il n'y a pas un seul temps à notre subjonctif, qui ne soit réellement indéfini, quand on les rapporte surtout au moment de la parole : et c'est un principe qu'il faut saisir dans toute son étendue, si l'on veut être en état de traduire bien exactement d'une langue dans une autre, et de rendre selon les usages de l'une ce qui est exprimé dans l'autre, sous une forme quelquefois bien différente.
§. Voyez Des temps de l'infinitif. J'ai déjà suffisamment établi ailleurs contre l'opinion de Sanctius et de ses partisans, que la distinction des temps n'est pas moins réelle à l'infinitif qu'aux autres modes. (Voyez INFINITIF.) On Ve voir ici que l'erreur de ces Grammairiens n'est venue que de l'indétermination de l'époque de comparaison dans chacun de ces temps, qui tous sont essentiellement indéfinis. Il y en a cinq dans l'infinitif de nos verbes français, dont voici l'exposition systématique.
SYSTÈME DES TEMS DE L'INFINITIF.
Je ne donne à aucun de ces temps le nom d'indéfini, parce que cette dénomination convenant à tous, ne saurait être distinctive pour aucun dans le mode infinitif.
Le présent est indéfini, parce qu'il exprime la simultanéité d'existence à l'égard d'une époque quelconque. L'homme veut être heureux ; cette maxime d'éternelle vérité, puisqu'elle tient à l'essence de l'homme qui est immuable comme tous les autres, est vraie pour tous les temps ; et l'infinitif être se rapporte ici à toutes les époques. Enfin je puis vous embrasser ; le présent embrasser exprime ici la simultanéité d'existence à l'égard d'une époque actuelle, comme si l'on disait, je puis vous embrasser actuellement. Quand je voulus parler ; le présent parler est relatif ici à une époque antérieure au moment de la parole, c'est un présent antérieur. Quand je pourrai sortir ; le présent sortir est ici postérieur, parce qu'il est relatif à une époque postérieure, au moment de la parole.
Après les détails que j'ai donnés sur la distinction des différentes espèces de temps en général, je crois pouvoir me dispenser ici de prouver de chacun des temps de l'infinitif, ce que je viens de prouver du présent : tout le monde en fera aisément l'application. Mais je dois faire observer que c'est en effet l'indétermination de l'époque qui a fait penser à Sanctius, que le présent de l'infinitif n'était pas un vrai présent, ni le prétérit un vrai prétérit, que l'un et l'autre était de tous les temps. In reliquum, dit-il, (Min. I. xiv.) infiniti verbi tempora confusa sunt, et à verbo personali temporis significationem mutuantur : ut cupio légère seu legisse, praesentis est ; cupivi légère seu legisse, praeteriti ; cupiam légère seu legisse, futuri. In passivâ verò, amari, legi, audiri, sine discrimine omnibus deserviunt ; ut voluit diligi ; vult diligi ; cupiet diligi. Ce grammairien confond évidemment la position de l'époque et la relation d'existence : dans chacun des temps de l'infinitif, l'époque est indéfinie, et en conséquence elle y est envisagée, ou d'une manière générale, ou d'une manière particulière, quelquefois comme actuelle, d'autres fois comme antérieure, et souvent comme postérieure ; c'est ce qu'a Ve Sanctius : mais la relation de l'existence à l'époque, qui constitue l'essence des temps, est invariable dans chacun ; c'est toujours la simultanéité pour le présent, l'antériorité pour les prétérits, et la postériorité pour les futurs ; c'est ce que n'a pas distingué le grammairien espagnol.
§. VI. Des temps du participe. Il faut dire la même chose des temps du participe, dont j'ai établi ailleurs la distinction, contre l'opinion du même grammairien et de ses sectateurs. Ainsi je me contenterai de présenter ici le système entier des temps du participe, par rapport à notre langue.
SYSTÈME DES TEMS DU PARTICIPE.
ART. VII. Observations générales. Après une exposition si détaillée et des discussions si longues sur la nature des temps, sur les différentes espèces qui en constituent le système, et sur les caractères qui les différencient, bien des gens pourront croire que j'ai trop insisté sur un objet qui peut leur paraitre minutieux, et que le fruit qu'on en peut tirer n'est pas proportionné à la peine qu'il faut prendre pour démêler nettement toutes les distinctions delicates que j'ai assignées. Le savant Vossius, qui n'a guère écrit sur les temps que ce qui avait été dit cent fois avant lui, et que tout le monde avouait, a craint lui-même qu'on ne lui fit cette objection, et il y a répondu en se couvrant du voîle de l'autorité des anciens (Anal. III. xiij.) Si ce grammairien a cru courir en effet quelque risque, en exposant simplement ce qui était reçu, et qui faisait d'ailleurs une partie essentielle de son système de Grammaire ; que n'aura-t-on pas à dire contre un système qui renverse en effet la plupart des idées les plus communes et les plus accréditées, qui exige absolument une nomenclature toute neuve, et qui au premier aspect ressemble plus aux entreprises séditieuses d'un hardi novateur, qu'aux méditations paisibles d'un philosophe modeste ?
Mais j'observerai, 1°. que la nouveauté d'un système ne saurait être une raison suffisante pour la rejeter, parce qu'autrement les hommes une fois engagés dans l'erreur ne pourraient plus en sortir, et que la sphère de leurs lumières n'aurait jamais pu s'étendre au point où nous la voyons aujourd'hui, s'ils avaient toujours regardé la nouveauté comme un signe de faux. Que l'on soit en garde contre les opinions nouvelles, et que l'on n'y acquiesce qu'en vertu des preuves qui les étaient, à la bonne heure, c'est un conseil que suggère la plus saine logique : mais par une conséquence nécessaire, elle autorise en même temps ceux qui proposent ces nouvelles opinions, à prévenir et à détruire toutes les impressions des anciens préjugés par les détails les plus propres à justifier ce qu'ils mettent en-avant.
2°. Si l'on prend garde à la manière dont j'ai procédé dans mes recherches sur la nature des temps, un lecteur équitable s'apercevra aisément que je n'ai songé qu'à trouver la vérité sur une matière qui ne me semble pas encore avoir subi l'examen de la philosophie. Si ce qui avait été répété jusqu'ici par tous les Grammairiens s'était trouvé au résultat de l'analyse qui m'a servi de guide, je l'aurais exposé sans détour, et démontré sans apprêt. Mais cette analyse, suivie avec le plus grand scrupule, m'a montré, dans la décomposition des temps usités chez les différents peuples de la terre, des idées élémentaires qu'on n'avait pas assez démêlées jusqu'à présent ; dans la nomenclature ancienne, des imperfections d'autant plus grandes qu'elles étaient tout à fait contraires à la vérité ; dans tout le système enfin, un désordre, une confusion, des incertitudes qui m'ont paru m'autoriser suffisamment à exposer sans ménagement ce qui m'a semblé être plus conforme à la vérité, plus satisfaisant pour l'esprit, plus marqué au coin de la bonne analogie. Amicus Aristoteles, amicus Plato ; magis amica veritas.
3°. Ce n'est pas juger des choses avec équité, que de regarder comme minutieuse la doctrine des temps : il ne peut y avoir rien que d'important dans tout ce qui appartient à l'art de la parole, qui diffère si peu de l'art de penser, de l'art d'être homme.
" Quoique les questions de Grammaire paraissent peu de chose à la plupart des hommes, et qu'ils les regardent avec dédain, comme des objets de l'enfance, de l'oisiveté, ou du pédantisme ; il est certain cependant qu'elles sont très-importantes à certains égards, et très-dignes de l'attention des esprits les plus délicats et les plus solides. La Grammaire a une liaison immédiate avec la construction des idées ; en sorte que plusieurs questions de Grammaire sont de vraies questions de logique, même de métaphysique ". Ainsi s'exprime l'abbé des Fontaines, au commencement de la préface de son Racine vengé : et cet avis, dont la vérité est sensible pour tous ceux qui ont un peu approfondi la Grammaire, était, comme on Ve le voir, celui de Vossius, et celui des plus grands hommes de l'antiquité.
Majoris nunc apud me sunt judicia augustae antiquittatis ; quae existimabat, ab horum notitiâ non multa modò Poetarum aut Historicorum loca lucem foenerare, sed et gravissimas juris controversias. Haec propter nec Q. Scoevolae pater, nec Brutus Maniliusque, nec Nigidius Figulus, Romanorum post Varronem doctissimus, disquirere gravabantur utrùm vox surreptum erit an post facta an ante facta valeat ; hoc est, futurine an praeteriti sit temporis, quando in veteri lege Atiniâ legitur ; quod surreptum erit, ejus rei aeterna autoritas esto, nec puduit Agellium hac de re caput integrum contexere XVIIe atticarum noctium libro. Apud eumdem, cap. IIe libri XVIII. legimus, inter saturnalitias quaestiones eam faisse postremam ; scripserim, venerim, legerim, cujus temporis verba sint, praeteriti, an futuri, an utriusque. Quamobrem eos mirari satis non possum, qui hujusmodi sibi à pueris cognitissima fuisse parùm prudenter aut pudenter adserunt ; cùm in iis olim haesitârint viri excellentes, et quidem Romani, suae sine dubio linguae scientissimi. Voss. Anal. III. XIIIe
Ce que dit ici Vossius à l'égard de la langue latine, peut s'appliquer avec trop de fondement à la langue française, dont le fond est si peu connu de la plupart même de ceux qui la parlent le mieux, parce qu'accoutumés à suivre en cela l'usage du grand monde comme à en suivre les modes dans leurs habillements, ils ne réfléchissent pas plus sur les fondements de l'usage de la parole que sur ceux de la mode dans les vêtements. Que dis-je ? il se trouve même des gens de lettres, qui osent s'élever contre leur propre langue, la taxer d'anomalie, de caprice, de bizarrerie, et en donner pour preuves les bornes des connaissances où ils sont parvenus à cet égard.
" En lisant nos Grammairiens, dit l'auteur des jugements sur quelques ouvrages nouveaux, (tom. IX. pag. 73.) il est fâcheux de sentir, malgré soi, diminuer son estime pour la langue française, où l'on ne voit presque aucune analogie, où tout est bizarre pour l'expression comme pour la prononciation, et sans cause ; où l'on n'aperçoit ni principes, ni règles, ni uniformité ; où enfin tout parait avoir été dicté par un capricieux génie. En vérité, dit-il ailleurs (Racine vengé, Iphig. II. Ve 46.) l'étude de la grammaire française inspire un peu la tentation de mépriser notre langue ".
Je pourrais sans-doute détruire cette calomnie par une foule d'observations victorieuses, pour faire avec succès l'apologie d'une langue, déjà assez vengée des nationaux qui ont la maladresse de la mépriser, par l'acueil honorable qu'on lui fait dans toutes les cours étrangères, je n'aurais qu'à ouvrir les chefs-d'œuvre qui ont fixé l'époque de sa gloire, et faire voir avec quelle facilité et avec quel succès elles s'y prête à tous les caractères, naïveté, justesse, clarté, précision, délicatesse, pathétique, sublime, harmonie, etc. Mais pour ne pas trop m'écarter de mon sujet, je me contenterai de rappeler ici l'harmonie analogique des temps, telle que nous l'avons observée dans notre langue : tous les présents y sont simples ; les prétérits positifs y sont composés d'un temps simple du même auxiliaire avoir ou être ; les comparatifs y sont doublement composés ; les prochains y prennent l'auxiliaire venir ; les futurs positifs y empruntent constamment le secours de l'auxiliaire devoir ; et les prochains, celui de l'auxiliaire aller : et cette analogie est vraie dans tous les verbes de la langue, et dans tous les modes de chaque verbe. Ce qu'on lui a reproché comme un défaut, d'employer les mêmes temps, ici avec relation à une époque, et là avec relation à une autre, loin de la déshonorer, devient au contraire, à la faveur du nouveau système, une preuve d'abondance et un moyen de rendre avec une justesse rigoureuse les idées les plus précises : c'est en effet la destination des temps indéfinis, qui, faisant abstraction de toute époque de comparaison, fixent plus particulièrement l'attention sur la relation de l'existence à l'époque, comme on l'a Ve en son lieu.
Mais ne sera-t-il tenu aucun compte à notre langue de cette foule de prétérits et de futur, ignorés dans la langue latine, au prix de laquelle on la regarde comme pauvre ? Les regardera-t-on encore comme des bizarreries, comme des effets sans causes, comme des expressions dépourvues de sens, comme des superfluités introduites par un luxe aveugle et inutîle aux vues de l'élocution ? La langue italienne, en imitant à la lettre nos prétérits prochains, se sera-t-elle donc chargée d'une pure battologie ?
J'avouerai cependant à l'abbé des Fontaines, qu'à juger de notre langue par la manière dont le système est exposé dans nos grammaires, on pourrait bien conclure comme il a fait lui-même. Mais cette conclusion est-elle supportable à qui a lu Bossuet, Bourdaloue, la Bruyere, la Fontaine, Racine, Boileau, Pascal, etc. &c. etc. Voilà d'où il faut partir, et l'on conclura avec bien plus de vérité, que le désordre, l'anomalie, les bizarreries sont dans nos grammaires, et que nos Grammairiens n'ont pas encore saisi avec assez de justesse, ni approfondi dans un détail suffisant le mécanisme et le génie de notre langue. Comment peut-on lui voir produire tant de merveilles sous différentes plumes, quoiqu'elle ait dans nos grammaires un air maussade, irrégulier et barbare ; et cependant ne pas soupçonner le moins du monde l'exactitude de nos Grammairiens, mais invectiver contre la langue même de la manière la plus indécente et la plus injuste ?
C'est que toutes les fois qu'un seul homme voudra tenir un tribunal pour y juger les ouvrages de tous les genres de littérature, et faire seul ce qui ne doit et ne peut être bien exécuté que par une société assez nombreuse de gens de lettres choisis avec soin ; il n'aura jamais le loisir de rien approfondir ; il sera toujours pressé de décider d'après des vues superficielles ; il portera souvent des jugements iniques et faux, et alterera ou détruira entièrement les principes du gout, et le goût même des bonnes études, dans ceux qui auront le malheur de prendre confiance en lui, et de juger de ses lumières par l'assurance de son ton, et par l'audace de son entreprise.
4°. A s'en tenir à la nomenclature ordinaire, au catalogue reçu, et à l'ordre commun des temps, notre langue n'est pas la seule à laquelle on puisse reprocher l'anomalie ; elles sont toutes dans ce cas, et il est même difficîle d'assigner les temps qui se répondent exactement dans les divers idiomes, ou de déterminer précisément le vrai sens de chaque temps dans une seule langue. J'ouvre la Méthode grecque de P. R. à la page 120 (édition de 1754), et j'y trouve sous le nom de futur premier, , et sous le nom de futur second, , tous deux traduits en latin par honorabo : le premier aoriste est , le second , et le prétérit parfait ; tous trois rendus par le même mot latin honoravi. Est-il croyable que des mots si différents dans leur formation, et distingués par des dénominations différentes, soient destinés à signifier absolument la même idée totale que désigne le seul mot latin honorabo, ou le seul mot honoravi ? Il faut donc reconnaître des synonymes parfaits nonobstant les raisons les plus pressantes de ne les regarder dans les langues que comme un superflu embarrassant et contraire au génie de la parole. Voyez SYNONYMES. Je sais bien que l'on dira que les Latins n'ayant pas les mêmes temps que les Grecs, il n'est pas possible de rendre avec toute la fidélité les uns par les autres, du-moins dans le tableau des conjugaisons : mais je répondrai qu'on ne doit point en ce cas entreprendre une traduction qui est nécessairement infidèle, et que l'on doit faire connaître la véritable valeur des temps, par de bonnes définitions qui contiennent exactement toutes les idées élémentaires qui leur sont communes, et celles qui les différencient, à-peu-près comme je l'ai fait à l'égard des temps de notre langue. Mais cette méthode, la seule qui puisse conserver surement la signification précise de chaque temps, exige indispensablement un système et une nomenclature toute différente : si cette espèce d'innovation a quelques inconvéniens, ils ne seront que momentanés, et ils sont rachetés par des avantages bien plus considérables.
Les grammairiens auront peine à se faire un nouveau langage ; mais elle n'est que pour eux, cette peine, qui doit au fond être comptée pour rien dès qu'il s'agit des intérêts de la vérité : leurs successeurs l'entendront sans peine, parce qu'ils n'auront point de préjugés contraires ; et ils l'entendront plus aisément que celui qui est reçu aujourd'hui, parce que le nouveau langage sera plus vrai, plus expressif, plus énergique. La fidélité de la transmission des idées d'une langue en une autre, la facilité du système des conjugaisons fondée sur une analogie admirable et universelle, l'introduction aux langues débarrassée par-là d'une foule d'embarras et d'obstacles, sont, si je ne me trompe, autant de motifs favorables aux vues que je présente. Je passe à quelques objections particulières qui me viennent de bonne main.
La société littéraire d'Arras m'ayant fait l'honneur de m'inscrire sur ses registres comme associé honoraire, le 4 Février 1758 ; je crus devoir lui payer mon tribut académique, en lui communiquant les principales idées du système que je viens d'exposer, et que je présentai sous le titre d'Essai d'analyse sur le verbe. M. Harduin, secrétaire perpétuel de cette compagnie, et connu dans la république des lettres comme un grammairien du premier ordre, écrivit le 27 Octobre suivant, ce qu'il en pensait, à M. Bauvin, notre confrère et notre ami commun. Après quelques éloges dont je suis plus redevable à sa politesse qu'à toute autre cause, et quelques observations pleines se sagesse et de verité ; il termine ainsi ce qui me regarde : " J'ai peine à croire que ce système puisse s'accorder en tout avec le mécanisme des langues connues. Il m'est venu à ce sujet beaucoup de réfléxions dont j'ai jeté plusieurs sur le papier ; mais j'ignore quand je pourrai avoir le loisir de les mettre en ordre. En attendant, voici quelques remarques sur les prétérits, que j'avais depuis longtemps dans la tête, mais qui n'ont été redigées qu'à l'occasion de l'écrit de M. Beauzée. Je serais bien aise de savoir ce qu'il en pense. S'il les trouve justes, je ne conçais pas qu'il puisse persister à regarder notre aoriste français, comme un présent ; (je l'appelle présent antérieur périodique) ; à moins qu'il ne dise aussi que notre prétérit absolu (celui que je nomme prétérit indéfini positif) exprime plus souvent une chose présente qu'une chose passée ".
Trop flatté du désir que montre M. Harduin de savoir ce que je pense de ses remarques sur nos prétérits, je suis bien aise moi-même de déclarer publiquement, que je les regarde comme les observations d'un homme qui sait bien voir, talent très-rare, parce qu'il exige dans l'esprit une attention forte, une sagacité exquise, un jugement droit, qualités rarement portées au degré convenable, et plus rarement encore réunies dans un même sujet.
Au reste que M. Harduin ait peine à croire que mon système puisse s'accorder en tout avec le mécanisme des langues connues ; je n'en suis point surpris, puisque je n'oserais moi-même l'assurer : il faudrait, pour cela, les connaître toutes, et il s'en faut beaucoup que j'aye cet avantage. Mais je l'ai Ve s'accorder parfaitement avec les usages du latin, du français, de l'espagnol, de l'italien ; on m'assure qu'il peut s'accorder de même avec ceux de l'allemand et de l'anglais : il fait découvrir dans toutes ces langues, une analogie bien plus étendue et plus régulière que ne faisait l'ancien système ; et cela même me fait espérer que les savants et les étrangers qui voudront se donner la peine d'en faire l'application aux verbes des idiomes qui leur sont naturels ou qui sont l'objet de leurs études, y trouveront la même concordance, le même esprit d'analogie, la même facilité à rendre la valeur des temps usuels. Je les prie même, avec la plus grande instance, d'en faire l'essai, parce que plus on trouvera de ressemblance dans les principes des langues qui paraissent diviser les hommes, plus on facilitera les moyens de la communication universelle des idées, et conséquemment des secours mutuels qu'ils se doivent, comme membres d'une même société formée par l'auteur même de la nature.
Les réflexions de M. Harduin sur cette matière, quoique tournées peut-être contre mes vues, ne manqueront pas du-moins de répandre beaucoup de lumière sur le fond de la chose : ce n'est que de cette sorte qu'il réflechit ; et il est à désirer qu'il trouve bientôt cet utîle loisir qui doit nous valoir le précis de ses pensées à cet égard. En attendant, je vais tâcher de concilier ici mon système avec ses observations sur nos prétérits.
" Il est de principe, dit-il, qu'on doit se servir du prétérit absolu, c'est-à-dire, de celui dans la composition duquel entre un verbe auxiliaire, lorsque le fait dont on parle se rapporte à un période de temps où l'on est encore ; ainsi il faut nécessairement dire, telle bataille s'est donnée dans ce siecle-ci : j'ai Ve mon frère cette année : je lui ai parlé aujourd'hui ; et l'on s'exprimerait mal, en disant avec l'aoriste, telle bataille se donna dans ce siecle-ci : je vis mon frère cette année : je lui parlai aujourd'hui ".
C'est que dans les premières phrases, on exprime ce qu'on a effectivement dessein d'exprimer, l'antériorité d'existence à l'égard d'une époque actuelle ; ce qui exige les prétérits dont on y fait usage : dans les dernières on exprimerait toute autre chose, la simultanéité d'existence à l'égard d'un période de temps antérieur à celui dans lequel on parle ; ce qui exige en effet un présent antérieur périodique, mais qui n'est pas ce qu'on se propose ici.
M. Harduin demande si ce n'est pas abusivement que nous avons fixé les périodes antérieurs qui précédent le jour où l'on parle, puisque dans ce même jour, les diverses heures qui le composent, la matinée, l'après-midi, la soirée, sont autant de périodes qui se succedent ; d'où il conclut que comme on dit, je le vis hier, on pourrait dire aussi, je le vis ce matin, quand la matinée est finie à l'instant où l'on parle.
C'est arbitrairement sans-doute, que nous n'avons aucun égard aux périodes compris dans le jour même où l'on parle ; et la preuve en est, que ce que l'on appelle ici aoriste, ou prétérit indéfini, se prend quelquefois, dans la langue italienne, en parlant du jour même où nous sommes ; io la viddi sto mane (je le vis ce matin). L'auteur de la Méthode italienne, qui fait cette remarque, (Part. II. ch. IIIe §. 4. pag. 86.) observe en même temps que cela est rare, même dans l'italien. Mais quelque arbitraire que soit la pratique des Italiens et la nôtre, on ne peut jamais la regarder comme abusive, parce que ce qui est fixé par l'usage n'est jamais contraire à l'usage, ni par conséquent abusif.
" Plusieurs grammairiens, continue M. Harduin ; " et c'est proprement ici que commence le fort de son objection contre mon système des temps : " plusieurs grammairiens font entendre, par la manière dont ils s'énoncent sur cette matière, que le prétérit absolu et l'aoriste ont chacun une destination tellement propre, qu'il n'est jamais permis de mettre l'un à la place de l'autre. Cette opinion me parait contredite par l'usage, suivant lequel on peut toujours substituer le prétérit absolu à l'aoriste, quoiqu'on ne puisse pas toujours substituer l'aoriste au prétérit absolu ". Ici l'auteur indique avec beaucoup de justesse et de précision les cas où l'on ne doit se servir que du prétérit absolu, sans pouvoir lui substituer l'aoriste ; puis il continue ainsi : " Mais hors les cas que je viens d'indiquer, on a la liberté du choix entre l'aoriste et le prétérit absolu. Ainsi on peut dire, je le vis hier, ou bien, je l'ai Ve hier au moment de son départ ".
C'est que, hors les cas indiqués, il est presque toujours indifférent de présenter la chose dont il s'agit, ou comme antérieure au moment où l'on parle, ou comme simultanée avec un période antérieur à ce moment de la parole, parce que quae sunt eadem uni tertio, sunt eadem inter se, comme on le dit dans le langage de l'école. S'il est donc quelquefois permis de choisir entre le prétérit indéfini positif et le présent antérieur périodique, c'est que l'idée d'antériorité, qui est alors la principale, est également marquée par l'un et par l'autre de ces temps, quoiqu'elle soit diversement combinée dans chacun d'eux ; et c'est pour la même raison que, suivant une dernière remarque de M. Harduin, " il y a des occasions où l'imparfait même (c'est-à-dire le présent antérieur simple) entre en concurrence avec l'aoriste et le prétérit absolu, et qu'il est à-peu-près égal de dire, César fut un grand homme, ou César a été un grand homme, ou enfin César était un grand homme " : l'antériorité est également marquée par ces trois temps, et c'est la seule chose que l'on veut exprimer dans ces phrases.
Mais cette espèce de synonymie ne prouve point, comme M. Harduin semble le prétendre, que ces temps aient une même destination, ni qu'ils soient de la même classe, et qu'ils ne diffèrent entr'eux que par de très légères nuances. Il en est de l'usage et de diverses significations de ces temps, comme de l'emploi et des différents sens, par exemple, des adjectifs fameux, illustre, célèbre, renommé : tous ces mots marquent la réputation, et l'on pourra peut-être s'en servir indistinctement lorsqu'on n'aura pas besoin de marquer rien de plus précis, mais il faudra choisir, pour peu que l'on veuille mettre de précision dans cette idée primitive. (Voyez les SYNONYMES FRANÇOIS). M. Harduin lui-même, en assignant les cas où il faut employer le prétérit qu'il appelle absolu, plutôt que le temps qu'il nomme aoriste, fournit une preuve suffisante que chacune de ces formes a une destination exclusivement propre, et que je puis adopter toutes ses observations pratiques comme vraies, sans cesser de regarder ce qu'il appelle notre aoriste comme un présent, et sans être forcé de convenir que notre prétérit exprime plus souvent une chose présente qu'une chose passée. (B. E. R. M.)
TEMS, (Critique sacrée) ce mot signifie proprement la durée qui s'écoule depuis un terme jusqu'à un autre ; mais il se prend aussi dans plusieurs autres sens ; 1°. pour une partie de l'année (Gen. j. 14.) 2°. pour l'espace d'un an ; les saints du pays, dit Daniel, VIIe 25. tomberont entre les mains de ce puissant roi pour un temps des temps, et la moitié d'un temps, ad tempus, tempora, et dimidium temporis ; ces expressions hébraïques signifient les trois ans et demi que durèrent les persécutions d'Antiochus contre les Juifs : tempus fait un an, tempora deux ans, dimidium temporis une demi-année ; 3°. ce mot signifie l'arrivée de quelqu'un, (Is. xiv. 1.) 4°. le moment favorable et passager de faire quelque chose ; pendant que nous en avons le temps, faisons du bien à tous, Galat. VIe 10.
Racheter le temps, dans Daniel, c'est gagner du temps ; comme les mages consultés par Nabuchodonosor, qui lui demandaient du temps pour expliquer son songe ; mais racheter le temps dans saint Paul, Eph. Ve 16. , c'est laisser passer le temps de la colere des mécans, et attendre avec prudence des circonstances plus heureuses.
Le temps de quelqu'un, c'est le moment où il reçoit la punition de son crime, Ezéchiel xxij. 3.
Les temps des siècles passés (Tite j. 2.) sont ceux qui ont précédé la venue de Jesus-Christ.
Les temps d'ignorance, , sont ceux qui ont précédé les lumières du christianisme, par rapport au culte de la divinité. Saint Paul annonce, Actes XVIIe 30. que Dieu, après avoir dissimulé ces temps, veut maintenant que toutes les nations s'amendent, c'est-à-dire qu'on ne rende plus de culte aux idoles. (D.J.)
TEMS, (Mythologie) on personnifia, on divinisa le temps avec ses parties ; Saturne en était ordinairement le symbole. On représentait le temps avec des ailes, pour marquer la rapidité avec laquelle il passe, et avec une faulx, pour signifier ses ravages. Le temps était divisé en plusieurs parties ; le siècle, la génération ou espace de trente ans, le lustre, l'année, les saisons, les mois, les jours et les heures ; et chacune de ces parties avait sa figure particulière en hommes ou en femmes, suivant que leurs noms étaient masculins ou féminins ; on portait même leurs images dans les cérémonies religieuses. (D.J.)
TEMS, se dit aussi de l'état ou disposition de l'athmosphère, par rapport à l'humidité ou à la sécheresse, au froid ou au chaud, au vent ou au calme, à la pluie, à la grêle, etc. Voyez ATHMOSPHERE, PLUIE, CHALEUR, VENT, GRELE, etc.
Comme c'est dans l'athmosphère que toutes les plantes et tous les animaux vivent, et que l'air est suivant toutes les apparences le plus grand principe des productions animales et végétales (voyez AIR), ainsi que des changements qui leur arrivent, il n'y a rien en Physique qui nous intéresse plus immédiatement que l'état de l'air. En effet, tout ce qui a vie n'est qu'un assemblage de vaisseaux dont les liqueurs sont conservées en mouvement par la pression de l'athmosphère ; et toutes les altérations qui arrivent ou à la densité ou à la chaleur, ou à la pureté de l'air, doivent nécessairement en produire sur tout ce qui y vit.
Toutes ces altérations immenses, mais régulières, qu'un petit changement dans le temps produit, peuvent être aisément connues à l'aide d'un tube plein de mercure ou d'esprit-de-vin, ou avec un bout de corde, ainsi que tout le monde le sait par l'usage des thermomètres, baromètres et hygromètres. Voyez BAROMETRE, THERMOMETRE, HYGROMETRE, etc. Et c'est en partie notre inattention, et en partie le défaut d'uniformité de notre genre de vie, qui nous empêche de nous apercevoir de toutes les altérations et de tous les changements qui arrivent aux tubes, cordes et fibres dont notre corps est composé.
Il est certain qu'une grande partie des animaux a beaucoup plus de sensibilité et de délicatesse que les hommes sur les changements de temps. Ce n'est pas qu'ils aient d'autres moyens ou d'autres organes que nous ; mais c'est que leurs vaisseaux, leurs fibres étant en comparaison de ceux des hommes, dans un état permanent, les changements extérieurs produisent en eux des changements intérieurs proportionnels. Leurs vaisseaux ne sont proprement que des baromètres, etc. affectés seulement par les causes extérieures ; au lieu que les nôtres recevant des impressions du dedans aussi bien que du dehors, il arrive que plusieurs de ces impressions nuisent ou empêchent l'effet des autres.
Il n'y a rien dont nous soyons plus éloignés que d'une bonne théorie de l'état de l'air. Mais on ne saurait y parvenir sans une suite complete d'observations. Lorsque nous aurons eu des registres tenus exactement dans différents lieux de la terre, et pendant une longue suite d'années, nous serons peut-être en état de déterminer les directions, la force et les limites du vent, la constitution de l'air apporté par le vent, la relation qui est entre l'état du ciel de différents climats, et les différents états du ciel dans le même lieu ; et peut-être nous saurons prédire alors les chaleurs excessives, les pluies, la gelée, les sécheresses, les famines, les pestes, et autres maladies épidémiques. Ces sortes d'observations s'appellent du nom général d'observations météorologiques. Voyez METEOROLOGIQUES.
Erasme Bartholin a fait des observations météorologiques jour par jour pour l'année 1571. M. W. Merle en a fait de pareilles à Oxford pendant les sept années 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343. Le docteur Plottau même lieu pour l'année 1684. M. Hillier au cap Corse pour les années 1686, 1687. M. Hunt, etc. au collège de Gresham pour les années 1695, 1696. M. Derham à Upminster, dans la province d'Essex pour les années 1691, 1692, 1697, 1698, 1699, 1703, 1705, 1707. M. Townley, dans la province de Lancastre, pour les années 1698, 1699, 1700, 1701. M. Hocke, à Oats, dans la province d'Essex, en 1692. Le docteur Scheuchzer à Zurich en 1708 ; et le docteur Tilly à Pise la même année. Voyez Transactions philosophiques.
Nous joindrons ici la forme des observations de M. Derham, pour servir d'échantillon d'un journal de cette nature, en faisant remarquer qu'il dénote la force des vents par les chiffres 0, 1, 2, 3, etc. et les quantités d'eau de pluie reçues dans un tonneau en livres et en centiemes.
Observations météorologiques. Octobre 1697.
Afin de faire voir un essai de l'usage de ces sortes d'observations, nous ajouterons quelques remarques générales tirées de celles de M. Derham.
1°. Les temps lourds font monter le mercure aussi-bien que les vents du nord ; ce qui, suivant M. Derham, vient de l'augmentation de poids que l'air reçoit par les vapeurs dont il est chargé alors. Voyez BROUILLARD. M. Derham remarque qu'il en est de même dans les temps de bruine. Voyez BRUINE.
2°. Le froid et la chaleur commencent et finissent à-peu-près dans le même temps en Angleterre et en Suisse, et même toutes les températures d'air un peu remarquables lorsqu'elles durent quelque temps.
3°. Les jours de froid remarquables pendant le mois de Juin 1708 en Suisse, précédaient communément ceux d'Angleterre d'environ 5 jours ou plus, et les chaleurs remarquables des mois suivants commencèrent à diminuer dans les deux pays à-peu-près dans le même temps, seulement un peu plus tôt en Angleterre qu'en Suisse.
4°. Le baromètre est toujours plus bas à Zurich qu'à Upminster, quelquefois d'un pouce, quelquefois de deux, mais communément d'un demi-pouce ; ce qui peut s'expliquer en supposant Zurich plus élevé que Upminster.
5°. La quantité de pluie qui tombe en Suisse et en Italie est plus grande que celle qui tombe dans la province d'Essex, quoique dans cette province il pleuve plus souvent ou qu'il y ait plus de jours pluvieux que dans la Suisse. Voici la proportion des pluies d'une année entière en différents lieux, tirée d'assez bonnes observations. A Zurich la hauteur moyenne de la pluie tombée pendant un an était de 31 1/2 pouces anglais ; à Pise 43 1/4 ; à Paris 23 ; à Lîle en Flandre 23 1/2 ; à Townley dans la province de Lancastre 42 1/2 ; à Upminster 19 1/4. Voyez PLUIE.
6°. Le froid contribue considérablement à la pluie, vraisemblablement à cause qu'il condense les vapeurs suspendues et les précipite ; en sorte que les saisons les plus froides et les mois les plus froids sont en général suivis des mois les plus pluvieux, et les étés froids sont toujours les plus humides.
7°. Les sommets glacés des hautes montagnes agissent non-seulement sur les lieux voisins, par les froids, les neiges, les pluies, etc. qu'ils y produisent, mais encore sur des pays assez éloignés, témoin les Alpes, dont l'effet agit jusqu'en Angleterre ; car le froid extraordinaire du mois de Décembre 1708, et les relâchements qu'il eut ayant été aperçus en Italie et en Suisse quelques jours avant qu'en Angleterre, doivent, suivant M. Derham, avoir passé de l'un à l'autre.
Depuis un certain nombre d'années, on fait par toute l'Europe les observations météorologiques avec une grande exactitude. La société royale de Londres adressa il y a environ vingt ans, un écrit circulaire à tous les savants pour les y exhorter. Il y avait déjà longtemps que l'on les faisait dans l'académie royale des Sciences de Paris. Dès avant 1688, quelques-uns de ses membres avaient observé pendant plusieurs années, la quantité d'eau de pluie et de neige qu'il tombe tous les ans, soit à Paris, soit à Dijon ; ce qui s'en évapore, et ce qui s'en imbibe dans la terre à plus ou moins de profondeur, comme on en peut juger par quelques ouvrages fort antérieurs, touchant l'origine des fontaines et des rivières, et surtout par le Traité du mouvement des eaux, de M. Mariotte. Mais il est certain qu'en 1688, la compagnie résolut de mettre ces observations en règle.
M. Perrault donna le dessein d'une machine propre à cet usage, et M. Sedileau se chargea des observations. Après M. Sedileau, ce fut M. de la Hire, etc. et enfin, elles ont été continuées jusqu'à aujourd'hui sans interruption. On y joignit bientôt les observations du baromètre et du thermomètre, le plus grand chaud et le plus grand froid qu'il fait chaque année, chaque saison, chaque jour, et avec les circonstances qui y répondent, les déclinaisons de l'aiguille aimantée, et dans ce siècle les apparitions de l'aurore boréale.
Pronostics du temps. Nous ne voulons point entretenir ici le lecteur de ces vaines et arbitraires observations du peuple. Nous abandonnons cette foule de prédictions qui ont été établies en partie par la ruse, et en partie par la crédulité des gens de la campagne ; elles n'ont aucun rapport naturel et nécessaire que nous connaissions avec les choses en elles-mêmes. Telles sont les prédictions de la pluie et du vent qu'on tire du mouvement qui est parmi les oiseaux aquatiques pour se rassembler vers la terre, et les oiseaux terrestres vers l'eau ; qu'on conclut encore, lorsque les oiseaux élaguent leurs plumes, que les oies crient, que les corneilles vont en troupe, que les hirondelles volent bas et geroillent, que les paons crient, que les cerfs se battent, que les renards et les loups heurlent, que les poissons jouent, que les fourmis et les abeilles se tiennent renfermées, que les taupes jettent de la terre, que les vers de terre se trainent, etc.
Nous n'offrirons rien de cette nature, mais ce qui peut être fondé en quelque manière sur la nature des choses, ce qui peut jeter quelque lumière sur la cause et les circonstances de la température de l'air, ou du moins aider à découvrir quelques-uns de ses effets sensibles.
1°. Lorsque le ciel est sombre, couvert, qu'on est quelque temps de suite sans soleil, ni sans pluie, il devient d'abord beau, et ensuite vilain, c'est-à-dire qu'il commence par devenir clair, et qu'ensuite il tourne à la pluie ; c'est ce que nous apprenons par un journal méteorologique que M. Clarke a tenu pendant trente ans, et que son petit-fils, le savant Samuel Clarke, a laissé à M. Derham. Il assurait que cette règle lui avait toujours paru s'observer dumoins lorsque le vent était tourné à l'orient. Mais M. Derham a observé, que la règle avait également lieu pour tous les vents ; et la raison, selon lui, en est assez facîle à trouver. L'athmosphère est alors rempli de vapeurs, qui sont à la vérité suffisantes pour réfléchir la lumière du soleil et nous l'intercepter, mais n'ont pas assez de densité pour tomber. Ensorte que tant que ces vapeurs restent dans le même état, le ciel ne change pas, et ces vapeurs y restent quelque temps de suite à cause qu'il fait alors ordinairement une chaleur modérée, et que l'air est fort pesant et propre à les soutenir, ainsi qu'on le peut voir par le baromètre qui est communément haut dans ce temps-là. Mais, lorsque le froid approche, il rassemble ces vapeurs par la condensation et en forme des nuages détachés, entre lesquels passent les rayons du soleil, jusqu'à-ce qu'enfin la condensation de ces vapeurs devient si considérable, qu'elles tombent en pluie.
2°. Un changement dans la chaleur du temps, produit communément un changement dans le vent. Ainsi les vents de nord et de sud, qui sont ordinairement réputés la cause du froid et du chaud, ne sont réellement que les effets du froid et de la chaleur de l'athmosphère. M. Derham assure, qu'il en a tant de confirmations, qu'il ne saurait en douter. Il est commun, par exemple, de voir qu'un vent chaud du sud se change en un vent froid du nord, lorsqu'il vient à tomber de la neige ou de la grêle, et de même de voir un vent nord et froid régner le matin, dégénérer en sud sur le soir, lorsque la terre est échauffée par la chaleur du soleil, et retourner ensuite au nord ou à l'est, lorsque le froid du soir arrive. Voyez VENT. Chambers. (O)
TEMS. Effets du temps sur les plantes. La plupart des plantes épanouissent leurs fleurs et leurs duvets au soleil, et les resserrent sur le soir ou pendant la pluie, principalement lorsqu'elles commencent à fleurir, et que leurs graines sont encore tendres et sensibles. Ce fait est assez visible dans les duvets de la dent-de-lion et dans les autres, mais surtout dans les fleurs de la pimprenelle, dont l'épanouissement et le resserrement, suivant Gerard, servent aux gens de la campagne à prédire le temps qu'il doit faire le jour suivant, l'épanouissement promettant le beau temps pour le lendemain, et le resserrement annonçant le vilain temps. Ger. herb. lib. II.
Est et alia (arbor in Tylis) similis, foliosior tamen, rosetque floris ; quem noctu compriments, aperire incipit solis exortu, meridie expandit. Incolae dormire cum dicunt. Plin. Nat. hist. lib. XII. cap. XIe
La tige du treffle, suivant que l'a remarqué milord Bacon, s'enfle à la pluie et s'éleve, ce qui peut être aussi remarqué, quoique moins sensiblement, dans les tiges des autres plantes. Suivant le même auteur, on trouve dans les chaumes une petite fleur rouge qui indique une belle journée, lorsqu'elle s'épanouit du matin.
On conçoit aisément que les changements qui arrivent dans le temps influent sur les plantes, lorsqu'on imagine qu'elles ne sont autre chose qu'un nombre infini de trachées ou vaisseaux à air, par le moyen desquels elles ont une communication immédiate avec l'air, et partagent son humidité, sa chaleur, etc. ces trachées sont visibles dans la feuille de vigne, dans celle de la scabieuse, etc. Voyez PLANTE, VEGETAUX, etc.
Il suit de-là que tout bois, même le plus dur et le plus compact, s'enfle dans les temps humides, les vapeurs s'insinuant aisément dans ses pores, surtout lorsque c'est un bois léger et sec. C'est de cette remarque qu'on a tiré ce moyen si singulier, de fendre des roches avec du bois. Voyez BOIS.
Voici la méthode qu'on suit dans les carrières : on taille d'abord une roche en forme de cylindre ; ensuite on divise ce cylindre en plusieurs autres, en faisant des trous de distance en distance dans sa longueur et à différents endroits de son contour. Et l'on remplit ces trous de pièces de bois de saule séché au four. Lorsqu'il survient après un temps humide, ces pièces de bois imbibées de l'humidité de l'air se gonflent, et par l'effet du coin elles fendent la roche en plusieurs pièces.
TEMS, (Philos. et Mor.) la philosophie et la morale fournissent une infinité de réflexions sur la durée du temps, la rapidité de sa course, et l'emploi qu'on en doit faire ; mais ces réflexions acquièrent encore plus de force, d'éclat, d'agrément et de coloris, quand elles sont revêtues des charmes de la poésie ; c'est ce qu'a fait voir M. Thomas, dans une ode qui a remporté le prix de l'académie Française en 1762. Sa beauté nous engage à la transcrire ici toute entière, pour être un monument durable à la gloire de l'auteur. L'Encyclopédie doit être parée des guirlandes du parnasse, et de tous les fruits des beaux génies qui ont sommeillé sur le sommet du sacré vallon. Voici l'ode dont il s'agit.
Le compas d'Uranie a mesuré l'espace.
O temps, être inconnu que l'âme seule embrasse,
Invincible torrent des siècles et des jours,
Tandis que ton pouvoir m'entraîne dans la tombe,
J'ose, avant que j'y tombe,
M'arrêter un moment pour contempler ton cours.
Qui me dévoilera l'instant qui t'a Ve naître ?
Quel oeil peut remonter aux sources de ton être ?
Sans doute ton berceau touche à l'éternité.
Quand rien n'était encore, enseveli dans l'ombre
De cet abîme sombre,
Ton germe y reposait, mais sans activité.
Du chaos tout-à-coup les portes s'ébranlèrent ;
Des soleils allumés les feux étincelèrent,
Tu naquis ; l'éternel te prescrivit ta loi.
Il dit au mouvement, du temps sois la mesure.
Il dit à la nature,
Le temps sera pour vous, l'éternité pour moi.
Dieu, telle est ton essence : oui, l'océan des âges
Roule au-dessous de toi sur tes frèles ouvrages,
Mais il n'approche pas de ton trône immortel.
Des millions de jours qui l'un l'autre s'effacent,
Des siècles qui s'entassent
Sont comme le néant aux yeux de l'Eternel.
Mais moi, sur cet amas de fange et de poussière
Envain contre le temps, je cherche une barrière ;
Son vol impétueux me presse et me poursuit ;
Je n'occupe qu'un point de la vaste étendue ;
Et mon âme éperdue
Sous mes pas chancelans, voit ce point qui s'enfuit.
De la destruction tout m'offre des images.
Mon oeil épouvanté ne voit que des ravages ;
Ici de vieux tombeaux que la mousse a couverts ;
Là des murs abattus, des colonnes brisées,
Des villes embrasées,
Par-tout les pas du temps empreints sur l'univers.
Cieux, terres, éléments, tout est sous sa puissance :
Mais tandis que sa main, dans la nuit du silence,
Du fragîle univers sappe les fondements ;
Sur des ailes de feu loin du monde élancée,
Mon active pensée
Plane sur les débris entassés par le temps.
Siècles qui n'êtes plus, et vous qui devez naître,
J'ose vous appeler ; hâtez-vous de paraitre :
Au moment où je suis, venez vous réunir.
Je parcours tous les points de l'immense durée,
D'une marche assurée ;
J'enchaine le présent, je vis dans l'avenir.
Le soleil épuisé dans sa brulante course
De ses feux par degrés verra tarir la source ;
Et des mondes vieillis les ressorts s'useront.
Ainsi que les rochers qui du haut des montagnes
Roulent dans les campagnes,
Les astres l'un sur l'autre un jour s'écrouleront.
Là de l'éternité commencera l'empire ;
Et dans cet océan, où tout Ve se détruire,
Le temps s'engloutira comme un faible ruisseau.
Mais mon âme immortelle aux siècles échappée
Ne sera point frappée,
Et des mondes brisés foulera le tombeau.
Des vastes mers, grand Dieu, tu fixas les limites !
C'est ainsi que des temps les bornes sont prescrites.
Quel sera ce moment de l'éternelle nuit ?
Toi seul tu le connais ; tu lui diras d'éclore ;
Mais l'univers l'ignore ;
Ce n'est qu'en périssant qu'il en doit être instruit.
Quand l'airain frémissant autour de vos demeures,
Mortels, vous avertit de la fuite des heures,
Que ce signal terrible épouvante vos sens.
A ce bruit tout-à-coup mon âme se reveille,
Elle prête l'oreille,
Et croit de la mort même entendre les accens.
Trop aveugles humains, quelle erreur vous enivre !
Vous n'avez qu'un instant pour penser et pour vivre,
Et cet instant qui fuit est pour vous un fardeau.
Avare de ses biens, prodigue de son être,
Dès qu'il peut se connaître,
L'homme appelle la mort et creuse son tombeau.
L'un courbé sous cent ans est mort dès sa naissance,
L'autre engage à prix d'or sa venale existence ;
Celui-ci la tourmente à de pénibles jeux ;
Le riche se délivre au prix de sa fortune
Du temps qui l'importune ;
C'est en ne vivant pas que l'on croit vivre heureux.
Abjurez, ô mortels, cette erreur insensée.
L'homme vit par son âme, et l'âme est la pensée.
C'est elle qui pour vous doit mesurer le temps.
Cultivez la sagesse : apprenez l'art suprême
De vivre avec soi-même,
Vous pourrez sans effroi compter tous vos instants.
Si je devais un jour pour de viles richesses
Vendre ma liberté, descendre à des bassesses ;
Si mon cœur par mes sens devait être amolli ;
O temps, je te dirais, préviens ma dernière heure ;
Hâte-toi, que je meure !
J'aime mieux n'être pas, que de vivre avili.
Mais si de la vertu les généreuses flâmes
Peuvent de mes écrits passer dans quelques âmes ;
Si je puis d'un ami soulager les douleurs ;
S'il est des malheureux dont l'obscure innocence
Languisse sans défense,
Et dont ma faible main doive essuyer les pleurs.
O temps, suspens ton vol, respecte ma jeunesse,
Que ma mère longtemps témoin de ma tendresse,
Reçoive mes tributs de respect et d'amour !
Et vous, gloire, vertu, déesses immortelles,
Que vos brillantes ailes
Sur mes cheveux blanchis se reposent un jour.
(D.J.)
TEMS DES MALADIES, (Médecine, Pathologie) les Pathologistes prennent ce mot temps dans diverses acceptions en l'appliquant au cours des maladies ; quelquefois ils l'emploient pour mesurer leur durée et en distinguer les jours remarquables ; d'autres fois ils s'en servent pour désigner les périodes et les états différents qu'on y a observés.
Dans la première signification, la longueur du temps a donné lieu à la division générale des maladies en aiguës et chroniques ; la durée de celles-ci s'étend au-delà de quarante jours, celles-là sont toujours renfermées dans cet espace de temps limité ; mais elles peuvent varier en durée d'autant de façons qu'on compte de jours différents. Car, suivant les observations répétées, il y a des maladies qui se terminent dans un jour, connues sous le nom d'éphémères ; d'autres sont décidées dans deux, dans trois, dans quatre, et ainsi de suite jusqu'à quarante. Cependant, suivant ce qui arrive le plus ordinairement, on a distingué quatre ou cinq temps principaux dans la durée des maladies qui en décident la briéveté, (acuties). Dans la première classe, on a compris les maladies qui sont terminées dans l'espace de quatre jours, on les a appelées perper-aiguès ; telles sont l'apoplexie, la peste, la sueur anglaise, etc. La seconde comprend celles qui durent sept jours, qu'on a nommé très-aiguès ou per-aiguès ; de ce nombre sont la fièvre ardente et les maladies inflammatoires, légitimes, exquises. La troisième classe renferme les maladies appelées simplement aiguës, qui s'étendent jusqu'à quatorze ou vingt-un jours, comme la plupart des fièvres continues ; enfin les autres, connues sous le nom d'aiguès par décidence, trainent depuis le vingt-unième jour jusqu'à quelqu'un des jours intermédiaires entre le quarantième, au-delà duquel, si elles persistent, elles prennent le titre de chroniques ; et dans cette acception, lorsqu'on demande à quel temps le malade est de sa maladie, on répond qu'il est, par exemple, au septième jour depuis l'invasion de la maladie, temps qu'il est assez difficîle de connaître au juste.
En second lieu, les anciens ont distingué trois périodes ou états dans le courant d'une maladie aiguë, qu'ils ont désigné sous le nom de temps. Le premier temps est celui qu'ils ont appelé de crudité, alors la nature et la maladie sont, suivant leur expression, engagées dans le combat, la victoire ne panche d'aucun côté, le trouble est considérable dans la machine, les symptômes sont violents, et les bonnes humeurs sont confondues avec les mauvaises, ou sont crues. M. Bordeu a appelé ce temps temps d'irritation, parce qu'alors le pouls conserve ce caractère ; il est tendu, convulsif, et nullement développé. Le second temps est le temps de coction ; il tire cette dénomination de l'état des humeurs qui sont alors cuites, c'est-à-dire que les mauvaises sont, par les efforts de la nature victorieuse, séparées du sein des bonnes, et disposées à l'excrétion critique, qui doit avoir lieu dans le troisième temps, qu'on nomme en conséquence temps de crise. Pendant les temps de la coction, les symptômes se calment, les accidents disparaissent, l'harmonie commence à se rétablir, le pouls devient mol, développé et rebondissant, les urines renferment beaucoup de sédiment. Le temps de crise est annoncé par une nouvelle augmentation des symptômes, mais qui est passagère, le pouls prend la modification critique appropriée ; et les évacuations préparées ayant lieu, débarrassent le corps de toutes les humeurs de mauvais caractères ou superflues, et la machine revient dans son assiette naturelle. Voyez CRUDITE, COCTION, CRISE et POULS. Les modernes ont admis une autre division qui pourrait se réduire à celle des anciens, et qui est bien moins juste, moins avantageuse, et moins exacte ; ils distinguent quatre temps ; 1°. le temps de l'invasion ou le commencement qui comprend le temps qui s'écoule depuis que la maladie a commencé jusqu'à celui où les symptômes augmentent ; 2°. le temps d'augmentation, qui est marqué par la multiplicité et la violence des accidents ; 3°. l'état où les symptômes restent au même point sans augmenter, ni diminuer ; 4°. la déclinaison, temps auquel la maladie commence à baisser et parait tendre à une issue favorable : ce dernier temps répond à ceux de coction et de crise des anciens, et les trois autres assez inutilement distingués ne sont que le temps de crudité ; lorsque les maladies se terminent à la mort, elles ne parcourent pas tous ces périodes, et ne parviennent pas aux derniers temps.
Traisiemement, dans les maladies intermittentes et dans les fièvres avec redoublement, on observe deux états, dont l'un est caractérisé par la cessation ou la diminution des symptômes, et l'autre par le retour ou leur augmentation ; on a distingué ces deux états sous le nom de temps, appelant le premier temps de la remission, et l'autre temps de l'accès ou du redoublement ; le médecin, dans le traitement des maladies, ne doit jamais perdre de vue toutes ces distinctions de temps, parce qu'il peut en tirer des lumières pour leur connaissance et leur pronostic, et surtout parce que ces temps exigent des remèdes très-différents. Voyez FIEVRE EXACERBANTE, INTERMITTENTE, PAROXYSME, ÉPILEPSIE, GOUTTE, HYSTERIQUE, passion, &c.
Il est aussi très-important de faire attention aux temps de l'année, c'est-à-dire aux saisons ; voyez PRINTEMS, AUTOMNE, ÉTE, HIVER, SAISONS, (Médecine) ; et aux temps de la journée, voyez MATIN et SOIR, (Médecine), parce que les maladies varient dans ces différents temps, et qu'il y a des règles concernant l'administration des remèdes, fondées sur leur distinction. (m)
TEMS AFFINE, (Marine) voyez AFFINE.
TEMS A PERROQUET, (Marine) beau temps où le vent souffle médiocrement, et porte à route. On l'appelle ainsi, parce qu'on ne porte plus la voîle de perroquet que dans le beau temps ; parce qu'étant extrêmement élevée, elle donnerait trop de prise au vent, si on la portait dans de gros temps. Voyez MATURE.
TEMS DE MER ou GROS-TEMS, (Marine) temps de tempête où le vent est très-violent.
TEMS EMBRUME, (Marine) temps où la mer est couverte de brouillards.
TEMS, (Jurisprudence) signifie quelquefois une certaine conjoncture, comme quand on dit en temps de foire.
Temps signifie aussi délai ; il faut intenter le retrait lignager dans l'an et jour, qui est le temps prescrit par la coutume.
Temps d'étude, est l'espace de temps pendant lequel un gradué doit avoir étudié pour obtenir régulièrement ses grades. Voyez ÉTUDE, DEGRÉS, GRADES, GRADUÉS, UNIVERSITé, BACHELIER, LICENCIé, DOCTEUR. (A)
TEMS, s. m. en Musique, est en général toute modification du son par rapport à la durée.
On sait ce que peut une succession de sons bien dirigée eu égard au ton ou aux divers degrés du grave à l'aigu et de l'aigu au grave. Mais c'est aux proportions de ces mêmes sons, par rapport à leurs diverses durées du lent au vite et du vite au lent, que la musique doit une grande partie de son énergie.
Le temps est l'âme de la musique ; les airs dont la mesure est lente, nous attristent naturellement ; mais un air gai, vif et bien cadencé nous excite à la joie, et à peine nos pieds peuvent-ils se retenir de danser. Otez la mesure, détruisez la proportion des temps, les mêmes airs resteront sans charmes et sans force, et deviendront incapables de nous émouvoir, et même de nous plaire : mais le temps a sa force en lui-même, qui ne dépend que de lui, et qui peut subsister sans la diversité des sons. Le tambour nous en offre un exemple, quoique grossier et très-imparfait, Ve que le son ne s'y peut soutenir. Voyez TAMBOUR.
On considère le temps en musique ou par rapport à la durée ou au mouvement général d'un air, &, selon ce sens, on dit qu'il est vite ou lent, voyez MESURE, MOUVEMENT ; ou bien, selon les parties aliquotes de chaque mesure, qui se marquent par des mouvements de la main ou du pied, et qu'on appelle proprement des temps ; ou enfin selon la valeur ou le temps particulier de chaque note. Voyez VALEUR DES NOTES.
Nous avons suffisamment parlé au mot RHYTME des temps de la musique des Grecs ; il nous reste à expliquer ici les temps de la musique moderne.
Nos anciens musiciens ne reconnaissaient que deux espèces de mesures ; l'une à trois temps, qu'ils appelaient mesure parfaite ; et l'autre à deux, qu'ils traitaient de mesure imparfaite, et ils appelaient temps, modes ou prolations les signes qu'ils ajoutaient à la clé pour déterminer l'une ou l'autre de ces mesures. Ces signes ne servaient pas à cet unique usage comme aujourd'hui, mais ils fixaient aussi la valeur des notes les unes par rapport aux autres, comme on a déjà pu voir aux mots MODE et PROLATION, sur la maxime, la longue et la semi-breve. A l'égard de la breve, la manière de la diviser était ce qu'ils appelaient plus précisément temps. Quand le temps était parfait, la breve ou carrée valait trois rondes ou semi-breves, et ils indiquaient cela par un cercle entier, barré ou non-barré, et quelquefois encore par ce chiffre. 3/1.
Quand le temps était imparfait, la breve ne valait que deux rondes, et cela se marquait par un demi-cercle ou C. Quelquefois ils tournaient le C à rebours ainsi , et cela marquait une diminution de moitié sur la valeur de chaque note ; nous indiquons cela aujourd'hui par le C barré, ; et c'est ce que les Italiens appellent tempo alla breve. Quelques-uns ont aussi appelé temps majeur cette mesure du C barré où les notes ne durent que la moitié de leur valeur ordinaire, et temps mineur celle du C plein ou de la mesure ordinaire à quatre temps.
Nous avons bien retenu la mesure triple des anciens ; mais par la plus étrange bizarrerie, de leurs deux manières de diviser les notes, nous n'avons retenu que la soudouble ; de sorte que toutes les fois qu'il est question de diviser une mesure ou un temps en trois parties égales, nous n'avons aucun signe pour cela, et l'on ne sait guère comment s'y prendre ; il faut recourir à des chiffres et à d'autres misérables expédiens qui montrent bien l'insuffisance des signes. Mais je parlerai de cela plus au-long au mot TRIPLE.
Nous avons ajouté aux anciennes musiques une modification de temps qui est la mesure à quatre ; mais comme elle se peut toujours résoudre en deux mesures à deux temps, on peut dire que nous n'avons que deux temps et trois temps pour parties aliquotes de toutes nos différentes mesures.
Il y a autant de différentes valeurs de temps qu'il y a de sortes de mesures et de différentes modifications de mouvement. Mais quand une fois l'espèce de la mesure et du mouvement sont déterminés, toutes les mesures doivent être parfaitement égales, et par conséquent les temps doivent aussi être très-égaux entr'eux : or pour s'assurer de cette égalité, on marque chaque temps par un mouvement de la main ou du pied ; et sur ces mouvements, on règle exactement les différentes valeurs des notes selon le caractère de la mesure. C'est une chose très-merveilleuse de voir avec quelle précision on vient à bout, à l'aide d'un peu d'habitude, de battre la mesure, de marquer et de suivre les temps avec une si parfaite égalité, qu'il n'y a point de pendule qui surpasse en justesse la main ou le pied d'un bon musicien. Voyez BATTRE LA MESURE.
Des divers temps d'une mesure, il y en a de plus sensibles et de plus marqués que les autres, quoique de valeur parfaitement égales ; le temps qui marque davantage s'appelle temps fort, et temps faible celui qui marque moins. M. Rameau appelle cela, après quelques anciens musiciens, temps bon et temps mauvais. Les temps forts sont le premier dans la mesure à deux temps, le premier et le troisième dans la mesure à trois et dans la mesure à quatre ; à l'égard du second temps, il est toujours faible dans toutes les mesures, et il en est de même du quatrième dans la mesure à quatre temps.
Si l'on subdivise chaque temps en deux autres parties égales qu'on peut encore appeler temps, on aura derechef temps fort pour la première moitié, et temps faible pour la seconde, et il n'y a point de parties d'un temps sur laquelle on ne puisse imaginer la même division. Toute note qui commence sur le temps faible et finit sur le temps fort, est une note à contre- temps, et parce qu'elle choque et heurte en quelque manière la mesure, on l'appelle syncope. Voyez SYNCOPE.
Ces observations sont nécessaires pour apprendre à bien préparer les dissonnances : car toute dissonnance bien préparée doit l'être sur le temps faible et frappée sur le temps fort, excepté cependant dans des suites de cadences évitées, où cette règle, quoiqu'encore indispensable pour la première dissonnance, n'est pas également praticable pour toutes les autres. Voyez DISSONNANCE, PREPARER, SYNCOPE. (S)
TEMS, en Peinture, c'est un très-petit contour. On dit, entre ces deux contours il y a un temps. On dit encore, ce contour a deux temps ; c'est-à-dire, une si petite sinuosité, qu'elle ne forme pas deux contours distincts.
TEMS, on appelle ainsi en termes de Manège, chaque mouvement accompli de quelque allure que ce soit ; quelquefois ce terme se prend à la lettre, et quelquefois il a une signification plus étendue. Par exemple, quand on dit au manège, faire un temps de galop, c'est faire une galopade qui ne dure pas longtemps ; mais lorsqu'on Ve au pas, au trot ou au galop, et qu'on arrête un temps, c'est arrêter presque tout court, et remarcher sur le champ. Arrêter un demi-temps, n'est que suspendre un instant la vitesse et l'allure du cheval pour la reprendre sans arrêter. Temps écoutés, c'est la même chose que soutenus, voyez SOUTENUS. Un bon homme de cheval doit être attentif à tous les temps du cheval, et les seconder à point nommé ; il ne doit laisser perdre aucun temps, autrement il laisse interrompre, faute d'aide, la cadence du cheval.
TEMS, estocade de, (Escrime) c'est frapper l'ennemi d'une botte dans l'instant qu'il s'occupe de quelque mouvement.
TEMS, terme de Vénerie ; on dit revoir de bon temps, lorsque la voie est fraiche et de la nuit.