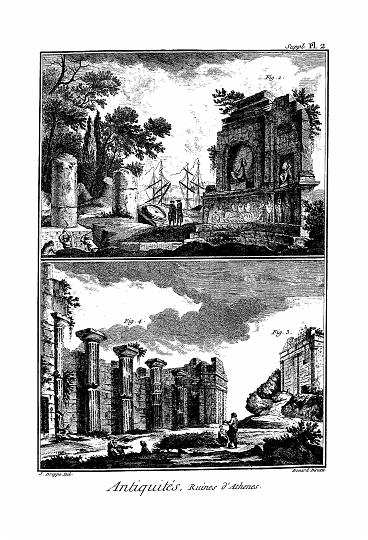S. f. (Mythologie) fausse divinité du sexe féminin. Voyez DIEU.
Les anciens avaient presque autant de déesses que de dieux : telles était Junon, Diane, Proserpine, Vénus, Thétis, la Victoire, la Fortune, etc. Voyez FORTUNE.
Ils ne s'étaient pas contentés de se faire des dieux femmes, ou d'admettre les deux sexes parmi les dieux ; ils en avaient aussi d'hermaphrodites : ainsi Minerve, selon quelques savants, était homme et femme, appelée Lunus et Luna. Mithra chez les Perses était dieu et déesse ; et le sexe de Vénus et de Vulcain, était aussi douteux. De-là vient que dans leurs invocations ils disaient : si vous êtes dieu, si vous êtes déesse, comme Aulugelle nous l'apprend. Voyez HERMAPHRODITE.
C'était le privilège des déesses d'être représentées toutes nues sur les médailles : l'imagination demeurait dans le respect en les voyant. Dictionnaire de Trévoux et Chambers.
Les déesses ne dédaignaient pas de s'unir quelquefois avec des mortels. Thétis épousa Pelée, et Vénus aima Anchise, etc. Mais c'était une croyance commune, que les hommes honorés des faveurs des déesses ne vivaient pas longtemps ; et si Anchise parait avoir été excepté de ce malheur, il en fut, dit-on, redevable à sa discrétion. (G)
DEESSES-MERES, (Litt. Antiq. Insc. Myth. Histoire) divinités communes à plusieurs peuples, mais particulièrement honorées dans les Gaules et dans la Germanie, et présidant principalement à la campagne et aux fruits de la terre. C'est le sentiment de M. l'abbé Banier, qu'il a étayé de tant de preuves dans le V I. volume des mémoires de l'académie des Belles-Lettres, qu'on ne peut s'y refuser.
Les surnoms que les déesses-mères portent dans les inscriptions, semblent être ceux des lieux où elles étaient honorées : ainsi les inscriptions sur lesquelles on lit matribus Gallaicis, marquaient les déesses-mères de la Galice ; ainsi les Rumanées sont celles qui étaient adorées à Rhumaneim dans le pays de Juliers, etc.
Leur culte n'était pas totalement borné aux choses champêtres, puisqu'on les invoquait non-seulement pour la santé et la prospérité des empereurs et de leur famille, mais aussi pour les particuliers.
Les déesses-mères étaient souvent confondues, et avaient un même culte que les Sulèves, les Commodeves, les Junons, les Matrones, les Sylvatiques, et semblables divinités champêtres. On le justifie par un grand nombre d'inscriptions qu'ont recueillies Spon, Gruter, Reynesius, et autres antiquaires.
Il n'est pas vraisemblable que les déesses-mères tirent leur origine des Gaules ou des Germains, comme plusieurs savants le prétendent, encore moins que leur culte ne remonte qu'au temps de Septime Sévère. On a plusieurs inscriptions qui prouvent que ces déesses étaient connues en Espagne et en Angleterre ; et il est probable que les uns et les autres avaient reçu le culte de ces déesses, soit des Romains, soit des autres peuples d'Italie, qui de leur côté le devaient aux Grecs, tandis que ceux-ci le tenaient des Egyptiens et des Phéniciens par les colonies qui étaient venues s'établir dans leurs pays. Voilà la première origine des déesses-mères, et de leur culte : en effet il parait par un passage de Plutarque, que les Crétais honoraient d'un culte particulier, même dès les premiers temps, les déesses-mères, et personne n'ignore que les Crétais étaient une colonie phénicienne.
C'est donc de la Phénicie que la connaissance des déesses-mères s'est répandue dans le reste du monde. Si l'on suit les routes des fables et de l'idolatrie, on les trouvera partir des peuples d'Orient qui, en se dispersant, altérèrent la pureté du culte qu'ils avaient reçu de leurs pères. D'abord ils rendirent leurs hommages à ce qui parut le plus parfait et le plus utile, au Soleil, et aux astres ; de leur adoration, on vint à celle des éléments, et finalement de toute la nature. On crut l'univers trop grand pour être gouverné par une seule divinité, on en partagea les fonctions entre plusieurs. Il y en eut qui présidèrent au ciel, d'autres aux enfers, d'autres à la terre ; la mer, les fleuves, la terre, les montagnes, les bois, les campagnes, tout eut ses divinités. On n'en demeura pas là ; chaque homme, chaque femme, eurent leurs propres divinités, dont le nombre, dit Pline, excédait finalement celui de la race humaine. Les divinités des hommes s'appelaient les Génies, celles des femmes les Junons.
Ainsi se répandit la tradition parmi presque tous les peuples de la terre, que le monde était rempli de génies ; opinion qui, après avoir tant de fois changé de forme, a donné lieu à l'introduction des fées, aux antres des fées, et s'est enfin métamorphosée en cette cabale mystérieuse, qui a mis à la place des dieux, que les anciens nommaient Dusii et Pilosi, les Gnomes, les Sylphes, etc. Voyez GENIE, etc.
Il n'est guère douteux que c'est du nombre de ces divinités, en particulier des Junons et des Génies, que sortaient les déesses-mères, puisqu'elles n'étaient que les génies des lieux où elles étaient honorées, soit dans les villes, soit dans les campagnes, comme le prouvent toutes les inscriptions qui nous en restent.
On leur rendait sans-doute le même culte qu'aux divinités champêtres ; les fleurs et les fruits étaient la matière des sacrifices qu'on offrait en leur honneur ; le miel et le lait entraient aussi dans les offrandes qu'on leur faisait.
Les Gaulois en particulier qui avaient un grand respect pour les femmes, érigeaient aux déesses-mères des chapelles nommées cancelli, et y portaient leurs offrandes avec de petites bougies ; ensuite après avoir prononcé quelques paroles mystérieuses sur du pain ou sur quelques herbes, ils les cachaient dans un chemin creux ou dans un arbre, croyant par-là garantir leurs troupeaux de la contagion et de la mort même. Ils joignaient à cette pratique plusieurs autres superstitions, dont on peut voir le détail dans les capitulaires de nos rais, et dans les anciens rituels qui les défendent. Serait-ce de-là que vient la superstition singulière pour certaines images dans les villes et dans les campagnes ? Serait-ce encore de-là que vient parmi les villageais, la persuasion des enchantements et du sort sur leurs troupeaux, qui subsiste toujours dans plusieurs pays ? C'est un spectacle bien frappant pour un homme qui pense, que celui de la chaîne perpétuelle et non interrompue des mêmes préjugés, des mêmes craintes, et des mêmes pratiques superstitieuses. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.