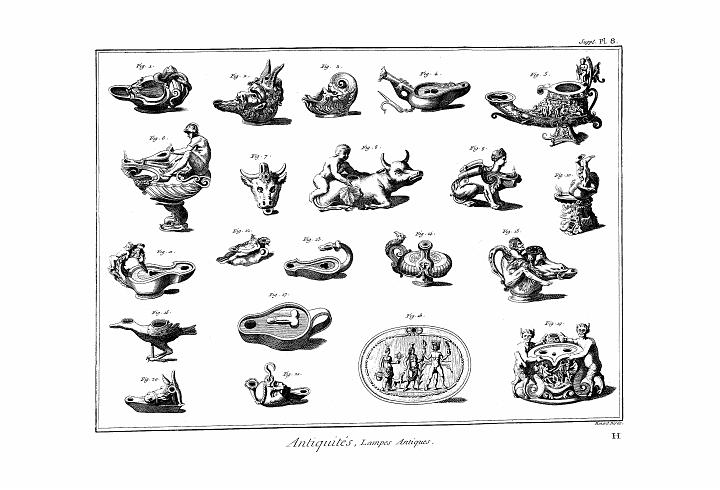S. f. (Marine) la quille d'un vaisseau. C'est une longue pièce de charpente ou l'assemblage de plusieurs pièces mises bout-à-bout et bien jointes ensemble qui fait la plus basse partie du vaisseau depuis la poupe jusqu'à la proue, pour soutenir tout le corps du bâtiment, et déterminer la longueur du fond de cale. Voyez Pl. I. figures 1 et 2, la quille marquée a, et Pl. I. figures 1 et 2, la quille cotée i.
Les quilles de petits bâtiments n'étant pas longues, sont d'une seule pièce ; il y en a de deux pièces ; les plus longues sont de trois pièces, il y en a même de quatre pièces.
Si on compare la carcasse d'un vaisseau à un squelete, les membres en sont les côtes, et la quille l'épine du dos ; elle est la première pièce qu'on mette sur le chantier de construction ; et pour s'en former une idée, il faut se représenter une ou plusieurs grosses poutres qu'on place bout-à-bout, et qu'on assemble les unes aux autres par des empatures ou entailles, qui étant faites dans les deux pièces, forment un assemblage à mibais, qu'on retient avec de grosses chevilles de fer frappées par-dessous la quille, et clavetées ou rivées en-dessus sur des viroles ; les empatures ont ordinairement de longueur cinq fois l'épaisseur de la quille.
La plupart des constructeurs font que la quille se courbe dans son milieu, et relève par les extrémités, ou, en terme d'art, ils lui donnent de la tonture.
Comme la virure ou la fîle de bordage la plus basse doit être calfatée avec la quille, on fait sur elle une feuillure ou rablure pour recevoir ces bordages.
Voici les règles de dimension qui ont été adoptées par différents constructeurs.
La hauteur ou la face verticale de la quille est d'un huitième de sa longueur réduite en pouces, ou, ce qui revient au même, la hauteur perpendiculaire de la quille au-dessus des tins ou des chantiers qui la portent, est d'une ligne six points par pieds de sa longueur, laquelle a cette même hauteur dans toute sa longueur.
La largeur horizontale de la quille au milieu est de dix lignes huit points par pouces de sa hauteur ; elle diminue d'un cinquième vers ses extrémités.
On donne à la quille plus de hauteur que de largeur, parce que les empatures sont prises dans ce sens, et qu'à quantité égale de matière elle en est plus forte.
La profondeur de la rablure de la quille est réglée par l'épaisseur du bordage le plus bas, qu'on nomme gabord.
Les vaisseaux se terminent en avant par une pièce de bois, qui a une forme circulaire : c'est ce qu'on appelle l'élancement de l'étrave ; et en arrière par une pièce de bois qui tombe obliquement sur la quille, ayant de la saillie en-dehors ; c'est cette saillie qu'on appelle la quête de l'étambord.
Pour avoir la longueur de la quille, il faut additionner la somme de la quête de l'étambord et de l'élancement de l'étrave, puis soustraire le produit de ces deux sommes de la longueur de la quille. Il faut donc commencer par déterminer la quête et l'élancement.
Pour trouver l'élancement de l'étrave, plusieurs constructeurs prenaient anciennement un huitième de la longueur totale du vaisseau, et ils donnaient pour la quête de l'étambord, le quart de l'élancement de l'étrave ; ainsi un vaisseau de 168 pieds de longueur aurait eu 21 pieds d'élancement, et 5 pieds 3 pouces de quête.
D'autres constructeurs donnent pour l'élancement de l'étrave la douzième partie de la longueur totale du vaisseau, pour les vaisseaux de 60 canons et au-dessus : pour ceux depuis 40 jusqu'à 60, la quatorzième partie de la longueur, et la quinzième pour les petits. Il y a aussi des constructeurs qui ne prennent que la quinzième partie de la longueur totale, même pour les gros vaisseaux ; et pour la quête de l'étambord, la sixième partie de l'élancement de l'étrave. (on entend par gros vaisseaux ceux de 40 canons et au-dessus.) Ainsi en prenant la quinzième partie, un vaisseau qui aurait 168 pieds de longueur, aurait 11 pieds un quart d'élancement, et 1 pied 10 pouces 1/2 de quête. Pour les frégates, ils prennent la treizième partie de la longueur du vaisseau pour l'élancement de l'étrave, et la sixième partie de cet élancement pour la quête de l'étambord.
Pour les petites frégates de 22 canons et au-dessous, ils prennent la quatorzième partie de la longueur totale du vaisseau pour l'élancement de l'étrave, et la sixième partie de l'élancement pour la quête de l'étambord ; enfin quelques constructeurs, pour avoir la quête et l'élancement, prennent 1/10 ou 1/12 de la longueur totale, divisent cette quantité en cinq parties égales ; ils en destinent quatre pour l'élancement, et une pour la quête.
A l'égard de l'épaisseur de la quille, il y a une règle adoptée par plusieurs constructeurs, qui est de prendre autant de pouces que le 1/3 et le 1/8 du maître ban ont de pieds.
Exemple. Un vaisseau de 70 canons a 42 pieds de maître-ban, le tiers de 42 est 14, le huitième de 41 est 5 pieds 3 pouces ; ajoutant ces deux sommes ensemble, on a 19 pieds 3 pouces : donc l'épaisseur à un pouce par pied est de 1 pied 7 pouces 3 lignes.
QUILLE, s. f. (Charpentier) grosse pièce de bois formant le derrière d'un bateau foncet. C'est celle qui supporte le gouvernail. On nomme aussi en quelques endroits, quille de pont, une longue pièce de bois qui soutient le pont. (D.J.)
QUILLE, s. f. (terme de Gantier) c'est un instrument dont se servent les Gantiers ; il est de bois dur et poli d'environ dix-huit pouces de long, ressemblant à une véritable quille, si ce n'est qu'il est beaucoup plus menu par le haut ; il sert à allonger les doigts des gants pour leur donner une meilleure forme.
QUILLES, en terme de marchand de modes, sont deux bandes de parements que l'on met à une robe le long de la couture du côté jusqu'à la fente. Voyez PAREMENS.
QUILLE, (Rubanier) c'est ordinairement le tiers d'une petite buche de bois rondin, que l'on attache au moyen d'une ficelle à l'extrémité des bâtons de retour, pour leur servir de contrepoids, et les faire remonter lorsque l'ouvrier tire un nouveau retour, après qu'il a fait travailler celui-ci : une pierre ferait le même effet que cette quille ; mais ceci est bien plus commode, lorsqu'il y a beaucoup de retours. Ces rondins de bois qui se trouvent tous en un tas, glissent plus facilement les uns le long des autres.
QUILLES, au jeu de ce nom, sont des bâtons tournés, de grandeur et de grosseur égales, qu'on abat jusqu'à un certain nombre pour gagner la partie. Il en faut neuf pour un jeu.
QUILLE le jeu de, est un jeu d'exercice et assez amusant. Il consiste à abattre un certain nombre de quilles fixé par les joueurs, avec une boule de grosseur proportionnée à celle de ces quilles. On peut y jouer plusieurs ensemble, à nombre pair ou impair. Voyez QUILLES.
On tire d'abord à qui aura la boule. Celui à qui elle est échue, joue le premier, et celui qui est à jouer le dernier, met le but, à moins que cet avantage n'accompagne la boule par convention faite. Il faut, pour gagner la partie, faire précisément le nombre de quilles qu'on a fixé ; car si on le passe, on creve, et on perd la partie, quand celui contre qui l'on joue, n'en aurait pas même abattu une. Voyez TIRER LA BOULE, AVOIR LA BOULE, METTRE LE BUT et CREVER, à leur article. Celui qui fait chou-blanc, perd son coup, c'est-à-dire, ne compte rien, puisqu'il n'a rien abattu. Toute quille abattue par autre chose que par la boule, n'est point comptée. Un joueur qui jetterait la boule, avant que toutes les quilles ne fussent redressées, recommencerait à jouer, quoique jouant pour peu de quilles, il ait fait le nombre qu'il lui fallait, d'un côté où toutes les quilles étaient relevées. Celui qui ne joue pas du but, est dans le même cas. Quand on est plusieurs, celui qui joue devant son tour, perd son coup ; et celui qui laisse passer son rang de même. Toute quille qui tombe quand la boule est arrêtée, ne vaut point, non plus que celle qui étant ébranlée et soutenue par une autre, ne tomberait que quand on aurait ôté celle-ci. Celles que la boule une fois sortie du jeu fait tomber en y rentrant, ne sont point comptées non plus.
Ce jeu ne se joue guère à Paris que parmi les domestiques dans les guinguettes et à quelques promenades ; il est plus commun à la campagne, où de fort honnêtes gens ne dédaignent pas d'y jouer.
QUILLE DU MILIEU, est une quille ordinairement plus ornée que les huit autres, qu'on plante au milieu d'elles, et qui en vaut neuf à celui qui a l'adresse de l'abattre seule, à moins qu'on ne soit convenu du contraire.
QUILLES AU BATON jeu de, ce jeu se joue avec sept quilles plus hautes et plus grosses que les quilles ordinaires que l'on plante l'une près de l'autre dans du sable, et sur la même ligne : on abat ces quilles avec des bâtons. Pour gagner, il faut toujours en abattre un nombre pair, l'impair perdant à chaque coup. Quand le tireur a renversé trois fois des quilles en nombre impair, il ne peut plus tirer ; il faut alors céder le bâton à un autre. Il en est de même quand il a tiré trois coups sans rien abattre. On peut jouer un grand nombre à ce jeu ; c'est le tireur qui le borne, quand il a partagé entre plusieurs parieurs l'argent qu'il veut hazarder. Ces parieurs qui jouent pour le nombre impair, mettent la même somme que lui au jeu, et tous perdent, s'il amène pair. On peut gagner ou perdre beaucoup à ce jeu en peu de temps. Il ne se joue guère que dans les foires de campagne, du moins je ne l'ai Ve jouer que là. Il n'est, à proprement parler, qu'un défi, qu'une gageure que fait un homme contre un autre d'abattre un nombre pair de quilles.