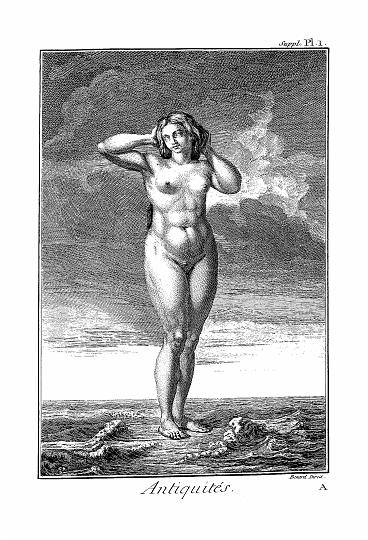(Géographie ancienne) nom de plusieurs villes que nous allons indiquer, en les distinguant par des chiffres.
1°. Thebae, ville de la haute Egypte, et à la droite du Nil pour la plus grande partie. C'est une très-ancienne ville qui donna son nom à la Thébaïde, et qui le pouvait disputer aux plus belles villes de l'univers. Ses cent portes chantées par Homère, Iliad. j. Ve 381. sont connues de tout le monde, et lui valurent le surnom d'Hécatonpyle. On l'appela pour sa magnificence Diospolis, la ville du Soleil ; cependant dans l'itinéraire d'Antonin, elle est simplement nommée Thebae. Les Grecs et les Romains ont célebré sa grandeur, quoiqu'ils n'en eussent Ve en quelque manière que les ruines ; mais Pomponius Méla, l. I. c. IXe a exagéré sa population plus qu'aucun autre auteur, en nous disant avec emphase qu'elle pouvait faire sortir dans le besoin dix mille combattants par chacune de ses portes.
Le nom de cette ville de Thebes ne se trouve pas dans le texte de la vulgate ; on ignore comment les anciens Hébreux l'appelaient ; car il est vraisemblable que le No-Ammon dont il est souvent parlé dans les prophêtes Ezéchiel, xxx. 14. Nahum, IIIe 8. Jérem. xlvj. 25. est plutôt la ville de Diospolis dans la basse Egypte, que la Diospolis magna, ou la Thebae de la haute Egypte. Quoi qu'il en sait, cette superbe ville a eu le même sort que Memphis et qu'Alexandrie, on ne la connait plus que par ses ruines.
2°. Thebae, ville de Grèce, dans la Béotie, sur le bord du fleuve Ismenus et dans les terres ; ceux du pays la nomment aujourd'hui Thiva ou Thive, et non pas Stiva ni Stives, comme écrit le P. Briet. Voyez THIVA.
Thebae, ou comme nous disons en français Thebes, fut ainsi nommée, selon Pausanias, de Thébé, fille de Prométhée. Cette ville capitale de la Béotie, fameuse par sa grandeur et par son ancienneté, l'était encore par les disgraces de ses héros. La fin tragique de Cadmus son fondateur, et d'Oedipe l'un de ses rais, qui tous deux transmirent leur mauvaise fortune à leurs descendants ; la naissance de Bacchus et d'Hercule ; un siege soutenu avant celui de Troie, et divers autres événements historiques ou fabuleux, la mettaient au nombre des villes les plus renommées ; Amphion l'entoura de murailles, et persuada par son éloquence aux peuples de la campagne de venir habiter sa ville. C'est ce qui fit dire aux poètes qu'Amphion avait bâti les murailles de Thebes au son de sa lyre, qui obligeait les pierres à se placer d'elles-mêmes par-tout où il le fallait. Bientôt la ville de Cadmus ne devint que la citadelle de Thebes qui s'agrandit, et forma la république des Thébains. Voyez THEBAINS.
Cette république fut élevée pendant un moment au plus haut point de grandeur par le seul Epaminondas ; mais ce héros ayant été tué à la bataille de Mantinée, Philippe plus heureux, se rendit maître de toute la Béotie, et Thebes au plus haut point de grandeur fut soumise au roi de Macédoine. Alexandre en partant pour la Thrace, y mit une garnison macédonienne, que les habitants égorgèrent sur les faux-bruits de la mort de ce prince. A son retour il assiégea Thebes, la prit, et par un terrible exemple de sévérité, il la détruisit de fond en comble. Six mille de ses habitants furent massacrés, et le reste fut enchainé et vendu. On connait la description touchante et pathétique qu'Eschine a donnée du saccagement de cette ville dans sa harangue contre Ctésiphon. Strabon assure que de son temps, Thebes n'était plus qu'un village.
Ovide par une expression poétique dit qu'il n'en restait que le nom ; cependant Pausanias, qui vivait après eux, fait encore mention de plusieurs statues, de temples, et de monuments qui y restaient, il serait maintenant impossible d'en pouvoir justifier quelque chose.
Mais il reste à la gloire de Thebes, la naissance du plus grand de tous les poètes lyriques, du sublime Pindare ; qui lui-même appelle Thebes sa mère. Ses parents peu distingués par leur fortune, tiraient cependant leur origine des Aegides, tribu considérable à Sparte, et d'où sortait la famille d'Arcésilas roi des Cyrénéens, à laquelle Pindare prétendait être allié. Quoique les auteurs varient sur le temps de sa naissance, l'opinion de ceux qui la placent dans la 65 olympiade, l'an 520 avant J. C. parait la mieux fondée. " Ce poète, dit Pausanias, étant encore dans sa première jeunesse, un jour d'été qu'il allait à Thespies, il se trouva si fatigué de la chaleur, qu'il se coucha à terre près du grand chemin, et s'endormit. Durant son sommeil, des abeilles vinrent se reposer sur ses lèvres, et y laissèrent un rayon de miel ; ce qui fut comme un augure de ce que l'on devait un jour entendre de lui ".
Il prit des leçons de Myrtis, femme que distinguait alors son talent dans le poème lyrique. Il devint ensuite disciple de Simonide de Lasus, ou d'Agathocle, qui excellait dans ce même genre de poésie ; mais il surpassa bientôt tous ses maîtres, et il brillait déjà au même temps que le poète Eschyle se signalait chez les Athéniens dans le poème dramatique.
La haute réputation de Pindare pour le lyrique, le fit chérir de plusieurs princes ses contemporains, et surtout des athletes du premier ordre, qui se faisaient grand honneur de l'avoir pour panégyriste, dans leurs victoires agonistiques ; Alexandre fils d'Amyntas, roi de Macédoine, renommé par ses richesses, était doué d'un goût naturel pour tous les beaux arts, et principalement pour la poésie et pour la musique. Il prenait à tâche d'attirer chez lui par ses bienfaits, ceux qui brillaient en l'un et l'autre genre, et il fut un des admirateurs de Pindare, qu'il honora de ses libéralités. Ce poète n'eut pas moins de crédit à la cour de Gélon et d'Hiéron, tyrants de Syracuse ; et de concert avec Simonide, il contribua beaucoup à cultiver et orner l'esprit de ce dernier prince, à qui son application continuelle au métier de la guerre, avait fait négliger totalement l'étude des belles-lettres ; ce qui l'avait rendu rustique, et d'un commerce peu gracieux.
Clément Alexandrin donne Pindare pour l'inventeur de ces danses, qui dans les cérémonies religieuses, accompagnaient les chœurs de musique, et qu'on appelait hyporchemes. Il est du-moins certain, que non-seulement il chanta les dieux par des cantiques admirables, mais encore qu'il leur éleva des monuments. Il fit ériger à Thebes, proche le temple de Diane, deux statues, l'une à Apollon, l'autre à Mercure. Il fit construire pour la mère des dieux et pour le dieu Pan, au-delà du fleuve Dircé, une chapelle où l'on voyait la statue de la déesse, faite de la main d'Aristomède et de celle de Socrate, habiles sculpteurs thébains. La maison de Pindare était tout auprès, et l'on en voyait encore les ruines du temps de Pausanias.
Ces marques de piété ne lui furent point infructueuses. Les dieux ou leurs ministres eurent soin de l'en récompenser. Le bruit se répandit que le dieu Pan aimait si fort les cantiques de Pindare, qu'il les chantait sur les montagnes voisines ; mais ce qui mit le comble à sa gloire, dit Pausanias, ce fut cette fameuse déclaration de la Pythie, qui enjoignait aux habitants de Delphes de donner à Pindare la moitié de toutes les prémices qu'on offrait à Apollon : en conséquence, lorsque le poète assistait aux sacrifices, le prêtre lui criait à haute voix de venir prendre sa part au banquet du Dieu. Voilà quelle fut la reconnaissance des Péans que sa muse lui avait dictés à la louange d'Apollon, et qu'il venait chanter dans le temple de Delphes, assis sur une chaise de fer, qu'on y montrait encore du temps de Pausanias, comme un reste précieux d'antiquité.
Pindare était aimé de ses citoyens et des étrangers, quoiqu'il ait découvert en plusieurs occasions un caractère intéressé, en insinuant à ses héros, que c'est au poids de l'or qu'on devait payer ses cantiques. Il n'était pas moins avide de louanges, et semblable à ses confrères, il ne se les épargnait pas lui-même dans les occasions ; en cela, il fut l'écho de toute la Grèce.
La grossiéreté de ses compatriotes était honteuse. Nous lisons dans Plutarque, que pour adoucir les mœurs des jeunes gens, ils permirent par les lois un amour qui devrait être proscrit par toutes les nations du monde. Pindare épris de cet amour infame pour un jeune homme de ses disciples nommé Théoxène, fit pour lui des vers bien différents de ceux que nous lisons aujourd'hui dans ses odes. Athénée nous a conservé des échantillons d'autres poésies qu'il fit pour des maîtresses ; et il faut convenir que ces échantillons nous font regretter la perte de ce que ce poète avait composé en ce genre, dans lequel on pourrait peut-être le mettre en parallèle avec Anacréon et Sapho.
Il eut des jaloux dans le nombre de ses confrères, outre le chagrin de voir ses dithyrambes tournés en ridicule par les poètes comiques de son temps, il reçut aussi une autre espèce de mortification de ses compatriotes.
Les Thébains alors ennemis déclarés des Athéniens, le condamnèrent à une amende de mille drachmes, pour avoir appelé ces derniers dans une pièce de poésie, le plus ferme appui de la Grèce ; et en conséquence il lui fallut essuyer mille insultes d'un peuple irrité. Il est vrai qu'il en fut dédommagé par les Athéniens, qui, pour lui marquer combien ils étaient reconnaissants de ses éloges, non-seulement lui rendirent le double de la somme qu'il avait payée, mais lui firent ériger une statue dans Athènes, auprès du temple de Mars ; honneur que ses compatriotes n'ont pas daigné lui accorder ; et cette statue le représentait vêtu, assis, la lyre à la main, la tête ceinte d'un diadême, et portant sur ses genoux un petit livre déroulé. On la voyait encore du temps de Pausanias.
Pindare mourut dans le gymnase ou dans le théâtre de Thebes. Sa mort fut des plus subites et des plus douces, selon ses souhaits. Durant le spectacle, il s'était appuyé la tête sur les genoux de Théoxène son éleve, comme pour s'endormir ; et l'on ne s'aperçut qu'il était mort, que par les efforts inutiles que l'on fit pour l'éveiller, avant que de fermer les portes.
L'année de cette mort est entièrement inconnue, car les uns le font vivre 55 ans, d'autres 66, et quelques-uns étendent sa carrière jusqu'à sa 80 année. Ce qu'il y a de sur, c'est qu'on lui éleva un tombeau dans l'Hippodrome de Thebes, et ce monument s'y voyait encore du temps de Pausanias. On trouve dans l'anthologie grecque six épigrammes à la louange de Pindare, dont il y en a deux qui peuvent passer pour des épitaphes, et les quatre autres ont été faites pour servir d'inscriptions à différentes statues de ce poète.
Sa renommée se soutint après sa mort, jusqu'au point de mériter à sa postérité les distinctions les plus mémorables. Lorsqu'Alexandre le grand saccagea la ville de Thebes, il ordonna expressément qu'on épargnât la maison du poète, et qu'on ne fit aucun tort à sa famille. Les Lacédémoniens, longtemps auparavant, ayant ravagé la Béotie, et mis le feu à cette capitale, en avaient usé de même. La considération pour ce poète fut de si longue durée, que ses descendants, du temps de Plutarque, dans les fêtes théoxéniennes, jouissaient encore du privilège de recevoir la meilleure portion de la victime sacrifiée.
Pindare avait composé un grand nombre d'ouvrages en divers genres de poésie. Le plus considérable de tous, celui auquel il est principalement redevable de sa grande réputation, et le seul qui nous reste aujourd'hui, est le recueil de ses odes destinées à chanter les louanges des athletes vainqueurs dans les quatre grands jeux de la Grèce, les olympiques, les pythiques, les néméens et les isthmiques. Elles sont toutes écrites dans le dialecte dorique et l'éolique.
Celles de ses poésies que nous n'avons plus, et dont il ne nous reste que des fragments, étaient 1°. des poésies bacchiques ; 2°. d'autres qui se chantaient dans la fête des portes-lauriers () ; 3°. plusieurs livres de Dithyrambes ; 4°. dix-sept tragédies ; 5°. des éloges () ; 6°. des épigrammes en vers héroïques, 7°. des lamentations () ; 8°. des Parthénies ; 9°. des Péans ou cantiques à la louange des hommes et des dieux, surtout d'Apollon ; 10°. des prosodies ; 11°. des chants scoliens ; 12°. des hymnes ; 13°. des hyporchemes ; 14°. des poésies faites pour la cérémonie de monter sur le trône (), etc.
Parmi ceux qui ont écrit la vie de Pindare, on peut compter Suidas, Thomas Magister, l'auteur anonyme d'un petit poème grec en vers héroïques sur ce même sujet : le Giraldy, Ger. J. Vossius, Jean Benait, dans son édition de Pindare à Saumur ; Erasme Schmidt dans la sienne de Wittemberg ; les deux éditeurs du beau Pindare d'Oxford, in-folio. Tannegui le Fèvre, dans son abrégé des vies des poètes grecs ; François Blondel, dans sa comparaison de Pindare et d'Horace, M. Fabricius dans sa bibliothèque grecque, et M. Burette dans les mémoires de littérature, tome XV. je lui dois tous ces détails.
Platon, Eschine, Dénys d'Halicarnasse, Longin, Pausanias, Plutarque, Athénée, Pline, Quintilien, ont fait à l'envi l'éloge de Pindare : mais Horace en parle avec un enthousiasme d'admiration dans cette belle ode qui commence :
Pindarum quisquis studet aemulari....
Il dit ailleurs que quand Pindare veut bien composer une strophe pour un vainqueur aux jeux olympiques, il lui fait un présent plus considérable que s'il lui élevait cent statues :
Centum potiore signis
Munere donat.
Le caractère distinctif de Pindare est qu'il possède à un degré supérieur l'élevation, la force, la précision, l'harmonie, le nombre, le feu, l'enthousiasme, et tout ce qui constitue essentiellement la poésie. S'il a quelquefois des écarts difficiles à justifier, on lui en reproche beaucoup d'autres sans fondement.
Quand il loue le père de son héros, sa famille, sa patrie, les dieux qui y sont particulièrement honorés, il ne fait que développer la formule dont on se servait pour proclamer le vainqueur. L'autre reproche qu'on lui fait d'avoir employé des termes bas en notre langue, attaque également tous les anciens, et est d'autant plus mal fondé, que des termes bannis de notre poésie, peuvent être employés avec élégance dans la poésie grecque et latine ; enfin quant à l'obscurité dont on accuse Pindare, je réponds que l'espèce d'obscurité qui procede du tour de phrase et de la construction des mots, n'est pas un objet de notre compétence. Nous sommes encore moins juges de l'obscurité qui nait de l'ignorance des coutumes et des généalogies. Au reste tout ce qui regarde le caractère de Pindare, que nous avons déjà tracé en parlant des poètes lyriques, a été savamment discuté dans les belles traductions françaises des odes de ce poète, par MM. les abbés Massieu, Fraguier et Sallier.
Cébès philosophe pythagoricien, né à Thebes, était le disciple de Socrate, dont il est parlé dans le Phédon de Platon. Nous avons sous le nom de ce Cébès une table, tableau, ou dialogue moral sur la naissance, la vie, et la mort des hommes. Cet ouvrage supérieur en ce genre à plusieurs traités des anciens, a exercé la critique de Saumaise, de Casaubon, de Wolfius, de Samuel Petit, de Relandus, de Fabricius, et de plusieurs autres savants. Il a été traduit dans toutes les langues ; M. Gronovius en a publié la meilleure édition à Amsterdam, en 1689, in-8 °. sur un manuscrit de la bibliothèque du roi. Cependant ce dialogue moral tel que nous l'avons, ne peut pas être du pythagoricien Cébès ; les raisons solides qu'en apporte M. Sévin, dans les mém. de Littérat. tome III. page 137. sont 1°. qu'on y trouve des choses postérieures à Cébès ; 2°. qu'on y condamne des philosophes inconnus de son temps ; 3°. que l'auteur ne suit pas les idées de la secte pythagoricienne, dont Cébès faisait profession ; 4°. qu'il n'a point écrit dans la dialecte en usage chez les philosophes de cette même secte ; 5°. qu'il n'est pas croyable qu'un ouvrage comme celui-là, eut été enseveli dans l'oubli pendant plus de cinq siècles ; car il est certain que personne ne l'a cité avant Lucien ; et certes il ne parait pas beaucoup plus ancien que cet auteur.
Clitomaque, athlete célèbre par sa pudeur, et par les prix qu'il remporta à tous les jeux de la Grèce, était de Thebes en Béotie. Voyez son éloge dans Pausanias et dans Aelien. Cratès, disciple de Diogène, le mari de la belle Hipparchie, était aussi de Thebes en Béotie. Son article a déjà été fait ailleurs.
Après avoir parlé de Thebes en Egypte, et de Thebes en Béotie, il ne me reste plus qu'à dire un mot des autres villes qui ont porté ce nom.
3°. Thebae, ville de la Macédoine, dans la Phthiotide ; c'est pourquoi elle est appelée Thebae-Phthiotidis, Thebae-Phthiae, Thebae-Phthioticae, ou ThebaeThessaliae par les Géographes et les Historiens ; Strabon met cette ville vers les confins de la Phthiotide, du côté du septentrion. Il est certain qu'elle était sur la côte de la mer ; car ses habitants se plaignent dans Tite-Live, l. XXXIX. c. xxv. de ce que Philippe de Macédoine leur avait ôté leur commerce maritime. Ce prince établit une colonie dans cette ville, dont il changea le nom en celui de Philippopolis.
4°. Thebae-Lucanae, ville d'Italie dans la Lucanie ; elle ne subsistait déjà plus du temps de Pline.
5°. Thebae-Corcicae, nom que Pline, l. IV. c. IIIe donne à la ville de Thebes, capitale de la Béotie. Elle ne porta cette épithète que dans le temps que les habitants de la ville Corceia y eurent été transférés.
6°. Thebae, ville de l'Asie mineure dans la Cilicie, près de Troie ; il parait que cette ville est la même que celle d'Adramyste.
7°. Thebae, ville de l'Asie mineure dans l'Ionie, au voisinage de Milet, selon Etienne le géographe.
8°. Thebae, ville de l'Attique, selon le même géographe ; il parait qu'il y avait aussi un bourg dans l'Attique de ce nom ; mais on en ignore la tribu.
9°. Thebae, ville dans la Cataonie, selon Etienne le géographe, qui met encore une autre Thebae en Syrie.
10°. Thebae, nom d'une colonne milliaire en Italie, dans le pays des Sabins, sur la voie Salarienne, au voisinage de Réate. (D.J.)