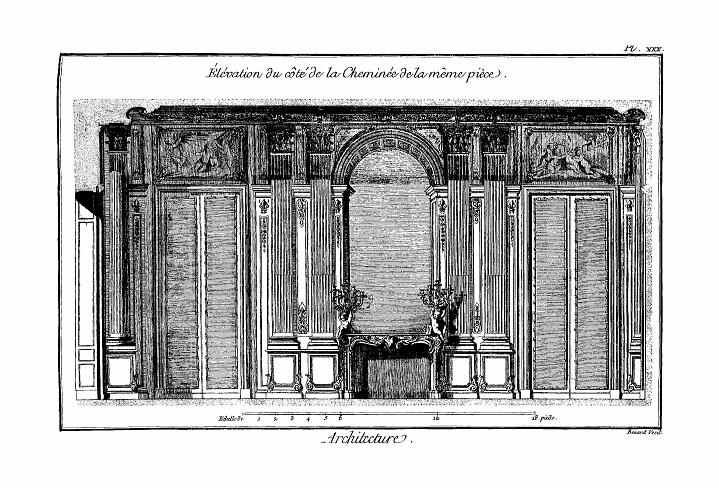S. m. (Arts) merveilleuse invention, qui est d'un si grand usage dans la vie, qui fixe la mémoire des faits, et immortalise les hommes ! Cependant ce papier admirable par son utilité, est le simple produit d'une substance végétale, inutîle d'ailleurs, pourrie par l'art, broyée, réduite en pâte dans de l'eau, ensuite moulée en feuilles carrées de différentes grandeurs, minces, flexibles, collées, séchées, mises à la presse, et servant dans cet état à écrire ses pensées, et à les faire passer à la postérité. Voyez l'article PAPETERIE.
Ce mot papier vient du grec , papyrus, nom de cette plante célèbre d'Egypte, dont les anciens ont fait un si grand usage pour l'écriture ; nous décrirons cette plante au mot PAPYRUS.
Il serait trop long de spécifier ici toutes les différentes matières sur lesquelles les hommes, en divers temps et en divers lieux, ont imaginé d'écrire leurs pensées ; c'est assez de dire que l'écriture une fois trouvée, a été pratiquée sur tout ce qui pouvait la recevoir ; on l'a mise en usage sur les pierres, les briques, les feuilles, les pellicules, l'écorce, le liber des arbres ; on l'a employée sur des plaques de plomb, des tablettes de bois, de cire, et d'ivoire ; enfin on inventa le papier égyptien, le parchemin, le papier de coton, le papier d'écorce, et dans ces derniers siècles le papier qui est fait de vieux linge ou de chiffons. Voyez Maffei, Hist. diplom. lib. II. Bibl. ital. tom. II. Leonis Allati, Antiq. etrusc. Hug. de Scripturae origine, Alexand. ab Alexand. l. II. c. xxx. Barthol Dissert. de libris legendis.
Dans certains siècles barbares, et dans certains lieux, on a écrit sur des peaux de poissons, sur des boyaux d'animaux, sur des écailles de tortues. Voyez Mabillon de re diplom. l. I. c. VIIIe Fabricii Biblioth. antiq. c. xxj. etc.
Mais ce sont principalement les plantes dont on s'est servi pour écrire ; c'est de-là que sont venus les différents termes de biblos, liber, folium, filura, scheda, etc. A Ceylan on écrivait sur des feuilles de tallipot, avant que les Hollandais se fussent rendus maîtres de cette ile. Le manuscrit bramin en langue tulingienne envoyé à Oxford du fort saint Georges, est écrit sur des feuilles d'un palmier de Malabar. Herman parle d'un autre palmier des montagnes de ce pays-là, qui porte des feuilles pliées, et larges de quelques pieds ; les habitants écrivent entre les plis de ces feuilles en enlevant la superficie de la peau. Voyez Knox, Hist. de Ceylan, l. III. Philosoph. Trants. n °. 155. et 246. Hort. ind. Malab. etc.
Aux îles Maldives, les habitants écrivent aussi sur les feuilles d'un arbre appelé macaraquean, qui sont longues de trois pieds, et larges d'un demi-pié. Dans différentes contrées des Indes orientales, les feuilles du musa ou bananier servaient à l'écriture, avant que les nations commerçantes de l'Europe leur eussent enseigné l'usage du papier.
Ray, Histoire plant. tom. II. lib. XXXII. nomme quelques arbres des Indes et d'Amérique, dont les feuilles sont très-propres à l'écriture : de la substance intérieure de ces feuilles on tire une membrane blanchâtre, large et fine comme la pellicule d'un œuf, et sur laquelle on écrit passablement ; cependant le papier fait par art, même le papier grossier, est beaucoup plus commode.
Les Siamais, par exemple, font de l'écorce d'un arbre qu'ils nomment pliokkloi, deux sortes de papiers, l'un noir, et l'autre blanc, tous deux rudes et mal fabriqués, mais qu'ils plient en livre, à-peu-près comme on plie les éventails ; ils écrivent des deux côtés sur ces papiers, avec un poinçon de terre grasse.
Les nations qui sont au delà du Gange, font leur papier de l'écorce de plusieurs arbres. Les autres peuples asiatiques de-deçà le Gange, hormis les noirs qui habitent le plus au midi, le font de vieux haillons d'étoffe de coton, mais faute d'intelligence, de méthode, et d'instruments, leur papier est fort lourd et fort grossier. Je ne tiendrai pas le même langage des papiers de la Chine et du Japon, car ils méritent tous nos regards par leur finesse, leur beauté, et leur variété.
On garde encore dans de vieux cloitres quelques sortes de papiers irréguliers manuscrits, dont les critiques sont fort embarrassés de déterminer la matière ; tel est celui de deux bulles des antipapes, Romanus et Formose, de l'an 891 et 895, qui sont dans les archives de l'église de Girone. Ces bulles ont près de deux aunes de long, sur environ une aune de large ; elles paraissent composées de feuilles ou pellicules collées ensemble transversalement, et l'écriture se lit encore en beaucoup d'endroits. Les savants de France ont hasardé plusieurs conjectures sur la nature de ce papier, dont l'abbé Hiraut de Belmont a fait un traité exprès. Les uns prétendent que c'est du papier fait d'algue marine, d'autres de feuilles d'un jonc appelé la bogua, qui croit dans les marais du Roussillon, d'autres de papyrus, d'autres de coton, et d'autres d'écorce. Voyez les Mém. de Trévoux, Septembre 1711.
Enfin l'Europe en se civilisant, a trouvé l'art ingénieux de faire du papier avec du vieux linge de chanvre ou de lin ; et depuis le temps de cette découverte, on a tellement perfectionné cette fabrique du papier de chiffons, qu'il ne reste plus rien à désirer à cet égard.
De-là vient que depuis peu, quelques physiciens ont tâché d'étendre les vues que l'on pouvait avoir sur le papier, en examinant si avec l'écorce de certains arbres de nos climats, ou même avec du bois, qui aurait acquis un certain degré de pourriture, on ne pourrait pas parvenir à faire du papier, et c'est ce dont quelques tentatives ont confirmé l'espérance. Il était assez naturel de soupçonner cette possibilité, puisque longtemps avant l'invention du papier européen, on en faisait en Egypte avec le papyrus, espèce de souchet du Nil, en orient avec le chiffon de toîle de coton, et avec le liber de plusieurs plantes. Les Japonais fabriquent aussi différentes espèces de papiers, avec l'écorce, et autres parties de leurs arbres ; les Chinois avec leur bambou, avec du chanvre, de la laine blanche, du coton, et de la soie, etc. Busbec nous apprend encore qu'on en fait au Cathay avec des coques de vers à soie. Voyez la lettre iv. de son ambassade en Turquie.
Le chiffon de toîle de chanvre ou de lin, n'est qu'un tissu de fibres ligneuses de l'écorce de ces deux plantes, que les lessives et les blanchissages ont débarrassées de plus-en-plus de la partie spongieuse, que les Botanistes appellent parenchyme. M. Guettard a d'abord examiné si ces fibres ligneuses, n'étant encore que dans l'état où elles portent le nom de filasse, ne donneraient pas du papier ; car par-là on rendrait utiles les chenevottes mêmes, ou le tuyau de la plante dont la filasse a été séparée, et il est plus que probable que les filasses d'aloès, d'ananas, de palmiers, d'orties, et d'une infinité d'autres arbres ou plantes, seraient susceptibles de la même préparation. La filasse de chanvre, simplement battue, a produit une pâte dont on a formé un papier assez fin, et qui pourrait se perfectionner.
Mais il faut avouer que nous ne sommes pas aussi riches en arbres et en plantes, dont on puisse aisément détacher les fibres ligneuses, que le sont les Indiens de l'un et de l'autre hémisphère. Nous avons cependant l'aloès sur certaines côtes : en Espagne on a une espèce de sparte ou de genêt qu'on fait rouir pour en tirer la filasse, et dont on fabrique ces cordages que les Romains appellent sparton ; on en pourrait donc tirer du papier. M. Guettard en a fait avec nos orties et nos guimauves des bords de la mer, et il ne désespère pas qu'on n'en puisse faire avec plusieurs autres de nos plantes, ou de nos arbres mêmes, sans les réduire en filasse.
Le raisonnement qui l'avait conduit à fabriquer du papier immédiatement avec la filasse, lui a fait essayer d'en tirer de même du coton, et il y a réussi. Il voulait s'assurer par-là si le duvet des plantes étrangères pouvait donner par lui-même une pâte bien conditionnée, pour travailler avec plus de sûreté sur les duvets de celles qui croissent chez nous, telles par exemple, que les chardons ; ou sur celles qui quoiqu' étrangères, viennent fort bien dans notre climat, comme l'apocyn de Syrte, etc.
La soie de nos vers à soie, est d'un usage trop précieux, et n'est pas à beaucoup près assez abondante chez nous pour être employée immédiatement à la fabrique du papier ; mais nous avons une espèce de chenille qu'on nomme commune, et qui ne mérite que trop ce nom, qui fîle une très-grande quantité de soie. C'est sur cette soie, tout au moins inutîle jusqu'à ce jour, que M. Guettard a fait ses expériences, et avec plus de succès qu'il n'eut osé l'espérer : le papier qu'elle lui a donné a de la force, et manque seulement de blancheur.
On a fait en Angleterre du papier avec des orties, des navets, des panais, des feuilles de choux, de lin en herbe, et de plusieurs autres végétaux fibreux ; on en a fait aussi avec de la laine blanche ; ce papier de laine n'est pas propre à écrire, parce qu'il est cotonneux, mais il pourrait être d'usage dans le commerce. Voyez Houghton, Collections, n °. 360. t. II. pag. 418. et suivantes.
En un mot, on est parvenu à faire du papier de toutes sortes de matières végétables, et d'une infinité de substances que nous rejetons comme inutiles ; je ne doute pas qu'on n'en put faire encore de boyaux et de tripes d'animaux, même de matières minérales cotonneuses, puisqu'on en fait de l'amianthe ou de l'asbeste ; mais l'important serait d'en faire qui coutât moins que le papier de chiffons, sans quoi toutes les recherches en ce genre ne sont que de pure curiosité.
On peut lire sur le papier Leonis Allatii, antiquittates etruscae ; nigrisoli de chartâ ejusque usu apud antiquos, pièce qui est dans la galeria di Minerva ; Mabillon, de re diplomaticâ ; Montfaucon, Palaeographia graeca ; Maffei, Historia diplomatica, ou Biblioth. italiq. t. II. Harduinus, in Plinium ; Reimm. Idaea system. antiq. litter. Bartholinus, Dissertatio de libris legendis ; Polydorus Virgilius, de rer. invent. Vossius, de arte Gram. lib. I. Alexand. ab Alexand. lib. II. cap. 30. Salmuth ad Pancirol. l. II. tit. cclij. Grew, Mus. reg. societ. Prideaux, Connections ; Pitisci, Lexicon antiq. rom. tom. I. voce charta ; enfin le Dictionnaire de Chambers, où l'article du papier est presque complet ; Fabricius indiquera les autres auteurs sur ce sujet dans sa Bibliotheca antiqua.
Les principaux papiers qui méritent notre examen se peuvent réduire au papier égyptien, chinois, japonais, européen, papier de coton, papier d'écorce, papier d'asbeste ; nous nous proposons de traiter de chacun de ces papiers en particulier.
Pour le faire méthodiquement nous parlerons,
1°. Du papier d'Egypte le plus célèbre de tous.
2°. Du papier de coton qui lui a succédé.
3°. Du papier d'écorce interne des arbres.
4°. Du papier de la Chine.
5°. Du papier du Japon.
6°. Du papier européen, c'est-à-dire du papier de linge.
7°. De la fabrique du papier marbré en particulier.
8°. Du commerce du papier de linge en général.
9°. Du papier d'asbeste, nommé papier incombustible.
10°. Enfin nous traiterons du papyrus et du parchemin sous leurs lettres particulières. (Le chevalier DE JAUCOURT ).
PAPIER D'ÉGYPTE, (Arts anciens) c'est ce papier fameux dont les anciens se servaient, et qui était fait par art d'une espèce de jonc nommé papyrus, qui croissait en Egypte sur les bords du Nil. Selon Isidore, Memphis a la gloire d'avoir la première su faire le papier du papyrus ; et Lucain semble appuyer cette idée, quand il dit :
Nondum flumineas Memphis contexere biblos
Noverat.
Pharsal. liv. III. Ve 222.
Ce qu'il y a de bien sur, c'est que de toutes les matières sur lesquelles les anciens ont écrit ; il n'en est point qui présente autant d'avantages que le papier, soit par rapport à sa légèreté, soit par rapport à la facilité de la fabrique ; c'était un présent simple de la nature, et le produit d'une plante qui n'exigeait ni soins, ni culture. Aussi toutes ces raisons le rendirent d'un usage presque général dans le monde civilisé. Quoiqu'on ait varié les matières qui peuvent recevoir l'écriture, cependant l'on a toujours préféré pour une chose si nécessaire ce qu'il y avait de plus commun et de plus facîle à transporter ; ainsi, le parchemin, le papier, et les tablettes de cire ont été d'un usage plus constant et plus étendu, et par la même raison le plomb doit avoir eu la préférence sur les autres métaux. Quelques auteurs ont admis sur ces faits un merveilleux que les hommes ont aimé de tous les temps à se persuader. Tel est celui qui a rapporté que l'iliade et l'odyssée avaient été écrites en lettres d'or sur le boyau d'un dragon, long de cent vingt pieds. Mais comme les romans conservent toujours des parties d'usage et de vérité, on voit par-là que les anciens ont écrit sur des boyaux, ce qui, dans le fond est fort naturel. On peut avoir écrit des ouvrages sur l'ivoire, mais indépendamment de la rareté dont cette matière était autrefois, les feuilles d'une épaisseur aussi médiocre que la chose est possible, auraient encore produit un poids excessif ; dans la portée des feuilles ordinaires, elles se seraient rompues. Cependant il est certain que les Romains écrivaient sur des tablettes d'ivoire les lettres missives, et souvent leurs affaires domestiques, usage qui s'est même conservé jusqu'à nous.
On ne convient pas du temps où l'on a commencé à se servir du papyrus pour en faire du papier. Varron place cette découverte dans le temps des victoires d'Alexandre le Grand, lorsque ce prince eut fondé la ville d'Alexandrie en Egypte ; mais Pline lui-même réfute le sentiment de Varron, et se fonde sur le témoignage de Cassius Hemina, ancien analyste, qui dit que Cn. Terentius Scribe, travaillant à un fonds de terre qu'il avait sur le Janicule, trouva dans une caisse de pierre les livres du roi Numa, écrits sur ce papier ; et qu'ils s'étaient conservés jusqu'à ce temps-là, sans pourriture, parce qu'ils étaient frottés d'huîle de cedre, quoiqu'il y eut 535 ans qu'ils avaient été mis sous terre. Il rapporte encore que Mucien qui avait été trois fois consul, assurait qu'étant préfet de Lycie, il avait Ve dans un temple une lettre sur du papier d'Egypte, écrite de Troie par Sarpedon, roi de Lycie. Mais on a des autorités plus sures, quoique moins anciennes, qui prouvent que le papier d'Egypte était en usage longtemps avant Alexandre le Grand, Guillandin cite Homère, Hérodote, Eschyle, Platon, Anacréon, Alcée, etc.
Pline, liv. XIII. ch. XIe a décrit amplement la manière dont les Egyptiens faisaient leur papier. Voici ce qu'il en rapporte. On sépare, dit-il, avec une éguille la tige du papyrus en lames ou feuillets fort minces, et aussi larges qu'il est possible, dont on compose les feuilles de papier. Les lames du milieu sont préférées, et ensuite selon l'ordre de la division. On étend les meilleures sur une table, en leur laissant toute la longueur qu'elles peuvent avoir, et coupant seulement ce qui déborde aux extrémités : sur cette première feuille déliée, on en étend une autre en travers, et d'un autre sens. L'eau du Nil, dont on les humecte, sert de colle pour les joindre ensemble. On y emploie aussi quelquefois la colle même ; ces feuilles ainsi collées sont mises à la presse, d'où on les retire pour les faire secher au soleil. Après cela, on les joint ensemble, les meilleures d'abord, ainsi à mesure, selon qu'elles diminuent de bonté ; enfin les plus mauvaises ; il n'y en a jamais plus de vingt dans une tige.
Ce papier, avant que d'être lavé, était anciennement appelé hiératique, sacré, et ne servait que pour les livres de la religion. Ce même papier étant lavé prit le nom d'Auguste, et porta celui de Livie sa femme, après avoir été lavé une seconde fois ; ainsi, le papier hiératique descendit du premier rang au troisième ; un autre, fort semblable, avait été appelé amphithéâtrique, du lieu où on le faisait : porté à Rome dans la boutique de Fannius, dont les ouvriers étaient fort habiles, il fit de ce papier commun, rendu plus fin par une manœuvre particulière, un papier qui surpassait les autres, et auquel on donna son nom : l'amphithéâtrique, qui n'avait pas été préparé de la même façon, conserva le sien.
La largeur du papier, continue Pline, varie extrêmement ; elle est de treize doigts dans le plus beau, de onze dans le hiératique, de dix dans celui de Fannius, de neuf dans le papier d'amphithéâtre, et de moins encore dans celui de Saïs, qui a peine de soutenir le marteau ; la largeur du papier des marchands ne passe pas six doigts. Ce qu'on regarde le plus dans le papier, c'est qu'il ait de la finesse, du corps, de la blancheur et du poli.
L'empereur Claude a privé du premier rang le papier d'Auguste, qui, beaucoup trop fin, ne soutenait pas la plume du roseau : de plus, sa transparence faisait craindre que les caractères ne s'effaçassent les uns les autres, sans compter l'oeil désagréable d'une écriture qui s'aperçoit à-travers la feuille. Il augmenta aussi la largeur de la feuille, qui n'était auparavant que d'un pied : les feuilles les plus larges, appelées macrocolla, avaient une coudée de largeur ; mais l'expérience découvrit l'inconvénient, lorsqu'en ôtant de la presse une seule de ces feuilles, un grand nombre de pages se trouvèrent gâtées ; c'est pourquoi le papier d'Auguste continua d'être en usage pour les lettres particulières, et le papier livien s'est maintenu dans l'usage où il était auparavant ; mais le papier claudien fut préféré à tous les autres dans l'usage général, parce que, sans avoir les défauts du papier auguste, il avait la solidité du papier livien.
On donne le poli au papier par le moyen de l'ivoire ou de la coquille ; mais les caractères sont sujets à se détacher. Le papier poli bait moins l'encre ; mais il a plus d'éclat. Quand le papier, dès la première opération, n'a pas été trempé avec précaution, il se refuse souvent au trait de celui qui écrit. Ce défaut de soin se fait sentir sous le marteau, et même à l'odeur du papier. Lorsqu'il y a des taches, on les découvre à la simple vue ; mais quand on a rapporté des morceaux pour boucher les trous, les fautes ou les déchirures, cette opération fait boire le papier, et l'on ne s'en aperçoit que dans le moment qu'on écrit. Telle est la mauvaise foi des ouvriers. Aussi prend-on la peine de donner une nouvelle façon à ce papier.
La colle ordinaire se prépare avec la fleur de farine détrempée dans de l'eau bouillante, sur laquelle on a jeté quelques gouttes de vinaigre. Car la colle des menuisiers et la gomme sont cassantes ; mais une meilleure préparation est celle qui se fait avec de la mie de pain levé, détrempé dans de l'eau bouillante, et passée par l'étamine ; le papier devient par ce moyen le plus uni qu'il se peut faire et même plus lisse que la toîle de lin. Au reste cette colle doit être employée un jour après avoir été faite, ni plus tôt, ni plus tard ; ensuite on bat ce papier avec le marteau ; on y passe une seconde fois de la colle, on le remet en presse pour le rendre plus lisse et uni, et on l'étend à coups de marteau. C'est ce papier qui donne une si longue durée aux ouvrages écrits de la propre main des Gracques, Tibérius et Caïus ; je les ai Ve chez Pomponius Secundus, poète et citoyen du premier mérite, près de deux cent ans après qu'ils avaient été écrits. Nous voyons communément ceux de Ciceron, Auguste, et de Virgile.
Les savants voudraient bien avoir à leur disposition cette bibliothèque de Pomponius Secundus. Mais que dirait Pline, s'il voyait, comme nous, des feuilles de papier d'Egypte, qui ont mille et douze cent ans d'antiquité ?
On a Ve dans ce détail de la traduction de Pline que pour les différentes espèces de papier qui se fabriquaient en Egypte les lames du papyrus trempées dans l'eau du Nil, étaient tissues sur une table ou planche ; mais il faut retrancher le mérite de cette eau comme étant du Nil ; car toute eau de rivière eut été également bonne pour cette première préparation, qui consistait à détremper les lames du papyrus, et à faciliter l'expression du suc qu'elles renfermaient ; mais l'ivoire, la coquille, la dent de loup, l'opération du marteau, etc. étaient dus à la préparation donnée au papier par les marchands de Rome. Pour ce qui est de la colle, comme les Egyptiens en connaissaient l'usage, il est vraisemblable qu'ils l'ont appliqué à celui du papier, dont l'emploi était également varié et étendu.
Les papiers d'Auguste, de Livie, de Fannius, d'amphithéâtre, enfin tous ceux qui portaient les dénominations romaines, étaient constamment faits avec le papyrus d'Egypte ; mais préparés et travaillés de nouveau à Rome. Le plus grand avantage de ces papiers ne consistait que dans la façon dont ils étaient battus, lavés, etc. On aperçoit par le récit de Pline, une grande différence dans les grandeurs de chaque feuille, en les comparant au papier fabriqué en Egypte ; on voit même que les papiers travaillés à Rome, sont de mesures variées ; mais en général plus petites. Enfin il ne faut pas douter que la manufacture du papier d'Egypte n'ait été beaucoup perfectionnée en Europe. Cassiodore fait l'éloge des feuilles de papyrus employées de son temps. Il dit qu'elles étaient blanches comme la neige, et composées d'un grand nombre de petites pièces, sans qu'il parut aucune jointure. On avait perfectionné l'art dont parle Ovide dans le I. liv. des tristes, de polir le papier avec la pierre-ponce.
Mais comme malgré tous ces soins, on ne pouvait éviter que les feuilles de papier trop fragiles pour se soutenir, ne vinssent à dépérir en peu de temps, surtout quand on les employait à faire des livres ; on s'avisa de les entremêler de feuilles de parchemin sur lesquelles l'écriture était continuée, de sorte qu'après quatre, cinq, six, ou quelquefois sept feuilles de papier d'Egypte, on mettait deux feuilles de parchemin. On conserve à l'abbaye de S. Germain des prés une partie des épitres de S. Augustin, écrites de cette manière sur du papier d'Egypte, entremêlé de feuilles de parchemin. C'est un vieux manuscrit, auquel on donne environ 1100 ans. Les lettres y sont encore en bon état, et l'encre sans s'éteindre a conservé sa noirceur.
Les Egyptiens faisaient dans tout le monde un grand commerce de leur papier ; ce commerce augmenta sur la fin de la république, et devint encore plus florissant sous le règne d'Auguste ; aussi comme le débit de ce papier était prodigieux pour les nations étrangères, on en manquait quelquefois à Rome ; c'est ce qu'on vit arriver du temps de Tibere ; comme on ne reçut à Rome qu'une petite quantité de papier d'Egypte, cet événement causa du tumulte, et le sénat nomma des commissaires, pour en distribuer à chacun selon ses besoins, autant que la disette le permettait. Plutarque fait voir combien le trafic de ce papier était grand, quand il dit dans son traité Colotès : " Ne faudrait-il pas que le Nil manquât de papyrus avant que ces gens-là cessassent d'écrire " ? L'empereur Hadrien, dans sa lettre à Servien, consul, que Vopisque nous a conservée, met entre les principaux arts qu'on exerçait à Alexandrie, celui de faire des feuilles à écrire. C'est une ville riche et opulente, dit-il, où personne ne vit dans l'oisiveté. Les uns travaillent en verre, les autres font des feuilles à écrire ; d'autres de la toîle : on les voit tous vacquer à toutes sortes de métiers. Il y a là de l'ouvrage pour les goutteux, et pour les aveugles ; ceux mêmes qui ont la chiragre ou la goutte aux mains, n'y manquent pas d'exercice. Sous les Antonins ce commerce continua dans la même forme. Apulée dit au commencement de ses métamorphoses, qu'il écrit sur du papier d'Egypte, avec une canne du Nil ; car c'étaient le Nil et Memphis qui fournissaient la plupart des cannes dont on se servait, comme on se sert aujourd'hui de plumes.
Les empereurs se servaient des feuilles de papier d'Egypte pour écrire leurs lettres et leurs mémoires. Domitien, dit Dion, écrivit les noms de ceux qu'il voulait faire mourir sur une feuille double de philyre ; car, selon Hérodien, ces sortes de feuilles simples étaient fort minces. Le commerce de ce papier était si grand vers la fin du IIIe siècle, que le tyran Firmus s'étant emparé de l'Egypte, se vantait qu'il avait assez de papier et de colle pour nourrir son armée ; c'était apparemment du prix qu'il retirerait de la vente de ce papier que Firmus prétendait être en état de nourrir son armée.
S. Jerome nous apprend que l'usage de ce papier d'Egypte était toujours le même dans le Ve siècle où il vivait : Le papier ne vous a pas manqué, dit-il, dans sa lettre à Chromace, puisque l'Egypte continue son commerce ordinaire. Les impôts sur le papier étant trop grands sur la fin du même siècle, ou au commencement du suivant, Théodoric, roi d'Italie, prince modéré et équitable, en déchargea le public. Ce fut sur cela que Cassiodore écrivit la 38 lettre de son XI. liv. où il semble féliciter toute la terre de la décharge de cet impôt, sur une marchandise si nécessaire à tout le genre humain.
Le VIe siècle, selon les PP. Montfaucon et Mabillon, fournit aussi des monuments écrits sur le papier d'Egypte. Ils citent une charte appelée charta plenariae securitatis de l'empereur Justinien ; le P. Mabillon l'a fait imprimer peu de temps avant sa mort avec la forme des caractères ; ce monument singulier est à la bibliothèque du roi de France.
Le P. Montfaucon dit aussi avoir vu, en 1698, à Venise dans la bibliothèque du procurateur Julio Justiniani, trois ou quatre fragments de papier d'Egypte, dont l'écriture était du même siècle ; mais dont on ne pouvait rien tirer, parce que c'était des morceaux rompus où l'on ne trouvait aucune suite. Le P. Mabillon parle dans sa diplomatique d'un autre manuscrit, qu'il croit être du même siècle, et qui était autrefois de la bibliothèque de M. Petau. Mais le P. Montfaucon n'a jamais pu voir ce manuscrit. Il cite en échange un manuscrit en papier d'Egypte qu'on conserve à la bibliothèque de S. Ambraise de Milan, et qui contient quelques livres des antiquités judaïques de Josephe en latin. Il donne à ce manuscrit à-peu-près la même antiquité ; mais il l'a trouvé en assez mauvais état.
Le même père dit avoir Ve dans la bibliothèque de S. Martin de Tours les restes d'un vieux livre grec écrit sur du papier d'Egypte, et qui lui parut être du VIIe siècle. Ce manuscrit n'avait ni accent, ni esprit.
Il croit encore que l'évangîle de S. Marc, qu'on garde dans le trésor de Venise, est écrit sur des feuilles de papier d'Egypte, qui lui ont paru cependant beaucoup plus délicates qu'aucune autre. Il pense que c'est le plus ancien de tous les manuscrits, et qu'on ne hasarde guère en disant qu'il est au plus tard du iv. siècle. Ce manuscrit est presque tout effacé, et si pourri, que les feuilles étant toutes collées l'une contre l'autre, on ne peut tenter de tourner un feuillet sans que tout s'en aille en pièces ; enfin, ajoute-t-il, on n'y saurait lire deux mots de suite.
On se servait, selon le même père, en France, en Italie, et dans d'autres pays de l'Europe, du papier d'Egypte pour des lettres ou des actes publics. Il en reste encore, dit-il, un assez grand nombre dans les abbayes et dans les archives des églises, comme à S. Denis, à Corbie, à l'abbaye de Grasse, et en d'autres endroits.
Il est vraisemblable que l'invention du papier de coton, dont nous parlerons séparément, a fait tomber l'usage du papier d'Egypte ; mais c'est une grande question de savoir dans quel temps on a cessé de faire le papier égyptien : car à présent la papyrotechnia aegyptiaca, la manufacture du papier égyptien est mise au nombre des arts qui sont perdus. Eustathius le savant commentateur d'Homère, assure que même de son temps, savoir, en 1170, il n'était plus en usage. Le P. Mabillon soutient à la vérité que l'usage en a duré jusqu'au XIe siècle après J. C. et cite un certain Fredegaire, moine, poète du Xe siècle, qui en parle comme d'une chose qui subsistait le siècle d'auparavant, c'est-à-dire, dans le ix. siècle ; mais le même P. Mabillon s'efforce de prouver que l'usage en a duré plus longtemps par plusieurs bulles des papes, écrites sur le papyrus dans le XIe siècle. Voyez Mabillon de re diplomat. lib. I. ch. VIIIe
Cependant le comte Maffei soutient dans son istor. diplomat. l. II. bibl. ital. t. II. p. 251. avec plus de probabilité, que le papyrus n'était déjà plus en usage avant le Ve siècle : il ne regarde point comme authentique les mémoires écrits sur ce papier, et datés postérieurement à ce temps. Les bulles des papes citées par le P. Mabillon paraissent à ce savant avoir été écrites sur le papier de coton ; mais les observations que nous faisons ne se rapportent qu'à l'usage général et public du papier d'Egypte ; car il ne serait pas étonnant que quelques particuliers eussent continué de l'employer quelques centaines d'années après qu'on avait cessé de s'en servir communément.
Le même savant italien est dans la persuasion que l'évangîle de S. Marc, qu'on conserve à Venise, est écrit sur du papier de coton ; et qu'au contraire, le Josephe de la bibliothèque de S. Ambraise de Milan lui parait au premier coup d'oeil écrit sur du papier égyptien.
Voilà les principales observations des savants en ce genre. Il n'est guère possible aujourd'hui d'ajouter quelque chose de nouveau sur le papier d'Egypte, à ce qu'en ont dit parmi les anciens Pline, liv. XIII. Théophraste, l. IV. ch. ix. et parmi les modernes Guilaudinus, Scaliger, Saumaise, Kirchmayer, Nigrisoli, le P. Hardouin dans son édit. de Pline, le P. Mabillon dans son ouvrage de re diplomaticâ ; dom Montfaucon dans sa palaeograph. et dans le recueil de littérature ; l'illustre Maffei dans son istor. diplom. et dernièrement M. le comte de Caylus, dans les mém. de l'acad. des Inscript. t. XXVI.
Guillardini (Melch.) Papyrus, h. e. commentarius in tria C. Plinii majoris de papyro capita, scilicet, lib. XIII. ch. XIe XIIe XIIIe Ce traité vit d'abord le jour à Venise en 1572, in -4°. et ensuite à Amberg, en 1613, in -4°. par les soins de Salmuth. C'est le plus savant commentaire qui ait été publié sur cette partie de l'ouvrage de Pline, et on n'en a point encore de meilleur sur aucun autre livre du grand naturaliste de Rome. Guillandin en a restitué très-heureusement plusieurs passages, et par ses propres lumières, et par l'autorité des anciens auteurs grecs et romains. Il s'est sans doute trompé quelquefois ; mais il a réussi très-souvent dans ses restitutions. Il parle de ce qu'il a Ve ; il a fait ses observations dans le pays même, où il a examiné la plante dont il s'agit ; c'est grand dommage qu'après son examen, il n'en ait pas donné de figure, et même qu'il ne l'ait pas décrite ; il eut levé par-là tous les doutes des botanistes modernes.
Scaligeri (Joseph-Just.) animadversiones in Melch. Guillardini comment. de papyro. Les animadversions de Scaliger ont paru pour la première fois dans les lectiones bibliothecariae memorabiles Rudolphi Capelli, à Hambourg en 1682. Elles distillent le fiel, la violence et la dureté ; mais elles n'ont pu faire tomber un ouvrage très-estimable par les recherches et l'érudition qui s'y trouvent. Enfin, le savant et ingénieux Maffei a vengé Guillardinus de la plupart des critiques de Scaliger, de Vossius, et du P. Hardouin.
Saumaise est très-bon à lire au sujet du papier égyptien, dans son commentaire sur la vie de Firmus par Vopiscus, un des historiens qu'on met au nombre des historiae augustae scriptores.
Kirchmayeri (M. Seb.) dissertatio philologica de papyro veterum, Wittebergae 1666. in -4°. c'est un simple extrait de Guillandin, où l'auteur aurait dû mettre plus de méthode et de gout.
La dissertation de Nigrisoli de chartâ veterum ejusque usu, est insérée, comme je l'ai dit ailleurs, dans la galeria di Minerva.
Mais le mémoire curieux de M. le comte de Caylus sur le papyrus d'Egypte a répandu des lumières sur une chose que le temps rendait dejà fort obscure, et à l'intelligence de laquelle on ne peut mieux arriver, que par la connaissance de la pratique de l'art. (D.J.)
PAPIER DE COTON, (Arts) On croit que c'est l'invention du papier de coton, qu'on appelle charta bombycina, qui a fait tomber le papyrus d'Egypte en Grèce. Ce papier est incomparablement meilleur, plus propre à écrire, et se conserve bien plus longtemps. On ne saurait dire précisément quand on s'est avisé d'en faire de cette matière. Le père Montfaucon prouve, par des autorités assez claires, que le papier de coton était en usage en 1100.
Ce papier s'appelle en grec , ou , ce qui signifie papier de coton. Quoique se prenne dans les auteurs pour de la soie, il se prend aussi, surtout dans le bas age, pour le coton, aussi-bien que . De-là vient que les Italiens appellent encore aujourd'hui le coton, bambaccio.
Ce fut au neuvième siècle ou environ que l'on commença dans l'empire d'orient à en faire du papier : en voici les preuves. Il y a plusieurs manuscrits grecs, tant en parchemin ou vélin, qu'en papier de coton, qui portent la date de l'année où ils ont été écrits ; mais la plupart sont sans date. Sur les manuscrits datés on juge plus surement, par la comparaison des écritures, de l'âge de ceux qui ne le sont pas. Le plus ancien manuscrit de papier de coton, que le père Montfaucon ait Ve avec la date, est celui du roi, numéroté 2889, qui fut écrit en 1050 ; un autre de la bibliothèque de l'empereur, qui porte aussi sa date, est de l'année 1095. Mais comme les manuscrits sans date sont incomparablement plus nombreux que ceux qui sont datés, ce père s'est encore exercé sur ceux-là ; et par la comparaison des écritures, il croit en avoir découvert quelques-uns du dixième siècle, entr'autres un de la bibliothèque du roi, coté 2436. Si l'on faisait la même recherche dans toutes les bibliothèques, tant de l'orient que de l'occident, on en trouverait apparemment d'autres, environ du même temps.
Il juge donc que ce papier bombycien ou de coton, peut avoir été inventé sur la fin du neuvième siècle ou au commencement du dixième. A la fin du onzième et au commencement du douzième, l'usage en était répandu dans tout l'empire d'orient, et même dans la Sicile. Roger, roi de Sicile, dit dans un diplome écrit en 1145, rapporté par Rocchus Pirrhus, qu'il avait renouvellé sur du parchemin une charte qui avait été écrite sur du papier de coton, in chartâ cuttuneâ, l'an 1102, et une autre qui était datée de l'an 1112. Environ le même temps, l'impératrice Irene, femme d'Alexis Comnène, dit dans sa règle faite pour des religieuses, qu'elle avait fondées à Constantinople, qu'elle leur laisse trois exemplaires de la règle, deux en parchemin, et un en papier de coton. Depuis ce temps-là, ce papier fut encore plus en usage dans tout l'empire de Constantinople. On compte aujourd'hui par centaines les manuscrits grecs de papier bombycien, qui se trouvent dans les bibliothèques curieuses.
Cette découverte fut fort avantageuse dans un temps où il parait qu'il y avait grande disette de parchemin ; et c'est en même temps ce qui nous a fait perdre plusieurs anciens auteurs : voici comment. Depuis le douzième siècle, les Grecs plongés dans l'ignorance, s'avisèrent de racler les écritures des anciens manuscrits en parchemin, et d'en ôter autant qu'ils pouvaient toutes les traces, pour y écrire des livres d'église : c'est ainsi qu'au grand préjudice de la république des Lettres, les Polybes, les Dions, les Diodore de Sicile, et d'autres auteurs que nous n'avons plus, furent métamorphosés en triodions, en pentécostaires, en homélies, et en d'autres livres d'église. Après une exacte recherche, faite par le père Montfaucon, il assure que parmi les livres écrits sur du parchemin depuis le douzième siècle, il en avait plus trouvé dont on avait raclé l'ancienne écriture que d'autres ; mais que comme tous les copistes n'étaient pas également habiles à effacer ainsi ces premiers auteurs, il s'en trouvait quelques-uns où l'on pouvait lire au-moins une partie de ce qu'on avait voulu raturer.
Ce fut donc l'invention de ce papier de coton qui fit tomber en orient le papier d'Egypte. S'il en faut croire Eustathe qui écrivait vers la fin du douzième siècle, l'usage de ces feuilles du papier d'Egypte, qu'il appelle , avait cessé peu de temps avant qu'il écrivit, . Il ne faut pas croire cependant que le papier de coton ait d'abord détruit l'usage de celui d'Egypte. Ces sortes de choses nouvellement inventées, ne s'établissent ordinairement que peu-à-peu.
Le savant grec, qui fit du temps de Henri II. un catalogue des manuscrits grecs de la bibliothèque du roi, appelle toujours le papier bombycien ou de coton, charta damascena, le papier de Damas ; serait-ce parce qu'il y avait en cette ville quelque célèbre manufacture de papier de coton ? quoi qu'il en sait, voyez Montfaucon, palaeograph. graec. lib. I. c. IIe lib. IV. c. VIe etc. Maffei, Istor. diplomat. lib. II. ou biblioth. italiq. tom. II. (D.J.)
PAPIER D'ECORCE, (Arts) Ce papier des anciens improprement ainsi nommé, était fait du liber, ou de la pellicule blanche la plus intérieure qui est renfermée entre l'écorce et le bois de différents arbres, comme l'érable, le plane, le hêtre et l'orme ; mais surtout le tilleul, , dont on se servait le plus communément à ce dessein. Les anciens écrivaient des livres sur cette pellicule après l'avoir enlevée, battue et sechée : on prétend qu'il existe encore quelques-uns de ces livres. Il faut consulter Pline, hist. natur. lib. XIII. c. XIe Harduinus, not. ad eund. Suid. lex. in vox ; Isid. orig. l. VI. c. XIIIe Alex. ab Alexand. l. II. c. xxx. Salmuth, ad Pancirol. l. II. t. XIII. p. 252. seq.
Les PP. Mabillon et Montfaucon parlent souvent des manuscrits et diplomes écrits sur écorce, et font une distinction bien positive entre le papyrus dont les Egyptiens se servaient, et le liber ou écorce qui était en usage dans d'autres pays : ces deux espèces différaient en ce que le papier d'écorce était plus épais et plus fragîle que le papyrus, et en même temps plus sujet à se fendre et à se casser, au moyen de quoi l'écriture s'écaillait quelquefois ; c'est ce qui est arrivé à un manuscrit sur écorce qui est à l'abbaye saint Germain, où le fond du papier est resté, mais la surface extérieure sur laquelle les lettres ont été tracées, est enlevée en beaucoup d'endroits. Voyez Montfaucon, palaeogr. graec. l. I. c. IIe p. 15. Mabillon, de re diplom. l. I. c. VIIIe Reimm. idea syst. antiq. litter. p. 311.
Mais le savant Maffei combat tout le système des manuscrits et des chartes écrites sur l'écorce, comme une erreur populaire ; et soutient que les anciens n'ont jamais écrit de diplomes sur l'écorce ; que la distinction que l'on fait des papiers faits de papyrus et d'écorce est sans aucun fondement ; qu'on ne se servait d'écorce de tilleul que pour faire des tablettes, pour les dypticha ou porte-feuilles et tablettes de poche, sur lesquelles on écrivait des deux côtés comme cela se fait parmi nous ; avantage qu'on n'avait pas avec le papier égyptien à cause de sa finesse. Chambers. (D.J.)
PAPIER DE LA CHINE, (Arts) De tous les peuples de la terre, celui chez qui le papier parait être le plus ancien, ce sont les Chinois ; ils en ont de temps immémorial et de très-beau ; ils en ont d'une grandeur à laquelle toute l'industrie des ouvriers européens n'a pu encore atteindre. Leur beau papier a aussi cet avantage, qu'il est plus doux et plus uni que celui d'Europe. Le pinceau dont les Chinois se servent pour écrire, ne pourrait couler facilement sur un fond un peu raboteux, et y fixer certains traits délicats. Ils ont de tant d'espèces de papier, que nous en connaissons en Europe plus de quarante, toutes curieuses par des circonstances particulières. Enfin, ils en ont de toutes sortes de matières ; les uns sont faits de pellicules internes ou d'écorce d'arbre, principalement de ceux qui ont beaucoup de seve, comme le mûrier et l'orme, mais particulièrement le bambou et l'arbre de coton. A la vérité chaque province a son papier particulier ; celui de Se-Chwen est fait de chanvre ; celui de Fo-Kien est fait de jeune bambou ; celui dont on se sert dans les provinces septentrionales est fait de l'écorce du mûrier ; celui de la province de Che-Kiang, de paille de blé ou de riz ; celui de la province de Kiang-Nam, d'une peau qu'on trouve dans les coques de vers à soie ; enfin, dans la province de Hu-Quang, l'arbre chu ou ko-chu fournit la principale matière dont on fait le papier.
La manière de fabriquer le papier des diverses écorces d'arbres, est la même que celle du bambou, qui est une espèce de canne ou roseau, creux et divisé par des nœuds, mais beaucoup plus large, plus uni, plus dur, et plus fort que toutes les autres sortes de roseaux.
Pour faire le papier de bambou, on prend ordinairement la seconde pellicule de l'écorce qui est tendre et blanche, on la bat dans de l'eau claire jusqu'à ce qu'elle soit réduite en pâte, que l'on met dans des moules ou formes très-larges, de sorte que cela fait des feuilles longues de dix ou douze pieds. On le perfectionne en le trempant feuille par feuille dans de l'eau d'alun, qui leur tient lieu de la colle dont nous nous servons, et qui non-seulement empêche le papier de boire l'encre ; mais de plus lui donne ce lustre qui le fait paraitre, au premier coup d'oeil, argenté, ou du-moins verni.
Le papier qu'on fait de la sorte est blanc, doux et serré, sans qu'il y ait la moindre inégalité qui puisse arrêter le mouvement du pinceau, ni occasionner le rebroussement d'aucun des poils qui le composent. Cependant quand il est fait d'écorce d'arbres, il se casse plus facilement que le papier d'Europe ; joignez à cela qu'il est plus sujet à prendre l'humidité ; que la poussière s'y attache, et que les vers s'y mettent en peu de temps. Pour obvier à ce dernier inconvénient, on est obligé de battre souvent les livres, et de les exposer au soleil. Outre cela, sa grande finesse le rendant sujet à s'user, les Chinois se trouvent souvent dans la nécessité de renouveller leurs livres en les faisant réimprimer souvent. Voyez le Comte, nouv. mém. sur la Chine ; Kust. bibl. nov. lib. an. 1697, lettr. édif. et cur. tom. XIX.
Il est bon de remarquer que le papier de bambou n'est ni le meilleur, ni le plus usité à la Chine. Par rapport à la qualité, il cede la primauté au papier fait de l'arbrisseau qui porte le coton, qui est le plus blanc et le plus fin, et en même temps le moins sujet aux inconvénients dont nous venons de parler, car il se conserve aussi-bien, et dure aussi longtemps que le papier d'Europe. Le docteur Grew croit qu'on trouverait en Angleterre beaucoup de plantes qui renferment un duvet, lequel très-probablement ferait du papier aussi fin que celui que les Chinois font avec le coton : ce discours fait voir que Grew s'est imaginé mal-à-propos que le papier chinois est fait non pas de l'écorce de l'arbrisseau de coton, mais du duvet ou du coton même. Voyez Grew, mus. reg. soc. part. II.
Le papier dont on se sert le plus communément à la Chine, est celui que l'on fait d'un arbre appelé chu-ku ou ku-chu, que le père du Halde compare tantôt au mûrier, tantôt au figuier, tantôt au sicomore, et enfin pour augmenter l'embarras, d'autres fois au fraisier, en sorte que nous connaissons moins cet arbre que s'il n'en avait rien dit du-tout : cette façon d'écrire est familière à cet auteur, qui est souvent d'une sécheresse extraordinaire au milieu de la plus grande prolixité, et qui n'est jamais plus diffus et moins méthodique, que quand il se propose de mettre de l'exactitude et de l'ordre dans ses écrits. Mais, pour revenir au ku-chu, voici la manière de le préparer pour en faire le papier : on ratisse d'abord légérement l'écorce extérieure de cet arbre, qui est verdâtre, ensuite on en lève la peau intérieure en longs filets minces, qu'on fait blanchir à l'eau et au soleil, après quoi on la prépare de la même manière que le bambou.
Il ne faut pas oublier d'observer que dans les autres arbres, ce n'est que l'intérieur de l'écorce qui sert à faire le papier ; mais le bambou, aussi-bien que l'arbre de coton, ont cela de particulier, que non-seulement on emploie leur écorce, mais même toute leur substance, par le moyen des préparations suivantes.
Outre les bois des plus larges bambous, on choisit les rejetons d'une année, qui sont à-peu-près de la grosseur du gras de la jambe d'un homme ; on les dépouille de leur première écorce verte, et on les fend en petites baguettes de six ou sept pieds de long ; on trempe ces baguettes ainsi fendues, dans un réservoir d'eau bourbeuse, jusqu'à ce qu'elles soient corrompues et attendries à force d'avoir trempé. Au bout de quinze jours on les retire, on les lave dans de l'eau nette, on les étend dans un grand fossé sec, et on les couvre de chaux pendant quelques jours. On les retire ensuite, et après les avoir lavé une seconde fais, on les partage en filaments, qu'on expose au soleil pour les sécher et les blanchir. Alors on les jette dans de grandes chaudières, où on les fait bouillir tout à fait ; enfin on les réduit en une pâte liquide par l'action de plusieurs grands marteaux.
Ensuite on prend quelques rejetons d'une plante nommée koteng, on les trempe quatre ou cinq jours dans l'eau jusqu'à ce qu'ils soient en une espèce de suc onctueux et gluant, qu'on mêle avec la pâte dont on veut faire le papier, à-peu-près de la même manière que les Peintres délaient leurs couleurs, ayant bien soin de n'en mettre ni trop, ni trop peu, parce que la bonté du papier en dépend.
Quand on a mêlé le jus du koteng avec le bambou, broyé et battu le tout, jusqu'à ce qu'il paraisse semblable à de l'eau épaisse et visqueuse, on jette le tout dans un grand réservoir, fait de quatre murs élevés jusqu'à hauteur d'appui, et dont les côtés et le fond sont si bien cimentés, que la liqueur ne peut pas en sortir, ni s'imbiber dedans.
Ensuite les ouvriers étant placés aux côtés du réservoir, ils trempent dedans leurs moules, et enlèvent la superficie de la liqueur qui dans l'instant devient papier, parce que le jus gluant et visqueux du koteng lie les parties, et rend le papier compact, doux et luisant, qualité que le papier européen n'a pas si-tôt qu'il est fait.
Pour rendre les feuilles fermes, et les mettre en état de supporter l'encre, on les trempe dans de l'eau d'alun : cette opération s'appelle faner, du mot chinois fan qui signifie alun. Voici quelle en est la préparation.
On met dans différentes écuelles pleines d'eau, six onces de colle de poisson, coupée bien menue ; on les fait bouillir en les remuant de temps en temps pour empêcher qu'il ne s'y forme des grumeaux : quand le tout est converti en une substance liquide, on y jette trois quarterons d'alun calciné, que l'on mêle et qu'on incorpore avec.
On verse ensuite cette composition dans un grand bassin, à-travers lequel est attaché un petit bâton rond : alors on serre l'extrémité de chaque feuille avec un bâton fendu d'un bout à l'autre, et dans cet état on trempe la feuille, en la tirant promptement aussi-tôt qu'elle est humectée, et la glissant par-dessus le petit bâton rond ; quand toute la feuille a passé à-travers la liqueur, le long bâton qui tient la feuille par l'extrémité, est attaché dans un trou à la muraille, et la feuille suspendue pour sécher.
A l'égard du moule avec lequel on fait la feuille, c'est une forme inventée de façon qu'on peut la hausser et baisser à volonté ; le fond n'en est pas fait de fil de laiton comme les nôtres, mais de petits filets menus de bambou, passés de distance en distance à-travers des trous pratiqués dans une plaque d'acier ; ce qui les rend aussi fins que s'ils étaient de laiton. On les fait ensuite bouillir dans l'huile, jusqu'à-ce qu'ils en soient imprégnés, afin que le moule entre plus légérement dans l'eau, et n'enfonce pas plus avant qu'il ne faut pour prendre de la matière suffisamment pour une feuille.
Pour faire des feuilles d'une grandeur considérable, ils ont soin d'avoir un réservoir et un moule proportionnés. Ce moule est soutenu par des cordons qui glissent sur une poulie. Au moment que le moule est élevé, les ouvriers placés à côté du réservoir sont prêts à en ôter la feuille, travaillant ensemble, et chacun ayant ses fonctions réglées. Pour sécher les feuilles qui sont tirées du moule, ils ont une muraille creusée, dont les côtés sont bien blanchis ; à un côté de ce mur est une ouverture par où, au moyen d'un tuyau, se communique la chaleur d'un fourneau qui est auprès ; et à l'extrémité opposée, est un petit vent qui chasse la fumée. Avec le secours de cette espèce d'étuve, ils séchent leur papier, presque aussi vite qu'ils le font.
La manière d'argenter le papier, est un autre secret qu'ont les Chinois, dont la pratique est de peu de frais, et pour laquelle ils ne se servent pas d'argent, mais ils prennent deux scrupules de glu faite de cuir de bœuf, un scrupule d'alun, et une pinte d'eau claire ; ils mettent le tout sur un feu lent, jusqu'à ce que l'eau soit consumée, c'est-à-dire, qu'il n'en sorte plus d'exhalaisons : alors ils étendent quelques feuilles de papier sur une table bien unie, et appliquent dessus avec un pinceau deux ou trois couches de cette glu ; ensuite ils prennent une poudre faite d'une certaine quantité de talc bouilli, et mêlé avec le tiers de cette quantité d'alun : ces deux drogues sont broyées ensemble, passées au tamis, et mises sur le feu dans de l'eau où on les fait bouillir derechef, ensuite on les fait sécher au soleil, et enfin on les broye. Cette poudre étant passée par un tamis fin, on l'étend également sur les feuilles de papier préparées comme devant ; ensuite on les étend à l'ombre pour les faire sécher : cela fait, on les remet encore sur la table, et on les lisse promptement avec un morceau de coton net, pour enlever le superflu du talc, qui sert une seconde fois au même usage ; avec cette poudre délayée dans l'eau, et mêlée avec la glu et l'alun, ils tracent toutes sortes de figures de fantaisie sur le papier. Voyez le P. du Halde, descript. de la Chine, tom. I.
Anciennement les Chinois écrivaient avec un pinceau de fer sur des tablettes de bambou ; ensuite ils se servirent du pinceau pour écrire sur du satin ; enfin, sous la dynastie des Hans, ils trouvèrent l'invention du papier 160 ans environ avant Jesus-Christ, suivant le P. Martini. Cette invention se perfectionna insensiblement, et leur procura différentes sortes de papier.
En général, le meilleur dont on se sert pour écrire, ne peut guère se conserver longtemps dans les provinces du sud ; et même nos livres d'Europe, selon le P. Parennin, ne tiennent guère à Canton contre la pourriture, les vers, et les fourmis blanches, qui dans quelques nuits en dévorent jusqu'aux couvertures : mais le même père assure que dans les parties du nord, surtout dans la province de Pékin, le papier quoique mince, se conserve très-longtemps.
Les Coréens eurent bien-tôt connaissance de la fabrique du papier des Chinois, et ils réussirent à le fabriquer d'une manière plus solide et plus durable ; car leur papier passe pour être aussi fort que de la toile, on écrit dessus avec le pinceau chinois. Si l'on voulait user des plumes d'Europe, il faudrait auparavant y passer de l'eau d'alun, sans quoi l'écriture serait baveuse.
C'est en partie de ce papier que les Coréens paient leurs tributs à l'empereur ; ils en fournissent chaque année le palais ; ils en apportent en même temps une grande quantité qu'ils vendent aux particuliers ; ceux-ci ne l'achetent pas pour écrire, mais pour faire les châssis de leurs fenêtres, parce qu'il résiste mieux au vent et à la pluie que le leur. Ils huilent ce papier, et en font de grosses enveloppes. Il est aussi d'usage pour les Tailleurs d'habits ; ils le manient, et le froissent entre leurs mains, jusqu'à ce qu'il soit aussi maniable et aussi doux que la toîle la plus fine, et ils s'en servent en guise de coton pour fourrer les habits. Il est même meilleur que le coton, lequel, lorsqu'il n'est pas bien piqué, se ramasse, et se met en une espèce de peloton. (D.J.)
PAPIER DU JAPON, (Arts) Le papier est fait au Japon de l'écorce du morus papyrifera sativa, ou véritable arbre à papier, de la manière suivante, selon Kaempfer à qui seul on en doit la connaissance.
Chaque année, après la chute des feuilles qui arrive au dixième mois des Japonais, ce qui répond communément à notre mois de Décembre, les jeunes rejetons qui sont fort gros, sont coupés de la longueur de trois pieds au-moins, et joints ensemble en paquets, pour être ensuite bouillis dans de l'eau avec des cendres. S'ils séchent avant qu'ils bouillent, on les laisse tremper vingt-quatre heures durant dans l'eau commune, et ensuite on les fait bouillir : ces paquets ou fagots sont liés fortement ensemble, et mis debout dans une grande chaudière qui doit être bien couverte : on les fait bouillir, jusqu'à ce que l'écorce se retire si fort, qu'elle laisse voir à nud un bon demi-pouce du bois à l'extrémité : lorsque les bâtons ont bouilli suffisamment, on les tire de l'eau, et on les expose à l'air, jusqu'à ce qu'ils se refroidissent ; alors on les fend sur la longueur pour en tirer l'écorce, et l'on jette le bois comme inutile.
L'écorce séchée est la matière dont ensuite on doit faire le papier ; en lui donnant une autre préparation qui consiste à la nettoyer de nouveau, et à trier la bonne de la mauvaise : pour cet effet, on la fait tremper dans l'eau pendant trois ou quatre heures ; étant ainsi ramollie, la peau noirâtre est raclée avec la surface verte qui reste, ce qui se fait avec un couteau qu'ils appellent kaadsi kusaggi, c'est-à-dire, le rasoir de kaadsi, qui est le nom de l'arbre ; en même temps aussi l'écorce forte qui est d'une année de crue, est séparée de la mince qui a couvert les jeunes branches. Les premières donnent le meilleur papier et le plus blanc ; les dernières produisent un papier noirâtre d'une bonté passable ; s'il y a de l'écorce de plus d'une année mêlée avec le reste, on la trie de même, et on la met à part, parce qu'elle rend le papier le plus grossier et le plus mauvais de tous : tout ce qu'il y a de grossier, les parties noueuses, et ce qui parait défectueux et d'une vilaine couleur, est trié en même temps pour être gardé avec l'autre matière grossière.
Après que l'écorce a été suffisamment nettoyée, préparée et rangée, selon ses différents degrés de bonté, on doit la faire bouillir dans une lessive claire ; dès qu'elle vient à bouillir et tout le temps qu'elle est sur le feu, on est perpétuellement à la remuer avec un gros roseau, et l'on verse de temps en temps autant de lessive claire qu'il en faut pour abattre l'évaporation qui se fait, et pour suppléer à ce qui se perd parlà : cela doit continuer à bouillir, jusqu'à ce que la matière devienne si mince, qu'étant touchée légérement du bout du doigt, elle se dissolve et se sépare en manière de bourre et comme un amas de fibres. La lessive claire est faite d'une espèce de cendres, en la manière suivante : on met deux pièces de bois en croix sur une cuve ; on les couvre de paille, sur quoi ils mettent des cendres mouillées, ils y versent de l'eau bouillante, qui à mesure qu'elle passe au travers de la paille, pour tomber dans la cuve, s'imbibe des particules salines des cendres, et fait ce qu'ils appellent lessive claire.
Après que l'écorce a bouilli de la manière qu'on vient de dire, on la lave ; c'est une affaire qui n'est pas d'une petite conséquence en faisant du papier, et doit être ménagée avec beaucoup de prudence et d'attention. Si l'écorce n'a pas été assez lavée, le papier sera fort à la vérité, et aura du corps, mais il sera grossier et de peu de valeur ; si au contraire on l'a lavé trop longtemps, elle donnera du papier plus blanc, mais plus sujet à boire, et mal propre pour écrire : ainsi cet article de la manufacture doit être conduit avec beaucoup de soin et de jugement, pour tâcher d'éviter les deux extrémités que nous venons de marquer. On lave dans la rivière, et l'on met l'écorce dans une espèce de van ou de crible au-travers duquel l'eau coule, et on la remue continuellement avec les mains et les bras jusqu'à ce qu'elle soit délayée à la consistance d'une laine, ou d'un duvet doux et délicat. On la lave encore une fois pour faire le papier le plus fin : mais l'écorce est mise dans un linge au lieu d'un crible, à cause que plus on lave, plus l'écorce est divisée, et serait enfin réduite en des parties si menues qu'elles passeraient au-travers des trous du crible et se dissiperaient. On a soin dans le même temps d'ôter les nœuds ou la bourre, et les autres parties hétérogènes grossières et inutiles, que l'on met à part avec l'écorce la plus grossière pour le mauvais papier. L'écorce étant suffisamment et entièrement lavée, est posée sur une table de bois uni et épais pour être battue avec des bâtons du bois dur kusnoki, ce qui est fait ordinairement par deux ou trois personnes jusqu'à ce qu'on l'ait rendu aussi fine qu'il le faut : elle devient avec cela si déliée qu'elle ressemble à du papier qui, à force de tremper dans l'eau, est réduit comme en bouillie, et n'a quasi plus de consistance.
L'écorce ainsi préparée est mise dans une cuve étroite avec l'infusion glaireuse et gluante du ris, et celle de la racine oreni qui est aussi fort glaireuse et gluante. Ces trois choses mises ensemble doivent être remuées avec un roseau propre et délié jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement mêlées, et qu'elles forment une substance liquide de la même consistance ; cela se fait mieux dans une cuve étroite, mais ensuite cette composition est mise dans une cuve plus grande, qu'ils appellent en leur langage fine : elle ne ressemble pas mal à celle dont on se sert dans nos manufactures de papier. On tire de cette cuve les feuilles une à une dans leurs moules qu'on fait de jonc, au lieu de fil d'archal, on les appelle miis.
Il ne reste plus qu'à les faire sécher à propos : pour cet effet, on met les feuilles en piles sur une table couverte d'une double natte, et l'on met une petite pièce de roseau, qu'ils appellent kamakura, c'est-à-dire coussin, entre chaque feuille ; cette pièce qui avance un peu sert ensuite à soulever les feuilles, et à les tirer une à une ; chaque pîle est couverte d'une planche ou d'un ais mince de la grandeur et de la figure des feuilles de papier, sur laquelle on met des poids légers au commencement, de peur que les feuilles encore humides et fraiches ne se pressent si fort l'une contre l'autre, qu'elles fassent une seule masse ; on sur charge donc la planche par degrés, et l'on met des poids plus pesans pour presser et exprimer toute l'eau ; le jour suivant, on ôte les poids : les feuilles sont alors levées une à une avec le petit bâton kamakura, dont on vient de parler ; et avec la paume de la main, on les jette sur des planches longues et raboteuses, faites exprès pour cela, les feuilles s'y tiennent aisément, à cause d'un peu d'humidité qui leur reste encore après cette préparation, elles sont exposées au soleil ; et lorsqu'elles sont entièrement seches, on les prend pour les mettre en monceaux, on les rogne tout-autour, et on les garde pour s'en servir ou pour les vendre.
J'ai dit que l'infusion de ris, avec un léger frottement, est nécessaire pour cet ouvrage, à cause de sa couleur blanche, et d'une certaine graisse visqueuse, qui donne au papier une bonne consistance et une blancheur agréable. La simple infusion de la fleur de ris n'aurait pas le même effet, à cause qu'elle manque de cette viscosité qui est une qualité fort nécessaire. L'infusion, dont je parle, se fait dans un pot de terre non vernissé, où les grains de ris sont trempés dans l'eau ; ensuite le pot est agité doucement d'abord, mais plus fortement par degrés : à la fin, on y verse de l'eau fraiche, et le tout est passé au-travers d'un linge ; ce qui demeure, doit être remis dans le pot, et subir la même opération en y mettant de l'eau fraiche ; et cela est répété tant qu'il reste quelque viscosité dans le ris. Le ris du Japon est le plus excellent pour cela, étant le plus gras et le plus gros qui croisse en Asie.
L'infusion de la racine oreni se fait de la manière suivante : la racine pilée ou coupée en petits morceaux est mise dans de l'eau fraiche ; elle devient glaireuse dans la nuit, et propre à l'usage destiné après qu'on l'a passée au-travers d'un linge. Les différentes saisons de l'année demandent une quantité différente de cette infusion mêlée avec le reste. Ils disent que tout l'art dépend entièrement de cela ; en été, lorsque la chaleur de l'air dissout cette colle et la rend plus fluide, il en faut davantage, et moins à proportion en hiver et dans le temps froid. Une trop grande quantité de cette infusion mêlée avec les autres ingrédiens rendrait le papier plus mince à proportion, et trop peu au contraire le rendrait épais, inégal et sec. Une quantité médiocre de cette racine est nécessaire pour rendre le papier bon et d'une égale consistance. Pour peu qu'on lève de feuilles, on peut s'apercevoir aisément si l'on en a mis trop ou trop peu. Au lieu de la racine oreni qui quelquefois, surtout au commencement de l'été, devient fort rare, les papetiers se servent d'un arbrisseau rampant, nommé sane kadsura, dont les feuilles rendent une gelée ou glu, semblable à celle de la racine oreni, mais qui n'est pas tout à fait aussi bonne.
On a remarqué ci-dessus que les feuilles de papier, lorsqu'elles sont fraichement levées de leurs moules, sont mises en pîle sur une table couverte de deux nattes : ces deux nattes doivent être faites différemment ; celle de dessous est plus grossière, et celle qui est au-dessus est plus claire, faite de joncs plus fins qui ne sont pas entrelacés trop près l'un de l'autre, afin de laisser un passage libre à l'eau, et ils sont déliés pour ne point laisser d'impression sur le papier. Le papier grossier, destiné à servir d'enveloppe et à d'autres usages, est fait de l'écorce de l'arbrisseau kadse kadsura avec la même méthode que nous venons de décrire. Le papier du Japon est très-fort, on pourrait en faire des cordes. On vend une espèce de papier fort épais à Syriga (c'est une espèce des plus grandes villes du Japon, et la capitale d'une province de même nom). Ce papier est peint fort proprement, et plié en si grandes feuilles, qu'elles suffiraient à faire un habit ; il ressemble si fort à des étoffes de laine ou de soie qu'on pourrait s'y méprendre.
Pour rendre complete l'histoire des manufactures de papier du Japon, Kaempfer y joint la description suivante des quatre arbres et des plantes dont on le fait.
1°. L'arbre à papier, en japonais kaadsi, est le principal. Kaempfer le caractérise ainsi : Papyrus fructu mori celsa, sive morus sativa, foliis urticae mortuae, cortice papyrifera.
D'une racine forte, branchue et ligneuse s'élève un tronc droit, épais et uni, fort rameux, couvert d'une écorce couleur de châtaigne, grosse dedans, où elle tient au bois qui est mou et cassant, plein d'une moèlle grande et humide. Les branches et les rejetons sont fort gros, couverts d'un petit duvet ou laine verte, dont la couleur tire vers le pourpre brun ; ils sont cannelés jusqu'à ce que la moèlle croisse, et sechent d'abord qu'on les a coupés. Les rejetons sont entourés irrégulièrement de feuilles à cinq ou six pouces de distance l'une de l'autre, quelquefois davantage : elles tiennent à des pédicules minces et velus de deux pouces de longueur, de la grosseur d'une paille, et d'une couleur tirant sur le pourpre brun. Les feuilles diffèrent beaucoup en figure et en grandeur ; elles sont divisées quelquefois en trois, d'autres fois en cinq lobes dentés comme une scie, étroits, d'une profondeur inégale et inégalement divisés. Ces feuilles ressemblent en substance, figure et grandeur, à celles de l'urtica mortua, étant plates, minces, un peu raboteuses, d'un verd obscur d'un côté, et d'un verd blanchâtre de l'autre. Elles se sechent vite dès qu'elles sont arrachées, comme font toutes les autres parties de l'arbre. Un nerf unique qui laisse un grand sillon du côté opposé, s'étend depuis la base de la feuille jusqu'à la pointe, d'où partent plusieurs petites veines quasi parallèles qui en poussent d'autres plus petites tournées vers le bord des feuilles, et se recourbant vers elles-mêmes. Les fruits viennent en Juin et en Juillet, des aisselles des feuilles aux extrémités des rejetons : ils tiennent à des queues courtes et rondes, et sont de la grosseur d'un pois et un peu plus, entourés de pois pourprés : ils sont composés de pepins qui sont verdâtres au commencement, et tournent ensuite sur le pourpre brun lorsqu'ils mûrissent. Le fruit est plein d'un jus douçâtre : je n'ai pas observé si ces fruits sont précédés par des fleurs.
Cet arbre est cultivé sur les collines et les montagnes, et sert aux manufactures de papier. Les jeunes rejetons de deux pieds de long sont coupés et plantés à terre à une médiocre distance environ le dixième mois ; ils prennent d'abord racine, et leur extrémité supérieure qui est hors de terre séchant d'abord, ils poussent plusieurs jeunes jets qui deviennent propres à être coupés vers la fin de l'année, lorsqu'ils sont parvenus à la longueur d'une brasse et demie, et à la grosseur du bras d'un homme médiocre. Il y a aussi une sorte de kaadsi ou arbre de papier sauvage, qui vient sur les montagnes désertes et incultes ; mais outre qu'il est rare, il n'est pas propre à faire du papier ; c'est pourquoi on ne s'en sert jamais.
2°. Le faux arbre à papier, que les Japonais nomment katsi kadsira, est appelé par Kaempfer en latin, papyrus procumbens, lactescens, folio longo lanceato, cortice chartaceo.
Cet arbrisseau a une racine épaisse, unique, longue, d'un blanc jaunâtre, étroite et forte, couverte d'une écorce grasse, unie, charnue et douçâtre, entremêlée de fibres étroites. Les branches sont nombreuses et rampantes, assez longues, simples, nues, étendues et fléxibles, avec une fort grande moèlle entourée de peu de bois. Des rejetons fort déliés, simples, bruns et velus aux extrémités sortent des branches ; les feuilles y sont attachées à un pouce de distance plus ou moins l'une de l'autre alternativement : elles tiennent à des pédicules petits et minces, et leur figure ne ressemble pas mal au fer d'une lance s'élargissant sur une base étroite, et finissant en pointe, longue, étroite et aiguë. Elles sont de différente grandeur, les plus basses étant quelquefois longues d'un empan, larges de deux pouces ; tandis que celles du haut de l'arbrisseau sont à peine un quart si grandes. Elles ressemblent aux feuilles du véritable arbre à papier en substance, couleur et superficie, sont profondément et également dentées, avec des veines déliées au dos, dont les plus grandes s'étendent depuis la base de la feuille jusqu'à la pointe, partageant la feuille en deux parties égales. Elles produisent plusieurs veines traversières, qui sont croisées encore par de plus petites veines. Je ne puis rien dire des fleurs ni des fruits, n'ayant pu les voir.
3°. La plante que des Japonais appellent l'oreni, est nommée par Kaempfer alua, radice viscosa, flore ephemero, magno, punico.
D'une racine blanche, grasse, charnue et fort fibreuse, pleine d'un jus visqueux, transparent comme le crystal, sort une tige de la hauteur d'une brasse ou environ, qui est ordinairement simple et ne dure qu'un an. Les nouveaux jets, s'il en vient, après un an sortent des aisselles des feuilles ; la moèlle en est molle, spongieuse et blanche, pleine d'un jus visqueux. La tige est entourée à distances irrégulières de feuilles qui ont quatre à cinq pouces de longueur, cambrée, d'un pourpre détrempé : les pédicules en sont ordinairement creux, charnus et pleins d'humeur.
Les feuilles ressemblent assez à l'alua de Mathiole, tirant sur le rond, d'environ un empan de diamètre, composées de sept lobes divisés par des anses profondes, mais inégalement dentées aux bords, excepté entre les anses : les creneaux ou dents sont grands, en petit nombre, et à une moyenne distance l'une de l'autre. Les feuilles sont d'une substance charnue, pleines de jus ; elles paraissent raboteuses à l'oeil, et sont rudes au toucher, d'un verd obscur. Elles ont des nerfs forts qui partagent chaque lobe également, courant jusqu'aux extrémités en plusieurs veines traversières, roides et cassantes, recourbées en arrière vers le bord de la feuille.
Les fleurs sont à l'extrémité de la tige et des rejetons, et sont d'un pouce et demi de longueur, portées par des pédicules velus et épais, dont la largeur augmente à mesure qu'ils finissent en calice. Les fleurs sont posées sur un calice composé de cinq pétales ou feuilles verdâtres, avec des lignes d'un pourpre brun et velues d'un bord : les fleurs sont aussi composées de cinq pétales ou feuilles d'un pourpre clair, tirant sur le blanc ; elles sont grandes comme la main, et souvent plus grandes : le fond en est fort grand, d'un pourpre plus chargé et plus rouge. Les feuilles des fleurs sont, comme on l'a dit, grandes, rondes et rayées : elles sont étroites et courtes au fond du calice qui est étroit, court et charnu ; le pistil est long d'un pouce, gras, uni et doux, couvert d'une poussière couleur de chair, jaunâtre, couché sur le pistil comme si c'était de petites bossettes ; le pistil finit par cinq caroncules couvertes d'un duvet rouge, et arrondies en forme de globe.
Les feuilles ne durent qu'un jour, et se fanent à la nuit ; elles sont remplacées peu de jours après par cinq capsules séminaires pentagones, faisant ensemble la forme d'une toupie, qui ont deux pouces de longueur, un pouce et demi de largeur, membraneuses, épaisses, tirant sur le noir au temps de leur maturité, que l'on distingue par les cinq capsules où sont contenues un nombre incertain de graines, dix ou quinze dans chacune, d'un brun fort obscur, raboteuses, plus petites que des grains de poivre, un peu comprimées et se détachant aisément.
4°. Le futo-kadsura des Japonais est nommé par Kaempfer, frutex viscosus, procumbens, folio telephii vulgaris aemulo, fructu racemoso.
C'est un petit arbrisseau garni irrégulièrement de plusieurs branches de la grosseur du doigt, d'où sortent des rejetons sans ordre, raboteux, pleins de verrues, gersés et d'une couleur brune. L'arbrisseau est couvert d'une écorce épaisse, charnue et visqueuse, composée d'un petit nombre de fibres déliées qui s'étendent en longueur. Si peu qu'on mâche de cette écorce, elle remplit la bouche d'une substance mucilagineuse. Les feuilles sont épaisses, et attachées une à une à des pédicules minces, cambrés, de couleur de pourpre, elles sont placées sans ordre, et ressemblent aux feuilles du telephium vulgare : étroites au fond, elles s'élargissent, finissent en pointe, et sont de deux, trois ou quatre pouces de longueur, un pouce de largeur au milieu au plus ; un peu roides, quoique grasses ; quelquefois pliées vers le dos, ondées, douces au toucher, d'un verd pâle, avec un petit nombre de pointes, en forme de dents de scie à leur bord ; coupées sur la longueur par un nerf traversé de beaucoup d'autres d'une petitesse presque imperceptible.
Les fruits pendent à des queues d'un pouce et demi de longueur, vertes et déliées : ils sont en forme de grappe, composée de plusieurs baies (quelquefois trente ou quarante) disposées en rond, sur un corps tirant sur le rond qui leur sert de base. Les baies ressemblent parfaitement aux grains de raisin, tirant sur le pourpre en hiver lorsqu'elles sont mûres. Leur membrane qui est mince contient un jus épais, quasi sans goût et insipide ; dans chaque baie on trouve deux graines, dont la figure ressemble à un oignon, un peu comprimées là où elles se touchent réciproquement. Elles sont de la grosseur des pepins des raisins ordinaires, couvertes d'une membrane mince et grisâtre ; leur substance est dure, blanchâtre, d'un goût âpre et pourri, très-désagréable au palais. Les baies sont disposées autour d'une base, tirant sur le rond ou ovale, d'une substance charnue, spongieuse et molle, d'environ un pouce de diamètre, ressemblant assez à une fraise, rougeâtre, d'une rayure relevée en forme de retre, dont les niches paraissent moyennement profondes quand les baies en sont détachées. (D.J.)
PAPIER DE LINGE, c'est là le papier européen, il est nommé papier de linge, parce qu'il se fabrique avec de vieux linge qu'on a porté, qu'on ramasse même dans les rues, et que par cette raison les François appellent vulgairement chiffons ; les manufacturiers nomment ces morceaux de vieux linge drapeaux, drilles, peilles ou pattes.
Ce papier donc se fait avec des haillons de toîle de lin ou de chanvre, pourris, broyés, réduits en pâte dans l'eau, ensuite moués en feuilles minces, carrées, qu'on colle, qu'on seche, qu'on presse, et qu'on met en rames ou en mains pour la vente.
Il faut d'abord observer que les anciens n'ont jamais connu cette sorte de papier. Les libri lintei, dont parle Tite-Live, décad. I. liv. IV. Pline, XIII. c. XIe et d'autres écrivains romains, étaient des livres écrits sur des morceaux de toîle de lin, ou de cannevas préparés à ce dessein, de même que nos peintres s'en servent toujours ; c'est ce qu'a démontré Guillandin dans son commentaire sur Pline, Allatius, et d'autres savants. Voyez Salmuth, ad Pancirolum, liv. II. tit. XIII.
Mais ce n'est pas assez d'être sur que le papier de linge est une invention moderne, on voudrait savoir par quel peuple, et quand cette invention a été trouvée. Polydore Virgile, de inventoribus rerum, l. II. c. VIIIe avoue n'avoir jamais pu le découvrir. Scaliger en donne sans preuve la gloire aux Allemands, et le comte Maffei aux Italiens. D'autres en attribuent l'honneur à quelques Grecs réfugiés à Bâle, à qui la manière de faire le papier de coton dans leur pays en suggéra l'idée. Le P. du Halde a cru mieux rencontrer, en se persuadant que l'Europe avait tiré cette invention des Chinois, lesquels dans quelques provinces fabriquent avec le chanvre du papier à-peu-près de la même manière que l'Occident ; mais l'Europe n'avait point de commerce avec les Chinois, quand elle employa le chiffon en papier. D'un autre côté, si l'invention en était dû. à des Grecs réfugiés à Bâle, qui s'y retirèrent après le sac de Constantinople, il faudrait qu'elle fût postérieure à l'année 1452, dans laquelle cette ville fut prise ; cependant la fabrique du papier de linge en Europe est antérieure à cette époque. Ainsi le jésuite Inchofer, qui la date seulement avec Milius vers l'année 1470, se trompe certainement dans son opinion.
Il est vrai qu'on ne sait rien de précis sur le temps auquel l'Occident commença de faire son papier de chiffon. Le P. Mabillon croit que c'est dans le XIIe siècle ; et pour le prouver, il cite un passage de Pierre de Clugny, dit le Vénérable, qui naquit vers l'an 1100. Les livres que nous lisons tous les jours, dit cet abbé dans son traité contre les Juifs, sont faits de peaux de bélier ou de veau, ou de plantes orientales, ou enfin ex rasuris veterum pannorum ; si ces derniers mots signifiaient le papier tel que nous l'employons aujourd'hui, il y avait déjà des livres de ce papier au XIIe siècle ; mais cette citation unique en elle-même est d'autant plus suspecte, que le P. Montfaucon qui la rapporte, convient que, malgré toutes ses perquisitions, tant en France qu'en Italie, il n'a jamais pu voir ni livre, ni feuilles de papier qui ne fût écrite depuis la mort de saint Louis, c'est-à-dire depuis 1270.
Le comte Maffei prétend aussi que l'on ne trouve point de traces de l'usage de notre papier, antécédente à l'an 1300. Conringius a embrassé le même sentiment dans une lettre où il tâche de prouver que ce sont les Arabes qui ont apporté l'invention de ce papier en Europe. Voyez les acta erudit. Lips. an. 1720.
Je sai que le P. Hardouin croit avoir Ve des actes et diplomes écrits sur le papier européen avant le XIIIe siècle ; mais il est très-probable que ce savant jésuite a pris des manuscrits sur papier de coton, pour des manuscrits sur du papier de lin. La méprise était facîle à faire, car la principale différence entre ces deux papiers consiste en ce que le papier de lin est plus fin ; or on sait que nous avons de ce même papier de différents degrés de finesse, et que c'est la même chose du papier de coton. Voyez Maffei, hist. diplom. lib. II. ou la Bibl. ital. t. II.
Mais enfin on cite trop d'exemples de manuscrits écrits sur notre papier dans le xiv. siècle, pour douter que sa fabrique n'ait été connue dans ce temps-là. Le jésuite Balbin parle de manuscrits sur notre papier qu'il a vus, et qui étaient écrits avant 1340. Un Anglais rapporte dans les Transactions philosophiques, que dans les archives de la bibliothèque de Cantorbery il y a un inventaire des biens d'Henri, prieur de l'église de Christ, qui mourut en 1340, lequel inventaire est écrit sur du papier. Il ajoute que dans la bibliothèque cotonnienne il y a divers titres écrits sur notre papier, lesquels remontent jusqu'à la quinzième année d'Edouard III. ce qui revient à l'année 1335. Voyez les philos. transact. n°. 288.
Le docteur Prideaux nous assure avoir Ve un registre de quelques actes de Jean Cranden, prieur d'Ely, fait sur papier, et qui est daté de la quatorzième année d'Edouard III. c'est-à-dire l'an de Jesus-Christ 1320. Voyez Prideaux, Connect. part. I. l. VII. p. 710.
Le même savant panche à croire que l'invention du papier de linge nous vient de l'Orient, parce que plusieurs anciens manuscrits arabes ou en d'autres langues orientales sont écrits sur cette sorte de papier, et que quelques-uns d'entr'eux se trouvent plus anciens que les dates ci-dessus mentionnées. Enfin M. Prideaux juge qu'il est probable que les Sarrasins d'Espagne ont apporté les premiers d'Orient l'invention du papier de linge en Europe.
Quoi qu'il en soit de toutes les conjectures que nous venons d'exposer, il nous importe encore davantage de connaître la manière de faire le papier de linge. Dans cette vue, je rapporterai d'abord la méthode des Français, qui est la même qu'en Hollande, ensuite j'indiquerai celle d'Angleterre, qui en diffère en quelques points.
Après que les chiffons ont été lavés, on les met tout mouillés pourrir dans des manières de cuves, ou lieux faits exprès, que l'on appelle pourrissoirs, d'où on les tire quand ils sont duement pourris, et propres à être réduits en ouvrage.
Cette première préparation d'où dépend en partie la bonté du papier, étant finie, on met les chiffons ainsi pourris dans des espèces de mortiers, garnis dans le fond d'une plaque de fer qu'on nomme piles à drapeaux, dans lesquelles par le moyen de plusieurs maillets ou pilons, aussi garnis de fer par le bout, qui tombent alternativement dans chaque pile, et à qui des moulins à eau donnent le mouvement, ils sont réduits en une espèce de bouillie ou de pâte, qui est le nom que les ouvriers lui donnent. Cette pâte est ensuite remise de nouveau dans d'autres mortiers qu'on appelle piles à fleurer. Celui qui a le soin des moulins et des piles, s'appelle gouverneur ou gouverneau.
La pâte ainsi disposée, se met dans des espèces de caisses de bois, où elle se séche, et d'où on la retire pour la mettre dans des lieux de réserve. Lorsque l'on s'en veut servir pour fabriquer le papier, on la fait passer pour la troisième fois par un mortier que l'on nomme pîle de l'ouvrier, dont les maillets ne sont point garnis de fer : c'est dans cette troisième pîle où elle prend sa dernière façon.
L'on fait ordinairement de trois sortes de pâte ; la commune ou bule, autrement gros-bon ; la moyenne ou vanante ; et la pâte fine, qui servent suivant leur degré de finesse, à faire du papier, ou très-gros, ou médiocre, ou très-fin.
La pâte perfectionnée, ainsi qu'on vient de le dire, se met dans de grandes cuves pleines d'une eau très-claire et un peu chaude, où elle est remuée et brassée à plusieurs reprises avant que de l'employer, afin que l'eau en soit également chargée, et que le papier qu'on en doit faire soit d'une même finesse. Les moules dans lesquels se fait chaque feuille de papier séparément, et l'une après l'autre, se nomment formes. Ce sont de petits châssis de bois carrés, plus grands ou plus petits, suivant la qualité du papier qu'on fabrique.
Le fond ou châssis, d'un côté est fermé par quantité de menus fils de laiton, très-serrés les uns contre les autres, et joints de distance en distance, par de plus gros fils nommés verjules ou verjures, en deux endroits du fond : justement au milieu de chaque demi-feuille se mettent d'un côté la marque du manufacturier, et de l'autre, une empreinte convenable à la sorte de papier qui se fait, comme des grappes de raisin, des serpens, des noms de Jesus, etc. Comme ces marques ou empreintes sont de fil de laiton, aussi-bien que les verjules, et qu'elles excédent un peu le fond, elles s'impriment dans le papier, et paraissent au jour plus transparentes que le reste. Il y a des manufacturiers assez curieux pour former leurs marques sur les moules avec du menu fil d'argent, en manière de filigrame.
Pour travailler au papier, chaque forme se plonge dans la cuve pleine de l'eau épaissie par la pâte faite de chiffons : lorsqu'on l'en retire, elle se trouve couverte du plus épais de cette matière, le plus clair s'écoulant par les intervalles imperceptibles des fils de laiton ; en sorte que ce qui reste se congéle dans l'instant, et devient assez solide pour que le coucheur (ouvrier destiné à cet effet) puisse renverser la feuille de papier sur le feutre ou porce, c'est-à-dire sur un morceau de revèche, ou autre étoffe de laine écrue.
Tandis que le plongeur fait une seconde feuille de papier, en plongeant une seconde forme dans la cuve, le coucheur couvre la première d'un second feutre, pour recevoir l'autre feuille qui se fabrique, et ainsi successivement, jusqu'à ce qu'il y ait une pîle suffisante de feuilles de papier et de feutres, pour être mises à la presse qui en doit exprimer la plus grande partie de l'eau.
Au sortir de cette presse, l'ouvrier que l'on nomme leveur, lève les feuilles de dessus les feutres, et les met les unes sur les autres sur une planche carrée appelée le drapant ; puis elles sont remises une seconde fois sous la presse, afin de les bien unir, et d'achever d'en exprimer toute l'humidité. Quand elles ont été suffisamment pressées, on les met sécher sur des cordes dans les étendoirs, lieux où l'air se communique à proportion qu'on le juge nécessaire, par le moyen de certaines ouvertures faites exprès, que l'on ouvre et que l'on ferme par des coulisses.
Lorsque le papier est bien sec, on le colle, ce qui se fait en plongeant plusieurs feuilles ensemble dans une chaudière de cuivre, remplie d'une colle très-claire, et un peu chaude, faite de rognures de cuir, ou de ratures et morceaux de parchemin, dans laquelle on jette quelquefois de l'alun de glace, ou de la couperose blanche en poudre.
La meilleure colle est celle du parchemin ; mais soit qu'on se serve de l'une ou de l'autre, le saleran ou séleran, c'est-à-dire le chef de la salle où l'on colle et où l'on donne les derniers apprêts et façons au papier, la doit faire bouillir 16 heures, et ne l'employer qu'après l'avoir coulée à-travers d'une chausse ou drapeau.
Après que le papier est bien et duement collé, on le met en presse afin d'en faire sortir le superflu de la colle, puis on tire les feuilles les unes après les autres pour les jeter sur des cordes qui sont dans les étendoirs, ce qui se fait par le moyen d'un instrument de bois de la figure d'un T, que l'on nomme ferlet ; quand les feuilles sont entièrement séches on les ôte de dessus les cordes, ce que l'on appelle les ramasser, pour les remettre encore sous la presse.
Lorsqu'elles sont retirées de cette presse, on les trie pour séparer les défectueuses d'avec les bonnes : on les lisse avec une pierre légèrement frottée de graisse de mouton, on les plie, on les compte pour en former des mains, et lorsque ces mains sont formées, on les remet de nouveau en presse ; ensuite on les ébarbe (c'est-à-dire que l'on en rogne légèrement les extrémités), et l'on les met par rames, chaque rame s'enveloppant de gros papier que l'on appelle maculature ou trace : enfin après qu'elles sont liées d'une ficelle, on les met pour la dernière fois sous la presse, ce qui est la dernière façon qu'on donne au papier, étant pour lors en état d'être vendu ou employé.
Voici présentement la manière de faire le papier de vieux linge de chanvre et de lin en Angleterre.
Après les avoir préparés, on les apporte dans les moulins à papier, on les sépare en ce qu'on appelle grobin fin, grobin deuxième, grobin troisième, car pour le reste, ce sont des chiffons de laine et de lin, que la saleté empêche de reconnaître jusqu'à ce qu'ils aient été lavés. La façon de les laver, est de les mettre dans un poinçon dont le fond est percé de beaucoup de trous, et qui a sur le côté des grilles faites de fil d'archal qui soit fort : là on remue souvent ces morceaux de linge, afin que la saleté s'en sépare.
Quand ils sont suffisamment lavés, on les met en tas carrés, et on les couvre bien serrés avec des pièces de grosse toîle propre, jusqu'à ce qu'ils suent et s'épaississent, c'est ce qu'on appelle fermentation ; elle se fait ordinairement en 4 ou 5 jours ; si on ne les retirait pas à-propos, ils pourraient se gâter tout à fait, changer de couleur et prendre feu. Quand ils ont bien fermenté, on les tord par poignées, ensuite on les hache avec un instrument de fer tranchant et crochu, qui est stable dans une forme, la pointe en-haut et le tranchant du côté de l'ouvrier, en observant de les tirer à soi, et les couper pièces par pièces d'un pouce et demi de long, ou comme les doigts le permettent.
Les chiffons étant ainsi préparés on les jette dans des mortiers ovales, d'environ 2 pieds de profondeur, faits de bon cœur de chêne : au fond de chaque mortier est une plaque de fer épaisse d'un pouce, large de 8, et longue de 30, qui est façonnée en-dedans comme un moule pour un saumon de plomb avec la tête et la queue arrondie : dans le milieu est un lavoir qui a 5 trous, et un morceau de tamis de crin, attaché en-dedans pour empêcher que les marteaux n'y touchent, et que rien n'en sorte, excepté l'eau sale.
Les mortiers sont fournis d'eau jour et nuit par le moyen de petits augets, qui sont eux-mêmes remplis par l'eau d'une citerne, que leur distribuent des sceaux attachés à chaque rayon d'une roue, tant que la roue tourne.
Les chiffons étant battus dans ces mortiers, deviennent propres à être mis en une presse qui est auprès : on les tire avec de petits sceaux de fer hors de chaque mortier, dont on peut arrêter le marteau sans que les autres cessent d'aller : c'est ce qu'on appelle la première matière.
Cette première matière tirée des mortiers, est mise dans des caisses de bois de 5 pieds de haut, semblables à celles dont se servent les marchands de blé, dont le fond est de planches posées de biais, avec une petite séparation dans le milieu pour écouler l'eau. La pâte de chiffons y étant mise, on ôte du couvercle autant de planches qu'il est nécessaire, et on presse cette masse de pâte à force de bras ; le lendemain on y remet encore de la pâte jusqu'à ce que la caisse soit remplie, et là on la laisse mûrir une semaine, plus ou moins selon le temps. Dans tout ce procédé il faut prendre garde qu'il n'y ait point d'instrument de fer sujet à se rouiller, car il teindrait de rouille la pâte, et gâterait le papier.
Ensuite on met la pâte dans d'autres mortiers, on la bat et on la remet dans des caisses comme devant, et dans cet état on l'appelle la seconde matière. Il faut entendre la même chose d'une troisième préparation qui rend la pâte propre à passer encore dans des mortiers, où elle est battue derechef, jusqu'à ce qu'étant mêlée avec de l'eau claire et brassée çà et là, elle paraisse comme la farine délayée dans de l'eau sans aucuns grumeaux.
La pâte ainsi préparée, on la passe encore une fois dans un mortier creux, dont le marteau n'est pas garni de fer. On fait couler continuellement de l'eau dans ce mortier, par le moyen d'un auget, tandis qu'on travaille à la chaudière. Quand l'eau et la pâte sont absolument incorporées ensemble, on retire la pâte pour la mettre dans la chaudière, et l'on ôte de la pâte des caisses pour en remettre dans le mortier, et ainsi successivement.
La chaudière est préparée suivant les règles, quand la liqueur a acquis une telle proportion de pâte que le moule, étant trempé dedans, en emporte autant qu'il en faut pour une feuille de l'épaisseur qu'on la veut. Un moule est une grille carrée d'un pouce d'épaisseur, dont le fond est fait de fil de laiton, soutenu de petites barres de bois pour empêcher qu'il ne cave, et le tenir parfaitement horizontal ; car s'il creusait quelque part, une partie de la feuille serait plus épaisse que l'autre.
Le plongeur trempe ce moule dans la chaudière, et le retire en le remuant, afin que l'eau qui est dans la pâte s'écoule par la grille : dans cet état il le donne au coucheur, qui couche la feuille sur un feutre posé sur une planche, et met un autre feutre par dessus, et ainsi successivement une feuille et un feutre, une feuille et un feutre jusqu'à ce qu'il y en ait de quoi remplir une pressée, c'est-à-dire environ 6 mains : on fait au moins 20 pressées par jour. Le coucheur ayant fait son office, rend le moule au plongeur, et le plongeur au coucheur successivement.
Quand il y en a plein une presse de fait, le plongeur ou le coucheur donne un coup de sifflet qui fait venir 4 ou 5 ouvriers, dont un tire la pîle sous la presse avec deux petits crochets, et les autres la pressent fortement jusqu'à ce qu'il n'y reste plus d'eau, ce qui se fait promptement en 2 ou 3 secousses.
Cela fait, on tire la pîle hors de la presse, et on la met au côté droit du siege du leveur : alors le leveur ôte le premier feutre, le rend au coucheur, et met la première feuille sur le siege : sur cette feuille il en met une seconde, ensuite une troisième, et continue de la sorte jusqu'à ce que tout soit levé. Ce tas est laissé là jusqu'au soir : alors on presse une seconde fois tout l'ouvrage du jour, et on le met exactement l'un sur l'autre, de façon que cela ressemble à un monceau de pâte solide.
Après que ce monceau a reçu 2 ou 3 coups de presse, comme ci-devant, le sécheur le retire, le porte dans une chambre faite exprès, et étend 6 ou 7 feuilles ensemble sur des cordes attachées à une machine appelée trible, chaque trible contenant 30 cordes de 10 ou 12 pieds de long.
Quand il est séché on le retire, on le met sur un siege à 3 pieds : dans cet état on l'adoucit avec les mains, ensuite on le met en monceau de 7 ou 8 pieds de haut, dans un lieu bien sec, où il reste jusqu'à ce qu'on le colle, c'est la dernière préparation.
On choisit un jour clair et sec : on met dans une chaudière 2 barrils d'eau, et quand elle commence à être chaude, on y jette 60 livres de rognures de parchemin, ou raclures de vélin, qu'on y fait bouillir jusqu'à ce qu'elles soient réduites parfaitement en colle, alors on la passe à-travers une chausse, et sur le tout on répand une dose convenable de vitriol blanc, et d'alun de glace réduit en poudre très-fine, dans un vase d'un pied de profondeur : auprès de ce vase on apporte 5 ou 6 rames de papier, on en trempe dans la colle une certaine quantité, à-peu-près autant qu'on en peut prendre à la fois avec les mains, et par un certain maniement vif et prompt, ils font en sorte que chaque feuille est collée. Après cela on met le tout en presse : le tout étant pressé, on l'ôte et on le transporte dans le séchoir, où on l'étend ordinairement feuille par feuille, jusqu'à ce qu'il soit sec. Mais il faut avoir soin que les rayons du soleil ne donnent pas directement dessus, avant que le tout soit sec, car autrement le soleil pourrait faire évaporer la colle. Dès que le papier est entièrement sec, on le retire, on l'adoucit, on le polit avec les mains comme auparavant, on le met en pile, on le presse fortement, et on le laisse dans cet état passer la nuit. Le lendemain matin on le retire et on le porte au magasin pour le trier : ce qui est pour le dedans des mains est mis à part, ce qui est dessus pareillement ; ensuite on le presse encore, et on le laisse ordinairement toute la nuit dans cet état.
Le lendemain matin on l'arrange par main de 24 ou 25 feuilles chacune, on le plie, on le met en monceau, et quand il y a une presse pleine, on le presse encore en double tout de suite, et alors on l'arrange en rames de 20 mains chacune, et en ballot de 10 rames chacune. Voyez Hought, collect. tome II. p. 412.
Les feuilles rompues se mettent ordinairement ensemble, et on met deux mains à chaque côté de la rame : cela fait, on les enveloppe avec le papier fait de l'écume de la chaudière, et dans cet état il est propre à être vendu.
Avec cette pâte dont nous venons de parler, on fait aussi le carton de la même manière que le papier, excepté qu'il est plus épais. Voyez CARTON.
Avec une certaine sorte fine de ce carton, on fait des cartes pour jouer. Voyez CARTES.
Avec de l'eau, où l'on a jeté différentes couleurs détrempées avec de l'huîle et du fiel de bœuf, on fait le papier marbré. Voyez PAPIER MARBRE.
Les manufactures de papier se sont multipliées dans presque toute l'Europe ; cependant la France, la Hollande, Gènes et l'Angleterre sont les pays où on le fait le mieux. En général il dépend beaucoup de la qualité du linge dont on se sert dans les lieux où on fabrique le papier : car selon que l'on porte le linge fin, grossier, ou peu blanc, etc. les morceaux ou chiffons, et conséquemment le papier qui en résulte, doivent avoir les mêmes qualités. C'est pour cela que les papiers de Hollande et de Flandres sont plus blancs que ceux d'Italie et de France, et beaucoup plus que celui d'Allemagne.
La Grande-Bretagne, dans le dernier siècle, tirait presque tout son papier de l'étranger. Elle ne date son premier moulin de papier, bâti à Dartfort, que de l'an 1588. Un poète de ce temps-là le consacra par des vers à son honneur : présentement l'Angleterre a compris que la vraie consécration des choses utiles consistait à les multiplier ; aussi tire-t-elle aujourd'hui peu de papier de l'étranger. Cependant elle pourrait encore perfectionner beaucoup ses papeteries, et les étendre davantage dans les trois royaumes, à l'imitation de la Hollande qui fait le plus beau papier du monde, et en plus grande quantité. (D.J.)
PAPIER, (Chimie, Mat. méd.) on en retire à la distillation à la violence du feu un esprit qui n'est autre chose qu'un alkali volatil, résous, très-foible et très-délayé, et gras ou huileux, provenu en partie du linge et en partie de la colle employée à la préparation du papier, et une huîle empyreumatique provenue des mêmes sources. On a érigé en remède particulier cet esprit et cette huile, auxquels c'est assurément faire assez d'honneur que d'attribuer les propriétés les plus communes des esprits alkalis volatils, et des huiles empyreumatiques. Voyez SEL VOLATIL et HUILE EMPYREUMATIQUE.
Tout le monde connait aussi l'usage de la fumée du papier brulant, principalement sans flamme, contre les vapeurs hystériques, l'espèce de vertige que certaines odeurs causent à beaucoup de sujets, les évanouissements, etc. Ce secours populaire est souvent très-efficace dans ces cas, et un des meilleurs qu'on puisse employer. (b)
PAPIER MARBRE, (Arts) le papier marbré est un papier peint de diverses nuances, ou de différentes couleurs. Il se fait en appliquant une feuille de papier sur de l'eau où on a détrempé diverses couleurs avec de l'huîle et du fiel de bœuf, qui empêche le mélange : selon la disposition qu'on leur donne avec un peigne, on forme les ondes et les panaches. Voici de quelle manière se fait le papier marbré en Angleterre.
On prépare un auget de la forme et de la grandeur du papier qu'on veut marbrer, et de 4 doigts de profondeur, fait de plomb ou de bois, bien joint et enduit de façon qu'il puisse contenir la liqueur. Pour la liqueur, on fait tremper un quarteron de gomme adragant pendant 4 ou 5 jours dans de l'eau claire : on la remue de temps en temps, et on y ajoute tous les jours de l'eau nouvelle, jusqu'à ce qu'elle ait un peu moins de consistance que l'huile, alors on la jette dans le petit auget.
Les couleurs qu'on doit appliquer par-dessus sont, pour le bleu, de l'indigo broyé avec du blanc de plomb : pour le verd, l'indigo et l'orpiment, l'un broyé et l'autre détrempé, mêlés et qui ont bouilli ensemble dans l'eau commune : pour le jaune, l'orpiment broyé et détrempé : pour le rouge, la laque la plus fine broyée avec des raclures de bois de Brésil, qui ont été préparées en bouillant une demi-journée. Dans toutes ces couleurs on mêle un peu de fiel de bœuf, ou de poisson, qui a vieilli 2 ou 3 jours. Si les couleurs ne s'étendent pas bien d'elles-mêmes, on y ajoute un peu plus de fiel ; au contraire si elles s'étendent trop, il faut surcharger le fiel et le corriger, en y ajoutant de la couleur sans fiel.
Voici l'opération de marbrer : quand la gomme est bien reposée dans l'auget, on déploie une feuille de papier que l'on détrempe sur la superficie de la liqueur, et on la retire aussitôt afin de l'agiter et de faire monter le sédiment de la gomme vers la surface, et que la liqueur en soit plus universellement imprégnée. Cela fait, et toutes les couleurs étant rangées dans des pots de fayance, sur une table où est aussi placé l'auget, on commence par tremper un pinceau de soies de cochon dans chaque couleur, ordinairement le bleu le premier, et on en répand sur la surface de la liqueur. Si la couleur est bien préparée, elle se dilatera d'elle-même. Ensuite on applique le rouge de la même manière, mais avec un autre pinceau ; ensuite le jaune, et enfin le verd : pour le blanc, il se fait en répandant par-dessus la liqueur un peu d'eau claire, mêlée avec du fiel de bœuf.
Lorsque les couleurs flottent ainsi sur la liqueur, pour leur donner ces nuances agréables que nous admirons dans le papier marbré, on se sert d'un bâton pointu qu'on enfonce dans la liqueur, en tirant d'un bout à l'autre de l'auget avec adresse, et en faisant que ce bâton agite la liqueur et les couleurs qui surnagent : alors avec un peigne qu'on tient avec les deux mains par la tête, on peigne la surface de la liqueur dans l'auget d'un bout à l'autre, observant seulement de n'enfoncer que les dents. Si cette opération est faite avec un mouvement prompt et uniforme, elle produit ces nuages et ces ondulations, d'où dépend beaucoup la beauté de ce papier.
Si on aime mieux que les couleurs représentent des figures de fantaisie, comme des serpens et autres semblables, cela se fait par le moyen du bâton pointu dont nous avons parlé ci-dessus, en traçant ces figures par-dessus ce qui a déjà été peigné ; il faut pour cet effet avoir la main adroite, et agiter la superficie de la liqueur en rond, comme si on voulait tracer quelque fleur, ou figurer des lettres.
Enfin les couleurs étant dans cet état, l'ouvrier déploie et applique par-dessus une feuille de papier blanc mouillé : cela demande dans l'ouvrier une adresse que l'usage seul peut donner, car il faut que le papier et la surface de la liqueur se rencontrent par-tout. Ensuite avant que les couleurs aient le temps de pénétrer, ce qui arriverait bientôt, à moins que le papier ne fût fort épais, ils enlèvent ce papier avec agilité et d'une même main, et ensuite l'étendant quelque temps sur une planche, ils le suspendent après sur une corde pour le faire sécher. Quand il est suffisamment sec, on le polit avec une pierre de marbre, ou un morceau d'y voire.
Il faut observer qu'on doit renouveller les couleurs de l'auget, et toutes les autres formalités avec le bâton pointu et le peigne, chaque fois qu'on veut appliquer un nouveau papier, parce que chaque feuille de papier emporte toute la couleur qui flotte sur la liqueur. Voyez Kircher, de luce et umbra, lib. X. Merret sur Neri, de arte vitr. ch. xlij. Hought, collect. t. II. p. 419. et seq.
On a essayé quelquefois de rendre le papier marbré plus riche, en mêlant l'or et l'argent avec les couleurs, ce qui a bien réussi principalement pour la bibliothéque des rois de France : cependant la grande dépense a empêché que cette manufacture n'ait eu lieu.
Toute cette opération est tirée de Chambers. Il est surprenant qu'on ne trouve dans Savari aucun détail sur l'art de marbrer le papier. Voyez l'article MARBREUR DE PAPIER, où cet article est décrit plus au long. (D.J.)
PAPIER, COMMERCE DU (Commerce) le papier est un objet d'un grand commerce ; il y en a différentes sortes ; eu égard à la couleur, on le divise en blanc, brun et bleu, etc. Par rapport à la qualité, on le divise en fin, second, bâtard, superfin, etc. Par rapport à l'usage, on le distingue en papier à écrire, à imprimer, à estampes, à cartouches, à patron, de chancellerie, etc. Par rapport aux dimensions, on le divise en moyen, à la couronne, au bonnet, au pot, royal, surroyal, impérial, éléphant, atlas. Par rapport aux pays où on le fabrique, on le divise en Allemand, Lombard, papier d'Hollande, de France, d'Angleterre, de Gènes, etc.
Il parait que par-tout le papier se vend par rames, excepté dans les manufactures d'Auvergne, où il se vend au poids sur le pied de quatorze onces la livre : chaque rame selon son espèce devant être d'un certain poids, suivant les règlements.
Le papier de France, se divise en grand, moyen et petit. Les petites sortes sont la petite romaine, le petit raisin ou bâton royal, le petit nom de jésus, le petit à la main, etc. qui prennent leur nom de la marque qu'on y empreint en les faisant ; le cartier propre à couvrir par-derrière les cartes à jouer. Le pot dont on se sert pour le côté de la figure : la couronne qui porte ordinairement les armes du controleur-général des finances : celui à la tellière qui porte les armes de M. le chancelier. Le tellier est un double T ; le champy ou papier à châssis ; et la serpente ainsi nommé, à cause d'un serpent dont il est marqué ; comme ce dernier est extrêmement fin, il sert aux éventaillistes.
Les moyennes sortes sont, le grand raisin simple, le carré simple, le cavalier et le lombard, dont les trois derniers servent pour l'impression ; l'écu ou de compte simple, le carré double, l'écu double, le grand raisin double, et la couronne double, dont les trois derniers sont appelés doubles, à cause de leur épaisseur : ajoutez à ceux-là, le pantalon ou papier aux armes d'Hollande, et le grand cornet, ainsi appelé à cause de sa marque.
Les grandes sortes sont, le grand jésus, petit et grande fleur de lis, le chapelet, le colombier, le grand aigle, le dauphin, le soleil et l'étoile, ainsi nommés à cause des marques qui y sont empreintes ; ils sont propres à imprimer des estampes et des thèses, même à faire des livres de marchands et à dessiner ; le grand monde est le plus large de tous.
Outre ces papiers que l'on appelle les trois sortes, et qui servent tous à l'écriture ou à l'impression, il s'en fabrique encore d'autres de toutes couleurs, soit collés, soit sans colle, pour envelopper différentes marchandises, et pour d'autres usages.
Indépendamment de la consommation du royaume, il s'en fait aussi des envois considérables dans les pays étrangers, comme dans le Nord, au Levant, et même dans les Indes orientales ; mais cette consommation dans l'étranger est prodigieusement diminuée depuis le commencement de ce siècle ; car on comptait autrefois cinquante-cinq moulins à papier, travaillans dans la seule province d'Angoumais, et aujourd'hui l'on n'en compte pas trente ; on doit dire la même chose des moulins à papier des autres provinces.
Les règlements de M. Colbert sur cette fabrique, quoique fort sages en général, auraient aujourd'hui besoin de plusieurs corrections ; mais il faudrait porter principalement ses vues à l'accroissement des papeteries dans le royaume. Celle de Montargis qui s'était élevée il y a trente ans, méritait d'être soutenue ; il en faudrait établir de nouvelles dans le Lyonnais, et autres provinces voisines. (D.J.)
PAPIER D'ASBESTE, (Arts) ce papier fait d'asbeste, autrement dit de lin incombustible, lapis asbestos, peut supporter le feu sans être endommagé. Le docteur Brukmann, professeur à Brunswick, a imprimé une histoire naturelle de l'asbestos dont on tire ce papier ; et ce qu'il y a de plus remarquable, il a fait tirer quatre exemplaires de son livre sur ce papier, ils sont dans la bibliothéque de Wolfembutel. Voyez Bibl. Germ. t. XIV. p. 190.
La manière de fabriquer ce papier extraordinaire, est décrite par M. Lloyd, d'après ses épreuves. Il broya une certaine quantité d'asbestos dans un mortier de pierre, jusqu'à ce qu'elle fût réduite en une substance cotonneuse ; ensuite il le passa dans un tamis fin, et par ce moyen le purgea le mieux qu'il put de ses parties terrestres ; car la terre et les pierrettes qu'il n'aurait pas pu enlever auparavant, étant réduites en poudre, passèrent à-travers le tamis, et il ne resta que le lin ou coton ; ensuite il porta sa matière dans un moulin à papier, et la mettant dans l'eau dans un vase assez grand précisément pour faire une feuille avec une certaine quantité ; il la remua suffisamment, et ordonna à l'ouvrier de l'employer à part avec la méthode ordinaire dont on use pour la fabrique du papier à écrire ; il lui recommanda seulement de la remuer toujours avant que de la mettre dans le moule ; parce qu'il considéra que la substance en étant beaucoup plus pesante que celle dont on se sert pour le papier ordinaire ; elle se précipiterait au fond, si on ne la remuait pas immédiatement avant de la mettre dans le moule. Enfin, on en fit du papier sur lequel on écrivait comme sur le papier de chiffons, et l'écriture s'en effaçait en le jetant dans le feu, d'où on le retirait sans être plus endommagé que la toîle d'asbeste ; mais ce papier était grossier et se cassait fort aisément ; cependant si la chose en valait la peine, il ne serait pas impossible en triturant fort longtemps la matière dans les mortiers, d'en former une pâte aussi fine que celle du papier de linge ; mais comme ce serait une chose couteuse, on ne doit la regarder que sur le pied d'une invention de pure curiosité. Philos. Trants. n°. 166.
PAPIER, (Ecriture) Le papier à écrire pour être bon doit avoir les qualités suivantes : la première et la principale, c'est d'être bien collé, ferme et pesant ; celui qui ne sonne pas clair, qui est mou, faible et lâche au maniement n'est pas bien collé, est conséquemment d'un mauvais usage ; il faut qu'il ait le grain délié, qu'il soit net, uni, sans taches ni rides, afin que la plume coule dessus facilement ; il faut regarder aussi à ce qu'il n'y ait ni filets, ni poils ; ces poils entrant dans la fente du bec de la plume, rendent l'écriture boueuse. Il faudrait encore qu'il fût blanc ; mais le papier le plus blanc n'est pas ordinairement le mieux collé. Tout étant égal d'ailleurs, le plus anciennement fabriqué sera préférable.
Manière de laver et de vernir le papier pour écrire : il faut avoir du papier de la qualité qu'on vient de prescrire ; on l'étend tout ouvert sur un ais bien net, et après avoir mis du vernis battu, autrement dit, sandarac, dans une écuelle ou terrine, on en frottera légèrement toutes les feuilles avec une patte de lièvre ; puis ayant mis dans un chauderon bien net six pintes d'eau, mesure de Paris, qui suffiront pour laver une rame ; on fera fondre sur le feu huit onces d'alun de roche, et une once de sucre candi blanc ; et après avoir fait bouillir le tout un bouillon, on le retire de dessus le feu ; et lorsque l'eau est tiede, on en lave le papier feuille à feuille avec une éponge fine, du côté qu'il a été vernis ; on pose ces feuilles les unes sur les autres ; et quand toute la rame est lavée, on la met en presse l'espace d'un demi jour, ou du soir au lendemain ; après quoi, on l'étend sur des cordes feuille à feuille pour qu'il seche ; lorsqu'il est à demi-sec, on le remet une seconde fois en presse pendant quelques jours, afin de le bien étendre ; de-là il passe chez le relieur pour être battu, il ne faut se servir de ce papier que trois ou quatre mois après qu'il a été ainsi préparé. Plus il est gardé, meilleur il est ; le papier battu pour écrire des lettres doit être frotté avec le sandarac, si l'on ne veut pas que l'encre s'épatte.
PAPIER BLANC, terme d'Imprimeur ; c'est le premier côté de la feuille qu'on couche sur la forme pour l'impression.
PAPIER BLEU, (Papeterie) papier qui sert aux Marchands à envelopper différentes marchandises ; le gros papier bleu est employé aux pains de sucre, le fin aux pièces de toile, à couvrir les brochures ou livres en feuilles, etc. il y en a encore de plus fin qui sert à d'autres usages. (D.J.)
PAPIER BRILLANT, ou à fleurs et figures brillantes ; c'était une sorte de papier que le sieur Papillon avait trouvé le secret de rendre très-agréable, soit qu'il l'eut inventé ou qu'il ne l'eut que perfectionné ; voici d'abord ce qu'il faisait. A deux onces de colle de poisson qu'il mettait tiédir et fondre, il ajoutait le double d'amidon qu'il délayait bien, en tournant jusqu'à ce qu'il n'y eut point de grumeaux et que tout fût bien mêlé ; il laissait reposer jusqu'au lendemain, que voulant s'en servir, il faisait derechef tiédir ; puis ayant poncé légèrement avec du charbon presque impalpable le dessein piqué qu'il voulait faire avec un pinceau, et de cette colle ci-dessus et tiéde, il dessinait toutes les fleurs du dessein piqué : ensuite il semait dessus du brillant d'une seule couleur qui ne s'attachait qu'aux endroits où avait passé le pinceau, et ayant laissé sécher, en époussetant la feuille le brillant ne restait qu'au dessein ; mais pour mettre sur une feuille plusieurs brillans de couleurs différentes, il se servait de patrons découpés par parties séparées, couchant à-travers sa colle avec une brosse ou gros pinceau sur la feuille chaque partie ; semée ensuite du brillant de la couleur qu'il voulait, séchée et époussetée, il procédait à coucher la colle à-travers un autre patron, et à mettre ensuite un brillant d'une autre couleur, faisant ainsi successivement jusqu'à ce que tous les brillans de différentes couleurs fussent appliqués sur la feuille, laquelle achevée devenait extrêmement riche : mais il fallait pour employer ce papier le coller très-proprement ; car la colle ordinaire qu'on mettait par-derrière pour le pouvoir poser, détrempait assez vite la colle des brillans, ce qui faisait barbouiller tout l'ouvrage ; il faisait aussi de la toîle avec mêmes brillans et de la même façon.
PAPIER BROUILLARD, (Papeterie) le papier brouillard ou papier gris, est un papier qui n'a pas été collé, et sur lequel par conséquent l'encre flue et s'étend ; on s'en sert dans les livres de compte, au lieu de sable, pour empêcher l'encre de gâter la feuille opposée ; ce même papier est aussi d'usage chez les Droguistes et Apoticaires pour filtrer les liqueurs, auxquelles la chausse d'Hypocras n'est pas si propre. (D.J.)
PAPIER DE COULEUR tout uni ; c'est un papier qui se fait avec une grosse brosse et de toutes sortes de couleurs ; c'est ordinairement de la couronne bule, qu'on y emploie préférablement au champi, qui n'est pas assez collé, et qui empêcherait non-seulement les couleurs de paraitre vives et belles, mais qui ne manquerait pas de tacher aux places où il boirait ces couleurs. Toutes ces couleurs sont liquides et sans corps, la plupart afin de pouvoir être couchées plus uniment.
Les ouvriers qui font ce papier ont la couleur proche d'eux dans une grande terrine ; et avec une brosse telle que celle des Cartiers, ils prennent de la couleur pour chaque feuille, faisant aller et venir la brosse de tout côté, le moins par goutte et le plus uniment qu'ils le peuvent ; puis ils étalent à mesure ce qu'ils ont fait, continuant à mettre la couleur tant qu'il reste de papier à la main, qu'ils ont déplié et mis devant eux tout en un tas sur la table ou l'établi où ils travaillent. Ce sont les marchands Papetiers qui vendent communément ces papiers tout d'une couleur. Pour faire le jaune, les ouvriers usent de la graine d'Avignon ; pour le rouge, de bois de Brésil, dit de Fernambouc ; pour le bleu, celui de tournesol et l'indigo ; pour le vert, celui de vessie ; pour l'oranger un jaune, mêlangé de mine de plomb ou d'autre rouge ; pour la couleur de bois, de la bistre, du brou de noix ou du jaune de graine d'Avignon, mêlé avec un peu de violet de bois d'inde : ils y emploient aussi la terre d'ombre ; le bois d'inde leur sert à faire le violet, qu'ils rendent d'un oeil rougeâtre, y mêlant du rouge de Brésil. Le noir, ils le font, soit avec le noir d'os, soit avec celui d'ivoire ou autre, mais rarement avec celui de fumée, parce qu'il ne se couche pas si bien. Ils font encore quelquefois des rouges différents avec le vermillon et avec la lacque liquide, du vert clair avec du vert de gris, mêlangé avec celui de vessie, et plusieurs autres couleurs, composées suivant qu'ils les éclaircissent ou qu'ils savent les mélanger. Voyez COULEURS A DETREMPER, LIQUIDES et SANS CORPS, etc.
PAPIER A DESSINER, (Papeterie) papier blanc sur lequel on a passé une éponge imprégnée d'eau de suie ; son usage est pour exempter l'ouvrage du crayon dans les endroits où le papier doit être chargé d'ombres de la couleur de ce papier ; pour les endroits clairs, on les fait dessus avec de la chaux blanche ; éléments de peinture. (D.J.)
PAPIER DOMINOTE. Voyez DOMINO, DOMINOTERIE, DOMINOTIER et RECALEUR.
PAPIER DORE et ARGENTE ; il y a de plusieurs façons de papier doré ; savoir, celui à fleurs ou fonds d'or qui se fait en Allemagne, mais dont l'or n'est que du cuivre, au lieu que celui d'argent fabriqué dans le même pays est d'argent fin ; car celui qui se fait avec de l'étain est d'un oeil si plombé, qu'on n'en fait pas de cas ; ces sortes de papiers se fabriquent à Francfort, à Nuremberg, etc. Le papier doré sur tranche est du papier à lettre.
Le papier doré par petit feuillet et fait d'or fin, sert à plusieurs ouvrages, particulièrement dans les couvens de religieuses qui en ornent des reliquaires, de petits tableaux de dévotion et autres choses ; employant aussi au même usage du papier argenté et des cartons dorés sur tranche, fabriqués par petites bandes, avec lesquelles elles exécutent tous ces petits rouleaux dorés qui sont dans les reliquaires et autres ouvrages de leurs mains. Ces papiers, tant dorés qu'argentés, aussi-bien que les cartons qu'on vient de dire, se fabriquent à Paris. Mais à l'égard du papier doré d'Allemagne, on ne l'imite point ici par la grande raison, que tirant le cuivre en feuille de cette contrée, il deviendrait trop cher. Ce papier se fait avec des planches de cuivre jaune évidées, bien en fond, autour des masses et des contours gravés ; les feuilles de cuivre appliquées partout sur la feuille de couleur qu'on veut dorer sont posées sur la planche de cuivre qui doit être chaude, comme à-peu-près le sont les fers dont se servent les Doreurs de couvertures de livres quand ils les emploient ; puis passant le tout entre deux rouleaux ou cylindres, tels que peuvent être ceux de la presse en taille-douce, la planche en gaufrant le papier fait attacher l'or ou l'argent dessus, puis la feuille, étalée pour la laisser refroidir et sécher, s'époussette pour en ôter tout l'or des endroits où n'ont point marqué les ornements, figures et traits de la planche de cuivre, ce qui la perfectionne et la met en état d'être vendue.
PAPIER D'ÉVENTAIL, (Eventaillistes) les Eventaillistes se sont partagés les différentes opérations de leur art ; les uns ne font que des bois d'éventails, les autres les peignent et dorent ; d'autres ne font que peindre les feuilles ; d'autres qui sont ceux dont il est question dans cet article, préparent les papiers que les autres emploient : d'autres enfin font commerce, sans travailler par eux-mêmes, quoiqu'ils aient tous également et indistinctement le droit de travailler à toutes ces sortes d'ouvrages. Ceux qui travaillent au papier, et qu'on pourrait appeler proprement Papetiers éventaillistes, les doublent ; c'est-à-dire, collent ensemble avec une colle légère deux feuilles de papier de serpente, de la qualité qui convient à l'ouvrage auquel elles sont destinées ; cependant une des deux feuilles est toujours plus belle que l'autre et sert d'endroit à l'éventail ; c'est sur ce côté qu'on fait les plus belles peintures. Pour coller ensemble les deux feuilles de papier, on commence par en coller une par les bords sur un cercle de bois vide, composé d'un demi cerceau et d'une règle, sur lesquels on la colle avec de l'empois ou autre colle de même nature ; on mouille légèrement le papier avec une éponge pour que l'humidité le fasse étendre, et séchant comme la peau d'un tambour ; en cet état, on laisse sécher le papier ; lorsqu'il est sec, on applique dessus la seconde feuille enduite de colle du côté qu'elle s'applique à la première ; on la lave bien avec une éponge, et on la laisse sécher. Voyez la Planche de l'Eventailliste, dont voici l'explication.
Vignette, femme qui colle des papiers sur des cercles ; papier pour coller.
2. Homme qui apporte le papier.
3. Ouvrier qui colle la seconde feuille de papier qui est l'envers sur la première.
4. Ouvrière qui enduit de colle avec un pinceau, la feuille de papier qui doit servir d'envers.
6. Homme qui tient un papier ployé.
7. Ouvrier qui passe le papier à la lisse, qui est faite à-peu-près comme la presse en taille-douce, composée de deux rouleaux entre lesquels passe une table de bois sur laquelle est une platine de cuivre c sur laquelle est un papier d'éventail ; le rouleau supérieur qui est garni de linges est mu par une roue que l'ouvrier fait tourner.
9. et 10. Cercles.
11. Papier collé sur un cercle.
12. Ais sur lequel est un papier collé par les bords avec de la gomme arabique, prêt à peindre.
13. Cercles avec des papiers dessus.
14. Modele d'un éventail ; la gorge.
15. Papier collé sur un ais, sur lequel on a tracé la forme du modèle.
16. Table à sabler les papiers, c'est-à-dire les couvrir sur une couleur dont ils ont été enduits d'une poussière d'or ou d'argent, au moyen d'un sac avec lequel on la répand uniformement sur tout le papier ; le fond de la table qui est entourée du rebord ; le papier ; le sac où est la poussière. Voyez AVANTURINE.
17. Pîle de cercles garnis de papier.
18. Papier rayé sur la forme à salper.
PAPIERS ET ENSEIGNEMENS, (Marine) ce sont tous les papiers et manuscrits qui se trouvent dans un vaisseau ; les papiers et enseignements du vaisseau échoué.
Papier de cartouche ou de gargousse, c'est de gros papier gris dont on se sert pour faire les gargousses : on le forme sur un moule, puis on l'emplit de mitrailles. (Q)
PAPIER, terme de Miroitier, c'est une longue bande de papier fort, composée de plusieurs morceaux collés ensemble, dont la largeur n'est guère que de sept ou huit pouces, et la longueur proportionnée au volume des glaces qu'on veut étamer, en sorte néanmoins qu'elles les passent de huit ou dix pouces de chaque côté. Ce papier sert à couvrir le bord de devant de la feuille d'étain après qu'elle a été chargée de vif-argent, afin d'y poser la glace, et qu'en la glissant, la feuille ne puisse être endommagée. Savary. (D.J.)
PAPIERS, (Reliure) les Relieurs mettent entre le carton et les feuilles du livre qu'ils relient une ou deux feuilles de papier blanc pour conserver les livres et éviter qu'ils ne se gâtent contre le carton ; souvent ils y mettent du papier marbré dont un feuillet est collé contre le carton, l'autre contre un feuillet de papier blanc.
Quelquefois ils usent de papier doré en place de papier marbré, et d'autres fois de satin ou autres étoffes, comme du tabis ou du maroquin, alors cela s'appelle doubler. Voyez DOUBLER.
PAPIER-REGLE, (Manufacture en soie) pour les desseins d'étoffes, de rubans et galons, c'est du papier imprimé d'après une planche gravée, qui représente seulement un nombre infini de lignes perpendiculaires, toutes coupées par des lignes horizontales sans nombre, ce qui forme une très-grande quantité de carrés parfaits ; voici comme la chose s'exécute. On prend une mesure de cinq ou six lignes, plus ou moins, suivant la grosseur ou la finesse que l'on veut donner au papier, par ces mesures répétées tant que la planche le peut permettre, tant perpendiculairement qu'horizontalement, on tire des lignes qui donnent par conséquent cinq à six lignes en carré ; ces carrés sont à leur tour traversés à égales distances par neuf autres lignes, mais beaucoup plus déliées que les premières, ce qui forme cent petits carrés égaux dans chaque carré qui est marqué par une ligne plus forte, et c'est ce qu'on appelle papier de dix en dix, pour le distinguer de celui qui sert aux Gaziers, et qui est appelé de huit en dix, parce que chaque carré n'en contient que quatre-vingt petits. On se sert de papier d'une extrême finesse pour les desseins que j'ai appelé représentatifs, voyez PATRON, parce qu'il est plus aisé de donner le contour que l'on souhaite sur ce papier fin, les angles qui terminent chaque carré étant moins sensibles ; le papier plus gros étant réservé pour les desseins ou patrons, que j'ai appelé au même article desseins démonstratifs : voici la façon dont on se sert pour dessiner sur ce papier. On emplit d'encre tous les petits carrés qui exprimeront les figures du dessein, qui sont toujours quelques figures d'ornements, ou de fleurs, même de figures humaines ; les points qui restent blancs marquent les découpés desdites figures, et expriment par conséquent le fond.
PAPIERS ROYAUX, (Politiq. et Comm.) ce sont tous ceux que le roi a créés, et avec lesquels il a payé ses sujets, au défaut d'argent monnoyé ; celui qui trouverait un bon projet pour l'acquit des papiers royaux, rendrait un service important à l'état ; le crédit du monarque tient à la manière dont il sortira de cette espèce d'engagement.
PAPIER TERRIER, (Jurisprudence) on appelle ainsi le registre qui contient toutes les déclarations passées au terrier d'un seigneur censier. Voyez TERRIER et DECLARATION, CENS, CENSIVE.
PAPIER ET PARCHEMIN TIMBRE, est celui qui porte la marque du timbre, et qui est destiné à écrire les actes publics dans les pays où la formalité du timbre est en usage.
Le timbre est une marque que l'on appose aux papiers et parchemins destinés à écrire les actes que reçoivent les officiers publics.
Quelques auteurs le définissent en latin signum regium papyro impressum, parce qu'en effet il représente communément les armes du prince ou quelque autre marque par lui ordonnée selon la qualité particulière de l'acte et le lieu de la passation.
Le nom de timbre que l'on a donné à ces sortes de marques parait avoir été emprunté du blason, et tirer son étymologie de ce que le timbre s'imprime ordinairement au haut de la feuille de papier ou parchemin, comme le casque ou autre couronnement, que l'on nomme aussi timbre, en terme de blason, se met au-dessus de l'écu.
Je ne dis pas indistinctement que le timbre s'appose au haut de la feuille, mais seulement qu'on l'appose ainsi ordinairement ; car quoique l'usage soit de l'imprimer au milieu du haut de la feuille, la place où on l'appose n'est point de l'essence de la formalité ; on peut indifféremment le mettre en tête de l'acte, ou au bas, ou au dos, ou sur l'un des côtés, et l'on voit beaucoup de ces timbres apposés diversement aux actes publics.
La prudence veut seulement que l'on ait attention de faire apposer le timbre ou d'écrire l'acte de manière que l'on ne puisse pas supprimer le timbre sans altérer le corps de l'acte ; et les officiers publics devraient toujours ainsi disposer leurs actes, ce que néanmoins quelques-uns n'observent pas, n'écrivant le commencement de leurs actes qu'au-dessous du timbre, d'où il peut arriver des inconvéniens, et notamment qu'un acte public dont on aura coupé le timbre ne vaudra plus que comme écriture privée, et même sera totalement nul, selon la nature de l'acte et les circonstances, ce que nous examinerons plus particulièrement dans la suite.
Au reste, à quelque distance que l'acte soit écrit du timbre il ne laisse pas d'être valable, et la disposition dont on vient de parler n'est qu'une précaution qui n'est pas de rigueur.
En France et dans plusieurs autres pays, on appose la marque du timbre avec un poinçon d'acier semblable à ceux qui servent à frapper les monnaies, excepté qu'il est moins concave ; en d'autres pays, comme en Allemagne, on imprime le timbre avec une planche de cuivre gravée, telle que celles qui servent à tirer les estampes.
En France et dans la plupart des autres pays où le timbre est en usage, on met de l'encre dans le poinçon pour marquer le timbre ; en Angleterre on ne met aucune couleur dans le poinçon, en sorte que la marque qu'il imprime ne parait que parce qu'elle se forme en relief sur le papier.
La formalité du timbre parait avoir été totalement inconnue aux anciens, et les actes reçus par des officiers publics n'étaient alors distingués des écritures privées que par le caractère de l'officier qui les avait reçus, et par le sceau qu'il y apposait, qui était plus connu que les sceaux des parties contractantes, à cause de la fonction publique de l'officier ; mais du reste ce sceau n'était que le cachet particulier de l'officier ; car les anciens n'avaient point de sceaux publics, tels que nous en avons en France, ainsi que l'observe Loyseau, des off. liv. II. chap. iv. n. 10. Les sceaux particuliers dont ils se servaient étaient plutôt de simples cachets que de vrais sceaux ; ils n'avaient pour objet que de tenir lieu de signature, comme cela s'est pratiqué longtemps dans plusieurs pays, et même en France, à cause qu'il y avait alors peu de personnes qui sussent écrire, et ces sortes de sceaux ou cachets n'avaient aucun rapport avec les timbres dont nous parlons.
Justinien fut le premier qui établit une espèce de timbre : cet empereur considérant le grand nombre d'actes que les tabellions de Constantinople recevaient journellement, et voulant prévenir certaines faussetés qui pouvaient s'y glisser, ordonna par sa novelle 44, laquelle fut publiée l'an 537, que ces tabellions ne pourraient recevoir les originaux des actes de leur ministère que sur du papier, en tête duquel (ce que l'on appelait protocole), serait marqué le nom de l'intendant des finances qui serait alors en place, le temps auquel aurait été fabriqué le papier et les autres choses que l'on avait coutume de mettre en tête de ces papiers destinés à écrire les originaux des actes que reçoivent les tabellions de Constantinople, ce que l'on appelait suivant la glose et les interprêtes, imbreviaturam totius contractus, c'est-à-dire un titre qui annonçait sommairement la qualité et substance de l'acte.
Par cette même novelle l'empereur défendait aussi aux tabellions de Constantinople de couper ces marques et titres qui devaient être en tête de leurs actes ; il leur enjoignait de les laisser sans aucune altération, et défendait aux juges d'avoir égard aux actes écrits sur du papier qui ne serait pas revétu en tête de ces marques, quelques autres titres ou protocoles qui y fussent écrits.
M. Cujas en ses notes sur cette novelle, examine ce que Justinien a entendu par le protocole qu'il recommande tant aux tabellions de conserver ; les uns, dit-il, veulent que ce soit une grande feuille royale ; d'autres que ce soit une simple note des actes ; d'autres que ce soit un exemplaire des formules dont les tabellions avaient coutume de se servir : mais ils se trompent tous également, dit M. Cujas, car de même qu'aujourd'hui notre papier a quelque marque qui indique celui qui l'a fabriqué, de même autrefois les papiers dont on se servait contenaient une note abrégée de l'intendant des finances qui était alors en place, parce que ces sortes d'intendants avaient inspection sur les fabriques de papier ; on y marquait aussi en quel temps et par qui le papier avait été fabriqué ; ce qui servait à découvrir plusieurs faussetés.
Loyseau, dans son traité des offices, liv. II. ch. V. n. 82. dit en parlant de la novelle 44, qu'elle nous apprend un beau secret qui avait été ignoré jusqu'à ce que le docte Cujas l'ait découvert, à savoir qu'elle défend de couper et ôter le protocole des chartes que nous pensons vulgairement être la minute et première écriture du contrat ; et de fait les ordonnances des années 1512, et encore celle d'Orléans, article xcxiij. l'usurpent en cette signification, combien qu'à la vérité ce soit la marque du papier où était écrite l'année qu'il avait été fait, laquelle marque Justinien défend de couper, comme on pouvait aisément faire, d'autant qu'elle était en haut du papier, et non pas au milieu, comme celle de notre papier, pour ce, dit-il, que par le moyen de ce protocole ou marque du papier plusieurs faussetés ont été découvertes, ce qui s'est aussi Ve quelquefois en France ; partant, dit-il, pour se servir à propos de cette antiquité, il serait expédient, ce semble, d'ordonner que tout papier serait marqué, et que la marque contiendrait l'année qu'il aurait été fait, chose qui ne couterait rien et empêcherait plusieurs faussetés, tant aux contrats qu'aux écritures.
Cette origine du papier et parchemin timbrés fut remarquée dans une cause qui se plaida au parlement d'Aix en 1676, entre des marchands de Marseille et le fermier du papier timbré, laquelle cause est rapportée par Boniface en ses arrêts de Provence, tom. IV. l. III. tit. XVe c. IIe le défenseur du fermier du papier timbré faisait valoir, " que le timbre n'était pas nouveau, puisqu'il y en avait du temps de Justinien en 537, qu'il y avait des marques pour les protocoles des notaires ; qu'on y marquait en chiffre l'année en laquelle ils avaient été faits avec le nom comitis sacrarum largitionum, qui était alors en exercice ; que Justinien voulait que le notaire qui avait commencé le protocole ou la charte achevât de l'écrire, et que le motif et le fondement de Justinien n'avait été que pour la précaution contre les faussetés, comme il parait par la novelle 44, suivie par Godefroy ".
Cette origine a aussi été remarquée par M. de Basville, intendant de la province de Languedoc, dans les mémoires qu'il a faits pour servir à l'histoire de cette province, dans lesquels en parlant du domaine il dit que, comme il y a deux généralités dans le Languedoc, il y a aussi deux sous-fermes du domaine, l'une pour la généralité de Toulouse, l'autre pour la généralité de Montpellier, et que dans ces sous-fermes sont compris le papier timbré, les formules et le contrôle des exploits ; et à ce propos il remarque en passant, que le papier timbré n'a pas été inconnu aux Romains, puisqu'on voit par la novelle 44, qu'ils avaient une espèce particulière de papier pour écrire les originaux des actes des notaires, lequel portait la marque que l'intendant des finances y faisait apposer, et la date du temps auquel il avait été fait.
Ainsi quoiqu'il paraisse peut-être d'abord singulier que l'on fasse remonter l'origine du papier timbré jusqu'au temps des Romains, cependant il est constant que cette formalité était déjà en quelque usage chez eux, puisque les titres, dates et autres marques que l'on apposait en tête du papier destiné à écrire les originaux des actes des tabellions de Constantinople, étaient une espèce de timbre qui avait le même objet que ceux qui sont aujourd'hui usités en France et dans plusieurs autres pays.
Mais suivant la même novelle de Justinien, cette formalité n'était établie que pour les actes des tabellions de Constantinople, encore n'était-ce que pour les originaux de ces actes, et non pour les expéditions ou copies, du moins la novelle n'en fait pas mention ; en sorte qu'à l'égard de tous les autres actes passés dans la ville de Constantinople par d'autres officiers publics que les tabellions, et à l'égard de tous les autres actes publics reçus hors la ville de Constantinople, soit par des tabellions, soit par d'autres officiers publics, il n'y avait jusqu'alors aucune marque sur le papier qui distinguât ces actes des écritures privées.
Cette formalité ne tomba pas en non-usage jusqu'au temps où elle a été établie en France, comme quelques-uns se l'imagineraient peut-être : il parait au contraire qu'à l'imitation des Romains, plusieurs princes l'établirent peu de temps après dans leurs états, et que nos rois ont été les derniers à l'ordonner.
En effet, du temps des comtes héréditaires de Provence, qui regnèrent depuis 915 ou 920 jusqu'en 1481, que cette province fut réunie à la couronne de France, les notaires de ce pays se servaient de protocoles marqués d'une espèce de timbre, ainsi que cela fut observé dans la cause dont j'ai déjà fait mention, qui fut plaidée au parlement d'Aix en 1676, et est rapportée par Boniface, liv. IV. tom. III. tit. 15. ch. IIe Le défenseur du fermier du papier timbré, pour faire voir que cette formalité n'était pas nouvelle, observait que non-seulement du temps de Justinien les protocoles étaient marqués, mais encore du temps des comtes de Provence, et que Me Jean Darbés, notaire à Aix, avait de ces anciens protocoles marqués.
Cette formalité fut introduite en Espagne et en Hollande vers l'an 1555.
Le papier timbré est aussi usité dans plusieurs autres états, comme en Angleterre, dans le Brabant et dans la Flandre impériale, dans les états du roi de Sardaigne, en Suède, et il a été introduit dans l'état ecclésiastique, à compter du 1 avril 1741, et dans d'autres pays, comme nous le dirons dans un moment.
Les timbres qu'on appose aux papiers et parchemins destinés à écrire les actes publics ont quelque rapport avec les sceaux publics dont on use aujourd'hui en France et dans plusieurs autres pays, en ce que les uns et les autres sont ordinairement une empreinte des armes du prince, ou de quelqu'autre marque par lui établie, qui s'apposent également aux actes publics, et les distinguent des actes sous signature privée ; cependant il ne faut pas confondre ces deux formalités, entre lesquelles il y a plusieurs différences essentielles.
La première qui se tire de leur forme est que les sceaux publics, tels que ceux du roi, des chancelleries, des juridictions, des villes, des universités et autres semblables, s'appliquent sur une forme de cire ou de quelqu'autre matière propre à en recevoir l'empreinte, laquelle est en relief ; il y a de ces sceaux qui s'appliquent ainsi sur l'acte même, d'autres qui sont à double face, et ne sont attachés à l'acte que par les lacs ; au lieu que le timbre n'est qu'une simple marque imprimée au haut du papier ou parchemin.
La seconde différence est que l'on n'appose point de sceau sur la minute des actes publics : cette formalité n'est même pas toujours nécessaire pour donner l'authenticité et la publicité aux expéditions ou copies collationnées des actes publics ; c'est plutôt le caractère et la qualité de l'officier qui a reçu l'acte et sa signature apposée au bas, qui rendent l'acte public : au lieu que dans les pays où le timbre est en usage, pour donner l'authenticité et le caractère de publicité à un acte, soit original, en minute ou en brevet, soit expédition ou copie collationnée, il doit être écrit sur du papier timbré ou en parchemin timbré, si l'acte est de nature à être écrit en parchemin.
La troisième différence qui se trouve entre les sceaux publics et les timbres, c'est que l'apposition du sceau est la marque de l'autorité publique dont l'acte est revêtu par cette formalité ; tellement qu'en quelques endroits, comme à Paris, le droit d'exécution parée en dépend, et que si un acte public n'était pas scellé, il ne pourrait être mis à exécution, quand même il serait d'ailleurs revêtu de toutes les autres formalités nécessaires : au lieu que le timbre contribue bien à donner à l'acte le caractère de publicité nécessaire pour qu'on puisse le mettre en forme exécutoire ; mais par lui-même il ne donne point ce droit d'exécution parée, qui dépend de certaines formalités qu'on ajoute à celle qui constitue la publicité.
Quoique la formalité du timbre semble n'avoir été établie que pour la finance qui en revient au prince, elle ne laisse pas d'être utîle d'ailleurs.
En effet, le timbre sert 1°. à distinguer à l'inspection seule du haut de la feuille sur laquelle l'acte est écrit, si c'est un acte reçu par un officier public, ou si ce n'est qu'une écriture privée.
2°. Le timbre fait respecter et conserver les affiches, publications ou autres exploits, ou actes que l'on attache extérieurement aux portes des maisons ou dans les places publiques, soit en cas de decret, licitation, adjudications ou autres publications, soit dans les exploits que l'on attache à la porte de personnes absentes auxquelles ils sont signifiés ; car comme ces sortes d'actes ne sont point scellés, il n'y a proprement que le timbre qui fasse connaître que ce sont des actes émanés de l'autorité publique, et qui les distingue des écritures privées.
3°. Le timbre annonce la solennité de l'acte aux personnes qui le signent, et sert en cela à prévenir certaines surprises que l'on pourrait faire à ceux qui signeraient un acte sans l'avoir lu ; par exemple, il serait difficîle de faire signer pour une écriture privée un acte public qui serait sur papier timbré, parce que l'inspection seule du timbre ferait connaître la surprise.
4°. Le timbre sert aussi à prévenir quelques faussetés dans les dates de temps et de lieu, qui peuvent se commettre plus facilement dans les actes où cette formalité n'est pas nécessaire : en effet, comme il y a un timbre particulier pour chaque état, et même en France pour chaque généralité, que la formule de ces timbres a changé en divers temps, et que l'on ne peut écrire les actes publics que sur du papier ou parchemin marqué du timbre actuellement usité dans le temps et le lieu où se passe l'acte, ceux qui écrivent un acte sur du papier ou parchemin marqué du timbre actuellement usité dans un pays, ne pourraient pas impunément le dater d'un temps ni d'un lieu où il y aurait eu un autre timbre, parce que la formule du timbre apposé à cet acte étant d'un autre temps ou d'un autre lieu, ferait connaître la fausseté des dates de temps et de lieu qu'on aurait donné à cet acte.
La formalité du timbre n'ayant été établie que pour les actes publics, il s'ensuit que tous les actes qui ne sont pas reçus par des officiers publics ne sont point sujets à être écrits sur papier timbré.
Boniface, en son recueil des arrêts du parlement de Provence, tom. IV. l. III. tit. XV. ch. j. et IIe rapporte à ce sujet deux arrêts de la cour des aides et finances de Montpellier.
Au mois de Mars 1655, Louis XIV. étant lors à Paris, donna un édit portant établissement d'une marque sur le papier et le parchemin destinés à écrire les actes reçus par les officiers publics. Cet édit fut enregistré en parlement, en la chambre des comptes et en la cour des aides le 20 du même mois. Il est au cinquième volume des ordonnances de Louis XIV. coté 3. fol. 69. et il en est fait mention dans le recueil des ordonnances, édits, etc. par M. Blanchart.
Cet édit n'eut aucune exécution ; mais dans la suite le roi voulant rendre le style des actes publics uniforme dans tout son royaume, donna une déclaration le 19 Mars 1673, par laquelle il ordonna qu'il serait dressé des formules imprimées pour toutes sortes d'actes publics, et que les exemplaires de ces formules seraient marqués en tête d'une fleur de lis, et timbrés de la qualité et substance des actes.
Les formules d'actes ordonnées par cette déclaration n'eurent cependant pas lieu, parce que l'on y trouva trop d'inconvéniens, et le roi donna une autre déclaration le 2 Juillet 1673, registrée au parlement le 10 du même mois, par laquelle en attendant que les formules fussent perfectionnées, il ordonna que les actes publics ne pourraient être écrits que sur du papier ou parchemin timbrés, comme ils devaient l'être pour les formules, avec cette différence seulement que le corps de l'acte serait entièrement écrit à la main ; et c'est de-là que le papier et le parchemin timbrés ont retenu le nom de formule.
Le 4 Juillet de la même année 1673, il fut fait un état des formules dont les papiers et parchemins devaient être timbrés, suivant la déclaration dont on vient de parler.
En exécution de cette déclaration, le papier et le parchemin destinés à écrire les actes publics, furent marqués en tête d'une fleur de lis, et intitulés de la qualité et formule de l'acte auquel il devait servir ; on y marquait même en tête et même dans les commencements, le nom du quartier dans lequel il devait servir ; précaution qui fut établie pour prévenir plusieurs faussetés qui peuvent se commettre à l'égard des dates. Cette précaution si utîle fut dans la suite retranchée, à cause que le papier ou parchemin timbré pour un quartier ne pouvait pas être vendu pendant le cours du suivant sans marquer la date de ce nouveau quartier, ce qui causait quelque embarras aux fermiers du timbre.
Le 3 Avril 1674, le roi en son conseil d'état, fit un règlement pour l'usage du papier et parchemin timbré ; ce règlement qui est divisé en vingt articles, explique nommément quels actes doivent être écrits sur papier ou parchemin timbré : il serait trop long d'en faire ici le détail ; il suffit de dire que ce sont tous les actes émanés des officiers publics, et ce qu'il est surtout important d'observer, c'est que ce règlement prononce la peine de nullité contre lesdits actes publics qui seraient faits sur papier ou parchemin commun. Ce règlement a été enregistré dans les différents parlements et autres cours, et il s'observe à la rigueur.
Plusieurs cours ayant fait des remontrances au sujet de ce règlement, le droit établi sur le papier et le parchemin timbré fut converti par édit du même mois d'Avril 1674, en un autre sur tout le papier et parchemin qui se consomme dans l'étendue du royaume.
La perception de ce nouveau droit fut différée par arrêt du conseil du 22 Mai 1674 ; et par un autre arrêt du conseil du même jour, le règlement du 3 Avril 1674 fait pour l'usage du papier et parchemin timbré fut confirmé, et en conséquence ordonné que les timbres et actes différents auxquels le papier était destiné seraient supprimés, et qu'à l'avenir au lieu d'iceux, tout le papier qui serait consommé par les officiers et ministres de justice, serait marqué d'une fleur de lis, et timbré du nom de la généralité où il devait servir.
Au mois d'Aout de la même année le roi donna un édit par lequel il révoqua pleinement celui du mois d'Avril précédent, portant établissement d'une marque générale sur tout le papier et parchemin pour continuer l'usage du papier et parchemin timbré, supprima les différents timbres établis pour chaque formule ou modèle d'acte, et ordonna que tous officiers et ministres de justice, et autres assujettis par ses précédents édits, déclarations et règlements à l'usage du papier et parchemin timbré, se serviraient, à commencer du 1 Octobre 1674, de papier et parchemin timbré, qui serait seulement marqué d'une fleur de lis et du nom de la généralité dans laquelle il devait être employé, et les droits en furent arrêtés, non plus selon la qualité et la nature des actes, mais selon la hauteur et la largeur du papier.
En exécution de cet édit, on commença au premier Octobre à se servir de papier et parchemin timbré pour les actes publics.
J'en ai Ve de timbré d'une fleur de lis, avec ces mots autour, généralité de Moulins, sur un explait fait dans ladite généralité le 3 Novembre 1674.
Il y a néanmoins encore plusieurs provinces de ce royaume dans lesquelles la formalité du timbre n'a jamais eu lieu ; telles sont la province d'Artais, la Flandre française, le Haynaut français, la principauté d'Arches et de Charleville, dont le territoire comprend la ville de Charleville, Arches qui en est le fauxbourg, et environ vingt-quatre villages. Il en est de même dans la Franche-Comté, l'Alsace et le Roussillon.
Il n'y en a pas non plus à Bayonne, ni dans le pays de Labour.
Il y a aussi trois principautés enclavées dans la France dans lesquelles on ne se sert pas de papier ni de parchemin timbré ; savoir la principauté souveraine de Dombes, celle d'Orange et celle d'Enrichemont et de Bois-Belle en Berry.
On ne se sert pas non plus de papier ni de parchemin timbré dans les îles françaises de l'Amérique, comme la Martinique, la Guadeloupe, la Cayenne, Marigalante, Saint-Domingue et autres, ni dans le Canada et le Mississipi.
Quoiqu'en général tous les officiers publics royaux ou autres, soient obligés de se servir de papier et parchemin timbré dans les lieux où il est établi, il y a néanmoins quelques tribunaux où l'on ne s'en sert point, quoique la formalité du timbre soit établie dans le pays. 1°. On ne s'en sert pas pour les mémoires ou requêtes que l'on présente au conseil royal des finances, et même les arrêts qui s'y rendent, s'expédient aussi en papier et parchemin commun ; mais quand le conseil ordonne que les mémoires ou requêtes seront communiqués aux parties intéressées, alors la procédure se fait à l'ordinaire, et tout ce qui se signifie doit être sur papier timbré.
2°. On ne s'en sert pas non plus dans les bureaux extraordinaires du conseil, lorsque la commission porte que l'instruction des affaires qui y sont renvoyées, se fera par simples mémoires et sans frais.
3°. Les requêtes que l'on présente à MM. les maréchaux de France pour les affaires d'honneur qu'ils jugent en l'hôtel de leur doyen, se donnent aussi sur papier commun.
4°. Les consuls, vice-consuls et chanceliers, et autres officiers résidant dans les villes et ports d'Espagne, d'Italie, de Portugal, du Nord, des échelles du Levant et de Barbarie, ne se servent aussi que de papier commun, même pour les actes qu'ils envoyent en France, parce que la juridiction qu'ils ont dans ces pays n'étant que par emprunt de territoire, ils ne peuvent ni se servir de papier timbré de France, ni de celui de puissance étrangère, dans le territoire de laquelle ils ne sont que par emprunt.
5°. Les ambassadeurs, envoyés, agens, résidents et autres ministres des princes étrangers auprès du roi de France, ne se servent pour les actes qu'ils font ni du papier timbré de leur pays, ni de celui de France, mais de papier commun.
6°. De même les ambassadeurs et autres ministres du roi de France dans les pays étrangers ne se servent que de papier commun.
7°. On ne se sert point de papier ni de parchemin timbré dans les conseils de guerre, même lorsque l'on y juge à mort quelqu'un pour délit militaire.
8°. On ne s'en sert point pour les affaires qui s'instruisent au conseil souverain de Dombes, qui se tient à Paris chez le prince de Dombes par emprunt de territoire.
9°. Les officiers des conseils des princes apanagistes, comme ceux de M. le duc d'Orléans, expédient en papier commun tous les actes qui se font dans le conseil, quoique ces actes soient authentiques, et les quittances du secrétaire des commandements passent à la chambre des comptes sur papier commun.
Les registres des hôpitaux, tant de Paris qu'autres lieux, même ceux des baptêmes, mariages, sépultures, se tiennent en papier commun, depuis le 1 Janvier 1737, article 15. de la déclaration du 9 Avril 1736 ; mais les extraits doivent être en papier timbré, art. 29.
Les maisons religieuses tiennent aussi leurs deux registres de vêture, noviciat et profession en papier commun, article 25. ibid.
Suivant l'article 1, un des originaux des registres, baptêmes, ondoyements, cérémonies du baptême, mariages et sépultures, doit être en papier commun.
La décharge de l'apport des registres se donne en papier commun, 18. ibid. et 20.
Voyez l'article 37. qui permet de mettre au greffe des expéditions en papier commun.
Article 38. Les états seront en papier commun.
Quoique le timbre ne soit qu'une formalité, il ne laisse pas d'y avoir plusieurs choses à considérer pour déterminer sur quelle sorte de papier on doit écrire les actes publics.
En effet, on distingue dans les actes trois sortes de formalités, qui se règlent chacune par des lois différentes.
Il y a des formalités qui habilitent la personne, c'est-à-dire qui lui donnent la capacité de contracter, comme l'autorisation du mari à l'égard de la femme dans les coutumes où elle est requise, le consentement du père qui est nécessaire en pays de droit pour faire valoir l'obligation du fils de famille en pays de droit écrit : l'observation de ces formalités et autres semblables se règle par la loi du domicîle des personnes qui s'obligent, parce que ces formalités ont pour objet de leur donner la capacité de contracter, qui dépend de la loi du domicile.
Il y a d'autres formalités qui concernent la substance de l'acte, telles que l'acceptation dans les donations, qui est une condition que la loi de la situation impose aux biens dont on veut disposer : aussi ces sortes de formalités se règlent-elles par la loi du lieu où les biens sont situés.
La troisième espèce de formalités est de celles qui ne concernent que la forme extérieure des actes : telles sont toutes celles qui ne servent qu'à rendre l'acte probant ou authentique, comme la signature des parties, celle des officiers publics et des témoins, l'apposition du sceau, le contrôle, l'insinuation, et autres semblables.
Ces formalités extérieures ne se règlent point par la loi du lieu où les biens sont situés, ni par la loi du domicîle des parties, ni par celle du lieu où les officiers publics qui reçoivent les actes font leur résidence ordinaire, mais par la loi du lieu où l'acte est passé, et cela suivant la maxime, locus regit actum, qui est fondée sur la loi 3. au digeste de testibus, sur la loi 1. au code de emencip. liber. et sur ce que dit M. Ch. Dumoulin sur la loi 1. au code liv. I. tit. I. verbo conclusiones de statutis. Aut statutum, dit-il, loquitur de his quae concernunt nudam ordinationem, vel solennitatem actus, et semper inspicitur statutum vel consuetudo loci ubi actus celebratur, sive in contractibus, sive in judiciis, sive in testamentis, sive in instrumentis aut aliis conficiendis.
Il n'y a certainement rien qui soit plus de la forme extérieure des actes que la qualité du papier ou parchemin sur lequel on les écrit ; soit qu'on ne considère que le papier même, si l'acte est écrit sur papier ou parchemin commun ; soit que l'on considère la marque du timbre, s'il est écrit sur papier timbré : car le papier et le parchemin et le timbre que l'on y appose, ne sont point de la substance de l'acte, puisqu'il pourrait subsister sans cela.
C'est pourquoi l'on doit suivre l'usage du lieu où se passent les actes pour déterminer s'ils doivent être écrits sur papier ou parchemin timbré, ou s'ils peuvent être écrits sur papier ou parchemin commun.
Ainsi les notaires, greffiers, huissiers, et autres officiers publics doivent écrire sur du papier ou parchemin timbré les actes qu'ils reçoivent à Paris, et dans les autres endroits où la formalité du timbre est établie.
Ils ne peuvent même pas se servir indifféremment de toute sorte de papier ou parchemin timbré, il faut que ce soit du papier ou parchemin timbré exprès pour le pays, et en particulier pour la généralité dans laquelle ils reçoivent l'acte : en sorte qu'un acte public reçu en France doit non-seulement être écrit sur du papier ou parchemin timbré d'un timbre de France, et non sur du papier marqué du timbre d'un autre état, mais il faut encore qu'il soit écrit sur du papier timbré pour la généralité dans laquelle il est reçu, y ayant autant de timbres différents que de généralités.
Au contraire si l'acte est reçu dans un état ou une province dans lesquels le papier ni le parchemin timbré ne sont point en usage, comme en Flandre, en Haynaut, etc. l'officier public qui reçoit l'acte, doit l'écrire sur papier ou parchemin commun.
Néanmoins un acte écrit sur papier ou parchemin timbré dans un pays où la formalité du timbre n'est pas établie, ne serait pas pour cela nul, parce que ce qui abonde ne vicie pas.
Les officiers publics qui ont leur résidence ordinaire dans un lieu où l'on ne se sert point de papier timbré, ne laissent pas d'être obligés de s'en servir pour les actes qu'ils reçoivent dans les pays où il est établi.
Et vice versâ, les actes publics reçus dans des pays où le papier timbré n'a pas lieu, doivent être écrits sur papier commun, quand même les officiers publics qui les reçoivent auraient leur résidence ordinaire dans un lieu où l'on se servirait de papier timbré.
Ainsi les notaires d'Orléans et ceux de Montpellier, les huissiers à cheval et à verge au châtelet de Paris, et autres officiers publics qui ont droit d'instrumenter par tout le royaume, doivent écrire les actes qu'ils reçoivent dans chaque lieu sur du papier marqué du timbre établi pour le lieu, ou sur du papier commun, si le timbre n'est pas établi dans le lieu où ils reçoivent l'acte.
De même un conseiller au parlement ou de quelque autre cour souveraine, qui serait commis par sa compagnie pour aller faire quelque visite, procès-verbal, enquête, information, ou autre instruction, dans une province du ressort dans laquelle le papier est marqué d'un timbre différent de celui de Paris, comme en Picardie, en Champagne, ou en Touraine, etc. serait obligé de se servir du papier du lieu où il ferait l'instruction, et par la même raison pourrait se servir de papier commun pour les actes qu'il ferait en Flandre, en Haynaut, etc. ou autres provinces, dans lesquelles il n'y a point de papier timbré.
Et lorsqu'un officier public qui a commencé un acte dans une généralité le continue en d'autres généralités ou provinces, soit par droit de suite, soit en vertu d'une commission particulière ou autre droit, comme il arrive quelquefois à l'égard des inventaires, procès-verbaux de visite, etc. l'officier doit pour chaque partie de l'acte qu'il reçoit se servir du papier ou parchemin timbré pour le lieu où il reçoit cette partie de l'acte, quand même le commencement de l'acte serait sur du papier marqué d'un timbre différent, parce que ces différentes parties sont proprement autant d'actes particuliers qui doivent être reçus chacun selon la forme usitée dans le lieu où ils se passent, et par conséquent être écrits sur du papier timbré pour le lieu où on les reçoit, et non pas sur du papier timbré pour le lieu où on a commencé l'acte.
Ce que l'on vient de dire, que toute sorte d'actes doivent être écrits sur le papier dont on se sert dans le lieu où ils sont reçus, s'entend non-seulement des minutes ou originaux des actes, mais aussi des grosses, expéditions et copies collationnées ; si elles sont délivrées dans le lieu où l'acte original a été reçu, elles doivent être écrites sur du papier marqué du même timbre, ou du-moins de celui qui est usité dans le pays au temps de l'expédition ; mais si l'original a été reçu hors du lieu de la résidence ordinaire de l'officier public dans un pays où le timbre est différent de celui qui est usité dans le lieu de sa résidence, les expéditions qu'il en délivre dans le dernier lieu doivent être écrites sur du papier marqué du timbre qui y a cours, parce que le fait de l'expédition ou copie est un nouvel acte qui doit être reçu suivant l'usage actuel du lieu où il se passe.
Ainsi un notaire d'Orléans qui aura écrit sur du papier timbré de la généralité de Paris l'acte qu'il aura reçu dans cette généralité, écrira sur du papier timbré de la généralité d'Orléans les expéditions ou copies qu'il délivrera de cet acte à Orléans.
Par la même raison, ce notaire d'Orléans qui aura écrit sur papier commun un acte qu'il aura reçu en Flandre ou autre pays, dans lequel il n'y a point de papier timbré, sera obligé d'écrire sur du papier timbré de la généralité d'Orléans l'expédition qu'il en délivrera dans cette généralité.
Par une suite du même principe, toutes expéditions ou copies délivrées depuis l'établissement du timbre dans les pays où il a lieu, doivent être écrites sur papier timbré, encore que les minutes ou originaux soient antérieurs à l'établissement du timbre et aient été reçus sur papier commun, parce que l'expédition ou copie doit être dans la forme usitée au temps où elle est faite, sans considérer en quelle forme est l'original.
Et comme toute expédition ou copie doit aussi être dans la forme usitée dans le lieu où elle est faite, ainsi qu'on l'a déjà expliqué ci-devant, il serait à propos que les officiers publics fissent toujours mention au-bas de la grosse, expédition ou copie, du jour et du lieu où ils l'ont délivrée, ce que la plupart n'observent pas, surtout dans les grosses : néanmoins cela est nécessaire pour connaître si la grosse, expédition ou copie, est dans la forme usitée dans le temps et le lieu où elle a été délivrée ; car elle ne l'est pas toujours dans le même temps, ni dans le même lieu, que la minute ou brevet original de l'acte ; or l'on ne peut juger si l'expédition est dans la forme où elle doit être, sans savoir le temps et le lieu où elle a été délivrée : on peut aussi avoir intérêt de savoir la date d'une grosse, parce que s'il s'en trouve deux, celle qui a été délivrée la première a plusieurs droits et privilèges que n'a pas la seconde : d'ailleurs il est important de savoir si l'officier public qui a reçu l'acte avait encore caractère d'officier public lorsqu'il a délivré l'expédition, et pour cela il en faut savoir la date : en un mot, il y a beaucoup d'inconvénients à ne pas marquer la date et le lieu des expéditions, et il serait plus régulier de le marquer, puisque le fait de l'expédition est proprement un acte particulier qui doit avoir sa date comme l'original a la sienne, et que l'expédition doit être faite dans la forme usitée dans le temps et le lieu où elle est délivrée.
C'est encore une question de savoir si dans un temps et dans un pays où le timbre a lieu on peut écrire un acte public à la suite d'un autre acte aussi public, reçu sur du papier ou parchemin non-timbré ou marqué d'un ancien timbre qui n'a plus cours.
Cela se pratique quelquefois pour faire mention sur la minute ou sur la grosse d'un acte, d'un payement, d'une décharge, d'une réduction, augmentation ou autre déclaration, qu'il est essentiel d'écrire sur l'acte auquel elle est relative, auquel cas la nécessité de joindre le nouvel acte à l'ancien d'une manière qu'il ne puisse en être séparé, autorise à écrire le nouvel acte à côté ou à la suite de l'ancien, quoique le papier sur lequel on l'écrit ne soit pas dans la forme usitée au temps où l'on passe le nouvel acte.
Mais si l'on écrivait à côté ou à la suite d'un acte ancien un nouvel acte qui n'aurait aucune connexité avec l'autre, alors n'y ayant pas de nécessité de joindre ces actes, il n'y aurait aucun prétexte pour s'écarter des règles ordinaires ; ainsi, dans ce cas, lorsque le premier acte auquel on en voudrait joindre un autre, serait écrit sur du papier non-timbré ou marqué d'un timbre qui n'a plus cours, on ne pourrait pas écrire le nouvel acte sur ce même papier, il faudrait l'écrire sur du papier timbré de la formule actuelle, autrement l'acte pourrait être argué de nullité, pour n'avoir pas été écrit sur du papier de la forme usitée au temps où il a été passé.
Les notaires au châtelet de Paris se sont longtemps servi du même papier et parchemin que les autres officiers publics ; avant 1673, ils écrivaient leurs actes sur papier ou parchemin commun ; et depuis 1673, époque de l'établissement du timbre, ils ont été obligés d'écrire tous leurs actes sur du papier ou parchemin timbré.
La formule du timbre a été changée plusieurs fais, mais la nouvelle formule que l'on introduisait était uniforme pour tous les actes publics, et les notaires au châtelet de Paris se servaient comme tous les autres officiers de papier ou parchemin timbré de la formule usitée au temps de la passation de leurs actes.
Ce ne fut qu'en 1723 que l'on commença à établir un timbre particulier pour les actes des notaires au châtelet de Paris : le roi par sa déclaration du 7 Déc. 1723, registrée le 22 desdits mois et an, en supprimant la formalité du contrôle, à laquelle ils avaient été assujettis comme tous les autres notaires du royaume, ordonna par l'article IIIe de ladite déclaration, qu'il serait établi des formules particulières pour les papiers et parchemins timbrés qui seraient employés par lesdits notaires pour les brevets, minutes et expéditions des actes qui seraient par eux passés, laquelle formule serait imprimée à côté de celle de la ferme.
L'article iv. ordonna que tous les actes seraient divisés en deux classes.
La première composée des actes simples, et qui se passent ordinairement sans minutes ; savoir, les procurations, avis de parents, attestations, etc. et autres actes qui sont énoncés nommément dans le dit article, et qu'il serait trop long de détailler ici.
La seconde classe, composée de tous les autres actes non-compris dans la première classe.
L'article Ve ordonne qu'il sera fait une première sorte de formule pour les actes de la première classe intitulés, actes de la première classe, et que si les parties jugent à propos qu'il reste minute de quelqu'un desdits actes, et qu'il leur en soit délivré des expéditions, lesdites expéditions ne pourront être faites que sur du papier de la même marque.
L'article VIe porte que les minutes des actes de la seconde classe seront écrites sur un papier, intitulé, minute des actes de la seconde classe : et à l'égard des expéditions et grosses qui seront délivrées des actes, que la première feuille de celles qui seront faites en papier, sera écrite sur un papier intitulé, première feuille d'expédition ; et que si l'expédition contient plus d'une feuille, les notaires se serviront pour les deuxiemes et autres feuilles à quelque quantité qu'elles puissent monter d'un papier intitulé, deuxiemes feuilles d'expéditions.
L'article VIIe ordonne que les notaires se serviront de parchemin intitulé de même pour les grosses et expéditions, que les parties désireront leur être délivrées en parchemin.
L'article VIIIe défend aux notaires au châtelet de Paris de se servir, à compter du premier Janvier 1724, d'autres papiers et parchemins, que ceux de la nouvelle formule, leur enjoint de les employer suivant la nature des actes, et ordonne que cela soit pareillement observé par tous autres officiers et personnes publiques, qui prétendent avoir droit de faire des inventaires et partages dans la ville et fauxbourgs de Paris.
L'article ix. ordonne que les expéditions et grosses dont la date sera antérieure audit jour premier Janvier 1724, seront faites et délivrées en papier ou parchemin timbrés seulement du timbre ordinaire des fermes.
Enfin l'article Xe porte que les quittances des rentes sur l'hôtel de ville ou sur les tailles, perpétuelles ou viageres, ainsi que les minutes, grosses et expéditions, des contrats qui ne seraient point encore passés avant le premier Janvier 1724, soient passés et expédiés sur le papier timbré ordinaire des fermes ; et qu'il en soit usé de même pour les copies collationnées par les notaires des grosses et expéditions, dont ils n'auront pas les minutes.
Cette déclaration fut exécutée pendant sept années ; mais l'embarras que la distinction du papier, selon la nature des actes, causait aux notaires et aux parties contractantes, engagea le roi à donner une autre déclaration le 5 Décembre 1730, registrée en la cour des aides le 15 du même mois, qui supprime, à commencer du premier Janvier 1731, les différentes formules dont l'établissement était ordonné par la déclaration du 7 Décembre 1723, sur les différents actes et expéditions des notaires de Paris, et en conséquence commue lesdites formules en une formule uniforme, qui sera établie à compter du premier Janvier 1731 sur tous les papiers et parchemins servant aux actes et contrats qui seront passés à compter dudit jour par les notaires de Paris, brevets, grosses, expéditions, copies collationnées, et extraits desdits actes et contrats, sans aucune distinction des différents actes, ni des premières et autres feuilles, des grosses, expéditions, copies collationnées ou extraits, laquelle formule sera intitulée, actes des notaires de Paris, et sera imprimée à côté du timbre ordinaire des fermes.
La même déclaration ordonne que les grosses, expéditions, extraits ou copies collationnées des actes et contrats qui auront été passés par lesdits notaires de Paris, à compter du premier Janvier 1724, seront aussi sujets à la nouvelle formule.
Les grosses, expéditions, copies collationnées et extraits des actes et contrats dont la date sera antérieure au premier Janvier 1724, sont dispensés de la nouvelle formule, ainsi que les contrats et quittances des rentes de l'hôtel de ville ou sur les tailles, perpétuelles et viageres, et aussi toutes autres quittances à la décharge de S. M. à condition toutes fois que les pièces justificatives du droit et des qualités de ceux qui donneront lesdites quittances, seront mises sur papiers timbrés de la nouvelle formule.
Cette déclaration porte aussi que les empreintes des timbres de la nouvelle formule, tant du papier que du parchemin, seront déposées au greffe de l'élection de Paris, qui connaitra en première instance des contraventions à sa disposition, et que les appels en seront portés en la cour des aides à Paris.
Cette déclaration est la dernière qui ait été rendue à l'égard des notaires à Paris, et même concernant le papier timbré en général, et elle a toujours eu son exécution.
Les deux déclarations, dont on vient de rendre compte, forment une exception en faveur des notaires de Paris, par rapport à ce que l'on a dit ci-devant que les officiers publics qui ont le droit d'aller recevoir des actes hors du lieu de leur résidence, et même en d'autres généralités ou provinces, sont obligés de se servir du papier usité dans chaque pays pour les actes qu'ils y reçoivent ; car les notaires au châtelet de Paris qui ont droit d'instrumenter par tout le royaume, peuvent, depuis les déclarations de 1723 et 1730, se servir par tout le royaume du même papier et parchemin dont ils se servent à Paris.
Lorsque les notaires au châtelet de Paris vont recevoir des actes en quelque province, dans laquelle il n'y a ni papier timbré, ni contrôle pour les actes des notaires, comme en Artais, ils peuvent écrire les actes qu'ils y reçoivent sur papier commun, parce qu'il n'y a rien qui les oblige à se servir en cette occasion de leur papier particulier : s'ils s'en servaient, l'acte n'en serait pas moins valable, parce que ce qui abonde, ne vicie pas ; ce serait seulement une dépense inutile.
Mais s'ils allaient recevoir des actes dans un pays où le papier timbré n'est pas en usage, et dans lequel néanmoins le contrôle des actes des notaires aurait lieu, alors ils seraient obligés de se servir du même papier dont ils se servent à Paris, parce que n'ayant été affranchis de la formalité du contrôle qu'au moyen du timbre particulier apposé au papier sur lequel ils écrivent leurs actes, on prétendrait peut-être que leurs actes y deviendraient sujets dans un tel pays, si ces actes étaient écrits sur papier commun.
Le papier destiné à leurs actes leur est tellement personnel, qu'aucun autre officier public ne pourrait s'en servir, même dans la généralité de Paris dont ce papier porte aussi le timbre général, parce que l'autre timbre particulier qui y est apposé avertit que ce papier ne peut servir qu'aux actes des notaires au châtelet de Paris.
Mais quoique les notaires au châtelet de Paris semblent être obligés par la déclaration du 5 Décembre 1730 de se servir pour tous leurs actes indistinctement de papier timbré de la nouvelle formule établie pour eux, il y a néanmoins quelques actes qu'ils peuvent écrire sur du papier timbré seulement de la formule générale des fermes ; savoir,
1°. Les grosses, expéditions, copies collationnées, et extraits des actes et contrats dont la date est antérieure au premier Janvier 1724, lesquels sont dispensés de la nouvelle formule par la déclaration du 5 Décembre 1730.
2°. Les contrats et quittances de rentes sur l'hôtel de ville ou sur les tailles, perpétuelles ou viageres, et toutes autres quittances à la décharge de Sa Majesté, à condition que les pièces justificatives du droit et des qualités de ceux qui donneront lesdites quittances, seront mises sur papier timbré de la nouvelle formule ; ce qui est ainsi ordonné par la même déclaration du 5 Décembre 1730.
3°. Les copies collationnées que les notaires délivrent des arrêts, sentences, et autres jugements, et des autres actes qui ne sont pas émanés du ministère des notaires.
4 °. Les notaires au châtelet de Paris peuvent écrire un acte, sujet au nouveau timbre, à côté ou à la suite d'un acte précédent, quoique reçu sur du papier timbré seulement de la formule générale des fermes ou d'un timbre précédent, ou même sur du papier commun, lorsque le nouvel acte a une liaison et une connexité naturelle avec celui auquel on le joint, comme lorsqu'il s'agit de faire mention sur l'original d'un acte, soit en minute ou en brevet, ou sur la grosse, d'un payement, d'une décharge, d'une réduction, augmentation ou autre déclaration, qu'il est important d'écrire sur l'acte auquel elle est relative, ainsi que cela a été remarqué ci-devant par rapport à tous les notaires en général.
Par une suite des principes généraux que l'on a établis à ce sujet, un notaire au châtelet de Paris ne pourrait pas à la suite ou à côté d'un acte ancien, reçu sur du papier qui ne serait pas revêtu du timbre actuellement usité, écrire un nouvel acte qui n'aurait aucune connexité avec celui auquel on le joindrait ; autrement le nouvel acte pourrait être argué de nullité pour n'avoir pas été écrit sur du papier timbré de la formule particulière, établie pour les actes des notaires de Paris, qui avait cours au temps où le nouvel acte a été passé.
L'observation de la formalité du timbre dans les lieux et les cas où elle est requise, est d'autant plus essentielle, que les règlements qui la prescrivent ne sont pas des lois simplement comminatoires ; ils prononcent formellement la peine de nullité contre tous actes publics, qui devant être écrits sur papier ou parchemin timbré, seraient écrits sur papier ou parchemin commun ; en sorte que l'on ne pourrait pas rendre valable un acte public écrit sur du papier ou parchemin commun, en le faisant timbrer après qu'il a reçu sa perfection par la signature des parties et des officiers publics, et cela même en payant aux fermiers du roi les droits et les amendes ; parce que le fermier ne peut remettre que son intérêt, et ne peut pas relever de la peine de nullité ceux qui l'ont encourue ; car dès que la nullité est encourue, le droit de l'opposer est acquis à tous ceux qui peuvent avoir intérêt d'empêcher l'exécution de l'acte ; et comme c'est une maxime certaine, que l'on ne peut préjudicier au droit acquis à un tiers, il ne dépend pas du fermier de remettre la peine de nullité une fois encourue par l'omission de la formalité du timbre.
Mais pour mieux entendre quel est l'effet de la peine de nullité prononcée par les règlements qui ont établi la formalité du timbre, il faut d'abord distinguer les actes contentieux des actes volontaires.
Les actes contentieux, comme les arrêts, sentences, ordonnances, et autres jugements, les enquêtes, informations, procès-verbaux de visite, rapports d'experts, les exploits et autres procédures et instructions qui se font par le ministère des officiers de justice, doivent sous peine de nullité absolue, être écrits sur papier ou parchemin timbré, dans les lieux où la formalité du timbre est établie, ainsi qu'il fut jugé par arrêt rendu à la séance de la chambre des vacations en la conciergerie du palais le 26 Octobre 1753, surveille de saint Simon, saint Jude : voici l'espèce de cet arrêt.
La demoiselle Robert, prisonnière pour dettes en la conciergerie, ayant demandé à cette séance sa liberté, en fut déboutée ; elle avait assisté à la plaidoirie de sa cause aussi-bien que son créancier ; après la prononciation de l'arrêt, elle lui donna un soufflet derrière le barreau : le substitut qui portait la parole à cette séance pour M. le procureur général, ayant entendu le coup qui venait d'être donné et le murmure que cela excita, rendit plainte de l'irrévérence commise envers l'audience, et conclut à ce qu'il en fût informé, ce qui fut ainsi ordonné par la chambre ; et comme ces sortes de procès s'instruisent sommairement, on entendit sur-le-champ les témoins qui avaient Ve donner le soufflet.
Lorsqu'on en était au recolement, le substitut s'aperçut que le greffier qui tenait la plume, avait par inadvertance écrit toute la procédure sur du papier commun ; il conclut à ce que toute cette procédure fût déclarée nulle ; et en effet il intervint arrêt conforme à ses conclusions, qui déclara toute ladite procédure nulle, et ordonna qu'elle serait recommencée, ce qui fut fait sur papier timbré, et cette seconde instruction ayant été achevée en bonne forme, la demoiselle Robert fut condamnée à faire réparation à l'audience, etc.
A l'égard des actes publics volontaires, tels que ceux émanés des notaires, tabellions, etc. il faut distinguer ceux qui ne sont obligatoires que d'une part, d'avec ceux qui sont synallagmatiques, c'est-à-dire qui sont respectivement obligatoires à l'égard de toutes les parties contractantes.
Les actes qui ne sont obligatoires que d'une part, comme une obligation, une quittance, et les actes qui ne forment point de convention, tels que les déclarations, les certificats, et autres actes de cette nature, ne sont pas absolument nuls à tous égards, lorsqu'il leur manque la formalité du timbre : toute la peine de nullité par rapport à ces sortes d'actes, est qu'ils ne sont pas valables comme actes publics, et qu'ils n'ont aucun des effets attachés à la publicité des actes, tels que l'authenticité, l'hypothèque, l'exécution parée ; mais ils sont quelquefois valables comme écriture privée.
En effet, lorsque l'on y a observé la forme prescrite pour les actes sous signature privée, ils sont valables en cette dernière qualité, quoiqu'ils eussent été faits pour valoir comme actes publics.
Mais si ayant été faits pour valoir comme actes publics, ils ne peuvent valoir en cette qualité faute de timbre, ou à cause de quelque défaut essentiel dans l'observation de cette formalité ; et que d'un autre côté ces actes ne soient pas dans une forme telle qu'ils puissent valoir comme écriture privée, c'est alors un des cas où ils sont absolument nuls aux termes des règlements.
Par exemple, si un notaire reçoit un testament sur papier commun, dans un lieu où il devait l'écrire sur du papier timbré, ce testament sera absolument nul, et ne vaudra même pas comme testament olographe, parce que, pour être valable en cette qualité, il faudrait qu'il fût entièrement écrit et signé de la main du testateur, au lieu qu'ayant été reçu par un notaire, ce sera le notaire ou un de ses clercs qui l'aura écrit.
De même, si un notaire reçoit une obligation sur papier commun, tandis qu'elle devait être sur papier timbré, elle ne sera pas valable, même comme promesse sous signature privée, parce qu'aux termes de la déclaration du roi du 22 Septembre 1733, registrée en parlement le 14 suivant et le 20 Janvier 1734, tous billets sous signature privée, au porteur, à ordre ou autrement, causés pour valeur en argent, sont nuls, si le corps du billet n'est écrit de la main de celui qui l'a signé, ou du-moins si la somme portée au billet n'est reconnue par une approbation écrite en toutes lettres aussi de sa main.
Cette déclaration excepte seulement les billets sous signature privée, faits par des banquiers, négociants, marchands, manufacturiers, artisans, fermiers, laboureurs, vignerons, manouvriers, et autres de pareille qualité, à l'égard desquels elle n'exige pas que le corps de leurs billets soit entièrement écrit de leur main ; en sorte que les obligations passées devant notaires par ces sortes de personnes, et reçues sur du papier commun, lorsqu'elles devaient être sur papier timbré, pourraient valoir comme billets sous signature privée, pourvu que l'acte fût signé de l'obligé.
Pour ce qui est des actes que les parties n'ont point signés, faute de savoir écrire, ou pour quelque autre empêchement, ils sont absolument nuls à tous égards, lorsque les officiers publics qui devaient les recevoir sur papier timbré, les ont reçus sur papier commun, et ces actes ne peuvent valoir même comme écriture privée, parce que les actes sous seing privé ne sont parfaits que par la signature des parties.
A l'égard des actes synallagmatiques, tels que les contrats de vente, d'échange, de société, les baux, et autres actes semblables, qui obligent respectivement les parties contractantes à remplir, chacun de leur part, certains engagements, lorsqu'ils sont reçus par des officiers publics sur du papier commun, dans un lieu où ils devaient être écrits sur papier timbré, ils sont aussi absolument nuls à tous égards, et ne peuvent valoir même comme écriture privée, encore que les parties contractantes les eussent signés, parce que pour former un acte obligatoire, synallagmatique, sous seing privé, il faut qu'il soit fait double, triple, ou quadruple, etc. selon le nombre des contractants, afin que chacun puisse en avoir un pardevers soi, ce que l'on appelle en Bretagne un autant ; et qu'il soit fait mention dans chaque expédition que l'acte a été fait double, triple, ou quadruple ; ce qui est tellement de rigueur, que l'omission de cette mention suffit pour annuller la convention.
Cette règle est fondée sur le principe, qu'une convention ne peut pas être valable, à moins que chaque contractant ne puisse contraindre les autres à exécuter leurs engagements, comme il peut être contraint de remplir les siens.
Pour mettre les contractants en état d'obliger les autres d'exécuter leurs engagements, il faut que chacun d'eux ait par-devers soi un titre contre les autres ; car un acte synallagmatique sous seing privé qui serait simple, ne formerait pas un titre commun, quoiqu'il fût signé de tous les contractants, puisque chacun d'eux ne pourrait pas l'avoir en sa possession, et que celui entre les mains duquel il serait, pourrait le faire paraitre ou le supprimer, selon son intérêt, au préjudice des autres contractants qui ne pourraient pas s'en aider.
Or lorsqu'un acte synallagmatique a été reçu par un officier public, pour valoir comme acte public, et que néanmoins il ne l'a reçu que sur papier commun, soit par impéritie ou autrement, quoiqu'il dû. le recevoir sur papier timbré, cet acte ne peut valoir que comme écriture privée, parce qu'il n'a point été fait double, triple, ou quadruple, etc. selon le nombre des contractants, et que par conséquent il n'y est pas fait mention qu'il ait été fait double ou triple, etc. d'où il s'ensuit qu'il ne peut être synallagmatique, et qu'il est absolument nul.
En vain prétendrait-on que la minute de cet acte synallagmatique devient un titre commun dont chaque contractant peut ensuite lever des expéditions, et par-là se procurer un titre pour obliger les autres parties à exécuter l'acte de leur part : dès que l'acte synallagmatique n'a pas été reçu par l'officier public sur papier timbré comme il devait l'être, et que par l'omission de cette formalité l'acte ne peut valoir comme acte public, l'original de cet acte que l'officier public a retenu par-devers lui, ne peut être considéré comme une vraie minute, qui soit un titre commun dont on puisse lever des expéditions, qui servent de titre à chacun des contractants, parce que l'original n'étant pas un acte public, mais seulement un acte privé simple, il pouvait être supprimé par ceux entre les mains desquels il était, et par conséquent ne pouvait pas devenir obligatoire : le dépôt qui en a été fait chez un officier public, ne peut pas réparer ce vice primordial, ni faire que les expéditions qu'en délivrerait l'officier public, servissent de titre à chacun des contractants, parce que l'acte étant nul dans le principe, ne peut être réhabilité par la qualité du lieu où il est gardé.
Il faut néanmoins excepter de cette règle certains actes que les notaires peuvent recevoir en brevet ; car si ces actes ont été faits doubles ou triples, selon le nombre des parties contractantes, ainsi que cela s'observe ordinairement, et que chaque double soit signé de la partie qu'il oblige ; ces actes qui ne seraient pas valables comme actes publics, s'ils étaient écrits sur du papier ou parchemin commun, dans un lieu où ils devaient l'être sur papier ou parchemin timbré, vaudraient du-moins comme écriture privée, parce qu'ils auraient en eux toutes les conditions nécessaires pour valoir en cette qualité.
En France, depuis quelque temps, on a établi dans chaque généralité où le papier timbré est en usage, une papeterie pour y fabriquer exprès le papier que l'on destine à être timbré ; et dans le corps de ce papier, au-lieu de la marque ordinaire ou enseigne du fabriquant, il y a au milieu de chaque feuille une marque intérieure du timbre extérieur qui doit y être apposé en tête.
La France n'est pas le seul pays où cette marque intérieure du timbre ait été établie, la même chose se pratique dans plusieurs autres états ; et notamment dans la Lorraine et dans le Barrais cela s'observe depuis plusieurs années.
Tout le papier qui se fait dans ces fabriques particulières est porté au bureau du timbre, et l'on n'en vend point aux particuliers qu'on n'y ait auparavant apposé le timbre extérieur de la généralité pour laquelle il a été fabriqué.
Suivant l'usage qui s'observe actuellement, la marque intérieure du timbre insérée dans le corps du papier timbré, ne parait pas être absolument de l'essence de la formalité, et à la rigueur il suffit que le papier sur lequel est écrit l'acte public soit timbré au haut de chaque feuille du timbre extérieur qui s'imprime avec le poinçon ou filigrame ; et en effet les officiers publics écrivent quelquefois leurs actes sur du papier commun, et font ensuite timbrer chaque feuille avant de signer et faire signer l'acte ; on fait aussi timbrer les mémoires, criées, enchères, et autres publications ou jugements imprimés que l'on doit signifier, et tous ces différents actes ainsi timbrés ne sont pas moins valables que ceux qui sont écrits sur du papier marqué, tant du timbre intérieur que de l'extérieur.
Il serait néanmoins à propos que les officiers publics ne pussent se servir pour les actes de leur ministère que de papier marqué de l'un et l'autre timbre ; car loin que cette répétition du timbre soit inutile, chacun de ces deux timbres a son utilité particulière.
Le timbre extérieur imprimé au haut de chaque feuille, contribue à donner à l'acte le caractère d'authenticité et de publicité, et fait connaître à l'inspection seule de l'acte, que c'est un acte public et non une écriture privée.
La marque intérieure du timbre qui est dans le corps du papier et faite en même-temps que le papier, sert à assurer que le papier était revêtu du timbre extérieur lorsque l'acte y a été écrit, et qu'il n'a pas été timbré après coup, parce qu'on ne délivre à personne du papier fabriqué pour être timbré que le timbre n'y ait effectivement été apposé, en sorte que la marque intérieure du timbre constate d'une manière plus sure la régularité de la forme de l'acte, que le timbre extérieur qui pourrait frauduleusement être appliqué après coup, pour faire valoir un acte auquel manquerait cette formalité.
Mais ce qui est encore plus important, c'est que la marque intérieure du timbre peut suppléer le timbre extérieur s'il n'avait pas été marqué, ou bien s'il se trouvait effacé ou déchiré ; c'est ce qui a été jugé récemment dans une affaire dont voici l'espèce.
Théophîle Vernet, banquier à Paris, fut emprisonné pour dettes en vertu de différentes sentences des consuls obtenues contre lui par le sieur le Noir son créancier. Il interjeta appel de ces sentences, et à la séance du 23 Décembre 1732, il demanda sa liberté, prétendant que toute la procédure était nulle, sous prétexte que l'explait du 6 Avril 1728, en quelque façon introductif de l'instance, était écrit sur papier non-timbré ; il fit valoir la disposition des règlements qui ont établi la formalité du timbre, lesquels prononcent la peine de nullité contre les actes émanés d'officiers publics, qui seront écrits sur papier commun.
La copie de l'explait en question n'avait réellement aucune marque du timbre extérieur ; mais Vernet était forcé de convenir que le carré de papier sur lequel elle était écrite, sortait de la fabrique des papiers destinés à recevoir l'empreinte du timbre, car en le présentant au jour on en voyait distinctement la marque : or, disait le défenseur du sieur le Noir, le papier de cette fabrique particulière ne sert qu'au bureau du timbre, par conséquent ce n'est pas la faute de l'huissier, mais des buralistes, si le timbre n'y est pas bien marqué, qu'il leur est assez ordinaire en marquant le papier, d'oublier quelquefois de renouveller l'encre que l'on met dans le poinçon ou filigrame du timbre, et de passer une feuille, laquelle ne reçoit l'empreinte du timbre que par la compression du papier, qu'en ce cas cette empreinte faite sans encre s'efface aisément, soit d'elle-même par la longueur du temps, soit en mettant le papier sous presse ; que ce dernier cas surtout se vérifie par l'expérience journalière que nous avons à l'égard des feuilles nouvellement imprimées, où les caractères des lettres forment du côté de l'impression autant de petites concavités qu'il y a de lettres, et de l'autre côté débordent et paraissent en relief ; mais que la feuille imprimée soit mise sous presse, le papier redevient uni de part et d'autre, et il est difficîle que l'on reconnaisse la trace des caractères qui débordaient, soit d'un côté seulement, soit de tous les deux.
Le défenseur du sieur le Noir ajoutait, que lorsqu'on s'aperçoit que le timbre n'est pas marqué, on n'a qu'à reporter la feuille aux buralistes qui ne font pas difficulté de la reprendre ; que l'huissier en écrivant au dos de l'empreinte l'explait en question ne s'en était pas aperçu ; qu'il n'avait pas examiné si elle était plus ou moins marquée ; qu'il était dans la bonne foi ; qu'il fallait même observer que Vernet n'avait relevé ce moyen qu'après plus de quatre ans, c'est-à-dire après s'être ménagé cette prétendue nullité avec le secours du temps, ou plutôt de la presse ; qu'aussi s'apercevait-on aisément que la place de l'empreinte était extrêmement polie, ce qui prouvait qu'elle n'avait disparu qu'avec peine ; mais qu'il en fallait toujours revenir au point de fait que le papier était émané du bureau du timbre ; que Vernet convenait lui-même que le papier était sorti de la fabrique particulière destinée au timbre ; que dès-lors que cette fabrique ne sert que pour les bureaux du timbre, il n'y avait point de nullité, qu'il n'y en avait qu'autant que les préposés à la distribution du papier timbré pourraient se plaindre de la contravention aux édits et ordonnances intervenus à ce sujet ; que puisque ces commis ne pouvaient se plaindre, et qu'on avait satisfait aux droits du roi, le sieur Vernet était non-recevable.
Cette question de nullité ayant été vivement discutée de part et d'autre, il intervint arrêt ledit jour 23 Décembre 1732, qui joignit au fond la requête de Vernet.
Quelque temps après, Vernet s'étant pourvu sur le fondement du même moyen devant M. de Gaumont, intendant des finances, on mit néant sur sa requête.
Enfin sur le fond de l'appel l'instance ayant été appointée au conseil, entr'autres moyens que proposait Vernet, il opposait que toute la procédure était nulle, attendu que l'explait introductif était sur papier non timbré.
La question de la validité de l'explait fut de nouveau discutée. La dame le Noir, au nom et comme tutrice de ses enfants, ayant repris au lieu de son mari, fit valoir les moyens qui avaient déjà été opposés à Vernet. Elle ajouta que l'arrêt rendu contre lui, à la séance du 23 Décembre 1732, était un débouté bien formel d'un moyen qui, s'il eut été valable, aurait dû dans le moment lui procurer sa liberté ; qu'à ce préjugé se joignait encore celui qui résultait du néant mis sur la requête présentée par ledit Vernet à M. de Gaumont, intendant des finances.
Par arrêt du 22 Aout 1737, rendu en la grande chambre, au rapport de M. Bochart de Saron, la cour en tant que touchaient les appels interjetés par Vernet, mit les appelations au néant, ordonna que ce dont était appel, sortirait son plein et entier effet, condamna l'appelant en l'amende : en sorte que l'explait en question a été jugé valable, et que dans ces sortes de cas, la marque intérieure du timbre supplée le timbre extérieur, soit qu'il n'ait pas été apposé, ou qu'il n'ait pas été bien marqué, et qu'il ait été effacé ou déchiré.
La marque intérieure du timbre fait donc présumer que le papier a reçu le timbre extérieur, et par-là sert à assurer que l'acte a été écrit sur du papier qui était déjà revêtu du timbre extérieur, et non pas timbré après coup, ce qui ne laisse pas d'être important ; car puisqu'il est enjoint aux officiers publics, sous peine de nullité des actes qu'ils reçoivent, d'écrire lesdits actes sur du papier timbré, ceux qui sont dépositaires des poinçons du timbre ne doivent pas timbrer un acte écrit sur du papier commun, lorsqu'il est déjà signé et parfait comme écriture privée, pour le faire voir après coup comme écriture publique : si on tolere que le timbre extérieur soit apposé sur un acte déjà écrit, ce ne doit être que sur un acte qui ne soit pas encore signé. C'est pourquoi il serait à propos d'assujettir tous les officiers publics à n'écrire les actes qu'ils reçoivent que sur du papier marqué des deux timbres ; c'est-à-dire de la marque du timbre qui est dans le corps du papier ; et du timbre extérieur qui s'imprime au haut de la feuille, parce que le concours de ces deux marques remplirait tous les objets que l'on peut avoir eu en vue dans l'établissement de cette formalité ; et la marque intérieure du timbre écarterait tout soupçon et toute difficulté, soit en constatant que le papier était revêtu du timbre extérieur lorsque l'acte y a été écrit, soit en suppléant ce timbre extérieur s'il ne se trouvait pas sur l'acte.
Mais cette précaution ne servirait que pour les actes qui s'écrivent sur du papier, et non pour ceux qui s'écrivent en parchemin ; parce que la matière du parchemin n'étant pas faite de main d'homme, on ne peut pas y insérer de marque intérieure, comme dans le papier dont la marque se fait en même temps : lesquelles marques intérieures, soit qu'elles représentent le timbre ou l'enseigne du fabriquant, sont fort utiles et one servi à découvrir bien des faussetés ; aussi y a-t-il beaucoup plus d'inconvénients à se servir de parche-l min qu'à se servir de papier, non-seulement parce que la destination du parchemin ne peut pas être constatée d'une manière aussi sure que le papier, mais encore parce que le parchemin est plus facîle à altérer que le papier : en sorte que pour mieux assurer la vérité des actes, il serait à souhaiter qu'on les écrivit tous sur du papier.
Les ordonnances, édits et déclarations qui ont établi la formalité du timbre, ne se sont pas contentés d'ordonner que tous les actes reçus par les officiers publics soient timbrés. L'ordonnance du mois de Juin 1680, rendue sur cette matière, a distingué les actes qui doivent être écrits en parchemin timbré, de ceux qu'il suffit d'écrire sur papier timbré. Cette distinction a été confirmée et détaillée encore plus particulièrement par la déclaration du 19 Juin 1691.
Ces règlements prononcent bien une amende contre ceux qui y contreviendraient ; mais ils ne prononcent pas la peine de nullité comme les premiers règlements qui ont établi la formalité du timbre en général.
Ainsi un acte qui doit être en parchemin timbré ne serait pas nul, sous prétexte qu'il ne serait qu'en papier timbré ; parce que tout ce qu'il y a d'essentiel dans la formalité, et qui doit être observé à peine de nullité, c'est que l'acte soit timbré : pour ce qui est de la distinction des actes qui doivent être en parchemin, d'avec ceux qui doivent être en papier, c'est un règlement qui ne concerne en quelque sorte que les officiers publics, qui en y contrevenant, s'exposent aux peines pécuniaires prononcées par les règlements.
Il y a néanmoins un inconvénient considérable pour les parties qui agissent en vertu de tels actes, c'est que les débiteurs, parties saisies ou autres personnes poursuivies en vertu de ces actes écrits sur papier timbré seulement, tandis qu'ils devraient être en parchemin timbré, obtiennent sans difficulté, par ce défaut de formalité, la main-levée des saisies faites sur eux, sauf aux créanciers, ou autres porteurs de ces actes, à se mettre après en règle. Telle est la jurisprudence que l'on suit à cet égard.
Pour ce qui est des actes qu'il suffit d'écrire sur papier timbré, et que l'on aurait écrit sur parchemin timbré, ou bien de ceux que l'on peut mettre sur papier ou parchemin commun, et que l'on aurait écrit sur papier ou parchemin timbrés, ils ne seraient pas pour cela nuls, parce que ce qui abonde ne vicie pas.
Mais il y aurait plus de difficulté si un acte d'une certaine nature, était écrit sur du papier ou parchemin destiné à des actes d'une autre espèce ; par exemple, si un notaire écrivait ses actes sur du papier ou parchemin destiné pour les expéditions des greffiers, et vice versâ ; dans ces cas, la contradiction qui se trouverait entre le titre du timbre et la qualité de l'acte, pourrait faire soupçonner qu'il y aurait eu quelque surprise, et qu'on aurait fait signer aux parties un acte pour un autre, ou du moins, ferait rejeter l'acte comme étant absolument informe.
De même s'il arrivait qu'un acte passé dans une généralité fût écrit sur du papier ou parchemin timbré du timbre d'une autre généralité, il y a lieu de croire qu'un tel acte serait déclaré nul ; et ce serait aux parties à s'imputer d'avoir fait écrire leur acte sur du papier qui ne pouvait absolument y convenir, et qu'ils ne pouvaient ignorer être d'une autre généralité, puisque le nom de chaque généralité est gravé dans le timbre qui lui est propre.
Et à plus forte raison un acte reçu par un officier public de la domination de France serait-il nul, s'il était écrit sur du papier ou parchemin sur lequel serait apposé un timbre étranger, parce que le timbre établi par chaque prince, ne peut convenir qu'aux actes qui se passent dans ses états.
Les poinçons ou empreintes du timbre sont déposés au greffe de l'élection de Paris, laquelle connait en première instance des contraventions aux règlements ; et l'appel Ve à la cour des aides. Voyez la déclaration du 5 Novembre 1730.
Sur ce qui concerne le papier et parchemin timbré, on peut encore voir le recueil des formules, du sieur de Nicet, et la nouvelle diplomatique des pères DD. Toussain et Tassin, t. I. où ces deux savants bénédictins ont eu la bonté de rappeler une petite dissertation que je fis sur cette matière en 1737, et qui fut insérée au mercure de Juin de la même année. (A)