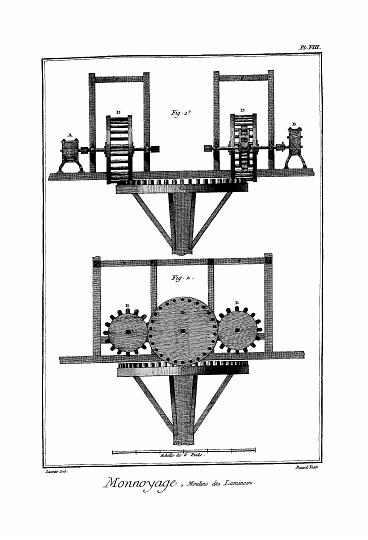S. m. (Droit naturel et Droit romain) l'usucapion est une manière d'acquérir la propriété, par une possession non interrompue d'une chose, durant un certain temps limité par la loi.
Toutes personnes capables d'acquérir quelque chose en propre, pouvaient, selon les jurisconsultes romains, prescrire valablement. On acquérait aussi par droit d'usucapion, toutes sortes de choses, tant mobiliaires qu'immeubles ; à moins qu'elles ne se trouvassent exceptées par les lois, comme l'étaient les personnes libres ; car la liberté a tant de charmes qu'on ne néglige guère l'occasion de la recouvrer : ainsi il y a lieu de présumer que si quelqu'un ne l'a pas réclamée, c'est parce qu'il ignorait sa véritable condition, et non pas qu'il consentit tacitement à son esclavage : de sorte que plus il y a de temps qu'il subit le joug, et plus il est à plaindre, bien-loin que ce malheur doive tourner en aucune manière à son préjudice, et le priver de son droit.
On exceptait encore les choses sacrées, et les sépulcres qui étaient regardés comme appartenans à la religion : les biens d'un pupille, tandis qu'il est en minorité ; car la faiblesse de son âge ne permet pas de le condamner à perdre son bien, sous prétexte qu'il ne l'a pas revendiqué ; et il y aurait d'ailleurs trop de dureté à le rendre responsable de la négligence de son tuteur.
On mettait au même rang les choses dérobées, ou prises par force, et les esclaves fugitifs, lors même qu'un tiers en avait acquis de bonne foi la possession : la raison en est que le crime du voleur et du ravisseur, les empêche d'acquérir par droit d'usucapion, ce dont ils ont dépouillé le légitime maître, reconnu tel.
Le tiers, qui se trouve possesseur de bonne foi, ne saurait non plus prescrire, à cause de la tache du larcin ou du vol, qui est censée suivre la chose : car, quoiqu'à proprement parler, il n'y ait point de vice dans la chose même, cependant comme c'est injustement qu'elle avait été ôtée à son ancien maître, les lois n'ont pas voulu qu'il perdit son droit, ni autoriser le crime en permettant qu'il fût aux méchants un moyen de s'enrichir, d'autant plus que les choses mobiliaires se prescrivant par un espace de trois ans, il aurait été facîle aux voleurs de transporter ce qu'ils auraient dérobé, et de s'en défaire dans quelque endroit où l'ancien propriétaire ne pourrait l'aller déterrer pendant ce temps-là.
Ajoutez à cela qu'une des raisons pourquoi on a établi la prescription, c'est la négligence du propriétaire à réclamer son bien : or ici on ne saurait présumer rien de semblable, puisque celui qui a pris le bien d'un autre, le cache soigneusement. Cependant comme dans la suite les lois ordonnèrent que toute action, c'est-à-dire, tout droit de faire quelque demande en justice, s'éteindrait par un silence perpétuel de trente ou quarante ans ; le maître de la chose dérobée n'était point reçu à la revendiquer après ce temps expiré, que l'on appelle le terme de la prescription d'un très-longtemps.
Je sais bien qu'il y a plusieurs personnes qui trouvent en cela quelque chose de contraire à l'équité, parce qu'il est absurde, disent-ils, d'alléguer comme un bon titre, la longue et paisible jouissance d'une usurpation, ou du fruit d'une injustice ; mais cet établissement peut être excusé par l'utilité qui en revient au public. Il est de l'intérêt de la société, que les querelles et les procès ne se multiplient pas à l'infini, et que chacun ne soit pas toujours dans l'incertitude de savoir si ce qu'il a lui appartient véritablement. D'ailleurs, le genre humain changeant presque de face dans l'espace de trente ans, il ne serait pas à propos que l'on put être troublé par des procès intentés pour quelque chose qui s'est passé comme dans un autre siècle ; et comme il y a lieu de présumer qu'un homme après s'être passé trente ans de son bien, est tout consolé de l'avoir perdu ; à quoi bon inquiéter en sa faveur, celui qui a été si longtemps en possession ? On peut encore appliquer cette raison à la prescription des crimes : car il serait superflu de rappeler en justice les crimes dont un long temps a fait oublier et disparaitre l'effet, en sorte qu'alors aucune des raisons pourquoi on inflige des peines, n'a plus de lieu.
Pour acquérir par droit d'usucapion, il faut premièrement avoir acquis à juste titre la possession de la chose dont celui de qui on la tient, n'était pas le véritable maître, c'est-à-dire posséder en vertu d'un titre capable par lui-même de transférer la propriété, et être d'ailleurs bien persuadé qu'on est devenu légitime propriétaire ; en un mot posséder de bonne foi.
Selon les lois romaines, il suffit que l'on ait été dans cette bonne foi au commencement de la possession ; mais le droit canonique porte que si avant le terme de la prescription expiré, on vient à apprendre que la chose n'appartenait pas à celui de qui on la tient, on est obligé en conscience de la restituer à son véritable maître, et qu'on la détient désormais de mauvaise foi, si du moins on tâche de la dérober adroitement à la connaissance de celui à qui elle appartient.
Cette dernière décision parait plus conforme à la pureté des maximes du droit naturel ; l'établissement de la propriété ayant imposé à quiconque se trouve en possession du bien d'un autre, sans son consentement, l'obligation de faire ensorte, autant qu'il dépend de lui, que la chose retourne à son véritable maître. Mais le droit romain, qui n'a égard qu'à l'innocence extérieure, maintient chacun en paisible possession de ce qu'il a acquis, sans qu'il y eut alors de la mauvaise foi de sa part, laissant au véritable propriétaire le soin de chercher lui-même et de réclamer son bien.
Au reste la prescription ne regarde pas seulement la propriété, à prendre ce mot, comme nous faisons, dans un sens qui renferme l'usucapion, et la prescription proprement ainsi nommée : elle anéantit aussi les autres droits et actions, lorsqu'on a cessé de les maintenir, et d'en faire usage pendant le temps limité par la loi. Ainsi un créancier qui n'a rien demandé pendant tout ce temps-là à son débiteur, perd sa dette. Celui qui a joui d'une rente sur quelque héritage, ne peut plus en être dépouillé, quoiqu'il n'ait d'autre titre que sa longue jouissance. Celui qui a cessé de jouir d'une servitude pendant le même temps, en perd le droit ; et celui au-contraire qui jouit d'une servitude, quoique sans titre, en acquiert le droit par une longue jouissance. Voyez sur toute cette matière Domat, Lois civiles dans leur ordre naturel ; I. part. l. III. tit. VIIe sect. 4. et M. Titius, observ. in Lauterbach. obs. MXXXIII. et seq. comme aussi dans son jus privatum romano-german. lib. II. cap. ix. Voilà pour ce qui regarde le droit romain, consultons à présent le droit naturel.
Par le droit naturel, la prescription n'abolit point les dettes, en sorte que par cela seul que le créancier ou ses héritiers ont été un longtemps sans rien demander, leur droit s'éteigne, et le débiteur soit pleinement déchargé. C'est ce que M. Thomasius a fait voir dans sa dissertation : De perpetuitate debitorum pecuniariorum, imprimée à Hall, en 1706.
Le temps, dit-il, par lui-même n'a aucune force, ni pour faire acquérir, ni pour faire perdre un droit : il faut qu'il soit accompagné de quelque autre chose qui lui communique cette puissance. De plus personne ne peut être dépouillé malgré lui du droit qu'il avait acquis en vertu du consentement d'un autre, par celui-là même qui le lui a donné sur lui. On ne se dégage pas en agissant contre ses engagements : et en tardant à les exécuter, on ne fait que se mettre dans un nouvel engagement, qui impose la nécessité de dédommager les intéressés. Ainsi l'obligation d'un mauvais payeur devenant par cela même plus grande et plus forte de jour en jour, elle ne peut pas, à en juger par le droit naturel tout seul, changer de nature, et s'évanouir tout d'un coup au bout d'un temps. En vain alléguerait-on ici l'intérêt du genre humain, qui demande que les procès ne soient pas éternels : car il n'est pas moins de l'intérêt commun des hommes que chacun garde la foi donnée ; que l'on ne fournisse pas aux mauvais payeurs l'occasion de s'enrichir impunément aux dépens de ceux qui leur ont prêté, que l'on exerce la justice, et que chacun puisse poursuivre son droit. D'ailleurs ce n'est pas le créancier qui trouble la paix du genre humain, en redemandant ce qui lui est dû ; c'est au-contraire celui qui ne paye pas ce qu'il doit, puisque s'il eut payé, il n'y aurait plus de matière à procès. En usant de son droit on ne fait tort à personne, et il s'en faut bien qu'on mérite le titre odieux de plaideur, ou de perturbateur du repos public.
On ne serait pas mieux fondé à prétendre que la négligence du créancier à redemander sa dette, lui fait perdre son droit, et autorise la prescription. Cela ne peut avoir lieu entre ceux qui vivent l'un par rapport à l'autre dans l'indépendance de l'état de nature. Je veux que le créancier ait été fort négligent : cette innocente négligence mérite-t-elle d'être plus punie que la malice nuisible du débiteur ? ou plutôt celui-ci doit-il être récompensé de son injustice ? quand même ce serait sans mauvais dessein qu'il a si longtemps différé de satisfaire son créancier, n'est-il pas du moins coupable lui-même de négligence ? l'obligation de tenir sa parole, ne demande-t-elle pas que le débiteur cherche le créancier, plutôt que le créancier le débiteur ? ou plutôt la négligence du dernier seul, ne devrait-elle pas être punie ? d'autant plus qu'il y aurait à gagner pour lui dans la prescription ; au-lieu que l'autre y perdrait.
Mais en faisant abstraction des lois civiles, qui veulent que l'on redemande la dette dans un certain espace de temps, on ne peut pas bien traiter de négligent le créancier qui a laissé en repos son débiteur, quand même en prêtant il aurait fixé un terme au bout duquel son argent devait lui être rendu ; car il est libre à chacun de laisser plus de temps qu'il n'en a promis, et il suffit que l'arrivée du terme avertisse le débiteur de payer. Le créancier peut avoir eu aussi plusieurs raisons de prudence, de nécessité, et de charité même, qui le rendent digne de louange, plutôt que coupable de négligence.
Enfin il n'y a pas lieu de présumer que le créancier ait abandonné la dette, comme en matière de choses sujettes à prescription, puisque le débiteur étant obligé de rendre non une chose en espèce, mais la valeur de ce qu'on lui a prêté, il ne possède pas, à proprement parler, le bien d'autrui, et il n'est pas censé non plus le tenir pour sien. Le créancier, au-contraire, est regardé comme étant toujours en possession de son droit, tant qu'il n'y a pas renoncé expressément, et qu'il a en main de quoi le justifier. M. Thomasius explique ensuite comment la dette peut s'abolir avec le temps, par le défaut de preuves, et il montre que, hors de-là, la prescription n'avait pas lieu par les lois des peuples qui nous sont connus, ni même par celles des Romains, jusqu'au règne de l'empereur Constance.
Il soutient aussi que par le droit naturel, la bonne foi n'est nullement nécessaire pour prescrire, pas même dans le commencement de la possession, pourvu qu'il se soit écoulé un assez long espace de temps, pour avoir lieu de présumer que le véritable propriétaire a abandonné son bien. De quelque manière qu'on se soit mis en possession d'une chose appartenante à autrui, du moment que celui à qui elle appartient, sachant qu'elle est entre nos mains, et pouvant commodément la revendiquer, témoigne ou expressément ou tacitement, qu'il veut bien nous la laisser, on en devient légitime maître, tout de même que si on se l'était d'abord appropriée à juste titre.
Théodose le jeune, en établissant la prescription de trente ans, ne demandait point de bonne foi dans le possesseur : ce fut Justinien, qui à la persuasion de ses conseillers, ajouta cette condition en un certain cas ; et le droit canonique enchérit depuis sur le droit civil, en exigeant une bonne foi perpétuelle pour toute sorte de prescription. Le clergé romain trouva moyen par-là de recouvrer tôt ou tard tous les biens ecclésiastiques, de quelque manière qu'ils eussent été aliénés, et quoique ceux entre les mains de qui ils étaient tombés les possédassent paisiblement de temps immémorial. Des princes ambitieux se sont aussi prévalus de cette hypothèse, pour colorer l'usurpation des terres qu'ils prétendaient réunir à leurs états, sous prétexte que le domaine de la couronne est inaliénable, et qu'ainsi ceux qui jouissaient des biens qui en avaient été détachés, étaient de mauvaise foi en possession, puisqu'ils savaient qu'on ne peut acquérir validement de pareilles choses.
De tout cela il parait que la maxime du droit canon, quelque air de piété qu'on y trouve d'abord, est au fond contraire au droit naturel, puisqu'elle trouble le repos du genre humain, qui demande qu'il y ait une fin à toutes sortes de procès et de différents, et qu'au bout d'un certain temps les possesseurs de bonne foi soient à l'abri de la revendication.
Voilà l'opinion de Thomasius, mais M. Barbeyrac qui parait être du même avis en général, pense en particulier que si le véritable maître d'une chose prise ou usurpée, acquise en un mot de mauvaise foi, ne la réclame point, et ne témoigne aucune envie de la recouvrer pendant un long espace de temps, quoiqu'il sache fort bien entre les mains de qui elle est, et que rien ne l'empêche de faire valoir son droit ; en ce cas là, le possesseur injuste devient à la fin légitime propriétaire, pourvu qu'il ait déclaré d'une manière ou d'autre, qu'il était tout prêt à restituer, supposé qu'il en fût requis : car alors l'ancien maître le tient quitte, et renonce manifestement, quoique tacitement, à toutes ses prétentions. Que si celui qui est entré de bonne foi en possession du bien d'autrui, vient à découvrir son erreur avant le terme de la prescription expiré, il est tenu à ce qui est du devoir d'un possesseur de bonne foi ; mais si en demeurant toujours dans la bonne foi, il gagne le terme de la prescription, soit que ce terme s'accorde exactement avec les maximes du droit naturel tout seul, ou que les lois civiles le réduisent à quelque chose de moins ; le droit de l'ancien maître est entièrement détruit ; tout ce qu'il y a, c'est que comme le possesseur de bonne foi qui a prescrit, est l'occasion, quoique innocente, de ce que l'autre se voit désormais débouté de toutes ses prétentions, il doit, s'il peut, lui aider à tirer raison de l'injustice du tiers qui a transféré un bien qu'il savait n'être pas à lui, et donné lieu ainsi à la prescription.
Du reste, quoiqu'ici la bonne foi soit toujours nécessaire pour mettre la conscience en repos, cela n'empêche pas que les lois humaines ne puissent négliger cette condition, ou en tout ou en partie, pour éviter un grand nombre de procès. Il semble même que pour parvenir à leur but, il soit plus à propos de ne point exiger de bonne foi dans les prescriptions auxquelles elles fixent un fort long terme, ou de ne la demander du moins qu'au commencement de la possession ; et ainsi la maxime du droit civil est mieux fondée que celle du droit canon.
L'artifice du clergé ne consiste pas tant en ce que les décisions des papes exigent une bonne foi perpétuelle dans celui qui doit prescrire, qu'en ce qu'elles font regarder les biens d'église comme inaliénables, ou absolument, ou sous certaines conditions qui donnent lieu d'éluder à l'infini la prescription.
Pour ce qui est des principes dont parle M. Thomasius, ils prétendent que le domaine de la couronne ne peut jamais être aliéné validement, et que la prescription n'a point de lieu entre ceux qui vivent les uns par rapport aux autres dans l'indépendance de l'état de nature. Voyez Puffendorf, liv. IV. ch. XIIIe et liv. VIII. ch. Ve si l'aliénation du royaume, ou de quelqu'une de ses parties, est au pouvoir du prince. (D.J.)