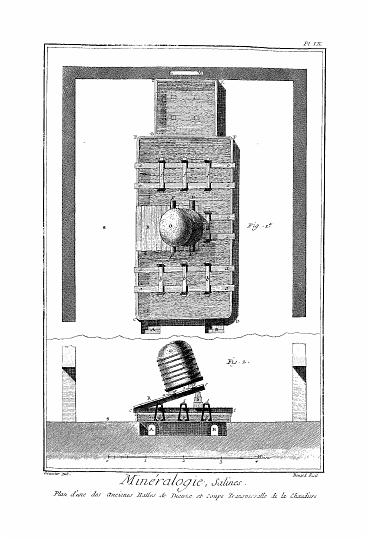S. m. (Histoire naturelle, Chimie et Minéralogie) selenites, sal seleniticum. Par sélénite ou sel séléniteux l'on désigne des substances fort différentes. Les minéralogistes allemands appliquent ce nom à une espèce de gypse ou de pierre à plâtre, composée de lames ou de feuillets transparents, telle que celle qui est connue sous le nom de pierre spéculaire ou de miroir des ânes, dont il se trouve une grande quantité à Montmartre. Quelques auteurs donnent le nom de sélénite au spath rhomboïdal, et composé de lames. D'autres ont donné ce même nom au crystal d'Islande, qui est rhomboïdal. Enfin, il y a des naturalistes qui se sont servis du mot sélénite pour désigner le talc.
Les chymistes et les naturalistes français par selenite entendent communément un sel neutre formé par la combinaison de l'acide vitriolique et d'une terre calcaire, telle que la craie, la marne, etc. En effet, si l'on verse de l'huîle de vitriol sur de la craie en poudre, il se fait une effervescence considérable, la dissolution devient trouble, et il se précipite une poudre blanche ; cette poudre examinée avec attention, ne montre qu'un amas de petits crystaux, qui ont la forme de petits feuillets ou d'écailles de poisson. Suivant M. Rouelle, la raison pourquoi ce sel se précipite aussi-tôt qu'il est formé, c'est qu'il est presque insoluble dans l'eau ; en effet, le savant chymiste a trouvé qu'il exigeait 360 parties d'eau pour le mettre en dissolution. La meilleure manière d'obtenir ce sel seleniteux, c'est de verser de l'acide vitriolique dans de l'eau de chaux ; mais il faut pour cela attraper le point de la saturation, ce que l'on reconnaitra en trempant un papier bleu dans la dissolution ; quand ce papier ne rougira plus, ce sera une preuve que l'on aura réussi.
La nature en se servant des mêmes matières produit un séleniteux ou une selenite tout à fait semblable ; on la trouve dans la terre qui tombe au fond de certaines eaux. Beaucoup de pierres et sur tout celles qui sont brillantes en sont chargées. Cela n'est point surprenant, puisque l'acide vitriolique est répandu dans notre athmosphère et dans le sein de la terre, qui contient d'ailleurs un grand nombre de substances calcaires auxquelles cet acide peut s'unir. On pourrait conjecturer que c'est à une combinaison semblable, aidée de quelques circonstances qui nous sont encore inconnues, que le gypse ou la pierre à plâtre doit son origine.