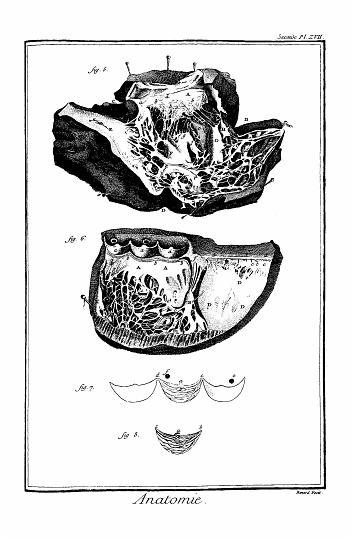SPAAT, ou SPAR, s. m. (Histoire naturelle, Minéralogie) spatum, marmor metallicum ; le mot spath a été introduit par les minéralogistes allemands et a été adopté par les Français. Les Anglais disent sparr. On désigne sous ce nom une pierre calcaire assez pesante, composée de lames ou de feuillets qui ne peuvent se plier, et qui sont tantôt plus tantôt moins sensibles à l'oeil ; elle se dissout avec effervescence dans les acides ; elle se brise et pétille dans le feu, ses lames y perdent leur liaison, et enfin elle s'y change en une vraie chaux ; en un mot, le spath a toutes les propriétés des pierres calcaires. Voyez l'article CALCAIRES.
Wallerius compte neuf espèces de spaths ; savoir, 1°. le spath opaque et romboïdal, c'est-à-dire qui se casse toujours en rhomboïdes ; il est pesant, compacte et de différentes couleurs.
2°. Le spath feuilleté ou en lames, spatum lamellosum ; il est très-tendre, il pétille et se brise dans le feu, cependant il finit par entrer en fusion. L'arrangement des lames dont ce spath est composé lui fait prendre souvent des figures très-singulières, et qui varient à l'infini.
3°. Le spath en particules fixes et placées sans ordre ni régularité, de façon qu'il n'est point aisé de distinguer la figure des lames ou des cubes dont il est composé ; il y en a de différentes couleurs.
4°. Le spath tendre et transparent, il est en rhomboïdes, ses couleurs sont variées, il y en a quelquefois qui est veiné.
5°. Le spath en rhomboïdes, clairs et transparents qui doublent les objets que l'on regarde au-travers ; ce spath est blanc et transparent comme du crystal de roche, c'est ce qu'on appelle crystal d'Islande.
6°. Le spath en crystaux ; ils différent du crystal de roche en ce que leurs colonnes sont ordinairement tronquées ou tranchées par le sommet. Ces crystaux de spath varient considérablement pour le nombre de leurs côtés ; il y en a de cubiques, d'exagones, d'octogones, de neuf côtés, de quatorze côtés ; les uns sont prismatiques ou à colonnes, d'autres sont par masses cristallisées qui présentent toutes sortes de figures singulières. Ils varient aussi pour les couleurs ; il y en a de blancs, de jaunes, de rouges, de violets, de verdâtres, etc. c'est proprement à ces crystaux spathiques que l'on doit donner le nom de fluors. Ils ont tous la propriété de devenir phosphoriques lorsqu'on les frotte les uns contre les autres, ou lorsqu'on les échauffe légérement sans les faire rougir.
7°. Le spath, fétide, appelé lapis suillus, qui est ou sphérique, ou rayonné, ou prismatique. Cette pierre répand une odeur désagréable lorsqu'on la frotte ; mais son odeur étant une chose purement accidentelle, ne mérite pas qu'on en fasse une espèce particulière.
8°. Le spath compacte et solide, que l'on nomme spath vitreux parce qu'il ressemble assez à une masse du verre. Il est plus ou moins transparent, sa couleur est ou blanche, ou grise, ou verdâtre, ou violette. Il n'affecte point de figure déterminée, mais il se brise en morceaux irréguliers, comme le quartz avec qui il a beaucoup de ressemblance au premier coup d'oeil ; il ne fait point effervescence avec les acides non plus que lui ; mais ce qui le distingue du quartz, c'est qu'il ne fait point feu lorsqu'on le frappe avec de l'acier ; échauffé il devient phosphorique ou lumineux lorsqu'on le frotte dans un endroit obscur. D'ailleurs il est rare qu'il soit d'un tissu assez compacte pour qu'un oeil exercé n'y aperçoive en quelque endroit une disposition à se mettre en lames, ou quelques surfaces unies. C'est ce spath que l'on nomme spath fusible ; nous parlerons de ses propriétés dans la suite de cet article, et des expériences qui ont été faites avec lui.
9°. Wallerius enfin ajoute à ces différentes espèces de spaths celui qu'il nomme spath dur ou spathum pyrimachum, parce qu'il donne des étincelles lorsqu'on le frappe avec de l'acier. M. Pott soupçonne que cela vient de ce que ce spath est intimement combiné avec des parties de quartz ; en effet, il est constant que de faire feu est une propriété étrangère au spath. Quoi qu'il en sait, M. Wallerius dit que ce spath se partage en morceaux cubiques rectangulaires, dont les surfaces sont très-unies. Voyez la minéralogie de Wallerius.
On voit par ce qui précède que le spath est un vrai protée ; il se montre sous une infinité de formes différentes, par les arrangements divers que prennent les lames ou feuillets dont cette pierre est toujours composée, et qui ordinairement caractérisent le spath. C'est de l'arrangement et de la liaison plus ou moins forte de ces lames que dépend le plus ou le moins de dureté et de solidité de cette pierre. Le spath accompagne un très-grand nombre de mines ; plus il est tendres, plus il donne d'espérance que l'on trouvera des métaux précieux, parce qu'alors il est plus propre à donner entrée aux exhalaisons minérales qui forment les mines. Voyez l'article MINE et MATRICE.
Les propriétés que nous avons assignées aux différentes espèces de spath, suffisent pour le mettre en état de le distinguer du quartz. En effet, cette dernière pierre ne se change point en chaux par la calcination ; elle ne fait point d'effervescence avec les acides ; elle ne devient point phosphorique après avoir été chauffée ; elle ne montre point de feuillets ni de disposition à se partager suivant des plans ou surfaces unies, tandis que ces signes conviennent en tout ou en partie aux spaths. Joignez à cela que le quartz est beaucoup plus dur ; il est d'un tissu compacte comme celui du verre ; il donne toujours des étincelles lorsqu'on le frappe avec de l'acier. Voyez QUARTZ.
On a déjà fait remarquer qu'il y avait une espèce de spath que les Allemands ont nommé fluss-spath ou spath fusible. Ce nom lui a été donné, soit parce qu'on s'en sert comme d'un fondant dans les fonderies, soit parce qu'il entre en fusion avec une facilité singulière pour peu qu'on y joigne de sel alkali.
M. Pott croit que ce spath fusible est redevable de sa fusibilité et de sa dureté, à une portion de terre de caillou (terra silicea) qui s'y trouve combinée avec la terre spathique ou calcaire. On a lieu de soupçonner outre cela quelqu'autre substance dans le spath fusible. En effet, la pesanteur extraordinaire de cette pierre donne lieu de croire qu'elle contient quelque substance métallique. Quelques auteurs ont cru que c'était de l'arsénic ; mais M. Pott assure qu'ayant fondu quelquefois du spath fusible avec du marbre blanc, il a obtenu quelques grains de plomb ; mais il convient que cette expérience ne lui a point toujours réussi ; ce qui vient, selon lui, de ce que l'action trop violente du feu a pu dissiper la partie métallique durant la fusion.
M. de Justi, très-habîle chimiste allemand, conteste la vérité de cette expérience de M. Pott ; il parait que ce n'est point sans raison, Ve que le marbre blanc ne contient point de matière propre à produire la réduction d'un métal. D'un autre côté, M. de Justi assure n'avoir jamais pu tirer le moindre atôme d'une substance métallique du spath, quelque fondant ou quelque matière qu'il ait employé pour en faire la réduction. De plus, il dit n'avoir jamais pu parvenir à faire entrer en fusion un mélange de spath et de marbre, quelque degré de feu qu'il ait donné, et quelque variété qu'il ait mise dans les proportions. M. Pott n'a pas manqué de répliquer à M. de Justi, et dans ses réponses il persiste toujours à maintenir la vérité de ses expériences, et il en rapporte encore de nouvelles, par lesquelles il persiste à maintenir la fusibilité du spath avec le marbre ; expérience que M. de Justi n'a jamais pu effectuer : sur quoi ce dernier soupçonne son adversaire de s'être trompé sur la qualité de la pierre qu'il travaillait, et l'accuse de ne pas connaître le spath pesant. En effet, à la vue de résultats si différents, on a lieu de croire que ces deux chymistes ont opéré sur des matières tout à fait différentes. Selon M. de Justi, le spath qu'il appelle pesant, se distingue de toutes les espèces de spaths par son poids extraordinaire, qui surpasse non-seulement celui de toutes les autres pierres, mais encore qui est plus grand que celui de plusieurs mines métalliques, et qui égale presque celui de l'hématite, qui est une mine de fer très pesante. M. de Justi présume du poids de ce spath, qu'il doit nécessairement contenir une portion considérable de quelque substance métallique ; il se fonde encore sur les effets que ce spath pesant produit dans les dissolvants. Les dissolvants agissent très-promtement sur les différents spaths, surtout lorsqu'ils sont réduits en poudre, et les dissolvent entièrement ; au lieu que l'eau forte n'agit point, selon lui, sur le spath pesant, à-moins que d'être bouillante, et même alors il dit que l'on voit clairement que ce dissolvant n'attaque pas la totalité de cette pierre, mais seulement quelques-unes de ses parties. L'eau régale ne parait point non plus avoir d'abord aucune action sur ce spath ; mais lorsqu'elle commence à bouillir, elle attaque vivement la totalité de la pierre ; mais elle lâche bientôt les parties qu'elle avait dissoutes, ce qui, selon lui, annonce la présence d'une substance métallique sur laquelle l'eau-forte a de la prise, tandis que l'eau régale ne peut la dissoudre.
M. de Justi a poussé plus loin ses expériences sur le spath qu'il nomme pesant. Il en prit un quintal poids d'essai, qu'il mêla avec trois quintaux de sable blanc parfaitement pur, et dans lequel la calcination n'avait développé aucune couleur ; il y joignit un quintal et demi de potasse bien purifiée, et un quintal de borax calciné. Il fit fondre ce mélange pendant deux heures au feu le plus violent : par-là il obtint un verre d'un beau jaune d'or foncé tirant sur le rouge. Il devient plus foncé encore quand on ne fait entrer dans le mélange que deux quintaux de sable contre un quintal de spath pesant. Voulant rendre la couleur de ce verre plus claire, M. de Justi fit le mélange d'une autre manière ; il prit un quintal poids d'essai de spath pesant, qu'il joignit avec six quintaux de sable, trois quintaux de potasse, et un quintal et demi de borax. Il fit fondre ce nouveau mélange pendant deux heures, et obtint un verre de très-beau jaune d'or tirant toujours sur le rouge. Il assure avoir fait ces expériences avec le même succès sur des spaths pesans venus de différents endroits.
D'un autre côté, M. Pott, par ses expériences, a eu des produits très-différents. Il prit deux onces de son spath, six gros de nitre et autant de borax, ce qui lui donna un verre verdâtre ; pareillement trois parties de spath avec une partie de sel alkali fixe bien pur, lui ont donné une espèce de scorie qui ressemblait à une agate d'un gris noirâtre. Enfin une partie de spath avec trois parties d'alkali fixe pur ont produit une masse noire.
Des produits si différents doivent faire conjecturer qu'il n'est guère possible que ces deux auteurs habiles aient travaillé sur la même substance. Pour convenir de leurs faits, il faudrait que ces deux chimistes se fussent communiqué une portion de la pierre que chacun d'eux appelait l'un spath fusible, et l'autre spath pesant, et que séparément ils eussent traité la même substance de la même manière. Il peut se faire que leurs spaths, quoique très-conformes les uns aux autres à l'extérieur, renfermassent des mélanges, des combinaisons et même des métaux très-différents.
Le spath qu'on nomme fusible n'entre point en fusion tout seul et sans addition ; il ne fait alors que se pelotonner, sans entrer en fusion dans les vaisseaux fermés. Quand aux spaths crystallisés et colorés, que l'on nomme fluors, ils perdent leurs couleurs, et deviennent tendres et friables. Mais le spath fusible a la propriété de communiquer une fusibilité étonnante aux pierres et aux terres les moins fusibles par elles-mêmes ; c'est, selon M. Pott, cette propriété qui fait que l'on a trouvé très-avantageux de traiter les mines qui ont le spath fusible pour matrice, Ve que ces mines portent leur fondant avec elles. Voyez la continuation de la lithogéognosie de M. Pott, pages 126137. Cependant M. de Justi croit que le spath n'agit point comme fondant dans le traitement des mines, mais comme précipitant, en se chargeant de la portion de soufre que ces mines contiennent.
La différence que l'on remarque entre le spath calcaire et le spath fusible dont on vient de parler, parait dû. à la partie métallique, c'est-à-dire, au plomb qui est, suivant les apparences, contenu dans ce dernier, d'autant plus que le plomb est toujours un très-puissant fondant, comme le prouvent tous les travaux de la métallurgie. Il y a une mine de plomb que l'on nomme spathique, qui ressemble parfaitement à du spath par son tissu feuilleté, et qui est une vraie mine de plomb. Voyez l'article PLOMB. Il y a aussi une mine de fer spathique, qui contient une très-grande quantité de métal, ce qui n'empêche point qu'elle ne ressemble parfaitement à du spath. Telle est la mine de fer blanche d'Alvare en Dauphiné. Voyez l'article FER. Tout cela prouve que le coup-d'oeil extérieur ne peut suffire pour nous faire connaître la nature des pierres, qui ne sont presque jamais homogènes et pures, lors même qu'elles le paraissent.
On peut donner le nom de spath calcaire à toute pierre calcaire qui parait composée d'un assemblage de lames ou de feuillets luisans ; ainsi les stalactites, les congélations, etc. sont du spath. Les particules luisantes que l'on remarque dans le marbre de Paros sont aussi spathiques ; mais elles sont enveloppées d'un gluten qui leur donne la dureté du marbre Voyez PAROS, marbre de. En général il parait que le spath est la pierre calcaire la plus pure, et que les feuillets ou lames dont il est composé sont la figure propre à cette pierre, lorsqu'elle est dans sa plus grande pureté.
On a cru devoir s'étendre sur cet article, Ve que le spath, par la variété de ses figures, de ses couleurs et de ses propriétés, est une pierre d'achoppement pour tous ceux qui commencent à s'appliquer à l'étude de la minéralogie. On se flatte qu'au moyen de ce qui a été dit ici, on pourra se faire une juste idée du spath ; qu'on le distinguera des pierres gypseuses et des pierres talqueuses qui sont feuilletées comme il l'est ordinairement, et surtout qu'on ne le confondra point avec le quartz ; inconvénient dans lequel sont tombés presque par-tout les auteurs anglais, qui donnent indistinctement le nom de spath à toutes les crystallisations qui accompagnent les mines. D'un autre côté, l'on ne sera point surpris des grandes variétés de cette pierre, quand on considérera que dans sa formation elle a pu se combiner avec des sucs lapidifiques d'une nature différente de la sienne, ce qui en a pu faire un corps dont les propriétés ont été altérées. Tout spath pur est une pierre calcaire et en a les propriétés. Voyez PIERRE. (-)
SPATH
- Détails
- Écrit par : Paul-Henri-Thiry, baron de Holbach (—)
- Catégorie : Minéralogie
- Clics : 1675