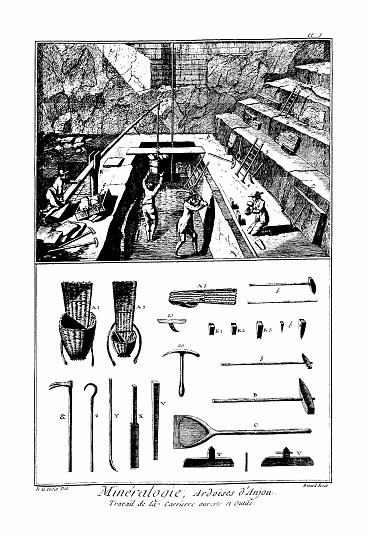- Détails
- Écrit par : Antoine Louis (Y)
- Catégorie : Chirurgie
Ce mot est formé du grec , air ou vent, et , tumeur.
Il y a deux sortes de pneumatocele ; dans l'une l'air est répandue entre le dartos et la peau : elle se connait par un boursoufflement semblable à celui qu'on voit aux chairs des animaux que les bouchers ont soufflés immédiatement après les avoir tués ; voyez EMPHYSEME, et dans l'autre les vents sont contenus dans la cavité du dartos ; alors la tumeur résiste, et le scrotum est tendu comme un ballon.
- Clics : 1753
- Détails
- Écrit par : Antoine Louis (Y)
- Catégorie : Chirurgie
Ces remèdes sont en très-grand nombre, et il n'y a presque personne qui n'en vante un dont il assure l'efficacité.
On applique avec succès un emplâtre de mastic ou de gomme élemi à la région des tempes. L'emplâtre d'opium a souvent produit un très-bon effet, de même que le cataplasme de racine de grande consoude pour réprimer la fluxion.
Quelques-uns appliquent des médicaments dans l'oreille du côté de la douleur. L'huîle d'amandes amères, ou la vapeur du vinaigre dans lequel on a fait bouillir du pouillot ou de l'origan. Le vinaigre est recommandé contre les fluxions chaudes ou inflammatoires : et quand l'engorgement vient d'une cause froide ou humorale, on coule dans l'oreille du jus d'ail cuit avec de la thériaque, et employé chaudement, ou bien un petit morceau de gousse d'ail cuit sous la cendre, et introduit dans l'oreille en forme de tente.
- Clics : 1534
- Détails
- Écrit par : Antoine Louis (Y)
- Catégorie : Chirurgie
- Clics : 1218
- Détails
- Écrit par : Antoine Louis (Y)
- Catégorie : Chirurgie
- Clics : 1191