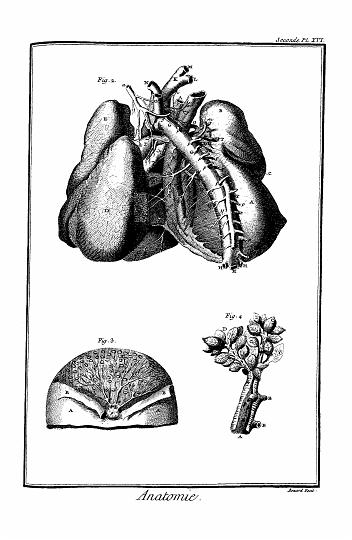- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Chimie
- Clics : 1843
- Détails
- Écrit par : Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie : Chimie
- Clics : 1353
- Détails
- Écrit par : Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie : Chimie
- Clics : 2519
- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Chimie
- Clics : 1528
- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Chimie
On a coutume de spécifier les différentes lessives par les noms des matières qui ont été lessivées : c'est ainsi qu'on dit lessive de soude, lessive de potasse, pour désigner une eau qui a été appliquée à la soude ou à la potasse pour en retirer le sel. (b)
* LESSIVE du linge, (Art mécanique) c'est la manière de le décrasser quand il est sale. Pour cet effet on a un grand cuvier percé au bas latéralement d'un trou qu'on bouche d'un bouchon de paille. On met le linge sale dans ce cuvier ; on le couvre d'un gros drap qui déborde par-dessus le cuvier. On charge ce linge ou drap d'une grande quantité de cendres de bois neuf et non flotté. Cependant on a fait chauffer de l'eau dont on arrose les cendres, sur lesquelles on rejette les bords du drap, et l'on couvre le cuvier d'un couvercle de natte ; cette eau chaude met en dissolution le sel du bois contenu dans les cendres : ce sel dissout, se sépare des cendres, passe à-travers le drap avec l'eau, Ve impregner le linge sale qui est dessous : la dissolution ou l'eau de lessive tombe au fond du cuvier, et sort par le bouchon de paille qu'on a mis au trou latéral du cuvier, d'où elle est reçue dans un autre cuvier plus petit placé au-dessous du premier. On reverse cette dissolution sur les cendres, on les arrose de nouvelle eau chaude, et l'on fait en sorte que tout le sel contenu dans les cendres soit dissous et déposé sur le linge. Quand on a épuisé les cendres de sel par l'eau chaude, quand on a fait repasser la lessive ou sa dissolution sur le linge sale, on enlève le drap avec les cendres, on tire le linge du cuvier, on le lave et on le bat dans l'eau claire, en le frottant de savon. Quand il est blanc et bien décrassé, on le lave et relave dans de l'eau claire seulement, jusqu'à ce qu'il n'y reste plus aucun vestige ni d'eau de lessive, ni d'eau de savon, ni de crasse. On l'étend sur des cordes pour le faire sécher : sec, on le détire et on le plie, puis on le serre dans des armoires à linge. La raison de cette opération est assez simple ; la saleté du linge est une graisse ; le sel des cendres s'y unit un peu, et forme avec elle une espèce de savon. Ce premier savon, formé dans le cuvier, s'unit facilement avec celui dont on frotte le linge au sortir du cuvier : ils se dissolvent ensemble ; en se dissolvant l'eau les emporte avec la crasse. D'ailleurs toute cendre n'est pas bonne pour la lessive : celles du bois flotté ne contiennent presque point de sel ; il a été dissous dans le flottage, et toute eau n'est pas également bonne pour la lessive ; les eaux séléniteuses, par exemple, sont mauvaises ; la sélénite venant à se dissoudre, son acide s'unit au sel du savon, et l'huîle du savon reste seule et surnage à l'eau en petits flocons.
- Clics : 2211